UNIVERSITE MICHEL
DE MONTAIGNE-BORDEAUX III
U.F.R. DES LETTRES
LE ROMAN POLICIER
A L’EPREUVE DES LITTERATURES
FRANCOPHONES
DES ANTILLES ET DU
MAGHREB :
ENJEUX CRITIQUES ET ESTHETIQUES
THESE
Pour l’obtention du Doctorat
ès Lettres
Discipline : Littératures
française, francophones et comparée
Présentée et soutenue
publiquement
par
Estelle MALESKI
Sous la direction de Madame
Martine JOB
Professeur des Littératures
francophones
Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III
JURY
Madame
Christiane Chaulet-Achour
Monsieur Jack Corzani
Madame Martine Job
Décembre 2003
- TOME I -
A mes
parents.
REMERCIEMENTS
Nous remercions le Professeur
Cette étude n’aurait pu aboutir sans le soutien de nos parents, de Boris et de nos proches qui par leurs encouragements, leur patience et leur disponibilité nous ont donné la volonté d’aller au bout de notre démarche.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide tout au long de ce travail :
Alain Breuille, Dominique Deblaine et Rafaël Lucas qui nous ont accompagnée attentivement dans la relecture de ce travail ;
Beate Bechter-Burtscher qui nous a permis d’accéder à la thèse de Rhéda Belhadjoudja ainsi qu’au roman de Yasmina Khadra publié en Algérie, La Foire des enfoirés ;
le Professeur Jack Corzani qui a fait naître notre intérêt pour la littérature antillaise, point de départ de nos recherches, et qui, dans le cadre de cette étude, nous a guidée dans le choix du corpus antillais, en nous communiquant par ailleurs certains textes difficilement accessibles ;
Tony Delsham, Fortuné Chalumeau, Jacob Cohen, Nicole Ben Youssef et Jean-Pierre Koffel qui ont consciencieusement et amicalement accepté de répondre à nos questions.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance et de nos sincères remerciements.
SOMMAIRE
|
INTRODUCTION PREMIERE
PARTIE : Approche du genre policier I- Structure et atouts du genre policier1- Un genre enraciné dans la modernité
1.1-
Naissance
et évolution 1.1.1- Des débuts jusqu’aux années 1920 1.1.2- Le tournant des années 1930 1.1.3-
La « Série noire » en France 1.2-
Le roman
policier à l’écoute de la modernité 1.2.1- Un genre témoin de
l’évolution sociale 1.2.2- Un genre urbain 1.2.3- Un genre réactif à l’effet de mode 2- Dualité de la fiction policière 2.1-
Jeux et
enjeux d’une « fiction vraie » 2.1.1- Effets de
réel et fiction 2.1.2- Double
enjeu de l’enquête : entre raison et morale 2.2-
De
l’enquête de fiction à la quête littéraire 2.2.1- Aspect ludique / Quête herméneutique2.2.2- Les « écarts » du récit policier II-
Panorama de l’implantation du genre policier dans les littératures
francophones des Antilles et du Maghreb
1- Prémices du genre 1.1-
Implantation
par touches dans la sphère littéraire antillaise 1.1.1- Occurrences du genre policier entre la fin du XIXème siècle et 1950 1.1.2- Daniel de Grandmaison 1.1.3- Michèle Lacrosil 1.1.4-
Un exemple guyanais de reprise du genre
policier : Bertène Juminer 1.2-
Implantation
tardive dans la sphère littéraire maghrébine 1.2.1- Romans d’espionnage des années 1970 1.2.2- Premiers
romans policiers des années 1980 2- Délimitation du corpus 2.1- Approche paratextuelle 2.1.1- Les romans policiers revendiqués 2.1.2- Les
polars « frileux » 2.1.3- Le cas Yasmina Khadra/Driss Chraïbi 2.1.4- L’enquête policière en filigrane 2.2-
Différents
types d’enquêtes 2.2.1- Enquêtes
au service de la fiction 2.2.2- L’enquête
de fiction aux prises avec le contexte référentiel 2.2.3- Vers une
« fiction documentaire » 2.3-
Différents
profils d’enquêteurs 2.3.1- Les
enquêteurs à succès 2.3.2- Les
limiers muselés 2.3.3- Les
enquêteurs névrosés DEUXIEME
PARTIE : Formes et enjeux de la transposition du genre policier aux
littératures francophones des Antilles
et du Maghreb
I- Acclimatation du cadre générique 1- Installation du décor :
intertexte, contexte 1.1-
Le rapport
aux pères 1.1.1- Interférences avec les modèles traditionnels1.1.2-
Ancrage dans un intertexte local 1.1.3-
Quête d’un « intertexte noir » 1.2-
Transposition
du cadre à la géographie locale 1.2.1- Cadre
insulaire 1.2.2- Cadre urbain 2- Ancrage dans la spécificité culturelle
locale 2.1- Orientations du discours social 2.1.1- Assombrissement
du tableau : perspective réaliste 2.1.2- Mise en valeur d’une contre-culture : perspective
fantasmée 2.1.3-
Désenclavement, par dérision (D. Chraïbi), par
affirmation (M. Condé) : quête de neutralité 2.2-
Influence
de la spécificité du cadre post-colonial 2.2.1- L’héritage de la violence2.2.2- Les représentants de l’ordre post-colonial : entre désillusion et aliénationII-
Tenants et aboutissants par-delà
l’enquête de fiction
1- Etat des lieux 1.1-
Le chaos
algérien 1.1.1- Rappel de quelques évènements clés 1.1.2- Le « noir » pour dire la guerre1.1.3- Du sang à la putréfaction1.2-
Le système
marocain sous la critique 1.2.1- Les milieux affairistes passés au crible1.2.2- Le système
tourné en dérision 1.3-
La
mangrove antillaise 1.3.1- Vie
communautaire grouillante : entre théâtralisation et introspection 1.3.2- Perceptions du réel antillais2- Enquête en amont 2.1-
L’Histoire
en creux 2.1.1- Invocation factuelle du passé 2.1.2- Prise en charge romanesque de l’Histoire 2.2-
Perspectives
critiques 2.2.1- Dénonciation
argumentative : crédibilité et preuves à l’appui 2.2.2- Passivité
et syndrome de l’« an tan lontan » TROISIEME PARTIE :
Jusqu’au bout du roman policier
I-
Le genre policier poussé à son
comble
1- Des données paroxystiques 1.1-
Enlisement
dans la face « noire » du genre 1.1.1-
Victoire du cynisme et de l’amertume 1.1.2- Le « noir », entre logique et esthétique 1.2-
Mise en
défaut du rationalisme 1.2.1-
Intrusion d’éléments perturbateurs 1.2.2-
Tentation d’un abandon à l’inexplicable 1.2.3- De l’inexpliqué à l’« énigme des mots »
2- Contamination du système énonciatif 2.1- Mise en place d’un
récit polyphonique 2.1.1-
La parole en flots 2.1.2-
Orientation et parti pris de l’énonciation 2.2- Le récit mis en scène 2.2.1-
Contextualisation du récit : modalisation du
système énonciatif 2.2.2-
Dimension spectaculaire et
« visibilité » du récit II- « L’ère du soupçon » 1- Le texte suspect 1.1-
Confessions
paradoxales 1.1.1- Quand dire c’est taire
1.1.2- Quand taire c’est dire 1.2-
« La
vérité et rien que la vérité » 1.2.1-
Conditionnement du lectorat 1.2.2- Les
« possibles textuels » 2- Processus de démembrement du roman 2.1- Présence/absence du scripteur 2.1.1- L’écrivain en scène
2.1.2- Le motif indiciel 2.2- Vers le roman en-quête 2.2.1- Littérature policière et littérature de recherche 2.2.2- Réflexivité
et projection du récit policier CONCLUSION ANNEXES Annexe 1 : Entretiens et échanges avec quelques écrivains
du corpus
- Fortuné Chalumeau - Jacob Cohen -
Jean-Pierre
Koffel -
Nicole
Ben Youssef -
Tony
Delsham Annexe 2 : Extraits de la bande-dessinée Le
Retour de Monsieur
Coutcha -
extrait 1 -
extrait 2 -
extrait 3 Annexe 3 : Extrait des aventures illustrées des
Frères Déhohême
BIBLIOGRAPHIE |
p. 10 p. 28 p. 29 p. 29 p. 30 p. 30 p. 37 p. 42 p. 46 p. 46 p. 49 p. 51 p. 56 p. 56 p. 57 p. 63 p. 67 p. 67 p. 71 p. 74 p. 74 p. 75 p. 75 p. 78 p. 82 p. 86 p. 89 p. 89 p. 95 p. 105 p. 109 p. 109 p. 116 p. 118 p. 124 p. 127 p. 128 p. 132 p. 135 p. 139 p. 139 p. 146 p. 151 p. 156 p. 157 p. 157 p. 158 p. 158 p. 164 p. 170 p. 176 p. 176 p. 181 p. 191 p. 192 p. 193 p. 200 p. 209 p. 217 p. 218 p. 226 p. 234 p. 234 p. 235 p. 235 p. 240 p. 247 p. 256 p. 257 p. 265 p. 273 p. 273 p. 282 p. 288 p. 289 p. 289 p. 295 p. 300 p. 301 p. 307 p. 314 p. 316 p. 317 p. 317 p. 318 p. 325 p. 333 p. 334 p. 343 p. 353 p. 362 p. 363 p. 364 p. 372 p. 380 p. 381 p. 390 p. 399 p. 401 p. 402 p. 402 p. 410 p. 417 p. 418 p. 423 p. 430 p. 431 p. 432 p. 437 p. 444 p. 445 p. 451 p. 456 p. 469 p. 470 p. 471 p. 475 p. 478 p. 491 p. 494 p. 504 p. 505 p. 506 p. 507 p. 508 p. 510 |
INTRODUCTION
I- Cheminement vers le choix du sujet
C’est en lisant à quelques jours d’intervalle Une Enquête au pays, du Marocain Driss Chraïbi et Solibo Magnifique, du Martiniquais Patrick Chamoiseau, que notre intérêt s’est porté, dans un premier temps timidement, sur la reprise du genre policier au sein des littératures francophones des Antilles et du Maghreb ; timidement dans la mesure où nous percevions bien que, tout en empruntant différents éléments constitutifs de la forme policière traditionnelle, ces romans ne se prêtaient pas de manière tout à fait conventionnelle aux contraintes et ressorts propres au genre policier dans son ensemble.
Cette première approche nous a donc surtout conduite à des interrogations nous permettant de poser les premiers jalons d’un cheminement qui a dû prendre le temps d’une très progressive maturation. C’est que jusque là, nous n’avions pas éprouvé un intérêt profond pour le genre policier et il ne nous était pas encore apparu pertinent d’en faire un sujet de recherches approfondies ; il y avait à cela plusieurs raisons.
Remarquons tout d’abord que le cadre policier ne participe pas a priori d’une véritable tradition littéraire en ce qui concerne les aires littéraires antillaises et maghrébines et que, de fait, l’intérêt d’auteurs issus de ces espaces culturels pour le genre policier peut paraître inattendu. D’autre part, ni l’un ni l’autre des deux romans à l’origine de notre questionnement ne se revendique ou simplement ne se signale comme relevant explicitement de la forme policière. En outre, qu’il s’agisse de Solibo Magnifique ou d’Une Enquête au pays, le cadre policier, induit par la mise en scène de représentants de l’ordre menant une enquête, n’apparaît que de manière secondaire au sein de l’intrigue : le meurtre sur lequel enquêtent les policiers conçus par P. Chamoiseau est en fait une mort naturelle ; l’inspecteur Ali, personnage de D. Chraïbi, ignore quant à lui l’objet de l’enquête qu’il mène aux côtés de son chef dans un village des hauteurs de l’Atlas marocain. Dans ces deux romans, l’enquête policière semble donc faire figure de prétexte à l’illustration d’un discours dépassant le strict intérêt ludique dont semble se revendiquer la forme policière traditionnelle.
En nous intéressant par la suite aux autres romans mettant en scène l’inspecteur Ali, nous avons découvert que Driss Chraïbi avait, à trois reprises, sollicité le cadre policier, mais cette fois-ci apparemment dans la plus pure tradition du genre. L’intérêt de Driss Chraïbi pour le genre policier nous a alors interpellée, et ce, d’autant qu’il proposait deux types d’adaptation de cette forme littéraire a priori surtout vouée à la reproduction générique conformiste : l’une n’utilisant le cadre traditionnel qu’en filigrane ; l’autre l’affichant presque exagérément, ne renonçant à aucun stéréotype ni cliché familiers du genre. Autrement dit, si la première approche proposée avec Une Enquête au pays semblait n’attribuer à l’intertexte policier qu’un rôle secondaire, le caractère stéréotypé des enquêtes suivantes menées par Ali ne permettait pas non plus de prendre véritablement au sérieux l’intérêt de D. Chraïbi pour le genre policier. Toutefois, l’originalité de la démarche, la liberté de ton permise par le cadre générique, le caractère provocateur de certains propos, de certaines scènes, les portraits satiriques ou encore la réflexion menée précisément sur la question du stéréotype et des a priori culturels, émaillaient les textes relatant les enquêtes de l’inspecteur Ali, développant déjà de façon originale, nous en avions l’intuition, quelques-unes des potentialités du genre policier.
Mis en éveil par la démarche de Driss Chraïbi, notre intérêt pour le genre policier s’est fait grandissant, et nous avons puisé là plusieurs types d’observations qui devenaient autant de motivations.
Tout d’abord, le genre policier n’a cessé de se faire remarquer par un public grandissant au cours des années 1990 tant sur les étals des librairies que sur les écrans de cinéma et de télévision, jusqu’à devenir un produit de consommation à succès, véhiculant un véritable effet de mode.
Aujourd’hui, en France, le roman policier classique a pris l’appellation plus moderne de « polar », subissant idéologiquement et structurellement les effets de son ancrage au sein de la société contemporaine, assumant encore la popularité dont il jouit auprès d’un public nombreux et s’adaptant au mieux aux diverses contraintes de l’économie de marché. Il convient en effet de rappeler un fait déterminant en ce qui concerne la prégnance du genre policier au sein de la littérature française -mais le phénomène concerne également une grande partie de la littérature mondiale-, c’est que le polar fait vendre : il n’est pas rare de constater la présence d’un roman de Mary Higgins Clark, romancière américaine auteur d’un grand nombre de romans policiers, par exemple, parmi les meilleures ventes de livres ; de même, peu nombreux sont les films d’action récemment apparus sur les écrans et attirant un large public, qui ne se revendiquent pas du polar. Aussi, s’il n’est guère surprenant de constater que le succès du genre policier concerne également les Etats-Unis, l’Angleterre, de nombreux pays d’Europe ou encore le Japon ainsi que l’Australie, il est sans doute plus singulier de le voir gagner des espaces littéraires a priori peu enclins à offrir une place de choix à un genre dit « ludique » et de réputation mineure ; nous touchons-là à un point qui s’est avéré essentiel dans l’évolution de notre cheminement.
Il s’agissait en effet pour nous de prendre en compte et d’interroger le fait qu’en dépit, et peut-être en raison même de sa popularité, le genre policier relève d’une classification spécifique peu valorisante au sein de la littérature. Caractérisé comme « genre mineur », « littérature de gare », « de distraction », « vite lu, vite oublié » ou encore « lecture facile », le roman policier ne semble guère pouvoir se départir du caractère ludique déterminant son mode de lecture. C’est, en tous les cas, le préjugé que lui vaut en général sa réputation et dont semblent jouir ironiquement, par ailleurs, certains auteurs, tel Driss Chraïbi, contribuant dans le même temps, pour peu que l’on se limite à une lecture superficielle des enquêtes de l’inspecteur Ali, à perpétuer la « mauvaise » réputation du genre.
Ainsi, alors que la reprise du genre policier pratiquée par Driss Chraïbi, avec Une Place au soleil, L’Inspecteur Ali à Trinity College et L’Inspecteur Ali et la C.I.A., tendait à conforter la perception d’une stricte fonction ludique du genre policier, l’arrivée de Yasmina Khadra sur le devant de la scène de la littérature policière a véritablement fait l’effet d’une « bombe » -ainsi que l’a notamment titré une journaliste de Libération[1].
La découverte des romans de Yasmina Khadra a alors définitivement entériné notre intérêt pour le genre et plus précisément pour la manière dont il est parvenu à s’adapter au « paysage » social et littéraire maghrébin.
C’est en 1999, alors que nous achevions un T.E.R. de maîtrise sur le roman de Patrick Chamoiseau, Solibo Magnifique, où nous n’accordions qu’une faible importance au cadre générique policier tandis que nous nous étendions longuement sur les difficultés rencontrées par des représentants de l’ordre pris entre un passé colonial mal assumé et une culture maternelle refoulée, que nous avons découvert les romans de Yasmina Khadra. Déjà publié en 1997 aux Editions Baleine, Morituri était alors réédité dans la collection « Folio policier ». Directement en prise avec une actualité bouleversante faisant état de la multiplication des attentats et des massacres commis en Algérie au cours des années 1990, ce roman a eu un effet retentissant sans doute sur la plupart de ses lecteurs ainsi que sur la critique journalistique de l’époque, et pas seulement littéraire.
En effet, alors qu’à ce moment-là, aucun Français n’ignore « ce qui se passe en Algérie », que les médias rapportent différents témoignages insoutenables expliquant la manière dont les « terroristes » viennent égorger, massacrer, décapiter, immoler des dizaines, voire des centaines de personnes, le roman de Yasmina Khadra apparaît comme une réponse à l’incompréhension et à l’impression de chaos suscitées par une situation surréaliste à certains égards. Le roman étant empreint d’un immense désespoir, traduisant l’amertume d’un homme témoin de la déchéance de son pays et pointant du doigt les responsables situés en amont de la crise, autrement dit la « mafia politico-financière », cette représentation littéraire avait, en outre, la particularité d’être tout à fait suggestive.
En effet, à travers les personnages dépeints, le chaos a finalement un nom, une allure, une fonction ; peu importe que cette peinture soit imaginaire, elle apparaît, aux yeux du lecteur qui veut savoir et comprendre, comme un témoignage précieux dont la valeur est, d’une certaine manière, attestée par l’anonymat de l’auteur, usant de surcroît d’un pseudonyme féminin, alors que les femmes comptent en masse parmi les victimes innocentes des massacres et que la difficile condition de la femme algérienne revient comme un leitmotiv dès qu’il est question de l’Algérie.
La lecture des deux derniers volets de ce qui est présenté comme la « trilogie » de Yasmina Khadra -ce concept est particulièrement prisé à ce moment-là- confirme la première impression de lecture sensible à l’accroissement encore de la noirceur du cadre et du désespoir du personnage principal, le commissaire Llob qui, finalement, meurt assassiné.
Alors que les romans de Yasmina Khadra ne cessent d’être commentés aussi bien dans la presse locale que française, l’auteur accorde au quotidien français Le Monde[2] un entretien où il révèle, à la surprise de bon nombre de ses lecteurs, qu’il est un homme, qu’il a déjà publié des ouvrages sous son véritable nom en Algérie et en France et qu’il garde son identité secrète pour des raisons de sécurité.
Tandis que le « cas » Yasmina Khadra intrigue de plus en plus, le mois de septembre 1999 se marque encore par l’apparition sur le devant de la scène littéraire française d’un autre écrivain algérien : Boualem Sansal. Publié dans la collection « blanche » de Gallimard, son roman intitulé Le Serment des barbares, propose au lecteur de suivre « une épopée rabelaisienne dans l’Algérie d’aujourd’hui », comme l’indique la quatrième de couverture. Deux éléments sont déterminants ici : d’une part, le personnage principal du roman est l’inspecteur Larbi, intrigué par la mort de deux hommes au profil opposé et décidé à faire la lumière sur les liens pouvant s’établir entre ces deux disparitions ; d’autre part, l’auteur signe de son vrai nom et il est présenté, en quatrième de couverture, comme « haut fonctionnaire en Algérie ». Notons, en outre, que sur fond d’enquête policière, le roman propose une intrigue touffue menée par une écriture extrêmement travaillée impliquant une lecture attentive et approfondie, loin de cette « lecture facile » traditionnellement attribuée au récit policier.
Désireuse d’approfondir notre approche du genre policier en Algérie, nous nous sommes rendue à l’Institut du Monde Arabe à Paris, afin de recueillir différentes critiques éventuellement publiées en Algérie, dans les journaux ou dans les revues spécialisées sur la littérature francophone maghrébine, et relatives aux ouvrages de Yasmina Khadra et Boualem Sansal. Au cours de cette visite, nous avons pu constater que d’autres romans relevant du cadre policier figuraient parmi les ouvrages proposés par la librairie de l’I.M.A., dont ceux du Marocain Jean-Pierre Koffel et des Tunisiens Al Sid et Charlotte -ces deux derniers publiant sous pseudonyme. Notre attention a alors été retenue par deux éléments essentiels : d’une part, ces auteurs publiaient l’un au Maroc, aux Editions Le Fennec, les deux autres en Tunisie, aux Editions Alyssa ; d’autre part, ces romans relevaient d’une forme encore différente de celles déjà proposées par Driss Chraïbi, Yasmina Khadra et Boualem Sansal.
Constatant que naissait un intérêt grandissant pour le genre policier au sein de la littérature maghrébine, aussi bien de la part des écrivains que des éditeurs, et ayant à l’esprit la première initiative policière de Patrick Chamoiseau avec Solibo Magnifique, nous avons tenté de déterminer si un même « phénomène » se produisait au sein de l’espace littéraire francophone antillais.
A partir de premières recherches effectuées en librairie, nous avons pu « sélectionner » différents ouvrages susceptibles d’étayer notre étude, parmi lesquels : L’Homme-au-bâton du Guadeloupéen Ernest Pépin, publié en 1992, mettant en scène une enquête policière « haute en couleurs » et malmenant quelque peu la forme policière traditionnelle ; Canal Laussat, du Guyanais[3] Patrice Mouren-Lascaux, publié en 1994, proposant une intrigue policière révélant les dessous de campagnes électorales frauduleuses ; Le Meurtre du Samedi-Gloria, du Martiniquais Raphaël Confiant, publié en 1997 et reprenant quant à lui le schéma traditionnel de la forme policière reposant sur la base meurtre/enquête/résolution ; ou encore La Dernière java de Mama Josépha, autre ouvrage de Raphaël Confiant, se présentant cette fois sous la forme d’un court récit publié en 1999.
Désireuse d’approfondir notre recherche, nous nous sommes alors adressée au Professeur Jack Corzani qui nous a conseillé la lecture d’autres ouvrages -dont il nous a permis l’accès le plus souvent- dont les romans des Martiniquais Guy Cabort-Masson (La Mangrove mulâtre ; Qui a tué le béké de Trinité ?) et Tony Delsham (Panique aux Antilles), des Guadeloupéens Fortuné Chalumeau (Pourpre est la mer) et Michèle Lacrosil (Demain, Jab-Herma) ou encore du Guyanais Bertène Juminer (Les Héritiers de la presqu’île).
La lecture de ces ouvrages, issus des Antilles-Guyane, nous a permis de découvrir des œuvres certes marquées par la présence d’un intertexte policier, mais usant la plupart du temps de ce cadre générique de manière subversive, offrant ce qui nous est apparu comme des romans policiers détournés.
Ainsi, contrairement à Yasmina Khadra revendiquant l’inscription de ses romans au sein du genre policier, la plupart des auteurs antillais nous ont semblé adopter une attitude ambiguë et paradoxale à l’égard de ce cadre générique. Or, la distance qu’ils affichaient à l’égard de la structure même du récit policier n’était finalement pas sans rappeler la singularité de la position éditoriale de Gallimard à l’égard du roman policier -mais non revendiqué comme tel au sein du paratexte- de Boualem Sansal.
D’autre part, après une première lecture de chacun de ces ouvrages, nous avons pu constater que chacun d’entre eux proposait, de manière plus ou moins significative, une peinture sociale dont le propos était notamment déterminé par l’éclairage des « crimes » de la société et, par glissement, par la mise en accusation de différents coupables et responsables. Il nous a donc semblé que chacun de ces romans proposait un discours de fond dépassant le strict cadre ludique généralement attribué au genre policier. En somme, non seulement la reprise du genre policier dans les espaces littéraires antillais et maghrébins semblait relever d’une démarche relativement originale, mais elle dissimulait également une intention qui ne consistait pas seulement à investir un genre jusque-là peu exploité. A bien des égards, cette reprise s’apparentait à une véritable adaptation, voire à une appropriation qui témoignait d’une intention littéraire précise et qui justifiait un discours social ciblé.
Afin de pouvoir définir plus précisément les contours de cette perspective, nous avons alors quitté la sphère des littératures francophones antillaise et maghrébine pour nous engager dans une étude plus approfondie du genre policier dans son ensemble.
Ne connaissant du genre policier, au stade initial de notre recherche, que les romans d’Agatha Christie et de Conan Doyle, tant nous considérions alors, il est vrai, le genre policier comme essentiellement ludique, il nous a fallu parfaire notre approche, en nous intéressant plus particulièrement aux références le plus fréquemment citées dans les différentes critiques émises sur le genre.
Nous avons rapidement pu constater que la critique littéraire relative au genre policier est considérable, mais également relativement éclectique. Ainsi, les critiques ou les études portant sur le genre policier, sa popularité, son histoire, son fonctionnement, ses attentes, ses perspectives, sont multiples et émanent aussi bien d’universitaires, de sociologues, de philosophes, d’écrivains, de journalistes que d’économistes.
Souhaitant appréhender le genre par la lecture d’ouvrages policiers, avant d’approfondir notre lecture de la critique, nous avons déterminé une bibliographie sélective regroupant différentes œuvres des auteurs les plus souvent cités, parmi lesquels Edgar Poe, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Chester Himes, Wilkie Collins, Georges Simenon, San Antonio, Maurice Leblanc, Jean-Patrick Manchette, Tony Hillerman, Ed McBain, Jean-Claude Izzo, Didier Daeninckx ainsi que celles de différents auteurs publiés dans la collection « Le Poulpe » ; nous avons élargi par la suite notre lecture à quelques ouvrages de William Faulkner, Patrick Modiano, Paul Auster ou encore Emilio Gadda.
Découvrant le roman policier sous de multiples facettes, nous nous sommes aperçue que l’histoire du genre demeurait encore floue, à certains égards, la plupart des critiques ne parvenant pas à s’accorder sur les circonstances de la naissance et de l’évolution du roman policier. Toutefois, au-delà de quelques points de désaccord, il nous est apparu que le genre policier, apprécié, détesté ou simplement étudié, pouvait fasciner une critique qui manifestement n’en finissait pas de s’interroger sur le fonctionnement, les potentialités et la portée de ce genre au sein de la « grande littérature ».
Nous nous sommes, par ailleurs, laissée convaincre, notamment à la lecture d’études littéraires menées sur le genre policier par des universitaires, qu’en dépit de la « rumeur » prêtant au roman policier un statut mineur et une fonction ludique, la valeur du texte policier ne faisait, en réalité, aucun doute ; un constat tout à fait attesté, par ailleurs, par la lecture des romans de Chester Himes, Raymond Chandler, Dashiell Hammett ou encore Georges Simenon.
Le genre policier nous est, dès lors, apparu sous une multitude de variantes relevant idéologiquement et structurellement de diverses approches ; l’élasticité du cadre générique s’avérant parfaitement adaptable à différents registres, différentes tonalités et globalement à différentes intentions scripturales. C’est vraisemblablement cette adaptabilité du cadre générique qui a conduit une multitude d’écrivains à s’y intéresser et à s’en inspirer pour finalement transcender les limites de la codification de son mode de fonctionnement. Le genre policier est rapidement apparu à certains scripteurs comme un moyen de communiquer avec le lecteur, voire de le manipuler, de le tromper parfois et, de manière générale, de tester sur lui son pouvoir de création. Aussi, les romans policiers « détournés » n’ont cessé de jalonner l’histoire du genre pour donner naissance à des textes proposant implicitement une réflexion sur la relation complexe s’établissant entre scripteur et lecteur, donnant à voir un texte en construction ou encore illustrant une multitude de perspectives métatextuelles. Les « nouveaux romanciers » participent, notamment en France, de cette réflexion engagée sur l’acte d’écriture à partir du recours au cadre policier et nous verrons dans quelle mesure leur approche pourra intéresser notre étude.
Après avoir cerné plus précisément la nature et le mode de fonctionnement du genre policier, nous nous sommes efforcée de dresser les limites de notre corpus.
Complétant nos recherches en librairie, prenant contact avec quelques écrivains, tels Jean-Pierre Koffel, Tony Delsham ou encore Patrice Mouren-Lascaux tout en poursuivant notre approche critique du genre policier, nous avons finalement regroupé plus d’une quarantaine d’ouvrages, relevant à la fois des espaces littéraires antillais et maghrébin ; une large sélection que nous avons souhaité affiner par la suite.
II-
Délimitation du corpus
Les ouvrages alors sélectionnés regroupaient des récits d’enquête s’apparentant à la forme classique du genre reposant sur la base meurtre/enquête/résolution, des récits moins centrés sur l’énigme à résoudre que sur la noirceur du crime sur le modèle du roman noir notamment, mais également des textes s’inspirant de la forme policière, en faisant par exemple intervenir une enquête menée par des policiers ou par des enquêteurs privés, sans toutefois qu’il y ait de véritable crime ou sans que l’énigme à résoudre ne trouve de solution in fine. Nous comptions encore parmi ces ouvrages des textes qui, sans mettre en scène de policier ni d’enquêteur officiellement réquisitionnés pour résoudre une énigme, prenaient la forme de « romans-enquête », produisant un récit calqué sur une sorte de cheminement tendu vers une vérité, une révélation ou le désir d’un retour à l’ordre.
Par ailleurs, notre étude se portait alors sur le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, ainsi que sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Enfin, les formes littéraires proposées relevaient essentiellement du roman, mais concernaient également le genre de la nouvelle.
Il nous a alors fallu procéder à différents choix afin de parfaire la cohérence et l’unité de notre corpus.
Dans un premier temps, nous avons préféré laisser de côté les ouvrages dont les intrigues ne concernaient pas directement les espaces antillais et maghrébin, comme par exemple le roman de Mouloud Akkouche, intitulé Causse toujours ![4], dont l’intrigue se situe en France et ne concerne en rien la « communauté maghrébine ». Il en est de même des romans de Lakhdar Belaïd[5], journaliste écrivain né en France, dont les intrigues policières se déroulent à Roubaix et abordent des sujets relatifs à la population d’origine maghrébine vivant en France ou encore aux stigmates encore prégnants dans les esprits de la Guerre d’Algérie et notamment des affrontements entre nationalistes et harkis. Nous avons, de la même manière, écarté le roman de Didier Daeninckx, intitulé Meurtres pour mémoire[6] et revenant sur la manifestation tragique des Algériens à Paris en octobre 1961 ayant fait des centaines de victimes à la suite de l’intervention meurtrière des forces de police.
Précisons, par ailleurs, que nous avons choisi d’intégrer le récit policier de Raphaël Confiant, intitulé La Dernière java de Mama Josépha, et ce, bien que l’action se déroule à Paris, dans la mesure où Raphaël Confiant est l’auteur de deux autres romans policiers ou d’inspiration policière auxquels nous nous intéresserons dans le détail. Au demeurant, l’approche que nous proposerons de cet ouvrage sera relativement succincte et concernera uniquement la prise en compte globale de la production policière de Raphaël Confiant.
Dans un deuxième temps, nous avons également écarté les écrivains qui ne relevaient pas strictement des espaces antillais et maghrébins. Ainsi, Patrice Mouren-Lascaux, qui nous a accordé un entretien téléphonique en nous révélant sa véritable identité et les circonstances de son séjour en Guyane, n’a pu être intégré au corpus. Bien qu’ayant décrit avec précision et pertinence les conditions parfois obscures et frauduleuses caractérisant le déroulement de certaines actions politiques menées en Guyane, ses origines métropolitaines et surtout la courte durée de son séjour en Guyane ne nous ont pas paru légitimer complètement son rattachement à la sphère des écrivains dits « antillais ».
De la même manière, bien que relatant une intrigue policière prenant pour cadre la ville d’Oran, le roman de Catherine Simon, intitulé Un Baiser sans moustache[7], n’a pas été intégré à notre corpus ; nous avons, en effet, pris en compte le fait que l’auteur réside en France où elle occupe la fonction de journaliste pour le quotidien français Le Monde ; aussi, elle ne nous a pas paru pouvoir relever totalement de l’élaboration d’un espace littéraire maghrébin.
Précisons ici que, concernant le choix des écrivains susceptibles de participer légitimement de l’espace littéraire maghrébin, nous avons eu quelques réticences à l’égard de Jean-Pierre Koffel. Né à Casablanca, J-P. Koffel se définit lui-même comme « Français du Maroc »[8]. Nous l’avons néanmoins intégré au corpus pour diverses raisons : il vit au Maroc, il y a enseigné près de quarante ans et surtout il y publie ses romans. Nous avons néanmoins décidé de nous intéresser strictement aux ouvrages de sa bibliographie qui prennent pour cadre le Maroc, et avons notamment écarté le roman inspiré de la forme policière intitulé Pas de visa pour le paradis d’Allah[9].
Nous avons également eu certaines réticences à intégrer le roman de Janine et Jean-Claude Fourrier intitulé Morts sur le morne. Bien que ne disposant que de très minces informations sur les auteurs de l’ouvrage, nous avons néanmoins choisi de prendre en compte ce roman au sein de notre étude, dans la mesure où il prend pour cadre la Guadeloupe, qu’il participe pleinement du genre policier et qu’il est publié aux Editions caribéennes, dans la série « Tropicalia » ; une dernière caractéristique qui justifie d’autant mieux notre choix qu’elle nous permettra sans doute de regrouper le thème policier et l’espace antillais au cœur d’une réflexion portant sur l’« étiquette » et plus précisément sur la question du stéréotype.
Progressivement, nous avons décidé de resserrer notre étude autour de deux nouveaux critères.
Le premier concerne le registre littéraire au sein duquel s’inscrivent les textes qui nous intéressent : nous avons souhaité privilégier la forme romanesque -offrant déjà une grande diversité d’un point de vue structurel au sein de notre corpus, notamment du fait de l’adaptabilité du cadre policier- et écarté, de fait, deux recueils de nouvelles, l’un de l’écrivain algérien Chawki Amari[10], l’autre signé d’un collectif d’écrivains issus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou encore d’Haïti[11].
Le second critère concerne une délimitation temporelle du corpus : la plupart des ouvrages sélectionnés ayant été publiés dans les vingt dernières années, nous nous intéresserons précisément aux œuvres éditées depuis 1980 jusqu’à nos jours, écartant entre autres, du cœur de notre étude, les ouvrages de Michèle Lacrosil ou encore de Bertène Juminer ; nous évoquerons néanmoins ces romans lorsque nous nous interrogerons sur les prémices du genre policier au sein des littératures qui nous concernent, avant les années 1980.
Précisons enfin qu’avec la mise à l’écart de l’œuvre de Bertène Juminer, l’espace littéraire guyanais n’est plus représenté au sein de notre étude ; la sphère littéraire haïtienne ne sera pas non plus abordée au cours de notre travail.
Aussi, il convient d’ores et déjà de souligner que notre réflexion concernera, pour ce qui est de la sphère antillaise, uniquement des œuvres martiniquaises et guadeloupéennes[12]. Néanmoins, afin de faciliter la désignation des espaces littéraires qui nous intéressent, nous nous réservons le droit de regrouper les œuvres martiniquaises et guadeloupéennes de notre corpus sous l’appellation généralisante de « littérature francophone antillaise » ou encore « littérature antillaise ». En d’autres termes, lorsque nous parlerons de « littérature antillaise » ou plus largement encore des « Antilles », le lecteur voudra bien comprendre qu’il n’y sera, en réalité, question ni de la Guyane, ni d’Haïti, mais bien uniquement de la Martinique et de la Guadeloupe.
Enfin, pour clore cette approche consacrée à la délimitation de notre corpus, ajoutons que notre étude pourra intégrer différentes œuvres ne relevant pas strictement de la forme policière traditionnelle, mais s’en inspirant fortement pour tendre vers cette forme de « roman-enquête » que nous évoquions plus haut ; l’introduction de ces ouvrages nous permettra, en effet, d’observer de manière plus explicite le processus de l’enquête et la manière dont il imprime le fonctionnement même du récit.
Avant de donner un aperçu des différentes étapes de notre développement, il convient de préciser d’ores et déjà les objectifs que nous nous fixons, ainsi que la manière dont nous souhaitons mener notre étude.
III-
Objectifs et orientation de l’étude
Il nous apparaît, en premier lieu, nécessaire de revenir sur le choix de mener cette étude au sein de deux espaces littéraires -antillais et maghrébin-, eux-mêmes divisés -d’une part, Guadeloupe et Martinique ; d’autre part, Maroc, Algérie et Tunisie.
Le corpus déterminé selon les critères précédemment énoncés compte trente-deux ouvrages, ce qui peut paraître relativement élevé dans le cadre d’un travail approfondi, détaillé et précis. Rappelons en ce sens que notre propos consiste en une étude portant sur un genre littéraire et qu’il s’agit plus précisément de rendre compte de l’adaptation et de l’évolution d’un genre au sein d’espaces géographiques, littéraires ou encore sociologiques bien déterminés. Aussi, nous ne pouvons faire l’économie du moindre ouvrage relatif à la fois au genre en question, de manière plus ou moins évidente, aux espaces dont il est question et à la période qui nous intéresse. Précisons en ce sens que si nous avons pris la liberté de laisser de côté certains ouvrages tunisiens très proches de ceux que nous avions déjà intégrés au corpus et n’apportant rien de plus à l’appréhension de notre sujet, nous avons néanmoins souhaité accorder une place de choix aux cinq romans policiers de Yasmina Khadra, chacun proposant une approche singulière de la forme policière et apportant un éclairage plus ou moins contrasté sur le contexte socio-politique algérien.
Disposant, par ailleurs, d’un corpus conséquent pour chacune des aires antillaise et maghrébine, nous aurions peut-être pu axer notre étude uniquement sur l’une de ces aires. Après réflexion nous y avons renoncé pour différentes raisons.
Le resserrage de notre corpus autour d’ouvrages relevant strictement de l’espace littéraire maghrébin ou antillais nous aurait privé de l’intérêt d’une approche comparatiste des plus intéressantes. En effet, notons tout d’abord que la reprise d’un même cadre générique presque simultanément au sein de deux espaces distincts nous permet de nous livrer légitimement à différentes comparaisons. Or, ces comparaisons s’avèrent être nécessairement significatives lorsqu’il est question de deux espaces, certes distincts et possédant chacun sa spécificité, mais porteurs d’une histoire en partie constitutive d’un même processus, celui de la colonisation française ; un processus qui a évolué différemment au sein de chacun de ces espaces : Martinique et Guadeloupe sont devenus des départements français en 1946 ; le Maroc et la Tunisie ont obtenu leur indépendance en 1956, l’Algérie en 1962.
Notons, d’autre part, que le processus d’implantation des colons français diverge pour ce qui est de ces deux espaces, les Antilles ayant été peuplées, au XVIIème siècle, par les colons après extermination des populations caraïbes originelles et déportation d’esclaves africains, tandis que les populations du Maghreb ont été envahies et asservies par les colons, au XIXème siècle.
Ces considérations relatives à l’histoire coloniale ayant marqué ces deux espaces alimentent la détermination de notre approche comparatiste, d’autant mieux que le genre policier n’y est pas indifférent. En effet, il existe au sein des aires antillaise et maghrébine un rapport singulier à la France s’exprimant notamment à travers deux perspectives : celle du pouvoir, de l’autorité et celle de la culture et plus précisément de la langue. Or, le roman policier mettant en scène une enquête censée permettre le retour à l’ordre, la condamnation des crimes ou encore l’affirmation de la double puissance de la raison et de la morale, propose, en filigrane, une réflexion portant sur l’ordre, l’autorité et à certains égards la répression. En outre, genre populaire se permettant certaines libertés, notamment d’ordre linguistique -avec par exemple le recours à la langue argotique dans le roman noir-, le roman policier favorise également une certaine perméabilité langagière que ne manquent pas d’exploiter la plupart des auteurs de notre corpus.
Prenant en compte des considérations à la fois d’ordre socio-historique et culturel, le genre policier nous permettra donc de porter un regard croisé sur les sociétés et les littératures des Antilles et du Maghreb. Nous pourrons ainsi tenter d’établir des points de connexion entre ces espaces culturels distincts et porter par là même un regard large sur la cohésion et les disparités caractérisant une partie de la francophonie littéraire.
L’élargissement du corpus à ces deux espaces nous permettra, en outre, d’aborder une grande diversité de textes, dévoilant dans le même temps les multiples potentialités d’un genre que nous apprendrons à « redécouvrir », notamment en regard de certains a priori dévalorisants véhiculés par l’étiquette dérangeante de ce genre dit « mineur ». Nous verrons en quoi la reprise et l’adaptation du roman policier aux espaces littéraires francophones des Antilles et du Maghreb participent de l’évolution d’un genre « universel » à bien des égards.
Réciproquement, les enjeux idéologiques et structurels développés par le genre policier nous offriront des peintures à la fois précises, argumentées et orientées des sociétés décrites, ainsi que des intentions scripturales d’auteurs s’étant parfois déjà illustrés en dehors du polar. Autrement dit, à travers le prisme de la fiction policière, nous découvrirons les sociétés antillaise et maghrébine sous un éclairage singulier et fortement caractérisé, dont le choix nous laissera entrevoir différentes intentions et stratégies à la fois scripturales et éditoriales.
Notons toutefois que cette approche comparatiste peut présenter l’inconvénient de sa propre richesse. En effet, il n’est pas question pour nous d’aborder superficiellement ces trente-deux ouvrages ; l’intérêt de l’approche consistant à mettre en évidence à la fois les affinités et divergences relatives à ces diverses adaptations du genre policier, cela nécessite une étude en profondeur de chaque œuvre. Cependant, tout en abordant ces différents textes sous des angles de vue variés, nous veillerons à mettre essentiellement en évidence les points susceptibles d’étayer l’ensemble de notre réflexion. En outre, au fur et à mesure de notre développement, nous privilégierons l’étude des textes nous paraissant les plus intéressants et significatifs pour l’avancée de notre réflexion et nous recentrerons donc notre étude autour de la démarche de certains auteurs en particulier.
Précisons encore qu’il nous est apparu nécessaire de proposer une étude argumentée et explicative de notre sujet ; nous n’avons, en ce sens, pas hésité à illustrer nos réflexions aussi souvent que nécessaire, en citant directement quelques passages clés des textes du corpus ainsi qu’en recourant à différents ouvrages critiques dont nous avons proposé divers extraits. Afin de proposer la vue d’ensemble ambitionnée par la perspective de l’étude d’un genre au sein d’espaces littéraires distincts, nous nous sommes, en effet, efforcée de multiplier les recoupements, croisements, comparaisons nécessaires à l’appréhension globale du sujet.
Au risque d’appesantir parfois la lecture, ces interventions nous ont paru indispensables aussi bien à la compréhension du propos de fond souvent dense, tenu notamment dans le cadre de romans se positionnant dans une approche de type référentiel, qu’à l’appréhension de la démarche littéraire empruntée par les différents écrivains qui nous concernent, notamment à la lecture de critiques spécifiquement consacrées à quelques-uns d’entre eux.
Ajoutons donc pour finir qu’il nous semble que notre étude propose différentes pistes s’efforçant, d’une part, de répondre à nos objectifs et esquissant, d’autre part, d’autres angles d’approche susceptibles d’être empruntés « individuellement » et de manière plus approfondie, sur telle œuvre et tel auteur.
Notre projet, tout en abordant déjà certaines questions par le détail, propose une appréhension globale des modalités d’adaptation du genre policier aux littératures francophones des Antilles et du Maghreb, à travers deux perspectives : à la lumière d’une étude approfondie menée sur le mode de fonctionnement, les tenants et aboutissants du genre policier, il s’agira de prendre en compte, d’une part, les enjeux critiques sous-tendant les motifs de la reprise de ce cadre générique et, d’autre part, de rendre compte des perspectives esthétiques engendrées et permises par l’investissement d’un genre perméable, modulable et porteur, par le biais de la perspective herméneutique engagée par le thème de l’enquête, d’une réflexion concernant son propre engendrement.
IV-
Annonce des étapes du développement
Afin de mener à bien notre étude, nous tenterons globalement de répondre à différentes interrogations.
Ainsi, qu’en est-il aujourd’hui du genre policier en France et plus largement dans le monde, après près d’un siècle d’existence ? Quels ont été les principaux ressorts et perspectives du genre tout au long de son évolution ? Existe-t-il réellement un roman policier type, codifié, repérable, reproductible à l’infini et réductible à une grille de lecture unique ? Qu’en est-il de la marge d’adaptabilité du genre ?
Mobile et « exportable » de par le monde, le genre policier parvient-il réellement à s’acclimater aux espaces qu’il est amené à visiter ou se limite-t-il à faire simplement usage du décor qui lui est proposé ?
Le fait de recourir au genre policier au sein d’espaces littéraires qui jusque-là l’avaient délaissé participe-t-il d’un simple effet de mode ? Comment expliquer l’intérêt des écrivains francophones des Antilles et du Maghreb pour ce genre a priori éloigné, de par son caractère ludique, des préoccupations littéraires propres à ces espaces ? Quelles sont les modalités d’adaptation du genre au sein de ces aires ? Que livrent ces expériences du genre policier des sociétés auxquelles il est confronté ? Quelles perspectives littéraires cette adaptation du genre policier permet-elle de développer au sein des espaces antillais et maghrébins ?
Autant d’interrogations auxquelles nous tenterons de répondre en proposant un développement conçu de manière tripartite.
Notre première partie proposera une approche globale du genre policier que nous mènerons en deux étapes.
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au cadre générique en lui-même, en déterminant les différents moments clés de la naissance et du développement du genre policier notamment au sein des littératures anglaise, américaine et française. Constatant les multiples rebondissements, revirements et enrichissements subis par le genre au fil des ans, nous pourrons, par ailleurs, nous interroger sur la mobilité de ce genre vraisemblablement à la fois réactif aux bouleversements sociaux et à l’écoute de la modernité.
Approfondissant, par la suite, notre approche du genre, nous tenterons de pénétrer au cœur même du fonctionnement du texte policier, en mettant notamment en évidence sa structure duelle : œuvre de fiction dite de distraction portant un regard parfois étonnamment précis et révélateur sur la réalité ou encore proposant au lecteur de se livrer au jeu superficiel de l’enquête tout en le soumettant au vertige de la fiction en train de s’écrire, le texte policier se présentera souvent à nous dans toute sa complexité et à certains égards dans toute sa « schizophrénie ».
Cette première approche du genre policier nous permettra, dans un deuxième temps, d’aborder et de présenter les différentes œuvres de notre corpus, en procédant déjà à quelques recoupements. Nous nous interrogerons tout d’abord sur les éventuelles apparitions du genre policier au sein des espaces littéraires francophones des Antilles et du Maghreb, avant les années 1980, ce qui nous permettra d’ores et déjà d’illustrer la singularité de chacun de ces espaces, diversement réactif à l’évolution du genre policier depuis son apparition, à la fin du XIXème siècle. Puis, nous brosserons un premier aperçu du corpus, en proposant notamment trois angles d’approche : le premier consistera à prendre en compte ce qui relève de l’encadrement de l’œuvre, autrement dit le paratexte, afin notamment de déterminer le positionnement de chaque œuvre et de chaque auteur à l’égard du cadre générique et plus précisément des différentes « étiquettes » qui lui sont prêtées ; le deuxième angle d’approche nous invitera à pénétrer au cœur des ouvrages, puisqu’il s’agira de définir et de distinguer les différents types d’enquête proposés par chacun d’eux ; enfin, dans une perspective complémentaire de la précédente, nous nous pencherons plus précisément encore sur les types d’enquêteur mis en scène, ce qui nous permettra de procéder à quelques rapprochements entre les différentes œuvres étudiées.
A la lumière de ces premiers éléments consolidant le socle de notre développement, nous consacrerons notre deuxième partie à une étude plus approfondie des textes qui nous concernent, en nous intéressant aux formes et enjeux de la transposition du genre policier aux littératures francophones des Antilles et du Maghreb.
Notre propos consistera, dans un premier temps, à rendre compte de la manière dont le genre policier parvient à s’adapter, voire à s’acclimater à ces espaces qui, nous le verrons, ne manquent finalement pas d’atouts garantissant à la forme policière un accueil relativement favorable. Prenant en compte la maturité de ce genre, déjà largement exploité de par le monde, les auteurs de notre corpus tenteront, en effet, de se l’approprier en lui insufflant notamment la spécificité à la fois culturelle et socio-historique des espaces qu’ils représentent.
Nous verrons alors, dans un deuxième temps, qu’après être parvenus à investir, à habiter ce cadre générique si singulier, la plupart des auteurs de notre corpus semblent véritablement profiter de l’occasion pour faire du genre policier le prétexte à une exploration à la fois précise et orientée de leur société. Livrant en quelque sorte un état des lieux des sociétés décrites, en mettant notamment l’accent, cadre policier oblige, sur les crimes réels ou imaginés responsables de nombreux dysfonctionnements, les romans qui nous intéressent nous donneront à voir différents tableaux, oscillant souvent entre perspectives réaliste et fantasmée, éclairant dans le même temps différents discours, différentes intentions scripturales.
Après avoir constaté la diversité des orientations idéologiques développées à travers le prisme du roman policier, rendu compte de la singularité de la démarche de certains auteurs et nous être interrogée globalement sur le discours de fond véhiculé par les différentes intrigues policières proposées, nous nous consacrerons, dans une troisième et dernière partie, à la manière dont la structure même du récit policier subit les effets de son acclimatation aux espaces littéraires antillais et maghrébin.
Il s’agira dans un premier temps de mettre en avant les modes et conséquences de cette acclimatation sur quelques principes structurels majeurs du genre policier traditionnel, tels que le manichéisme et le cartésianisme, appliqués respectivement au crime et à l’énigme, avant de rendre compte, plus largement, des bouleversements engendrés par cette mise à l’épreuve du genre sur le mode de fonctionnement du système énonciatif du récit lui-même. Nous découvrirons, en effet, que la structure du récit policier implique une orientation singulière, précise et réfléchie de son système énonciatif, servant à certains égards, plus que le fond même de l’intrigue, le bon déroulement du récit.
Véritablement orienté, mis en scène, apprêté, le récit policier nous révèlera alors, dans un deuxième temps, le caractère stratégique de son mode de fonctionnement que nous choisirons d’éclairer à la lumière de quelques réflexions proposées notamment par le courant littéraire insufflé par les Nouveaux Romanciers. Les travaux effectués par ces derniers sur le roman et sur le mode de fonctionnement du récit, placé notamment sous le sceau de « l’ère du soupçon », nous permettront en effet de nous interroger sur les modalités d’application de la notion de vérité au sein du roman et plus largement sur la fiabilité de la narration dans le cadre du récit policier ; réflexion que nous pourrons alors confronter aux différents textes de notre corpus qui pratiquent notamment une reprise détournée de la forme policière, parodiant, avortant, subvertissant les principales étapes de son schéma narratif traditionnel. Cette approche nous permettra par la suite d’engager une réflexion plus large sur le roman en général et sur la visibilité du scripteur au sein du récit, pour enfin nous permettre de confronter, toujours à la lecture de quelques-uns des textes de notre corpus, littérature policière et littérature de recherche, donnant à voir par là même une autre orientation essentielle de la reprise du genre policier au sein des espaces littéraires francophones des Antilles et du Maghreb.
PREMIERE PARTIE
Approche du
genre policier
I- Structure et atouts du genre policier
S’intéresser au genre policier peut s’avérer plus compliqué qu’il n’y paraît. C’est un genre que tout le monde connaît ou prétend connaître ; un genre jugé facile de lecture comme d’écriture ; un genre dit ludique, mineur, populaire, accrocheur et commercial ; un sous-genre au style bâtard, mi-standard, mi-argotique, porte-drapeau des « littératures de gare », « de plage » et autres lieux de passage ; un genre inscrit dans l’éphémère et la fugacité qui peut cependant se targuer d’une longévité remarquable, en regard des critiques dont il a toujours fait l’objet.
C’est que le genre policier attire et il séduit en premier lieu le créateur. Ce dernier peut, en effet, succomber aux charmes d’un genre caractérisé par une codification si aisément perméable, se transformant en véritable laboratoire stylistique -si tant est que l’écrivain se fasse quelque peu créatif-, assurant l’intérêt d’une part importante du lectorat et garantissant par là même un écoulement intéressant du tirage éditorial, tout en offrant à son auteur cette touche de modernité relayée par l’effet de mode qui enveloppe aujourd’hui le genre policier, tant sur les étals de librairie que sur les écrans de télévision. Le genre policier attire et il plaît aux nombreux lecteurs qui y consacrent du temps libre, séduits par le côté sériel et l’aspect feuilletonesque de certaines aventures, grisés par le rythme, la vivacité et le suspense généralement imposés au genre, installés dans un certain confort favorisé, dans la forme la plus classique, par la traditionnelle happy-end, parés encore contre l’ennui que pourraient susciter certaines descriptions ou réflexions trop longues et qui l’emporteraient sur l’action. Le couple lecteur/créateur semble donc parfaitement en phase en ce qui concerne le genre policier, lié par un effet d’attente, et ce, sous les yeux d’un troisième protagoniste. Si le genre policier attire le créateur, s’il plaît, de manière générale, au lecteur, il semble véritablement fasciner la critique, qui ne cesse de décrier, d’encenser ou d’interroger un genre mondialement connu, repris et aux multiples variantes, donc complexe car véritablement paradoxal dans ses principes et ses fondements mêmes.
1- Un genre enraciné dans la modernité
Nous nous proposons, dans un premier temps, de nous intéresser à la modernité du genre policier ; modernité notamment constitutive de deux facteurs interdépendants : la longévité du genre et son adaptabilité à l’évolution sociale.
Dès son apparition sur la scène littéraire, à la fin du XIXème siècle, le genre policier n’a en effet cessé d’évoluer, de se transformer, de s’adapter aux attentes du lectorat, invité par là même à prendre en compte une certaine réalité sociale alors en pleine mutation. Jugé mineur, accessible à tous et, de ce fait, « légitimement » adaptable, le genre policier a pu être décliné de multiples façons par les nombreux écrivains qui s’y sont intéressés, donnant naissance à différentes variantes que nous allons tenter de distinguer, en reprenant notamment les principales étapes de l’évolution du genre depuis son apparition.
1.1- Naissance et évolution
Apparu à la fin du XIXème siècle, le genre policier a bénéficié de l’intérêt que lui ont porté de nombreux auteurs, issus d’aires géographiques et culturelles différentes, relevant essentiellement alors de l’Angleterre, des Etats-Unis et de la France. A l’écoute les uns des autres, ces écrivains ont contribué à l’évolution du genre qui a ainsi fait preuve d’une certaine vivacité tout au long du XXème siècle. Soumis à de nombreux rebondissements, à différentes innovations, à d’affligeants ratés aussi bien qu’à de remarquables réussites, le genre policier a pu profiter des multiples apports des uns et des autres qui n’ont cessé de susciter l’intérêt, voire de favoriser l’attachement du public à son égard.
1.1.1- Des débuts jusqu’aux années 1920
De l’avis de nombreux critiques, c’est à l’écrivain américain Edgar Allan Poe que l’on doit les prémices du roman policier, sous la forme de nouvelles dont les plus célèbres sont intitulées Le Double Assassinat de la rue Morgue (1841), Le Mystère de Marie Roget (1842) ou encore La Lettre volée (1841). Ces nouvelles, sans adopter la forme policière classique telle qu’on la définit aujourd’hui, présentent l’intérêt nouveau pour l’époque de s’inscrire dans la logique du récit d’énigme : prenant pour point de départ l’exposition d’une énigme, elles s’achèvent finalement sur sa résolution, à la suite d’un processus intellectuel procédant par observation, raisonnement, puis déduction. Le Double Assassinat de la rue Morgue signe, en ce sens, à bien des égards, les futures pistes qui seront exploitées quelques décennies plus tard par le genre policier, comme le souligne Denis Fernandez Recatala :
« Avec ce court récit, Poe invente le mystère de la chambre close, le détective à l’argumentation logique et infaillible, la fausse piste entraînant l’inculpation d’un innocent suspecté. Dans le même temps il dresse des limites : le hasard en sera exclu, et tout indice, tout événement, circonstance, tout discours n’ont qu’un but, efficace, celui de servir l’économie de la narration. »[13]
C’est à E. Poe que l’on doit également la création de la figure de l’enquêteur, du rationaliste à la logique implacable, sous les traits de son personnage Charles-Auguste Dupin. Dupin observe, écoute, raisonne et déjoue les évidences afin d’expliquer les circonstances d’un événement devenu mystérieux, car survenu à l’abri des regards : il est un archétype du détective, valorisé qui plus est par la présence à ses côtés d’un assistant à qui il peut livrer ses raisonnements et exposer ses conclusions.
Sur les traces de l’écrivain américain et de son enquêteur français, Emile Gaboriau, feuilletoniste français, parvient, une vingtaine d’années plus tard, à transposer le récit d’énigme au cadre romanesque. Respectant le schéma crime/enquête/résolution inauguré par E. Poe, il écrit L’Affaire Lerouge qui paraît sous forme de feuilleton en 1863 dans Le Pays, puis deux ans plus tard de manière plus concluante vis-à-vis du public, dans Le Soleil, avant d’être finalement publié en librairie l’année suivante[14]. Ce succès donnera naissance à d’autres romans construits sur le même modèle : Le Dossier 113 (1867), Les Esclaves de Paris (1867), Le Crime d’Orcival (1867), Monsieur Lecoq (1869), La Corde au cou (1873). Contrairement à E. Poe, l’enquêteur mis en scène par E. Gaboriau est policier et devient, de ce fait, le « premier policier professionnel de l’histoire de la littérature policière »[15].
Dans la continuité de ces deux premiers pas, un troisième s’accomplit, et non le moindre, puisqu’il donne naissance à l’un des plus fameux enquêteurs de la littérature policière, à savoir Sherlock Holmes, qui apparaît pour la première fois en 1887, dans un roman intitulé Une Etude en rouge, sous la plume d’Arthur Conan Doyle, médecin écossais de trente-sept ans, inspiré à la fois par E. Poe et E. Gaboriau :
« Gaboriau
exerçait sur moi une assez forte attraction par sa façon nette de charpenter un
drame, et M. Dupin, le magistral policier d’Edgar Poe, était l’un de mes héros
depuis l’enfance. Pouvais-je, aux créations de ces deux auteurs, ajouter la
mienne ? Je songeai à mon ancien professeur, Joseph Bell, à sa face
d’aigle, à ses procédés bizarres, à sa manière un peu fantastique d’observer le
détail. Policier, il eût certainement cherché à rapprocher d’une science exacte
une méthode captivante qui demeurait chez lui toute instinctive. Je devais
tenter d’y parvenir. »[16]
Publiant les aventures de Sherlock Holmes et de son célèbre assistant et faire-valoir le Docteur Watson, dans le Strand Magazine, sous forme de nouvelles à partir de juillet 1891, Conan Doyle rencontre un vif succès auquel il décide subitement d’échapper, en prenant le parti d’assassiner son héros, deux années plus tard, dans Le Problème final. Sous la pression du public -dont les réactions à la mort du héros furent véritablement démesurées- Conan Doyle est finalement contraint de ressusciter le très populaire Sherlock Holmes, en 1897, pour une pièce de théâtre, puis en 1901, avec le roman intitulé Le Chien des Baskerville.
Le génie autant que l’excentricité de Holmes lui ont assuré une renommée internationale et ont fait de lui, aux dires de nombreux critiques, le personnage de fiction le plus célèbre au monde.
Ainsi, selon Marc Lits[17], si le genre policier est né avec E. Poe et E. Gaboriau, c’est uniquement Conan Doyle qui lui a permis de se distinguer des autres formes de la littérature populaire avec la création du personnage de Sherlock Holmes.
Holmes incarne le héros infaillible, celui qui voit par le raisonnement ce que les autres ne devinent pas, le sauveur sur qui tous les espoirs se portent. Jean Bourdier définit son pouvoir en ces termes :
« La force de Sherlock Holmes se ramène à deux facteurs essentiels : par l’observation méticuleuse, il enregistre des détails qui ont totalement échappé aux autres, et, sur les détails ainsi observés, il fonde un raisonnement à la logique implacable. Son grand secret est là : il a le courage de sa logique, et poursuit son raisonnement jusqu’à son terme, sans se laisser détourner de son chemin. » [18]
D. Fernandez Recatala met par ailleurs en avant la théâtralité de ce personnage et la manière dont Conan Doyle parvient à valoriser ses méthodes :
« Holmes ne serait pas perçu comme il l’a été sans la théâtralité ; son raisonnement rigoureux est mis non moins rigoureusement en situation : il fait évènement, et ses conclusions sont exposées comme autant de dépouilles opimes. La science et le théâtre se confondent dans la révélation qui est l’avatar sublime du coup d’éclat. »[19]
De la même manière, certains critiques constatent que tout ce contre quoi il ne peut pas lutter lui est épargné, et en premier lieu, les femmes. L’analyse de Geoffrey O’Brien paraît à ce sujet tout à fait pertinente :
« Dans le monde de Sherlock Holmes, aussi fermé à la sexualité que son appartement de Baker Street est imperméable au vent et au brouillard extérieurs, les mystères sont contrôlés et réduits à de simples objets : une lettre volée, une bouteille de somnifère, un conduit d’aération caché. Ce sont des anomalies dans un monde ordonné où le temps et l’espace forment des lignes clairement définies. En consultant un tableau horaire et une carte, il est facile d’isoler l’élément perturbateur. […] Ce genre de récit policier exclut les femmes pour la même raison qu’il élimine le surnaturel : ce sont des mystères qui se situent bien au-delà des capacités du détective. » [20]
A ce jeu de la représentation, le lecteur se fait bon spectateur, car Holmes, en dépit de sa côte de popularité, est loin d’être parfait : sa dépendance aux narcotiques en atteste ; ses crises de vague à l’âme, de spleen baudelairien également. Certes, il persévère dans ses enquêtes par amour de la vérité, mais on peut également le soupçonner de chercher à y engloutir sa mélancolie.
Quoi qu’il en soit le personnage de Sherlock Holmes aura non seulement marqué les lecteurs de Conan Doyle mais également tous ceux qui se seront exercés au genre après lui. Les méthodes et la réputation du célèbre détective seront ainsi souvent parodiées et caricaturées, notamment dans quelques-uns des romans de notre corpus, comme nous le verrons ultérieurement.
Sur les traces du célèbre détective de Baker street et parallèlement au succès de la forme feuilletonesque dans les magazines, de nombreux autres détectives de fiction voient le jour, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, notamment en Grande-Bretagne. La nouvelle, forme jusqu’alors privilégiée, cède progressivement le pas au roman, qui trouve véritablement son point d’ancrage au début des années 1920, avec la forme du whodunit, contraction de l’expression « who has done it ? » (« qui l’a fait ? »), archétype de ce que l’on appellera le « roman policier classique » ou encore « roman d’énigme ».
Le whodunit propose, sous forme romanesque, le récit d’une enquête partant d’un crime et aboutissant à la révélation de l’identité du ou des coupables. Reproduisant ce schéma de base, au-delà de l’originalité et de l’inventivité de chacun des créateurs, son fonctionnement répond à des codes bien précis ; codification que certains[21] ont rapprochée des règles de dramaturgie énoncées par Aristote, reconnaissant dans le genre policier classique le respect de certaines valeurs telles l’unité de lieu, d’action, le nombre restreint de personnages ou encore la courte durée de l’intrigue. D’autres règles ont encore été avancées par différents auteurs, poussant à une forme de mécanisation du genre. En ce sens, Jacques Dubois déclare :
« La fiction policière propose des objets en “kit” : les éléments de bases sont là, le mode d’emploi aussi, il n’y a plus qu’à monter. » [22]
Poussant plus loin cette volonté d’institutionnaliser le genre, S.S. Van Dine, pseudonyme de Willard Huntington Wright (1888-1939), journaliste, critique et auteur de romans policiers dont le héros est un détective nommé Philo Vance, publie, en 1928, un article intitulé « Vingt règles pour le crime d’auteur », dans The American magazine ; en voici quelques-unes :
1- Le lecteur et le détective doivent avoir des chances égales de résoudre le problème.
2- L’auteur n’a pas le droit d’avoir recours, vis-à-vis du lecteur, à des ruses et des procédés autres que ceux utilisés par le criminel à l’égard du détective.
3- Le véritable roman policier ne doit pas comporter d’intrigue amoureuse.
4- Le coupable ne doit jamais se révéler être le détective lui-même ou un représentant de la police.
5- On doit déterminer l’identité du coupable par une série de déductions, et non par accident, par hasard ou à la suite d’une confession volontaire.
6- Tout roman policier exige, par définition, un policier. Ce policier doit faire son travail, et il doit le faire correctement.
7- Pas de roman policier sans cadavre. Etc.[23]
Après avoir fait quelques adeptes, ces règles fondatrices sont bientôt dépassées par la nécessité de renouvellement et d’originalité se manifestant au sein du genre.
Le roman d’énigme connaît un succès retentissant outre-Manche entre 1920 et 1940, époque où l’on découvre notamment une autre grande figure du roman policier : Agatha Christie. Son enquêteur vedette, nommé Hercule Poirot, petit Belge excentrique aux allures pincées, connaît un succès presque aussi important que son prédécesseur Sherlock Holmes.
Inspirée, entre autres, par Conan Doyle et Gaston Leroux, Agatha Christie publie en 1920 son premier roman policier, intitulé La Mystérieuse affaire de Styles, mais c’est en 1926, avec Le Meurtre de Roger Ackroyd, qu’elle se fait véritablement remarquer. Affichant très tôt son désir de bouleverser la rigidité du genre, elle fait du narrateur de ce roman le meurtrier démasqué in fine, médusant lecteurs et critiques et inspirant de nombreux autres écrivains qui comprendront par la suite l’intérêt suscité par cette forme de manipulation narrative.
Agatha Christie a poursuivi l’entreprise « holmesienne » de mise en scène d’un enquêteur à matière grise, procédant par déduction et capable de résoudre toute énigme ; mais elle a surtout fait naître un narrateur menteur, manipulateur et criminel et l’on ne peut douter que son œuvre aura inspiré bon nombre d’écrivains dont notamment, en France, les Nouveaux Romanciers. Réputée, notamment auprès du public, pour être une des représentantes les plus significatives de la forme classique -avec ce que cela implique de préjudiciable du point de vue de la critique- Agatha Christie a néanmoins contribué à offrir au genre policier des perspectives de réflexion métalittéraire, jusque-là insoupçonnées.
De nombreux autres romanciers anglo-saxons contemporains d’Agatha Christie s’essayèrent et se spécialisèrent, la plupart du temps, dans le roman d’énigme, parmi lesquels les Anglais Dorothy L. Sayers (1893-1957), Anthony Berkeley (1893-1971) ou encore l’Américain John Dickson Carr (1906-1977).
Le « phénomène policier », particulièrement sensible au début du siècle dans la littérature anglo-saxonne, s’est également distingué en France. Comme nous venons de l’évoquer, Agatha Christie s’est notamment inspirée d’un écrivain français, Gaston Leroux, auteur, entre autres, d’un grand classique de la littérature policière intitulé Le Mystère de la chambre jaune (1907), qui inaugure les aventures du reporter Joseph Rouletabille, résolvant les mystères les plus insensés à force de raisonnement, de logique, de méfiance à l’égard des apparences et d’intuition. Certains critiques[24] ont apparenté Rouletabille à Arsène Lupin, créature de Maurice Leblanc qui publie ses aventures sous forme de feuilleton à partir de 1905, dans le Strand Magazine. Arsène Lupin, « gentleman cambrioleur », bandit au bon cœur, se situant du côté des faibles et se jouant des institutions, a connu un succès retentissant auprès du public. Sa capacité à résoudre les mystères les plus complexes à la manière des grands détectives, héros des feuilletons de l’époque, a fait de lui une autre figure marquante de la littérature populaire de ce début de siècle.
Malgré ces cas isolés, et contrairement au phénomène vécu en Grande-Bretagne, la littérature policière ne perce pas encore véritablement sur le sol français. Il faut, en fait, attendre 1927 et la naissance de la collection « Le Masque » qui se spécialise -et à sa suite de nombreuses autres nouvelles collections- dans la traduction de romans d’énigme anglo-américains. Notons, par ailleurs qu’Albert Pigasse, instigateur du « Masque », est également à l’origine de la création, en 1930, du prix du roman d’aventures, qui donne notamment naissance au roman d’espionnage sous la plume de Jean Bommart et Pierre Nord[25].
Selon Francis Lacassin, la naissance du roman policier classique, en France, correspond à une volonté de créer un genre transposant l’univers du roman bourgeois dans un registre mineur, permettant de contrebalancer le triomphe du roman psychologique propulsé par Marcel Proust ou André Gide :
« Le
roman policier, devenu la récréation du roman psychologique ou divertissement
cérébral, prend l’allure d’un puzzle brouillé que rétablit, par pur
dilettantisme, un enquêteur génial ou distingué mais toujours pontifiant. C’est
le règne du “roman-problème” dont le pont aux ânes est le crime en local
clos. »[26]
Il existe donc bien une raison littéraire à la naissance du genre policier qui peut, au demeurant, paraître ambivalente. En se situant en porte-à-faux par rapport au roman psychologique ou de manière plus générale au roman traditionnel balzacien, le genre policier signe une certaine forme de renouveau susceptible de lui assurer une réception favorable ; mais en associant dès le départ cette modernité à la simplicité et à la sérialité du schéma narratif, la critique a fait de cette singularité une marginalité, ce que Uri Eisenzweig explique en ces termes :
« C’est
donc dans la mesure même où le roman policier consiste en une forme narrative strictement codifiée
(encore qu’impossible) s’opposant quasiment en tous points à celle du roman
réaliste “conventionnel”, que s’expliquent tant l’émergence soudaine que le
caractère si intensément négatif de la perception du genre, dès lors que
commence à vaciller la représentation positiviste du monde. »[27]
Il ajoute :
« Avec
le début de la crise du roman balzacien (ou dickensien), la forme narrative
policière, forme impossible, est littéralement inventée par le discours critique traditionnel et brandie par lui
comme une sorte d’antithèse idéale. Face à toutes les tentatives et, surtout,
tentations romanesques nouvelles, la littérature policière, définie comme genre et donc a priori comme non artistique, présente au public bourgeois une
image quasi caricaturale de ce qui est à rejeter -et par contrecoup, lui
indique ce qui est à préserver. »[28]
Dès sa naissance, le roman policier est donc devenu une entité à part, un genre entre-deux, comme le souligne encore Jacques Dubois :
« Le roman policier a occupé très tôt une région de la sphère littéraire que l’on peut qualifier de moyenne ou d’intermédiaire. Survenant dans la seconde moitié du siècle, il a même pris place entre ces deux “blocs” étanches que constituaient alors la production lettrée et la production populaire, atténuant quelque peu le hiatus qui existait entre eux. »[29]
Selon J. Dubois, c’est précisément cette situation qui est censée permettre à la littérature populaire, de « remédier à son déclassement »[30]. En fait, le récit de détection, et de manière générale la littérature populaire, ne seront jamais véritablement et totalement reclassés, encore moins surclassés, par la critique, et ce, en dépit de leur succès auprès du public ; nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement.
1.1.2- Le tournant des années 1930
La fin des années 1920 et le début des années 1930 marquent un tournant dans l’histoire du genre policier, notamment avec l’apparition du roman hard-boiled aux côtés du roman d’énigme traditionnel. Cette nouvelle vague, qui va révolutionner l’univers du roman policier classique, se forme dès 1920 aux Etats-Unis, avec la création du mensuel Black Mask à l’initiative de deux intellectuels américains notoires, H.L. Mencken et G.J. Nathan, dans le but de réunir les fonds nécessaires au financement de leur revue luxueuse et brillante intitulée Smart Set[31]. Les pulps magazine, dont Black Mask est le modèle et qui doivent leur nom à la mauvaise qualité du papier qui servait à leur impression, connaissent véritablement leur heure de gloire avec Dashiell Hammett, à partir de 1926.
Avant l’apparition des pulps, le récit policier avait, notons-le, déjà fait son apparition dans la littérature américaine notamment avec les dime novels, fascicules populaires à bon marché. Les premiers personnages de détectives urbains y apparurent dès 1860, mais il faudra attendre 1886 pour que le plus célèbre d’entre eux, Nick Carter, détective new-yorkais, fasse son entrée sous la plume de John Russell Coryell, dans le New-York Weekly qui devint le Nick Carter Stories, puis le Detective Story Magazine, premier pulp policier[32].
Le roman hard-boiled, littéralement « dur à cuire », est l’ancêtre d’un genre que nous appelons aujourd’hui plus communément le « roman noir ». Carroll John Daly crée le premier véritable « privé dur-à-cuire » (hard-boiled dick), Race Williams, dans le magazine Black Mask, mais c’est avec les enquêtes de l’anonyme Continental Op, puis (à partir de 1929) de Sam Spade, tous deux personnages de Dashiell Hammett, que le genre parvient à s’épanouir. Selon Francis Lacassin :
« La contribution de Hammett va bien
au-delà d’un renouvellement de la thématique, du personnel et du décor par le
biais d’une optique réaliste. Mérite plus important, il a renouvelé les
structures narratives du roman policier. Au roman du discours tel que l’ont
pratiqué Agatha Christie ou Van Dine, il oppose le roman du regard avec toutes
les conséquences qui en découlent. […] Bannissant la réflexion, l’analyse, le
commentaire qui s’exprimaient par le discours, il réduit la parole à des
dialogues brefs et incisifs, et retient surtout le mouvement ou le geste.
Hammett ne sollicite pas l’intelligence du lecteur, mais ses nerfs ou ses
tripes, il néglige la perception au profit de la sensation. […] Les personnages
ne se définissent plus par une psychologie, des connaissances, un caractère
dont l’auteur ne dit rien, mais par ce qui tombe sous le regard, ou accroche le
regard : particularités physiques, signalées dès la première
apparition. »[33]
Contrairement au roman policier classique anglais ou français de l’époque, le hard-boiled intensifie l’action, vivifie le déroulement de l’intrigue, se construit autour de dialogues percutants qui participent véritablement de l’action. Le temps n’est plus à la réflexion, à l’examen interminable des indices, à la méditation ; le temps est à l’action. Le roman gagne à la fois en réalisme, noirceur, amertume, cynisme et en dynamisme ; dynamisme véhiculé par un style percutant, des personnages secondaires marquants -beautés fatales, gangsters redoutables entre autres- et une volonté d’inscrire le genre dans un registre nouveau : l’humour, noir, nonchalant, grinçant. L’humour est ici essentiellement le fait du personnage central : le Privé.
Dans le roman noir pratiqué par D. Hammett, mais également par Raymond Chandler -second père du roman noir, qui a également publié dans la revue Black Mask à partir de 1933-, le héros, le Private Eye, semble en fait posséder tous les traits d’un anti-héros et n’a en ce sens plus rien à voir avec le gentleman-détective mis en scène dans le roman d’énigme.
Désabusé, travaillant en marge des lois et souvent en mauvais termes avec la police, parfois brutal et colérique, adepte du tabac et de l’alcool, le Privé fait néanmoins figure de chevalier solitaire, luttant contre le Mal dans un monde gangrené par le crime organisé. Car si le Privé fait figure de marginal bourru dans l’univers dépeint par D. Hammett ou R. Chandler, c’est que le monde va mal.
Philip Marlowe, qui apparaît pour la première fois en 1939, dans le roman intitulé Le Grand sommeil, incarne le détective privé sous sa forme définitive. En marge des lois et des institutions, mais du côté du Bien, Marlowe puise sa force dans une forme de cynisme aiguisant son sens critique tout en masquant une profonde sensibilité : sous ses airs de « dur à cuire », le Privé cache une bonté d’âme remarquable. Alors que le détective type du roman d’énigme paraît motivé essentiellement par son goût de l’énigme, par cette forme de jeu intellectuel dans lequel l’entraîne le mystère du crime, le détective de roman noir semble agir par compassion. Cette perspective est particulièrement sensible chez Marlowe, comme le souligne Francis Lacassin :
« L’insolence, chez Marlowe, recouvre la critique sociale. Celle-ci révèle en lui un homme différent de celui dont il feint l’apparence. Un être exquis comme il s’en trouve peu dans l’univers grisâtre et désabusé du roman noir. Pour le découvrir, il faut percer l’écorce de raillerie, de cynisme, de désinvolture dont il protège sa vraie personnalité : sensible, généreuse, inquiète. En se donnant des airs de dur, il laisse volontiers croire qu’il travaille pour gagner sa vie. En réalité, c’est pour porter secours. Il lui arrive souvent de travailler pour moins de “vingt-cinq dollars par jours plus les frais”, et même pour rien du tout. » [34]
Il ajoute:
« Marlowe est un sentimental. Incapable de résister à la détresse d’autrui, il ne peut s’empêcher d’en assumer sa part. […] Sensibilité aux problèmes d’autrui, émotion devant la mort ; deux attitudes à contre-courant des usages du roman noir. Elles ont pour clef la solitude. Celle de Marlowe, celle des incompris qui le touchent. » [35]
Raymond Chandler a donc apporté au roman noir, inauguré par Dashiell Hammett, une touche d’humanité supplémentaire, cette perspective touchante qui a sans doute fortement contribué à l’attachement du public pour le Privé et qui en a fait la figure mythique qu’il est rapidement devenu et qu’il demeure encore aujourd’hui.
Plus que d’une évolution motivée par un enjeu purement littéraire, le hard-boiled doit sa naissance à de profondes mutations au sein de la société américaine, et notamment à l’avènement de la Mafia et du crime organisé. Le crime froid et calculé du roman d’énigme se fait ici plus sombre, plus sanglant, plus réaliste. La violence n’y est plus expliquée, elle y est vécue, comme le souligne Isabelle Boof-Vermesse :
« La différence entre la tradition anglaise -où le crime préexiste à l’action, le récit n’étant que la reconstruction d’évènements antérieurs à son propre départ- et le nouveau genre américain -qui aligne crime et détection, histoire et récit : le détective, devenu vulnérable, ne se contente plus de comprendre, de raconter, il agit, et désormais son action est placée sur la même séquence temporelle que celle du coupable- se situe précisément sur cette utilisation narrative de la violence, discutée et élucidée ici, vécue et subie là. »[36]
Avant de nous arrêter plus précisément sur l’aspect social du roman noir, nous souhaiterions nous intéresser quelques instants à un autre enquêteur célèbre, le commissaire Jules Maigret, contemporain de Spade et Marlowe et qui a vu le jour sur le sol français.
Maigret est né dans le Berry en 1887 ; il est le héros de cent deux romans ou nouvelles parus de février 1931 à juillet 1972, sous la plume de l’écrivain belge Georges Simenon. Bien que Maigret ne possède pas le statut de Privé, puisqu’il dépend de la police officielle, il nous paraît toutefois intéressant d’en dire quelques mots à la lumière des précisions apportées sur ses contemporains américains.
Il est à noter, en tout premier lieu que Maigret, comme les privés américains, ne recherche pas une vérité absolue ; l’énigme ne présente pour lui qu’un intérêt minime, secondaire. Ce qui intéresse n’est plus le comment, ni le qui mais le pourquoi. Francis Lacassin explique que Maigret se définit par :
« […]
son aptitude à comprendre l’autre jusqu’à assumer son comportement et
communiquer en silence avec lui, au-delà du langage, des gestes et des mots.
Cette attitude, Simenon l’attribue à l’instinct et Bergson l’appellerait
“faculté de sympathie” ; elle explique les réussites de ce policier pas
comme les autres et domine ce qu’il se refuse à appeler sa méthode. Il préfère
le mot d’approche : jusque dans la terminologie, il écarte la rigidité de
la règle au profit du contact humain. »[37]
De plus, comme dans les hard-boiled, la figure du détective est, chez G. Simenon, fortement individualisée. Maigret se singularise tout d’abord par son allure : physique imposant, inconditionnel de la pipe, manières gauches qui contribuent à lui conférer cette force tranquille qui fera son succès. Selon D. Fernandez Recatala, Maigret symbolise « une présence un peu lourde, presque pataude, une pipe, et une capacité d’écoute infinie. A peine un policier »[38].
Par ailleurs, tout en étant affilié à l’institution policière, Maigret s’en détache, notamment par sa façon non manichéenne de percevoir les choses, par sa manie de s’intéresser moins au crime qu’au criminel et à ses motivations. Comme les Privés américains, il se distingue donc de l’institution, mais contrairement à eux, cette distanciation se fait plus officieuse qu’officielle : elle concerne ses états d’âme et non sa situation professionnelle.
Par ailleurs, comme le souligne Uri Eisenzweig, « l’univers petit-bourgeois des enquêtes de Maigret est clairement aux antipodes de celui du “ruisseau hammettien”»[39] et le rythme des enquêtes menées par le commissaire de police n’est pas vraiment aussi soutenu que celui que tentent de véhiculer les romans noirs américains. Ainsi, selon Ernest Mandel :
« L’inspecteur Maigret est le plus ordinaire des petits-bourgeois, heureux de retrouver sa femme après une bonne journée de travail qui lui assure une bonne paie, quelqu’un que l’on n’imaginerait jamais allant avec une prostituée. »[40]
Entre la traduction des hard-boiled, dans la collection « Le Masque », et le succès de Maigret, apparenté par certains côtés à ses cousins américains, le roman noir commence à se faire une place en France dès les années 1930, aux côtés du roman d’énigme encore très populaire, mais il faudra véritablement attendre l’après-guerre pour que le public français s’y intéresse plus particulièrement.
1.1.3- La « Série noire » en France
La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans l’histoire du genre policier en France, pour des raisons évidentes, comme par exemple le besoin de nouveauté, alors que le public français est sevré depuis le début du siècle de romans d’énigme classiques, et consécutivement à un phénomène simple : la venue de soldats américains amateurs de hard-boiled sur le sol français. Dès 1945, Marcel Duhamel lance, pour les éditions Gallimard, la collection « Série noire » qui propose, dans un premier temps, les traductions de Dashiell Hammett, Raymond Chandler bien sûr, mais également Horace Mac Coy, James Hadley Chase, James Cain ou encore Peter Cheney. Cette orientation éditoriale est également choisie par les Presses de la Cité et marque la fin de la période d’efflorescence du roman d’énigme classique quelque peu essoufflé du point de vue de ses potentialités narratives et en décalage, de par son aspect ludique, par rapport au contexte socio-historique bouleversé de l’époque. Marc Lits précise :
« La violence du monde réel va pénétrer dans le roman par la porte qu’avait ouverte le “roman-jeu”. Ce dernier ayant mis l’accent sur le criminel, il suffira d’accentuer les traits plus durs de celui-ci. Le policier cessera aussi d’être un fonctionnaire de police ou un amateur éclairé de la noblesse ou de la bourgeoisie, la place sera prise par les détectives privés, plus ou moins honnêtes, plus ou moins violents, à l’image d’un monde où le Bien et le Mal ne sont plus très distincts et où les valeurs morales ont tendance à perdre de leur importance. Le roman policier va refléter cette évolution. »[41]
L’après-guerre signe donc l’émergence massive des détectives privés dans le paysage littéraire français, perspective déjà amorcée dès 1943 avec la naissance de Nestor Burma. Personnage créé par Léo Malet, dans le roman intitulé 120, rue de la Gare, Nestor Burma est le premier exemple français de Privé à l’américaine ; « détective qui met le mystère K.-O. », il est cynique, gouailleur, désinvolte, séducteur et il entretient de mauvais rapports avec la police officielle. Souvent victime du mauvais sort, mais ne s’avouant jamais vaincu, il symbolise le Privé dans toute sa splendeur, à la limite même de la parodie.
Parmi les écrivains américains publiés par M. Duhamel, un en particulier retient notre attention : il s’agit de Chester Himes, dont l’influence semble avoir été considérable sur la majorité des auteurs de notre corpus.
C’est au
début des années 1950 que Chester Himes, écrivain américain au passé mouvementé
-il est arrêté en 1928 pour vol de voiture et passe sept ans en prison-, décide
de tenter sa chance en Europe, encouragé par Marcel Duhamel qui, après avoir
déjà traduit un de ses romans (S’il
braille, lâche-le), lui ouvre les portes de la « Série noire ».
Chester
Himes a publié neuf romans dits noirs, mettant en scène les enquêteurs
Fossoyeur Jones et Ed Cercueil Johnson, deux policiers américains de
couleur, arpentant les rues de Harlem, pistolets à canon nickelé en main,
intraitables face aux crimes et véritablement terrifiants. Leurs enquêtes,
souvent teintées de délire, gravitent autour de multiples personnages,
« pommes »[42] ou
truands, et oscillent sans cesse entre gravité et grotesque, animées par des
dialogues se voulant réalistes au cœur de scènes parfois surréalistes. Ed
Cercueil et Fossoyeur Jones font figure de héros sans concession pour le crime,
terrorisant les malfrats, particulièrement habiles de leurs mains et de leurs
armes. Véritables nettoyeurs du crime, ils laissent la plupart du temps
derrière eux des scènes de désolation, n’offrant guère d’écart entre enquêteurs
et criminels ; une perspective que l’on retrouvera notamment chez Patrick
Chamoiseau. Avec Chester Himes, l’aspect sordide du roman noir prend tout son
sens quand l’histoire prend pour cadre le quartier de Harlem, comme le souligne
Francis Lacassin :
« Toute une faune de gueux et de médiocres, escrocs, mendiants, drogués, voleurs, putains, tricheurs, traînards, souteneurs, forçats et exploités... Pour la plupart ils n’ont rien à voler si ce n’est quelques rêves et autant d’illusions. Alors, ils passent le temps à s’entre-dérober des hardes sordides, des épaves inutiles, quelques dollars crasseux. Ils demandent l’oubli au sexe, à la drogue, au vol, à l’escroquerie, à la religion. Un décor qui s’écroule et se déglingue. Murs suintants d’humidité, escaliers pourris, réchauds puant le pétrole, draps sales, carreaux cassés, meubles fatigués. »[43]
Sur les traces de Burma et aux côtés des plus grands auteurs de romans noirs américains, Gallimard et les Presses de la Cité lancent différents auteurs français, dont Albert Simonin, José Giovanni, Auguste Le Breton, Jean Amila ou encore Michel Lebrun. D’autres éditions entrent à leur tour sur le marché, comme les éditions Fleuve noir qui créent la collection « Spécial police », consacrée à des auteurs français, dont le plus célèbre sera Frédéric Dard/San Antonio.
Tandis que Frédéric Dard diversifie sa production en écrivant différents thrillers et romans d’espionnage, San Antonio, son double et pseudonyme, se consacre aux aventures de son héros éponyme, qui connaîtront un succès retentissant alimenté par la truculence d’un style inoubliable. L’apport de San Antonio et de ses personnages -dont le célèbre et immonde Alexandre-Benoît Bérurier, dit « Béru » ou « le Gros » et sa Berthe, surnommée « la Gravosse »- au roman noir est considérable et significative en ce qu’elle lui a offert de nouvelles perspectives inspirées par la prédominance de l’humour et par le choix d’une forme d’argot remanié en guise de langue quasi officielle. Selon D. Fernandez Recatala :
« L’arrivée de l’abominable Bérurier marque un tournant décisif dans l’évolution du cycle : du roman noir standardisé, on passe peu à peu à un délire total, où se mêlent calembours pitoyables, considérations féroces sur le monde en général, insultes aux lecteurs, grossièretés d’une densité mallarméenne, le tout entassé de force dans le cadre d’une intrigue très vague qui n’en peut mais. »[44]
Avec San Antonio, le personnage et son langage prennent le pas sur l’intrigue et, plus fort encore, sur la narration même dont les codes sont littéralement bafoués, livrant le lecteur, désormais sans protection aux délires de l’auteur. Véritable dérive du roman policier classique, empruntant au roman noir son goût pour l’argot, le cynisme, l’humour noir et la dérision, le « style san antoniesque » fait voler en éclats toute perspective de norme générique, ce que suggère Sven Storell :
« Si
San-Antonio ne dévie donc pas du modèle classique de l’enquête policière
rigoureuse, il s’écarte de la norme générique en ce qui concerne les rôles
respectifs des trois éléments fondamentaux du roman policier : le criminel,
la victime, le détective. Ce dernier s’impose non pas uniquement comme tête
pensante, obsédé par l’élucidation de sa propre méthode, comme Sherlock Holmes,
mais comme Moi écrivant, pleinement conscient de l’acte d’écriture, se
permettant d’utiliser des procédés métanarratifs et métalinguistiques pour
souligner le caractère fictif de ses récits. Le ton de grosse blague, l’énorme
bonne humeur suscitée par le plaisir indéniable de la fabulation rompent
nettement l’illusion réaliste de la norme générique. »[45]
Or, ce regard porté sur la narration, cette mise en abyme du roman en train de se faire, marquent un moment déterminant dans l’histoire du roman policier, mais également dans l’histoire littéraire dans son ensemble. San Antonio a inspiré de nombreux écrivains qui lui ont succédé et son style plane sur de nombreux romans de notre corpus.
En marge du style singulier véhiculé par San Antonio, d’autres auteurs français, inspirés par l’avènement du roman noir en France, se sont essayés au genre policier en tentant d’en renouveler la forme. Parmi eux, les écrivains et essayistes Pierre Boileau et Thomas Narcejac.
Ces deux écrivains, qui ont choisi de s’unir au service du genre policier, ont publié de nombreux romans dans la collection « Crime-Club », créée en 1958 par l’éditeur Denoël, et ont, d’une certaine manière, remis au goût du jour le roman d’énigme en exploitant une de ses variantes les plus porteuses aux yeux du public : le suspense. D’autres se sont inscrits, à leur suite, dans le sillage du roman à suspense, tels Louis C. Thomas, Hubert Monteilhet, René Réouven ou encore Sébastien Japrisot. Jacques Dubois propose une définition du roman à suspense :
« Le
roman à suspense opère un déplacement si subtil qu’il ne semble plus
correspondre à un modèle stable. Au long du récit, le crime est encore à
commettre et l’on ne sait de qui il viendra ni qui il atteindra. Mais la menace
pèse, de plus en plus lourde, et l’attente du drame va croissant. En certains
cas, le roman est celui d’un suspect qui s’efforce d’échapper à l’accusation
pesant sur lui. »[46]
Malgré l’arrivée et le succès du roman noir, le genre policier classique, loin de disparaître, s’est diversifié, composant avec la nouveauté et exploitant d’autres variantes jusqu’à donner naissance à ce que l’on a pu appeler les « sous-genres de la littérature policière ». Sans reprendre cette expression et ce qu’elle peut véhiculer de jugement dépréciatif, nous parlerons plutôt de « variantes » du genre policier, parmi lesquelles le « polar », né de la rencontre du roman policier classique et du roman noir, dès la fin des années 1960. La révolution sociale de mai 1968 inspirera cette vague du polar sous la plume, entre autres, de A.D.G. -pseudonyme d’Alain Fournier qui a fait ses débuts à la « Série noire » en 1971, connu dans le milieu du polar tant par la qualité de son style que par son militantisme au Front national- ou de Jean-Patrick Manchette -également publié en 1971 dans la « Série noire » et engagé politiquement, mais cette fois-ci à l’extrême gauche. Inscrivant le polar dans un cadre politiquement et socialement clairement défini, ils vont insuffler la variante du « néo-polar », qui révèlera des auteurs comme Didier Daeninckx -auteur notamment, en 1984, de Meurtres pour mémoire qui revient sur le passé noir de la France en Algérie- ou Thierry Joncquet, tous deux adeptes du roman noir perçu comme reflet de la société.
Aujourd’hui encore, et peut-être plus que jamais, le roman policier et notamment ses variantes dites « noires » (roman noir, polar, néo-polar, etc.) demeurent vivaces précisément parce qu’elles s’inspirent de l’évolution, des mutations et des errements de la société contemporaine. Depuis l’apparition du roman noir dans les années 1930, la puissance de la branche sociale du genre policier n’a cessé de s’affirmer, contribuant vraisemblablement à la longévité du genre et à son inscription dans la modernité.
1.2- Le roman policier à l’écoute de la modernité
Comme le remarque à juste titre Jacques Dubois, « depuis plus d’un siècle, le policier n’a pas désarmé »[47] ; mieux, il n’a cessé d’évoluer, de s’adapter en se faisant notamment le reflet de l’évolution de la société. Miroir de la réalité, il a d’une certaine manière pu accompagner, tout au long du siècle, son lectorat et entretenir, de fait, avec lui une relation privilégiée et à certains égards interactive.
1.2.1- Un genre témoin de l’évolution sociale
Tandis que le roman policier classique répandu dans les années 1920 semble s’inscrire dans un hors-espace, hors-temps, favorisant la narration aux dépens du contexte, le roman noir tiré du hard-boiled trouve précisément son essence dans une forme d’ancrage dans la réalité, le contexte social n’agissant plus en tant que décor mais véritablement en tant que personnage. En effet, le roman policier classique semble totalement épuré de tout ce qui ne se déroule pas au sein de l’univers clos où s’inscrivent crime, enquête et résolution du mystère. La réalité n’y apparaît pas ; pire, elle est supplantée par l’utopie beaucoup plus séduisante aux yeux du lecteur. Yves Di Manno précise :
« Pris au piège de leurs fictions, les auteurs doivent séduire : le fond de toile de leurs spéculations sera de préférence un milieu social utopique et idéalisé. La petite ou moyenne bourgeoisie de la “bonne société” est à son tour le rêve du lecteur. »[48]
Il ajoute :
« Les
fictions d’Agatha Christie dégagent le respect de toutes les valeurs
bourgeoises libérales de l’Angleterre d’alors. Volontiers feutrée, l’atmosphère
qui y règne efface toute idée de désordre, de malheur social, à plus forte
raison de luttes. Quand la corruption pousse un membre de la bourgeoisie à
commettre des actes répréhensibles et préjudiciables, elle est toujours
présentée comme accidentelle, et noblement réprimée par la morale complaisante
dont Hercule Poirot est l’incarnation rêvée. »[49]
Cette platitude, cette conception épurée du monde est alors confrontée aux profonds bouleversements sociaux qui deviennent incontournables à partir des années 1930. Comme nous l’avons vu précédemment, c’est à cette époque que la réalité sociale américaine prend le pas, dans l’histoire du genre policier, sur « une Angleterre fin-de-siècle agonisante et mythifiée »[50] ; un phénomène qui se répand en France, dès les années 1930 et qui s’affirme encore après les évènements de mai 1968. C’est que, d’une part, le crime prend une nouvelle dimension au sein de la société et que, d’autre part, la société évoluant, les attentes de lecture se voient également modifiées.
Le meurtre calculé, voire intellectualisé, laisse alors place au crime organisé, commandité, au meurtre par intérêt, à la corruption sociale, parfois même politique. Désormais, le roman du crime ne peut plus faire abstraction de la recrudescence de violence qui caractérise la société de l’époque et, bien au contraire, il peut véritablement en faire son fond de commerce, proche en ce sens d’une approche médiatique du fait social. La réflexion de Claude Gaugain sur le sujet nous paraît tout à fait intéressante :
« La vraisemblance du roman policier américain repose toujours sur cette double légitimation, celle du réel et celle du livre et de l’écriture ; mais plutôt que de se référer à une tradition du genre pour assurer sa crédibilité, le roman policier américain cherche à cacher et naturaliser ses conventions sous les dehors d’une écriture de l’Actualité ; c’est aussi la Presse, les journaux qui sont l’horizon livresque du roman. Ainsi un roman à énigme anglais perd les contours et les coutures du réel en se référant à une mode rhétorique romanesque et livresque qui n’a pas su s’adapter face à un roman américain qui rend transparents les conventions et les personnages en les empruntant à la mouvance de la Presse, de l’actualité journalistique. » [51]
C’est véritablement dans cette écriture de l’actualité que le genre policier va se renouveler aux Etats-Unis et plus tard en Europe ; reconversion assurée par le soutien d’un public avide de faits divers, présentés -de manière alarmiste, au confort d’un lecteur épargné- comme récits de l’horreur d’un autre et d’un ailleurs. Alimenté, non plus par une imagination faillible, mais par une réalité riche en évènements stupéfiants, le roman policier « à l’américaine » se noircit alors, faisant de la Mafia et de la corruption ses nouveaux thèmes de prédilection : il ne s’agit plus de savoir qui a tué mais comment et dans quel but le corrompu ou le mafieux a fait tuer sa victime. Par voie de conséquence, le roman policier se fait, à partir de ce moment-là, roman du crime, genre-reflet d’une société en pleine mutation. Ernest Giddey précise :
« Avec le passage du roman policier classique au hard boiled novel, la présence de gangs devient plus fréquente. Quand l’énigme à résoudre renonce à être un divertissement de l’esprit pour refléter les problèmes existentiels du moment, le meurtre personnel cède la place au crime organisé, qui est perçu comme une des formes du combat économique. Les règles du jeu de société sont bousculées par les exigences du mal de société. Qui est le vrai coupable ? Pas nécessairement celui qui presse la gâchette. » [52]
Le criminel n’est désormais plus un être mystérieux, c’est un homme de main ; le détective cesse d’être un homme distingué de salon, il devient un roublard de la rue. La société est, quant à elle, corrompue, corruptrice et malfaisante, engendrant ses tares et ses folies. Le roman policier « à l’américaine » perd en raffinement pour gagner en réalisme et pour que le vraisemblable s’impose au fantasme, le roman policier va descendre dans la rue.
Or, dans la rue, le détective n’est plus en sécurité, il prend des coups et risque la mort à tout moment ; il n’est plus cette figure victime de sa matière grise, Sisyphe des temps modernes condamné à résoudre indéfiniment des énigmes, sorti du placard par son créateur à chaque nouveau crime mystérieux. Désormais il vit et son enquête se fait quête, comme le remarque Claude Gaugain :
« Dans la ville ouverte du roman noir, un détective cherche les pièces éparpillées d’un puzzle. Le manoir est le lieu où se poursuit une enquête, dans la ville le privé entreprend une quête qui l’entraîne dans une poursuite incertaine. »[53]
1.2.2- Un genre urbain
Avant les enquêtes de salons rendues célèbres notamment par Agatha Christie, le crime avait déjà fait son apparition dans la ville, dès les nouvelles d’Edgar Poe qui mettent en scène un Paris mystérieux, si ce n’est véritablement dangereux.
L’apparition d’une civilisation urbaine, et plus exactement d’une ville industrielle à la fin du XIXème siècle, constitue l’une des circonstances de la naissance du roman policier.
Le développement du commerce et de l’industrie va faire et défaire les fortunes, susciter les conflits d’intérêt, réduire des hommes au désespoir -suicidaire quand il n’est pas meurtrier-, donner naissance à des affrontements sans fin, engendrer des querelles dévastatrices : plus la ville se développe, plus le crime se répand. Or, la ville dispose de toute une palette d’accessoires et d’artifices assurant au roman du crime un renouvellement constant : gratte-ciels lugubres, ruelles sombres, entrepôts abandonnés, terrains vagues soumis à la grisaille, la pluie, le brouillard, les bruits, les odeurs étouffantes, et livrés en pâture aux financiers, politiques, désœuvrés et malfrats en tout genre ; autant d’éléments familiers du crime, qui lui sont propices et lui confèrent une quasi normalité. Avec l’industrialisation des villes, le crime a trouvé son lieu de prédilection et le roman un formidable lieu d’inspiration, particulièrement vivace encore aujourd’hui dans le genre policier et notamment au sein de sa variante dite « noire ».
Cette inspiration puisée dans les rues contribue notamment à modifier la langue romanesque traditionnellement véhiculée par le modèle classique. Avec la ville, l’argot et son lot de familiarités et de grossièretés font leur apparition dans le texte :
« A partir du moment où le roman policier
devient polar, dès que le texte installe la ville moderne au cœur du récit,
alors le style change : il devient hard
boiled (dur, dur-à-cuire), et impose son rythme sec, syncopé, haché, brutal.
Il est permis de voir là l’irruption de l’urbain dans l’écriture. Le lexique
s’ouvre à l’argot des bas-fonds qui, jusque là, ne servait qu’à faire couleur
locale. Le style se durcit : il évacue les périphrases, renie les
quartiers de noblesse du bien-parler pour aller tâter du langage des bas
quartiers. La phrase se tend : elle acquiert la vitesse, la grossièreté et
la redoutable efficacité des propos de la rue. La contemplation est remplacée
par l’action, et la temporalité paisible et lente des saisons et des jours par
le rythme saccadé et bruyant des villes. »[54]
L’heure est à la phrase courte, directe, sans détours : raison de plus pour que les politiciens à la « langue de bois » se retrouvent dans la ligne de mire. Avec le roman noir, les véritables parias de la ville ne sont plus les miséreux, les désœuvrés mais les puissants qui, calfeutrés dans leurs bureaux, ne connaissent finalement plus leur ville.
Le roman noir, roman du crime, se fait ainsi roman authentique et crédible de la ville, si bien que, comme l’indique Jean-François Vilar, « le roman noir nous apprend à lire une ville »[55].
D’une enquête sur un crime dans la ville, le roman policier glisse, en effet, vers la recherche du meurtrier de la ville. Devenue victime, la ville est alors sondée, autopsiée, ses habitants interrogés, suspectés ; le crime d’un individu se fait ainsi le prétexte à une véritable enquête sociale ; enquête attendue car la ville, immense et mystérieuse, ne cesse d’inquiéter :
« La
ville industrielle, gigantesque, anonyme, frénétique, qui fait se côtoyer
richesse et pauvreté, nouveautés et permanences, futur et passé, et qui semble
croître sans qu’à aucun moment une volonté humaine unique et clairement
consciente de ses buts ne paraisse diriger et ordonner ce développement, voilà
qui demeure encore un objet de stupéfaction et d’effroi pour un certain nombre
de nos contemporains. »[56]
Le roman noir se met alors en quête de révéler la ville. A l’obscurité du crime il oppose la lumière blafarde d’une enquête menée dans la fange, dans les vastes dessous de la ville, décrits en ces termes par Jean-Noël Blanc :
« La ville monte des profondeurs : sous la surface, un monde caché, creusé. Au-dessus, la ville policée, les mœurs pleines d’urbanité, les séductions, les illusions, puis, au-dessous, la ville réelle, la dureté, les luttes impitoyables, le drame. L’apparente plénitude urbaine recouvre des vides. Les évidences masquent des évidements. Le jour se change en nuit dans cette vie verticale qui perd ses certitudes et sa tranquillité parce que, dans ces failles souterraines, il se révèle que la ville a quelque chose à cacher. » [57]
De victime, la ville devient rapidement coupable, complice voire responsable de la dérive des hommes qu’elle accueille, qu’elle étouffe :
« La
ville écrase les personnages. Elle les enfonce. Jusqu’à des profondeurs sans
nom. Jusqu’au plus profond d’elle-même, là-bas en bas : au trente-sixième
dessous. Elle y entraîne les plus faibles. Elle les ensevelit. Alors se révèle
toute l’ampleur du piège. Le trou, la fosse. Car elle n’est pas lisse cette
ville. Elle est creusée. On y descend, on s’y débat, on peut s’y enterrer
irrémédiablement. »[58]
L’intrusion de la ville dans le récit opère donc un renversement radical dans l’histoire du genre. Tandis que l’enquête de salon naît dans l’obscur pour évoluer vers la clarté de la révélation finale, l’enquête urbaine part du crime pour s’enfoncer plus encore dans la noirceur, la violence, l’insécurité ; autant de perspectives qui ont fait et font encore recette auprès du public. Car, outre l’intérêt sociologique que présente le genre, en se faisant le roman de la ville, la perspective de l’effet de mode n’est pas négligeable dans l’explication du succès du roman policier et de sa variante noire, notamment dans les sociétés occidentales.
S’inspirant de la réalité et de ses mutations, le roman policier se révèle être en constante évolution, détenteur, dans le même temps, d’une certaine modernité renforcée, qui plus est, par la mise en valeur de quelques attributs prisés par l’effet de mode qu’ils véhiculent immanquablement.
1.2.3- Un genre réactif à l’effet de mode
Le genre policier, ainsi que ses différentes variantes, doivent en partie leur succès aux valeurs qu’ils véhiculent : traque du secret, voyeurisme, suspense, happy-end, ludisme et évasion pour sa version la plus classique ; vivacité, action, dénonciation sociale, crudité, violence pour sa branche la plus noire ; ou encore secrets d’Etat, patriotisme, héroïsme pour la variante développée dans le roman d’espionnage ; autant d’éléments « accrocheurs » et recherchés par des lecteurs, à la fois acteurs et spectateurs d’une société qui parfois les dépasse. Notons en outre que le genre policier, dans sa globalité, est réputé pour être de lecture facile et rapide, autrement dit, particulièrement productif :
« Le
genre [policier] se conforme à l’esprit du capitalisme libéral en exprimant et
véhiculant une certaine conception de la productivité. La formule du roman
d’enquête introduit sur le marché un type de récit voué à une
production-consommation aussi rapide qu’efficace. »[59]
Tout à fait en adéquation avec la société de consommation moderne, il prend des allures de produit jetable, à usage unique, vite oublié, vite remplacé. Il se montre, par ailleurs, tout à fait ouvert aux nouvelles technologies : criminels et enquêteurs disposent de moyens de plus en plus sophistiqués ; les lecteurs, quant à eux, peuvent même poursuivre leurs lectures sur Internet et participer à l’enquête interactive.
D’autre part, le principe même du genre policier consiste à « appuyer là où ça fait mal », à remuer le sordide, à puiser son essence dans ce que le fait divers contient de plus abject, en le vulgarisant. Le roman policier, version classique, « manichéise », simplifie et braque les projecteurs sur le Mal pour rehausser le Bien et ses adeptes. Le policier, version noire quant à lui, se fait plus confus, témoignant de l’impossibilité à distinguer le Bien du Mal dans une société où le crime semble généralisé ; l’introduction de l’humour lui permet néanmoins de dédramatiser la situation, afin de ne pas se faire trop noir. Par ailleurs, le sentiment d’insécurité urbaine qu’il véhicule attire un lecteur vraisemblablement en mal d’action et qui trouve peut-être dans la fiction policière cette excitation, née de la violence et véhiculée par d’autres fictions littéraires, cinématographiques et surtout télévisuelles, mais absente de sa propre vie. Le genre policier semble en fait alimenter ses lecteurs en sensationnalisme, comme une certaine presse peut le faire, et favoriser l’inquisition -notamment à la manière de la presse people, dont la particularité est de traquer les célébrités. Alain-Michel Boyer s’interroge :
« L’époque contemporaine verrait-elle dans l’intrigue policière, sous sa forme cinématographique aussi bien que littéraire, un miroir privilégié ? Le roman policier serait-il devenu, pour de larges parties du corps social, et pour beaucoup d’écrivains, ce que furent, jadis, certains des grands genres de l’ancienne rhétorique ? Ne rejoint-il pas, par bien des côtés, et à sa manière, quelques hantises de notre temps ? Ere du soupçon, figures de la quête et de l’errance, empire de l’énigme : derrière son discours fréquemment monosémique et dichotomique, derrière sa confiance dans les pouvoirs de la rationalité, sa recherche éperdue d’un sens, se glissent toute une série de clivages, de tensions, de questionnements, toute une logique de l’inquisition. »[60]
Le genre policier, qu’on le veuille ou qu’on le déplore, présente la particularité de distraire et de plaire en exploitant le filon de l’insécurité, en suscitant la peur, en se servant de cette forme d’excitation, de montée d’adrénaline, de stupéfaction qui s’empare de chacun de nous face à un spectacle horrible. Les éditeurs l’ont compris, de même que les metteurs en scène et directeurs de programmes télévisés.
Depuis les années 1970, les collections policières paraissent en grand format et sont même publiées, depuis quelques années, en grand format avant une éventuelle édition en format de poche. Ce changement paraît tenir davantage à une raison économique -le grand format peut être trois à cinq fois plus coûteux que le format de poche- qu’à une véritable revalorisation du genre, d’un point de vue littéraire car, comme le soulignent P. Boileau et T. Narcejac, le roman policier présente des atouts commerciaux non négligeables :
« Le roman policier se prête, plus que tout autre genre, à une vaste diffusion, pour des raisons évidentes : il est en quelque sorte organisé pour provoquer, chez le lecteur, curiosité et tension. Il procure donc une puissante distraction. Or, la distraction est quelque chose qui peut faire l’objet d’un commerce. C’est pourquoi, dès l’origine, apparaît un marché florissant du livre policier. »[61]
Ce succès s’avère être particulièrement marqué dans les sociétés occidentales qui comptent bon nombre de polars parmi leurs best-sellers. La sortie de certains ouvrages provoque des pics de vente impressionnants dans les librairies. Christine Ferniot[62] rapporte, par exemple, qu’un roman d’Andrea Camilleri a été vendu en Italie à deux cent mille exemplaires en cinq jours : autant dire que le polar se révèle être une véritable manne financière, d’autant qu’il est consommé avec avidité par des lecteurs en manque. Ainsi, selon Claude Murcia, le roman policier est lu comme une drogue est consommée, autrement dit à la suite d’une sensation de manque :
« Comme l’explique J. Dubois, le dévoilement implique la banalisation du sens, qui n’est précieux que tant qu’il est secret. De là le désir de lecture d’un autre roman policier, qui permettra le renouvellement d’une tension équivalente, à son tour libérée par la nécessaire et appauvrissante clôture du dénouement. Une clôture qui engendrera à nouveau le manque, dans un enchaînement sans fin de lectures successives mettant en évidence ce mécanisme de compulsion répétitive, spécifique de la relation du lecteur au récit policier, qui explique la nature sérielle tant de la production que de la lecture de ce genre de roman. »[63]
Avec un tel succès, il eût paru étrange que le cinéma et la télévision ne s’en mêlassent pas. Remarquons tout d’abord que le roman policier et les pratiques audiovisuelles sont intrinsèquement liés. En effet, si le succès et la popularité de certains détectives se sont faits aussi retentissants, c’est également du fait de leur passage sur le grand puis le petit écran. Sam Spade et Philip Marlowe laissent ainsi une empreinte quasi mythique, auprès du public littéraire et cinématographique, aidés en cela par l’interprétation mémorable de quelques grandes figures hollywoodiennes, dont notamment Humphrey Bogart. De la même manière, Jean Gabin ou Michel Simon participeront de la popularité du Commissaire Maigret en interprétant son rôle au cinéma, tandis que Jean Richard le portera sur le petit écran, pendant vingt-trois ans, devant des millions de téléspectateurs.
Le caractère héroïque des personnages et la sérialité du genre contribuent fortement au succès de la forme policière sur les écrans, d’autant qu’une fois encore, elle semble répondre parfaitement aux préoccupations du moment, en faisant du crime et de la violence ses vecteurs essentiels.
La série policière occupe aujourd’hui une grande part dans le paysage télévisuel français, favorisé dès 1975 par l’éclatement de l’ORTF et l’arrivée de chaînes commerciales, du satellite et du câble sur le marché. Ce phénomène a son intérêt dans notre étude : rappelons en effet que les téléspectateurs maghrébins et antillais n’ignorent rien ou peu de choses du paysage télévisuel français -lui-même marqué par la production américaine-, et ce, grâce à la technologie câblée particulièrement répandue dans ces pays. Rien d’étonnant alors à ce qu’aux côtés des références traditionnelles (Sherlock Holmes, Philip Marlowe, le commissaire Maigret, San-A. ou Hercule Poirot) apparaissent, dans les textes de notre corpus, les noms de quelques-unes des figures policières célèbres du petit écran, parmi lesquelles le commissaire Navarro ou le lieutenant Columbo.
La série Navarro, créée par Tito Topin -lui-même auteur de romans policiers- et dont le personnage principal est incarné par Roger Hanin, sévit sur les écrans français et sur la chaîne T.F.1 en particulier depuis une quinzaine d’années. Le succès de cette série a suscité de nombreuses autres vocations à partir des années 1990, parmi lesquelles son pendant féminin Julie Lescaut -l’équation policier + féminin, autre valeur populaire du moment, garantissant doublement le succès.
Le lieutenant Columbo, issu de la télévision américaine -mais connu dans le monde entier puisque le propre de la série télévisée américaine est de se répandre au maximum hors de ses frontières- a, quant à lui, été créé dans les années 1970, par Richard Levinson et William Link. Figure marquante de la série policière, incarnée par l’acteur Peter Falk, Columbo se distingue de ses collègues par son air idiot, ses manières grossières et une allure singulière : vieil imperméable, cheveux en bataille, visage grimaçant, inséparable de son cigare, de sa Peugeot 404 et de son chien, citant, pour finir, sa femme à tout bout de champ ; une allure de « poire » qui fait sa force face à des adversaires qui, inévitablement, ne se méfient pas et le sous-estiment.
Le genre policier doit donc la modernité qui le caractérise à sa vivacité, son urbanité ainsi qu’à l’effet de mode qui accompagne son développement, notamment depuis la fin des années 1970. Genre calqué sur les mutations sociales, il suit l’évolution de l’histoire du crime et de la ville en même temps que les attentes du lecteur, s’assurant de ce fait une certaine pérennité.
Notons, par ailleurs, que si le succès du genre policier joue sans aucun doute d’un effet de mode, s’il bénéficie d’une tendance au sensationnalisme et s’il profite, d’une certaine manière, de l’impact de l’apport télévisuel -facteurs somme toute peu valorisants-, cela ne signifie pas que le genre policier est dépourvu de qualités. La popularité dont il jouit peut, certes, paraître malsaine à bien des égards ; elle ne doit pas entacher pour autant la qualité de certains grands textes policiers qui confirment que la culture populaire n’est pas à rejeter en bloc.
D’un point de vue commercial, le genre policier jouit de cette modernité ; d’un point de vue littéraire, cette forme d’adéquation avec les attentes du lectorat lui est fatale : un genre populaire et à succès commercial ne parvient pas, ou très difficilement, à jouir d’une totale considération.
Le genre policier, en dépit de sa popularité, de ses tours parfois faciles, de son style volontairement léger, de son caractère quelque peu racoleur, présente plus d’intérêt qu’il n’y paraît -même si comme tout genre littéraire, il n’a pas uniquement engendré des chef-d’œuvres. Sous sa simplicité apparente, il soulève des questionnements des plus intéressants, de par une structure souvent ambivalente.
2- Dualité de la fiction policière
La fiction policière traite d’évènements extraordinaires, effrayants, incroyables et globalement à l’opposé de la routine quotidienne pouvant éventuellement caractériser l’existence de ses plus fervents amateurs ; c’est là précisément ce qui détermine le caractère distrayant qui lui est généralement prêté. Or, l’objectif de la fiction policière consiste à capter d’emblée l’attention du lecteur ainsi qu’à maintenir son intérêt et son envie de poursuivre la lecture le plus rapidement possible ; il s’agit, en d’autres termes, d’impliquer intellectuellement et émotionnellement le lecteur dans l’intrigue qu’il découvre et qu’il sait néanmoins issue de l’imagination de l’auteur.
Objet de distraction en surface, la fiction policière relève, en coulisses, de la mise en place de procédés et de mécanismes complexes nécessitant une parfaite orchestration du scripteur contraint à maîtriser les multiples jeux et enjeux d’un genre répondant à la sérialité d’un schéma narratif et devant, de ce fait, assumer la transparence de son mode de fonctionnement ; une contrainte qu’il retourne finalement à son avantage en déroulant son récit à un double niveau, lui permettant à la fois d’embrasser pleinement et de se détacher du cadre fictionnel.
2.1- Jeux et enjeux d’une « fiction vraie »
Dans la mesure où le déroulement du récit coïncide avec celui de l’enquête, la réussite du premier se voit a priori constitutive de la qualité de la seconde : autrement dit pour que le récit séduise le lecteur, l’enquête doit nécessairement paraître crédible -ceci est particulièrement valable en ce qui concerne les romans s’inspirant du whodunit. La réussite de la fiction dépend ainsi de sa vraisemblance et, en un sens, de l’équilibre que le récit parvient à maintenir entre le caractère fictif de l’intrigue et le réalisme de l’enquête constitutif de l’agencement du récit. Conjuguant de concert déroulement de l’intrigue et fonctionnement du récit, la fiction policière favorise une certaine forme d’interactivité entre le texte et le réel, proposant finalement différents niveaux interprétatifs.
2.1.1- Effets de réel et fiction
Le roman policier puise toute sa crédibilité dans le mécanisme de l’enquête : pour que le roman soit réussi, l’enquête doit se montrer efficace, procéder par logique et se faire le réceptacle de toute la puissance intellectuelle de l’enquêteur. Ceci est particulièrement vrai dans la forme classique du genre.
La première des conditions requises réside en ce que l’enquêteur doit paraître crédible ; il n’est pas un simple personnage, il est une tête pensante qui, à la seule force de sa réflexion fait avancer l’enquête, et par là même le roman. L’enquêteur de roman policier classique nous paraît, de ce fait, presque vivant d’autant qu’il est en général affublé de caractéristiques physiques et psychologiques marquantes. Ernest Giddey en fait état, en ce qui concerne Sherlock Holmes :
« Physiquement aussi bien que par ses aptitudes morales et mentales, Holmes est doté de signes distinctifs qui le rendent crédibles : sa pipe, sa loupe, sa casquette, sa passion pour le violon, ses rêveries, ses moments d’abattement, la lucidité de son sens de l’observation, la rigueur de ses déductions… L’adresse précise qui est la sienne à Londres et la netteté méthodique qui préside à la description du mobilier de sa demeure concourent à lui donner une consistance qui est celle des êtres de la vie quotidienne. Quittant la fiction, il entre dans l’histoire. »[64]
D’autres enquêteurs sont soumis à ce genre de caractérisation : Hercule Poirot et ses moustaches lissées, son costume tiré à quatre épingle et ses fameuses cellules grises ; Maigret et sa pipe ou encore Marlowe et ses vingt-cinq dollars par jour, son whisky et son humour désinvolte ; autant de détails, de manies, de traits de caractère qui contribuent à familiariser le lecteur avec ces personnages qui en deviennent, à ses yeux, presque « vivants ». Ces différents artifices, relevant à certains égards du déguisement, participent paradoxalement de l’effet de réel dont semble jouir le roman policier ; un genre qui, selon P. Boileau et T. Narcejac, s’apparente en un sens à une « fiction vraie » :
« Le
roman policier se présente comme une fiction
vraie. Il emprunte à la fiction ses protagonistes, ses décors, voire même
ses passions ; mais il est vrai par sa méthode, puisque cette méthode ne
doit rien à l’imagination, puisqu’elle est identique à celle du savant. »[65]
Ils ajoutent :
« Par conséquent, lorsque le romancier invente une histoire, cette histoire, purement imaginaire, devient un vrai fait divers par la vertu du raisonnement. »[66]
Chaque enquêteur dispose donc d’une méthode : il s’agit d’observer, de déduire, d’induire et de raisonner, pour enfin conclure, preuves à l’appui, alliant quête empirique et quête logique. Comme le souligne André Peyronie[67], le détective est à la fois celui qui voit et celui qui sait voir en contournant les illusions du monde sensible.
Existant au sein de la fiction au travers d’une méthodologie qui « ne doit rien à l’imagination », l’enquêteur semble disposer d’un statut quelque peu ambigu, le situant d’une certaine manière entre fiction et réalité. Il est en ce sens au cœur d’une problématique paradoxale à bien des égards.
Ainsi, plus les méthodes de l’enquêteur paraissent « vraies », plus sa démarche paraît scientifique, vérifiable, concrète et en prise avec la réalité et plus il a de chances d’être véritablement reconnu au sein de la fiction policière. De même, c’est au moment où sa manière de procéder paraît la plus convaincante, c’est-à-dire au moment où ses suppositions se vérifient, qu’il use au mieux des avantages et des opportunités que lui offre la fiction. Ainsi, fier de la qualité de son raisonnement, il ne manque généralement pas de théâtraliser l’exposition de ses conclusions et de se prendre par là même au jeu de la représentation. Au terme de son enquête et donc du roman, l’enquêteur convoque en ce sens les différents personnages et leur ôte leur masque respectif publiquement, en prenant soin de garder le meilleur -la révélation du nom du coupable- pour la fin. Or, accaparant et orchestrant le terme du récit, l’enquêteur donne finalement l’impression de prendre une certaine indépendance vis-à-vis de l’organisation narrative et d’échapper, d’une certaine manière, à la soumission et à la passivité du personnage de fiction, simple automate du scripteur. Imprimant au récit, soumis au déroulement de l’enquête, sa ligne directrice et disposant traditionnellement de l’organisation du terme du récit, l’enquêteur semble donc pouvoir aspirer à une certaine liberté à l’égard des contingences imposées par la fiction romanesque et cette prise d’indépendance s’exprime parfois de manière relativement explicite au sein même du récit. Le regard que porte l’enquêteur sur son propre rôle participe notamment de cette démarche.
Ainsi, dans le roman intitulé La Grande fenêtre, Marlowe ironise par exemple sur ses méthodes de parfait détective de roman policier -après que l’un des personnages ait souligné cette singulière parenté :
« Je
prends les faits séparément, je les réunis avec précision et exactitude, j’y
glisse deux ou trois petits tuyaux de mon cru que j’ai en réserve dans ma
poche-révolver, je dissèque les mobiles et les personnages, je les fais
apparaître sous un jour tout nouveau qui, jusqu’à présent avait échappé à tous,
aussi bien qu’à moi-même d’ailleurs, et finalement j’abats une main vengeresse
sur le plus inattendu des suspects. »[68]
Bien qu’usant des poings et des menaces pour faire surgir de nouvelles pistes, vérifier les alibis et obtenir quelques tuyaux et en dépit du fait qu’il circule en marge des lois, le détective de roman noir n’est pas pour autant dispensé d’avoir recours au raisonnement logique pour faire aboutir son enquête. C’est sur cette soumission au code que Marlowe ironise, semblant clamer dans le même temps qu’il n’est pas dupe : il est peut-être un personnage de roman policier, subséquemment soumis au respect de certains codes, mais il a le mérite de le mettre au jour. Cette mise en abyme du personnage signe l’innovation de l’écriture de R. Chandler et souligne le potentiel méta-discursif du genre.
Il apparaît donc que la fiction policière ne cesse de s’affirmer et de se perfectionner en tant que telle, tout en multipliant les effets de réel et les réflexions méta-discursives susceptibles d’offrir différentes issues possibles à la structure traditionnellement close sur elle-même qui caractérise la fiction romanesque.
Cette forme d’oscillation permanente entre fiction et réalité paraît, en outre, d’autant plus prégnante qu’elle participe de certains effets de lecture produits notamment par l’implication émotionnelle du lecteur vis-à-vis de la tension véhiculée par l’intrigue, en particulier si le roman est « réussi », c’est-à-dire notamment s’il parvient à maintenir le suspense.
Bien que le lecteur ait conscience, à la lecture d’un roman policier, que l’intrigue qui lui est livrée n’est que le fruit de l’imagination du scripteur -sauf mention contraire dans le paratexte par exemple- et que quelles que soient la violence et l’horreur des scènes décrites, il n’a personnellement rien à craindre, il n’est pas rare que l’angoisse ou la peur ne vienne néanmoins accompagner, voire conditionner, sa lecture. Ainsi, la confrontation physique avec la mort, symbolisée par la découverte d’un cadavre à l’ouverture du récit, n’est pas sans susciter quelques frissons chez le lecteur, aidé en cela par quelques effets savamment distillés par le scripteur -effets d’attente, d’ellipse, voire de paralipse, à la manière des procédés choisis par A. Rimbaud, dans son poème Le Dormeur du Val, par exemple. Or, tout en tentant d’impliquer émotionnellement le lecteur, remarquons que la fiction policière procède parallèlement à une dédramatisation de la mort.
En effet, nous avons vu précédemment que l’observation de la réalité avait contribué à l’épanouissement du genre policier qui avait progressivement glissé d’un motif purement littéraire à de véritables perspectives sociologiques. S’inspirant de la criminalité urbaine, le genre policier a pu ainsi transformer le fait divers en fait littéraire, offrant à son texte une caution réaliste tout en transposant la réalité à un univers totalement fictif, l’acte d’écriture supplantant le simple acte narratif, propre au reportage ou à l’article de presse par exemple. Cette transposition de la réalité dans le roman s’accompagne, en ce qui concerne le genre policier, d’une certaine dédramatisation de l’horreur.
En révélant le crime et ses motifs, l’enquêteur contribue à réparer la faute ou du moins à en gommer l’aspect exceptionnel. Contrairement au crime qui n’occupe que quelques pages de l’incipit, quand il n’est pas éludé ne laissant sur son passage que la découverte d’un cadavre, l’enquête peut quasiment jouir du roman entier pour exister et prédominer : avec la résolution finale, c’est l’enquête qui devient véritablement remarquable et qui fait, d’une certaine manière, disparaître le crime. Cette disproportion textuelle indique que si le roman policier gravite autour du crime, l’approche de la mort y est paradoxalement dédramatisée, comme le souligne Ernest Mandel :
« La mort -le meurtre surtout- est au centre du roman policier. Il est rare de ne pas y trouver une mort violente […]. Mais, dans le roman policier, la mort n’est pas traitée comme un élément central de la destinée humaine ou comme une tragédie. Elle y devient un objet d’enquête. On ne la vit pas, on n’en souffre pas, on ne la craint pas, on ne la combat pas. Elle devient un cadavre à disséquer, un objet à analyser. La réification de la mort est au cœur même du roman policier. »[69]
La mort n’est pas considérée, dans le genre policier, comme le point final de la vie, mais comme le commencement du récit. Aussi horrible qu’elle puisse paraître, elle n’est que le catalyseur du « train-train » de l’enquête. Jacques Dubois précise :
« Généralement on verse peu de larmes sur le sort de la Victime. Ses proches, l’auteur, le lecteur ne se complaisent pas au deuil et n’ont qu’une impatience : passer au plus vite à l’enquête. La mort y gagne une certaine légèreté, le meurtre y prend (provisoirement) un caractère accidentel : passages obligés, sans plus, vers l’ouverture du récit même. »[70]
Cette forme de dédramatisation de la mort concerne en premier lieu la forme classique du genre où l’enquête révèle certains enjeux ludiques, mais elle participe également du roman noir, et ce, bien qu’il y soit souvent question de rendre compte de situations tragiques trouvant écho dans la réalité.
Ainsi, lorsque Fossoyeur Jones et Ed Cercueil enquêtent dans les rues de Harlem, le lecteur ne peut ignorer la misère et le désespoir qui y ont régné effectivement durant de nombreuses années. Cependant, sous le coup de la fiction, de la caractérisation poussée à l’extrême des personnages qui font davantage figures d’acteurs que de personnes et du délire qui semble parfois s’emparer de l’imagination de l’auteur, le lecteur parvient à traverser la fiction sans vraiment s’émouvoir de la sordidité des rues de Harlem, certainement plus sensible à l’humour noir, au cynisme et au caractère loufoque de certaines scènes -après tout, il ne lit qu’un polar. La détermination du cadre générique semble ici privilégier le caractère fictif du récit qui parvient à s’approprier la réalité à laquelle il se réfère. Transposé au récit policier, le contexte référentiel, pourtant prégnant dans la variante noire du genre notamment, se laisse ainsi totalement submerger par la fiction, si bien qu’il finit par en subir de profondes transformations, voire altérations. Remarquons, en ce sens, que la lecture d’une fiction peut avoir certaines répercussions sur la perception du lecteur et ceci est notamment bien illustré dans le cadre de la fiction policière où le lecteur est soumis à une représentation de la réalité pas nécessairement juste mais à laquelle il est tenté d’adhérer, influencé en cela par le pouvoir que semble exercer sur lui le personnage central du récit, à savoir l’enquêteur. Plus l’enquêteur aura l’air réel et plus le lecteur sera tenté d’avaliser la représentation de la réalité que la fiction lui proposera.
En effet, quel que soit le mode narratif utilisé, la voix qui prime dans la fiction policière est nécessairement celle de l’enquêteur. Il est celui qui lance les pistes, l’éclaireur du récit, le point de référence du lecteur, particulièrement dans la forme classique du genre. Son jugement est capital et le lecteur adhère en général à son opinion. S’il ne lui voue pas une totale confiance ou s’il hésite à se ranger à son jugement, comme c’est parfois le cas dans le roman noir qui présente la particularité de mettre en scène des enquêteurs imparfaits, le lecteur est néanmoins inévitablement marqué par l’opinion émanant de la voix centrale du roman. Ainsi, lorsque le détective fait une description du cadre dans lequel il évolue, sa ville par exemple, le lecteur imagine aussitôt l’endroit tel que décrit, même s’il connaît personnellement le lieu en question ; influence d’autant plus marquée que l’enquêteur, de par le caractère sériel du genre, est un habitué, presque un proche auquel le lecteur accorde immanquablement une certaine sympathie. Ainsi, selon François Rivière :
« La
fiction s’origine précisément en cet instant précis où l’on choisit, en totale
complicité avec l’auteur du roman ou du conte, de jouer sans retenue avec les éléments structurels et archétypiques
du récit proposé, et ce faisant de donner au projet romanesque la coloration
d’une dimension nouvelle, affectée mais donnée sans cesse pour vraie, jusque
dans ses moindres détails. Londres préexistait à Sherlock Holmes ; ce qui
a changé c’est notre regard, devenu celui de la fiction-Holmes. »[71]
C’est ainsi que le roman policier parvient à superposer à la réalité son propre univers auquel le lecteur veut bien croire, tout en demeurant conscient de la facticité du tableau dépeint :
« L’archétype
de la fiction policière revêt une existence qui peut parfois frôler le vertige.
[…] Il use à un degré tel de son impossibilité à exister réellement,
c’est-à-dire dans le réalisme quotidien où s’origine le roman psychologique,
qu’il en arrive à créer sa propre vie dans cet univers parallèle qui se
superpose à l’autre, rendu d’autant plus vraisemblable (c’est-à-dire
cathartique encore) qu’il est fabriqué de toutes pièces, faux pour le plaisir,
inouï d’être faux. »[72]
Convaincant, populaire, accessible à tous et susceptible de transmettre d’éventuels messages subliminaux en jouant sur cette interaction de la réalité et de la fiction, le genre policier ferait, en un sens, un formidable outil de propagande. Il a d’ailleurs fait ses preuves dans la sphère politique, comme le suggère l’aspect gauchisant de certains polars français, notamment depuis les années 1990, avec, entre autres, la naissance de la collection intitulée « Le Poulpe » à l’initiative de Jean-Bernard Pouy et dans la perspective de fond de lutter contre les dérives fascisantes du Front National en France. Cette perspective propagandiste a pu, par ailleurs, être poussée à l’extrême avec l’exploitation, au sein du roman d’espionnage, de thèmes propices à ce genre d’approche, tels que le patriotisme et la haine de l’Autre, de l’étranger autrement dit du terroriste ou de l’espion potentiels. Notons que si le roman d’espionnage est aujourd’hui démodé, ses principes de fonctionnement demeurent vivaces, au point que l’on pourrait être en droit de s’interroger sur le degré de paternité du genre dans l’approche médiatique contemporaine. Précisons également que le roman d’espionnage s’est notamment développé en France avec la série des O.S.S. 117 qui a véhiculé et enraciné bon nombre de préjugés à connotation raciste qui lui ont également survécu. Nous verrons, par ailleurs, ultérieurement que le roman d’espionnage s’est également distingué dans les pays du Maghreb et notamment en Algérie, dans les années 1970.
Véritable pont communiquant entre réalité et fiction, le genre policier fonctionne et signifie perpétuellement de manière duelle. Les enjeux mêmes de l’enquête menée par le fin limier, pourtant a priori évidents -il s’agit de démasquer le coupable- relèvent d’une double perspective puisque l’énigme cristallise à la fois le conflit du mystère contre la raison et celui du crime contre la morale.
2.1.2- Double enjeu de l’enquête : entre raison et morale
Au sein de la fiction policière, le rôle de l’enquêteur consiste à démasquer le coupable, c’est-à-dire d’une part, à lever l’énigme d’un crime commis secrètement et, d’autre part, à confondre et désigner l’individu coupable. L’enquêteur poursuit en ce sens un double objectif, l’un soumis au pouvoir de la raison, l’autre, à celui de la morale. Maxime Chastaing distingue, en ce sens, l’ordre mental de l’ordre social :
« La
littérature policière, définie par deux axes où varient la logique et
l’expérience, se définit aussi par les deux variables du crime et du criminel.
En ordonnée, l’enquêteur cherche à résoudre le problème posé par un
méfait ; en abscisse, il veut accumuler des “preuves” afin d’inculper
le malfaiteur et de disculper des accusés innocents. Son enquête a pour
objectif : là, le retour à l’ordre mental par la vérité ; ici, le
retour à l’ordre social par la justice. »[73]
Si le retour à l’« ordre mental » relève d’un strict processus intellectuel, il n’est permis que par le conditionnement du retour à l’« ordre social ». Ainsi, la quête de vérité engagée par le détective n’a d’autre but que celui de retrouver le coupable, en vue de le soumettre à la punition qu’il mérite. La découverte de la vérité s’apparente alors à un retour à l’ordre, au rétablissement d’un équilibre social rompu par le crime, autrement dit à la victoire du Bien sur le Mal.
Relevant d’un paradigme de lecture manichéen, la fiction policière regroupe en ce sens ses personnages selon une double orientation : d’un côté, les « bons » c’est-à-dire la victime, les enquêteurs, les innocents ; de l’autre, les « mauvais » autrement dit les criminels, voire les suspects. Le rôle des « bons » consiste à faire la lumière sur les « mauvais » qui, dans la perspective de l’enquête deviennent les « obscurs » ; celui des « mauvais », à l’inverse, consiste à empêcher les « bons » d’accéder à la lumière. Voilà pourquoi le suspect, à la fois coupable et innocent vraisemblables, peut être répertorié parmi les « mauvais ». En effet, tout suspect ne l’est que par son manque de clarté : attitude mystérieuse ou agressive envers les enquêteurs, alibi douteux ou invérifiable, passé trouble. C’est ce manque de caractérisation qui fait de lui, d’emblée, un personnage en instance qui va devoir lutter pour être socialement reconnu, comme le remarque Jacques Dubois :
« La grande préoccupation du suspect est d’établir qu’au moment décisif, au moment du crime, il était en un autre lieu ; ce qui est une manière de dire qu’il n’adhère pas à la fonction qu’on lui prête, qu’il n’est pas celui qu’on croit, qu’il est un autre. Mais, dans l’attente de cette démonstration par défaut, l’auteur dosera subtilement en lui la part de la vertu et celle du vice, la part de la vérité et celle du mensonge -en tenant compte des exigences de sa stratégie herméneutique. Il pourra s’ensuivre que, même innocenté, le suspect garde par-devers lui quelque chose de son appartenance initiale au régime de l’équivoque. »[74]
Le suspect cristallise en un sens la fusion, voire la confusion, au sein de l’enquête, de la raison et de la morale. Nous distinguons dès lors deux types de suspects : celui dont la culpabilité ne laisse guère de doute pour l’enquêteur, sans qu’aucune preuve tangible ne puisse cependant accréditer ses soupçons ; celui qui, par ses secrets ou simplement son manque de crédibilité, nuit à la compréhension de l’énigme. Dans ce dernier cas, le suspect peut être totalement innocent et vierge de tout crime, il n’en demeure pas moins irrémédiablement sali par les soupçons dont il a été l’objet.
Ainsi, celui dont la parole a été mise en doute publiquement ne peut véritablement s’en relever sans heurts ; ce phénomène est d’autant plus marqué s’il s’avère que le suspect a effectivement quelque chose à cacher. Or, qui n’a strictement rien à cacher, qui plus est au sein d’une fiction qui se doit, par n’importe quel moyen, de différer la résolution d’une énigme, autrement dit de faire diversion d’une manière ou d’une autre tout en maintenant l’intérêt du lecteur en quête de révélations ? Il convient, en effet, de préciser que si, dans le cadre de l’« ordre social » le suspect est nécessairement « mauvais », il constitue un des piliers essentiels du récit d’énigme, permettant le retour progressif à l’« ordre mental ». En d’autres termes, la révélation des secrets des uns et des autres constitue un ressort essentiel de certains romans policiers classiques.
Eliminant une à une les zones d’ombre persistantes et cherchant à procéder par recoupements, Hercule Poirot s’efforce en ce sens de mettre au jour les différents sous-crimes gravitant autour de son enquête. Avant d’en venir au meurtre, il est ainsi question d’usurpation d’identité, de vol, d’enlèvement, de chantage et encore d’autres trafics susceptibles de tempérer l’attente de la divulgation finale. Notons, en outre, que la révélation de ces sous-crimes témoigne de la perspicacité de Poirot, en même temps qu’elle le conforte dans son rôle de moralisateur. Face à l’enquêteur, en effet, tout secret même infime est nécessairement mauvais, appelant une révélation publique en guise de châtiment. Notons, en ce sens, la modernité du genre policier tout entier tendu vers un processus de divulgation et, par glissement, d’anéantissement de la sphère privée terrassée par l’intervention d’un enquêteur immanquablement soumis au « devoir de tout dire qui appartient en propre aux sociétés modernes »[75]. Nous constatons, en ce sens, que l’enquêteur ne lutte pas contre le crime puisque c’est justement ce dernier qui détermine sa présence et son action, mais il lutte contre le secret, le caché, le tu c’est-à-dire contre tout ce qui peut nuire à la cohésion sociale.
Chargé par la communauté de rétablir l’ordre de la raison en même temps que l’ordre public, l’enquêteur oscille de ce fait entre rationalisme et conservatisme ou, comme le précise Wystan Hugh Auden, entre esthétique et éthique :
« La
tâche du détective consiste à restaurer l’état de grâce dans lequel
l’esthétique et l’éthique ne formaient qu’un. Comme l’assassin qui a causé leur
séparation est l’individu esthétiquement provocant, son adversaire, le
détective, doit être soit le représentant officiel de l’éthique, soit un
individu exceptionnel qui se trouve lui-même en état de grâce. Dans le premier
cas, c’est un professionnel ; dans le second, un amateur. »[76]
Remarquons, en ce sens, que l’arrivée du détective privé sur le devant de la scène n’est pas sans malmener quelque peu cette conception plutôt conservatrice et presque sacralisée de la fonction de l’enquêteur.
Ainsi, dans le cas d’une enquête menée par un détective privé se voulant, par tradition, peu fréquentable, la sauvegarde de l’éthique peut sembler compromise dans la mesure où elle dépend alors d’un individu qui se situe en marge des lois, parfois même hors la loi, et qui n’hésite pas à faire usage de la force, voire du chantage, pour parvenir à ses fins. Ici, esthétique et éthique ne sont plus les maîtres mots de l’enquêteur ; l’homme reprend le dessus sur les codes, le Bien ne coïncide plus avec les lois mais avec une certaine forme d’humanisme. Avec le roman noir, et contrairement aux apparences, le détective s’humanise en effet et devient compréhensif. Ni rationaliste hors pair, ni garant indéfectible d’une morale juridique figée et conservatrice, il est désormais moins juriste que justicier. C’est bien le crime qu’il prétend, quant à lui, combattre, recentrant finalement l’enquête de fiction sur des objectifs moins ludiques, plus en prise avec la réalité. Ainsi que le souligne Jean-Noël Blanc :
« Le
roman noir, sous ses allures révolutionnaires, est finalement un roman moral,
voire moraliste. Le but de l’action du privé n’est pas de changer le système
social, mais de lutter contre la saleté morale. Non pas de remplacer un ordre
social par un autre, mais de permettre aux gens de vivre dans une certaine
pureté morale. »[77]
Le Privé ne cherche plus à faire éclater la vérité ; il s’emploie à révéler le mensonge, autrement dit la « vraie vérité », celle du sordide, du mal, celle qui sévit au quotidien, si bien qu’avec l’enquête menée par le Privé, la vérité ne peut plus être synonyme de Bien.
Avec le rationaliste, l’enquête s’engage dans un processus d’épuration, le retour à l’ordre coïncidant avec la purgation des secrets. Les personnages n’y existent que dans les limites des besoins de l’intrigue ; ils sont des rôles et leurs secrets des ressorts du récit. Au sein du roman noir, ces rôles sont mis en situation, ces personnages prennent vie. Le Privé offre en ce sens une lecture du monde : la « trame embrouillée de la réalité » prend dès lors le pas sur « l’austère simplicité de la fiction »[78].
Ce glissement de la forme classique vers la variante noire renvoie au statut ambigu du genre policier qui semble perpétuellement osciller entre fiction et réalité, entre ludisme, légèreté, distraction et profondeur, réflexion, métadiscursivité.
Qu’il relève de la forme classique ou de la variante noire, qu’il revendique une approche ludique ou qu’il engage une réflexion argumentative sur la société et son fonctionnement, le roman policier semble toujours exister et signifier à un double niveau : il y a l’intrigue en tant que telle et sa contextualisation. En d’autres termes encore, la fiction s’anime autour d’une intrigue et elle se crée en aval d’un objectif, d’une démarche, d’une intention : elle crée et elle se crée simultanément sous les yeux du lecteur.
2.2- De l’enquête de fiction à la quête littéraire
Participant d’une démarche ludique ou revendiquant une approche réaliste, le récit policier, en faisant le choix de son orientation -classique ou noire- et en suggérant, par là même, le mode de lecture correspondant à ce choix, témoigne de l’intention du scripteur qui paraît en général explicitement, dès le paratexte. Or, aussitôt la lecture amorcée et conditionnée, d’une certaine manière, par la sérialité du cadre générique, cette intention doit totalement disparaître de l’esprit du lecteur afin que celui-ci puisse pleinement se prendre au jeu et répondre aux exigences du genre. Suscitant, de ce fait, une certaine docilité chez son lecteur, le scripteur a libre champ pour mener son récit et n’hésite pas, la plupart du temps, à exploiter largement la latitude qui lui est ainsi offerte. Jouant avec le lecteur, comme le genre le lui autorise, le scripteur de récit policier s’engage dans une entreprise de brouillage, suscitant toujours plus de questionnements, gommant les repères en redistribuant, par exemple, les rôles et les fonctions de chacun au fil du récit, si bien que le jeu engagé ne tarde pas, bien souvent, à gagner le mode de fonctionnement même du récit, au risque finalement de le perdre.
2.2.1- Aspect ludique / Quête herméneutique
Ainsi que nous venons de le souligner, le genre policier s’inscrit dans un paradigme de lecture susceptible de se dédoubler, proposant une lecture légère et de distraction, au premier degré ; suscitant une lecture plus profonde et de perspective herméneutique, en filigrane.
A un premier degré, le moteur du genre policier réside en une question que le lecteur est amené à se poser aussi bien dans la forme classique -au premier plan- que dans la variante noire -en arrière plan cette fois, mais la question demeure posée- : « Qui a tué ? » ou, pour la variante noire, « Qui a fait tuer ? ». Il s’agit, dès lors, pour l’enquêteur de sonder l’entourage de la victime, opérant de ce fait un glissement de « Qui a tué ? » à « Qui est qui ? », c’est-à-dire menant, en marge de son enquête empirique des faits, une investigation d’ordre psychologique. Or, cette enquête en profondeur parvient à atteindre tous les personnages, qui ne peuvent se soustraire à l’analyse, devenant, de ce fait, subitement faillibles.
En engageant cette chasse aux masques, l’enquêteur entraîne la fiction dans une vaste crise identitaire. Interrogatoires, témoignages, anecdotes, confessions se succèdent comme autant de démarches énonciatives propices à l’introspection, la divulgation à voix haute levant inévitablement les barrières du refoulé. Poussé à son comble, le processus gagne finalement l’enquêteur lui-même. En effet, afin de saisir les motivations profondes du criminel et pouvoir ainsi en comprendre et donc en décrire le comportement, l’enquêteur doit tenter de se glisser dans la peau de son adversaire : adopter son raisonnement, imaginer son état d’esprit et s’en imprégner, mimer ses agissements, autrement dit se glisser dans la peau du criminel et jouer son rôle. Ce travestissement n’est pas sans risque pour l’enquêteur qui se retrouve contraint à une perpétuelle remise en cause de sa propre identité, comme le souligne Jacques Dubois :
« Le
détective participe de la crise d’identité et, par-delà, de la détention d’un
secret […]. Il est celui -et l’exemple de Maigret nous brûle- qui, pour savoir
et pour comprendre, n’a pas d’autre recours, si ce n’est de pauvres indices,
que de s’identifier à l’Autre -victime, suspect ou bien coupable. Changer de
peau, en esprit, pour reconstituer un itinéraire, une biographie. Voué à un
rôle récurrent de substitution, il est sans trêve dans la perte de soi. »[79]
A chaque nouvelle énigme à résoudre, le détective est donc contraint à enquêter sur lui-même, à la manière, comme le soulignent certains critiques[80], des chevaliers de la Table Ronde, engagés dans des périples initiatiques en quête de leur propre vérité, tout en découvrant le monde dans lequel ils vivent.
Confronté au profil psychologique des personnages et livré à ses propres angoisses, le détective est progressivement conduit à mener une enquête au creux de l’enquête. La fiction se livre alors au jeu du soupçon, l’univers du dehors -le vu, le su, le montré, le perceptible- devenant le masque, le leurre d’un univers sous-jacent, celui du dedans -le caché, le tu, le refoulé, le susceptible. Inaugurant le temps des aveux, le roman policier signe en ce sens l’émergence du dedans ; la victoire de la parole et de l’échange collectif, sur le silence et la pensée refoulée, signe alors véritablement la coexistence, au sein même du récit et du système énonciatif, de ces deux univers. C’est en effet le récit qui se dédouble alors et plus précisément encore qui se démultiplie, s’offrant à toutes les versions, à tous les témoignages relevant à la fois du dehors et du dedans, modifiant considérablement la donne descriptive du roman : une scène peut ainsi nous être rapportée sous différents points de vue ; un seul récit, inédit, sera conservé à la fin, l’enquêteur ayant eu la lourde tache de faire le tri parmi les différentes propositions.
Notons que si le choix d’une version parmi d’autres tend à prouver, en surface, le talent de l’enquêteur, il témoigne en réalité et en filigrane d’une intention du scripteur, s’en remettant à un schéma narratif prédéterminé. C’est désormais le texte lui-même qui peut se lire à un double niveau : comme « texte en fonction » -ce que le narrateur, agent du détective, livre au lecteur : le rôle du texte- et comme « texte en fonctionnement » -ce que l’auteur fabrique en coulisses : la manière du texte.
Tandis que le texte en fonctionnement est nécessairement voué à la clandestinité, sans quoi le principe même du récit d’énigme n’a plus lieu d’être, le texte en fonction est littéralement livré en pâture au lecteur, dont l’appétit est savamment aiguisé par la diffusion d’indices censés le mettre sur la piste de la découverte de l’énigme. Crédule ou pas -s’il veut préserver l’intérêt de son roman, l’auteur doit logiquement faire en sorte qu’il soit impossible, au lecteur, de parvenir à trouver la clé de l’énigme avant l’enquêteur officiel-, le lecteur est donc invité à partir en quête d’indices. Daniel Couegnas apporte quelques précisions quant à la notion indicielle :
« A
l’opposé de ce que les linguistes appellent “signal”, l’indice exclut la
volonté de communiquer. De là toute l’ambiguïté de l’indice policier dans la
littérature, qui pose lui aussi le problème plus général de l’intention
“réaliste” dans le roman […]. L’indice efficace est celui qui, donnant
l’impression au lecteur qu’il a fait un pas en avant dans l’enquête, lui fait
faire en réalité deux pas en arrière. »[81]
L’existence d’indices censés témoigner des ratages du criminel constitue, en réalité, le signe visible de l’irruption de la main de l’auteur dans le texte et trahit la fiabilité du pacte de lecture prétendument instauré, accordant au lecteur, si ce n’est un droit de regard, du moins une possibilité de participer de manière interactive à l’enquête. Au-delà de ce pacte illusoire, c’est bien l’enquêteur qui demeure le seul maître à bord, à la surface du texte, véritable double de l’auteur, en filigrane.
L’enquêteur fusionne en effet avec son créateur, dans la mesure où son rôle n’est autre que de raconter le crime, de rapporter le récit absent, après avoir recueilli les différentes voix, établi les circonstances et déterminé les tenants et aboutissants du crime. Alain-Michel Boyer revient en ce sens sur les affinités pouvant s’établir entre l’approche préparatoire de l’enquêteur et celle requise par le travail d’écriture :
« Le policier ne cesse de corriger, de vérifier les détails, d’ajouter des développements, de choisir une voie plutôt qu’une autre, de reprendre, comme un auteur, le schéma narratif qu’il dessine, de l’accroître de quelques personnages -soudain frappées de suspicion-, de l’amputer d’un autre, et chaque apport nouveau, chaque modification s’apparente à une variation sur le même thème, jusqu’à ce qu’il ait trouvé l’ “expression” adéquate. »[82]
Il ajoute :
« En
servant le progrès de l’action et en liant les données entre elles, le
policier, qui remplit apparemment le rôle instrumental de fil directeur,
expérimente sa parole comme un agir créateur : son entreprise est de
l’ordre de la poièsis. Il crée la
narration en tant qu’elle se crée en lui. »[83]
L’enquêteur se présente ainsi comme sosie de l’écrivain, construisant son récit final par touches successives, collectant, ordonnant, imaginant, expérimentant pour enfin se livrer à l’énonciation. C’est finalement le roman qui paraît se construire au fil de l’enquête, porté à bout de bras par la puissance de l’acte narratif. Progressivement, l’histoire du crime est retracée et, avec elle, celle de la victime ; une victime, personnage mort-né accouché par le texte qui renaît sous les projecteurs de l’enquête, qui est d’une certaine manière réinventée par le biais de la reconstitution à laquelle procède l’enquêteur ; car le véritable drame de la fiction policière, c’est que le crime a eu lieu en dehors du texte. Le rôle du détective consiste donc bien à occuper le vide narratif imposé par la découverte du cadavre au début du roman, de rétablir ce texte, pour le bien des personnages de fiction menacés par une éventuelle récidive du criminel, aussi bien que dans l’intérêt du lecteur, nécessairement pris de vertige devant ce vide narratif.
C’est donc bien un récit en train de se construire -il en donne pour le moins l’impression- qui s’offre au lecteur, le fin limier recevant non seulement la direction de l’enquête, mais également celle du récit. A cet égard, la position du lecteur peut s’apparenter à celle des différents témoins et suspects auxquels l’enquêteur est confronté, à la fois spectateurs, interlocuteurs et finalement victimes des subterfuges, coups de bluff et autres procédés malicieux nécessaires à l’aboutissement de l’enquête ; en charge du récit, l’enquêteur/scripteur résiste rarement à la tentation de soumettre le lecteur au même type de procédés.
2.2.2- Les « écarts » du récit policier
Si l’on s’intéresse aux écarts de conduite du récit policier ou en d’autres termes à ses prises de liberté vis-à-vis des codes, à sa façon de transgresser les règles propres au cadre générique ou encore à sa manière de tromper les attentes du lecteur, on est tenté de penser en premier lieu au roman noir, pour toutes les raisons précédemment évoquées. La variante noire du genre policier signe l’irruption, dans le texte, de la réalité, de l’urbain, du crime en tant que phénomène de société. Elle s’éloigne, de ce fait, de l’univers clos prisé dans la forme classique, de son caractère ludique, de son conservatisme hautement mis à mal par la mise en scène de détectives imparfaits, aux manières et au vocabulaire grossiers.
En fait, le roman noir semble posséder toutes les caractéristiques de la « variante sale » du genre policier, voire de l’enfant indigne, ingrat, n’hésitant pas à ironiser sur la bienséance et la réglementation du classicisme fondateur. Le roman noir se fait ainsi provocateur, certains de ses héros paraissant même prétendre à s’échapper de la fiction, à en balayer aisément les limites textuelles. L’usage de l’argot participe de cette attitude, comme le souligne Claude Gaugain :
« Le roman policier essaye de faire oublier qu’il est livre, il voudrait être un récit parlé, un récit immédiat, c’est-à-dire non médiatisé par le livre. Le roman policier voudrait recréer l’illusion du reportage en direct grâce à un recours à la langue parlée qui jusque-là n’appartenait guère au domaine du livre. C’est le but de cette mise en argot du texte. L’argot, généralement très compréhensible, n’est pas le langage hermétique du milieu, son rôle semble plutôt de nier la substance du livre et d’ébaucher une sorte de roman parlé. Parole feinte qui travaille à se faire oublier comme écriture et littérature. »[84]
Le roman noir semble donc véritablement se complaire dans la subversion de la forme classique ; c’est néanmoins bien à cette dernière que revient la palme de la perversion, ou plus exactement de l’usurpation, d’une part, parce qu’elle repose sur un contrat de lecture illusoire, comme nous venons de le constater, et, d’autre part, dans la mesure où elle pousse la caractérisation de sa forme narrative, de son intrigue, de ses personnages aux portes de la caricature, voire de la parodie. Les Sherlock Holmes et Hercule Poirot impressionnent par leurs facultés intellectuelles ; ils n’en demeurent pas moins très souvent ridicules aux yeux du monde. Par ailleurs, leur certitude d’avoir toujours raison et leur suffisance agacent ; autant de caractéristiques et de motifs propices à la transgression dans la moquerie et que certains auteurs de notre corpus ne manqueront pas d’exploiter.
Notons, par ailleurs, que la narration policière présente ceci de singulier qu’elle est totalement et surtout ouvertement programmée : le lecteur ignore ce qu’il va trouver dans le roman mais il sait déjà sous quelle forme, selon quelle mécanique. Il sait qu’on lui annoncera un crime ou qu’il sera confronté à une énigme, dès le début du roman ; il sait également qu’un enquêteur, qu’il connaît déjà la plupart du temps, sera chargé de résoudre le mystère, qu’il sera amené à suspecter, disculper, interroger, prospecter, supputer. En outre, le lecteur ne doute pas de la réussite de l’enquêteur qui ne peut être qu’infaillible ; il s’attend donc aux révélations finales, à la victoire de la raison sur le mystère ; il est sûr que tout est joué d’avance, mais s’il veut bien jouer le jeu de la fiction, il se laissera gagner par le suspense, le désir de savoir et la stupéfaction finale et sera séduit par les rebondissements de dernière minute.
Le lecteur de roman policier classique est donc un « bon lecteur », exigeant, intraitable sur la qualité de la marchandise mais docile : il suit l’enquêteur les yeux fermés. Installé dans un certain confort de lecture, il est une proie idéale, un animal de laboratoire rêvé pour tout écrivain désireux de mettre à l’épreuve « l’horizon d’attente » du lecteur et d’expérimenter le pouvoir et la fiabilité de la narration. Jacques Dubois souligne en ce sens la propension de nombreux auteurs policiers à jouer avec les lois du genre, à les manipuler, à les traiter « de façon paradoxale ou ironique »[85] et finalement à pratiquer un « jeu à l’intérieur du jeu »[86]. Parmi ces transgressions, relevons notamment l’absence de crime ou de coupable, l’illégitimité du détective, l’absence de dénouement ou encore les culpabilités incroyables comme celle de l’enquêteur, du narrateur ou du scripteur lui-même.
Pressentie dès les premières années de la forme classique, la perspective visant à détourner l’usage traditionnel de la forme policière semble être à l’origine de la diversification du genre en de multiples variantes ; elle tend, en un sens, à expliquer sa longévité ainsi que l’intérêt que lui ont porté de nombreux écrivains de toutes aires ; un intérêt résultant également des multiples facettes et ramifications d’un genre qui, en outre, ne souffre pas d’être transformé, adapté, voire malmené.
Le genre policier a ceci de singulier que tout en affirmant son adhésion à un schéma narratif et à une codification générique parfaitement reconnaissables, il demeure porteur de surprise, d’incertain, d’inattendu ; en fait, il est tant attendu qu’il a finalement tout loisir de surprendre. De même, la simplicité apparente dont semble relever son fonctionnement n’est que le résultat d’une maîtrise extrême du scripteur, soumis à une rigueur indéfectible.
Roman adaptable au cadre urbain, en prise avec la réalité et avec l’évolution sociale, il peut par ailleurs se faire le témoin d’une époque, livrant des informations précieuses d’un point de vue sociologique notamment.
Réactif à la modernité, il jouit en outre d’une présence ininterrompue sur le devant de la scène littéraire, parvenant même à gagner d’autres « transmetteurs » plus modernes lui permettant de toucher un public encore plus large -ce qui n’est pas un gage de réussite mais qui souligne l’adaptabilité du genre.
Populaire et accessible à tous, il entretient encore un rapport privilégié avec son lectorat et se pose en véritable vecteur de communication, jouant de surcroît sur le pouvoir de conviction dont semble jouir sa pièce maîtresse, l’enquêteur.
Créant et se créant en elle-même, la fiction policière offre enfin de nombreuses potentialités à tout scripteur désireux de s’engager dans une « littérature de recherche », dans la perspective d’une réflexion métalittéraire.
C’est sans doute pour ces nombreuses raisons que le roman policier est finalement parvenu, après un siècle d’existence, à s’implanter au sein d’espaces littéraires où, en tant que genre réputé mineur, il n’était guère attendu ni même pressenti ; une implantation qui, comme nous nous proposons de le démontrer, s’est faite différemment et de manière plus ou moins marquée dans les aires littéraires qui nous intéressent.
II- Panorama de l’implantation du genre policier dans les littératures francophones des Antilles et du Maghreb
Après cette rapide approche des principales caractéristiques de la forme policière, de son évolution et de son « potentiel », il s’agit-là, d’une certaine manière, d’expérimenter ces diverses données à la lumière d’un corpus précis, puisé dans les littératures francophones antillaise et maghrébine.
D’implantation significative plutôt récente dans lesdites littératures, le genre policier n’est pas toutefois apparu brusquement et sans raison au sein de ces aires qui a priori ne l’y prédisposaient pas. Avant d’aborder et de définir notre corpus, qui concerne globalement une période s’étendant des années 1980 jusqu’à nos jours, et de tenter d’en déterminer les grandes lignes et points de connexion, il convient de repérer et d’analyser, de manière relativement succincte, les premiers pas du genre dans les littératures francophones des Antilles et du Maghreb. Nous pourrons nous interroger sur la nature des formes policières alors pratiquées, sur les raisons ayant conduit des écrivains antillais ou maghrébins à s’intéresser à la forme policière, ou encore sur les éventuelles incidences de ces prémices sur l’évolution du genre policier en général et au sein des espaces littéraires concernés en particulier.
1- Prémices du genre
Si, comme nous le postulons, le genre policier tend à se développer sous différentes variantes, dans le paysage littéraire francophone, notamment antillais et maghrébin, ce n’est globalement que depuis une vingtaine d’années. Avant les années 1980, le genre policier n’y apparaît que de manière sporadique et généralement sous une forme davantage prisée pour son caractère populaire que pour ses vertus littéraires. Dans le cadre d’une étude portant sur le renouvellement du genre policier, l’évocation de ces occurrences nous paraît néanmoins nécessaire et particulièrement intéressante : d’une part, dans la mesure où elles nous permettent d’établir la manière dont le genre a pu évoluer sur place ; d’autre part, parce qu’elles témoignent de l’universalité et de l’intemporalité du genre.
Nous nous intéresserons, dans un premier temps, à la sphère antillaise, en évoquant quelques apparitions du genre entre la fin du XIXème siècle et 1950, puis nous nous pencherons sur trois auteurs en particulier, Daniel de Grandmaison, Michèle Lacrosil et Bertène Juminer, tous trois auteurs de romans policiers -plus ou moins conformes au modèle classique- entre 1950 et la fin des années 1970.
Notre approche sera sensiblement différente en ce qui concerne la sphère littéraire francophone du Maghreb, puisque nous nous intéresserons uniquement à une période relativement récente, le genre policier n’apparaissant pas de manière véritablement significative au sein de la littérature dite « coloniale » ; nous nous intéresserons, dans un premier temps au développement du roman d’espionnage, particulièrement sensible au cours des années 1970, avant d’aborder les premiers romans plus conformes à la forme classique, écrits avant les années 1980 notamment.
1.1- Implantation par touches dans la sphère littéraire antillaise
L’apparition du genre policier au sein de la littérature francophone antillaise est le fait de quelques auteurs et se manifeste par le biais de différentes variantes du genre, dont la première chronologiquement relève du roman noir gothique. Ancêtre du roman-feuilleton, lui-même catalyseur du développement du roman d’énigme, le roman gothique a trouvé écho dans la littérature antillaise de la fin du XIXème et du début du XXème siècles, privilégiant alors une approche ludique, populaire, de distraction, usant de « grosses ficelles » et de péripéties rocambolesques. A partir des années 1950 et du Martiniquais D. de Grandmaison, le genre prend une autre orientation, favorisant encore la perspective ludique et populaire propre au genre, mais inscrivant l’intrigue au cœur d’un tableau permettant au lecteur d’appréhender une certaine réalité sociale. Concrétisant de manière encore plus convaincante les potentialités de la fiction policière, la Guadeloupéenne Michèle Lacrosil propose quant à elle, à la fin des années 1960, un roman utilisant le cadre policier pour porter un regard critique sur la société créole de l’époque alors engluée dans des dysfonctionnements sociaux et des traumatismes identitaires à l’origine de douloureux drames. Nous aborderons enfin un ouvrage du Guyanais Bertène Juminer qui, bien que relevant d’une aire ne nous concernant pas directement, s’engage, à la fin des années 1970, dans une adaptation de la forme policière qui nous paraît intéressante et que nous commenterons brièvement.
1.1.1- Occurrences du genre policier entre la fin du XIXème siècle et 1950
Il est établi que le roman policier, en tant que récit d’énigme, est né avec Edgar Poe, en 1841, et a bénéficié de la popularité naissante du roman feuilleton, dont la forme lui était, en outre, particulièrement favorable. Or, précisons ici que le roman feuilleton profitait lui-même, dans les années 1840, du déclin d’un autre genre populaire baptisé « roman noir » ou « roman gothique » -déclin lié à celui du romantisme-, qui connut un immense succès de la fin du XVIIIème siècle à 1840. Totalement opposés en substance -le roman gothique verse généralement dans le fantastique alors que l’objectif principal du récit d’énigme consiste à prouver que toute énigme a une solution rationnelle-, roman noir gothique des XVIIIème-XIXème siècles et roman policier ont en commun d’expérimenter le récit du crime. Il n’est, par conséquent, pas exclu que Poe ait été influencé par les effluves du roman gothique, savamment recyclées alors par le roman feuilleton.
Selon Michel Raimond[87], le roman noir de la fin du XVIIIème siècle peut prendre diverses formes : « roman à spectres », caractérisé par l’intervention de phénomènes surnaturels ; « roman de brigands », centré sur le récit de séquestrations, d’attaques à mains armées, de disparitions mystérieuses ; roman plus gore peuplé d’histoires de sang et de folie ; et enfin roman caractérisé par la présence d’un personnage aux pouvoirs surnaturels, voire démoniaques.
Cette charge fantastique propre au roman gothique ne laisse pas indifférent, en particulier dans des sphères sociales marquées par la prégnance de certaines croyances. La société antillaise et ses empoisonneurs, ensorceleurs et autres quimboiseurs trouve, en effet, son compte -souvent aux dépens de la qualité- dans cette littérature inspirée à la fois du roman noir gothique et de la forme feuilletonesque. C’est ainsi que Jack Corzani, auteur de l’ouvrage intitulé La Littérature des Antilles-Guyane françaises[88], déplore que trop souvent, dans la littérature antillaise de la fin du XIXème siècle, le roman de mœurs « ne tourne au roman noir »[89]. Le critique évoque notamment le cas de l’homme de lettres guadeloupéen, Adolphe Belot (1829-1890), auteur, par nécessité financière entre autres -il était joueur- de romans populaires, dont Le Secret terrible (Mémoires d’un caissier)[90], écrit en 1868, en collaboration avec Jules Dautin. J. Corzani résume l’ouvrage en ces termes :
« Le Secret terrible (Mémoires d’un caissier) […] part d’un sujet sérieux : l’indélicatesse d’un employé jusqu’alors irréprochable qui, victime d’influences néfastes, finit par puiser dans la caisse qui lui était confiée. Mais, après quelques pages consacrées à l’analyse psychologique, aux tourments d’un honnête homme dévoré de remords, l’auteur, soucieux d’allonger la sauce, fait appel au roman noir, aux retournements simplistes, plagie ridiculement Les Misérables […] multiplie les coups de théâtre […], bref sombre dans le roman-feuilleton le plus insignifiant. Et il en va de même pour la plupart de ses récits policiers. »[91]
Non content d’« allonger la sauce », A. Belot la pimente deux ans plus tard, en publiant notamment deux romans très populaires en même temps que controversés : Mademoiselle Giraud, ma femme[92] et surtout La Femme de feu[93], en 1874, qui relate l’« histoire d’une nymphomane, Diane Bérard, que le désir pousse au crime, ce qui permet d’unir l’érotisme au canevas policier »[94].
Notons que la perspective du roman noir gothique, doublée de l’attrait feuilletonesque déterminant à l’époque, se prolonge aux Antilles, jusque dans les années 1930, où certains auteurs choisissent encore de jouer des ressorts tels que la succession de péripéties conduisant inévitablement au drame, souvent au crime, voire à la folie et sous-tendue par l’existence d’un lourd secret.
Jack Corzani fait notamment référence à Salavina, pseudonyme de Virgile Savane, né à Saint-Pierre en 1865 et auteur, en 1932, d’un roman « médiocre, douceâtre et rocambolesque »[95], à l’intrigue visiblement marquée par le roman noir gothique, intitulé Amours tropicales ou Martinique aux siècles des Rois[96] : une baronne, partagée entre son racisme et ses désirs, porte l’enfant d’un Noir, nommé Supato ; des années plus tard, le fils de la baronne s’éprend d’une Caraïbe, déjà prisée par Supato ; le fils tue alors Supato qui, avant de mourir, lui révèle qu’il a engrossé sa mère. Une fois encore, l’influence du roman noir gothique se traduit par une succession de péripéties rocambolesques et spectaculaires, sans grand intérêt. La peinture de la société martiniquaise s’efface en effet devant les fioritures de l’intrigue ; les personnages « dignes d’un tableau de mœurs, sont déplacés dans un canevas feuilletonesque »[97].
D’autres écrivains des Antilles se lanceront encore, au cours des années 1930, dans le roman noir gothique, comme par exemple Sully Lara (1867-1950), romancier guadeloupéen, auteur de l’ouvrage intitulé Sous l’esclavage[98]. Nous nous référons là encore aux remarques de J. Corzani :
« Vengeances, trahisons, sadisme, retournements de situations, tous les ingrédients du roman “gothique” sont là, accentuant la théâtralisation, au risque de rendre peu crédibles les éléments historiques pourtant authentiques. »[99]
Alimenté par le fantastique, le tragique et le sensationnalisme, l’aspect feuilletonesque semble ainsi souvent primer, dans ces romans, aux dépens de la peinture sociale qui fait alors cruellement défaut à la littérature des Antilles, en ce premier tiers du XXème siècle. Alors que la vague du roman hard-boiled semblerait bienvenue -mais peu vraisemblable- dans une littérature si engluée dans le roman feuilleton romantique, la bourgeoisie antillaise s’obstine à rejeter toute forme d’écriture réaliste ; incohérence que Jack Corzani tente d’expliquer :
« Un roman réaliste, dénonçant la disparité sociale, ne mettrait nullement en évidence sa puissance -cette dernière appartenant aux sociétés européennes ou aux derniers Grands Blancs antillais- mais sa veulerie. »[100]
Ainsi peut s’expliquer la fadeur de la plupart des romans du début du siècle jusqu’à la fin des années 1930.
Si le roman noir gothique a trouvé écho dans la littérature des Antilles, à la fin du XIXème et au début du XXème siècles, le genre policier, de forme classique cette-fois, a également inspiré quelques auteurs antillais ; Daniel de Grandmaison en est un exemple significatif.
1.1.2- Daniel de Grandmaison
Daniel de Grandmaison, Blanc créole issu d’une vieille famille de souche martiniquaise ayant exercé dans le journalisme, est l’auteur de deux romans policiers, écrits à quasiment trente années d’intervalle : Rendez-vous au Macouba[101] et Le Bal des créoles[102].
Rendez-vous au Macouba, désigné en couverture comme « roman de mœurs martiniquaises », se présente sous la forme d’un récit d’énigme relativement classique ; tous les ingrédients semblent, au demeurant, réunis au départ : alors que Raoul du Gravier reçoit, sur son habitation, quelques-uns de ses amis et membres de la caste blanche créole pour le week-end, un des invités, Guy de Longpré -sur le point de quitter son épouse et amant contesté de Solange de Soutras- est retrouvé mort, empoisonné. Gilbert Marin, Commissaire à la Sûreté à Paris, chargé de l’affaire par le Procureur de la République, réquisitionne la bibliothèque de l’habitation pour procéder aux interrogatoires. Ignorant des pratiques sociales du milieu béké à son arrivée, il est progressivement confronté au racisme des Blancs, à leurs préjugés, leur hypocrisie, leur conservatisme notamment vis-à-vis du divorce, réalisant que la Martinique n’est pas vraiment à l’image de « ces îles bienheureuses et chaudes où l’on cultive les plantes parfumées »[103] dont il rêvait enfant. La découverte d’un second cadavre, celui de Sinvilia, servante indienne, et la confrontation avec la complexité des relations sociales martiniquaises, plongent Marin dans le désarroi ; il en vient même à douter de ses facultés intuitives sous les Tropiques :
« Le
commissaire était gêné en présence de l’étranger. Il avait certains dons
intuitifs qui lui avaient déjà rendu en France les meilleurs services. Pourquoi
donc ne pouvait-il les exercer ici ? Subissait-il déjà les atteintes du
climat ou bien était-ce le colombo ? Toujours est-il qu’il n’arrivait pas
à porter un jugement précis sur la personnalité du chimiste. »[104]
Persistant néanmoins dans son enquête, et malgré les pressions de ses supérieurs, qui l’invitent à davantage de délicatesse, Marin finit par trouver l’identité de l’assassin : il s’agit de Jean Guilouard, le fils d’un grand industriel, qui, désireux d’épouser la femme de Longpré, sans que cette dernière n’ait recours au divorce -par souci des convenances-, s’est résolu au crime. Comprenant que Marin sait tout, Jean envisage de se suicider ; il renonce au dernier moment, plaçant ses espoirs dans une issue positive de la justice, avant de se blesser grièvement par accident. Défiguré par une décharge de chevrotine, il s’achève finalement. Après hésitation -celle du criminel mais également, semble-t-il, celle de l’auteur- le criminel est finalement puni ; il est, en contrepoint, épargné par Marin qui décide de taire ses conclusions, pour préserver les bonnes relations de l’Etat français avec la caste blanche créole.
D’un point de vue littéraire, ce roman présente l’intérêt de transférer le récit d’énigme traditionnel à l’univers antillais, où il s’adapte d’ailleurs fort bien, aidé en cela par différents éléments propices au développement du genre, notamment sur le modèle anglo-saxon : l’existence d’une bourgeoisie aux mœurs complexes, malsaine, hypocrite et puritaine, recelant de secrets plus ou moins avouables, sur fond de propriétés gigantesques peuplées de domestiques. En outre, la question raciale, assortie de son lot de mépris et de désir de vengeance, constitue un ressort potentiel solide de l’intrigue ; encore faut-il que l’auteur soit capable, à l’image de D. de Grandmaison, d’un recul nécessaire à l’égard de sa propre caste pour en brosser un portrait digne d’intérêt. Il convient, en effet, de préciser que si le regard de D. de Grandmaison n’est pas totalement épuré de préjugés, à la fois sociaux et raciaux, il témoigne néanmoins d’une tolérance assez remarquable. Ainsi, Rendez-vous au Macouba présente véritablement un intérêt sociologique, comme le souligne Jack Corzani :
« Plus
que le “suspens” policier comptent le tableau de mœurs, la dénonciation d’une
justice trop encline à ménager les maîtres séculaires, la mise en évidence de
tabous sociaux dont le respect peut conduire au meurtre, l’aveu de la présence
obsédante du racisme. Ce roman, bien que maladroitement écrit, ne manque pas
d’attrait, ses tableaux restituant la vision du monde des milieux békés les
plus fermés, ce qui complète avec bonheur les témoignages des auteurs qui, à la
même époque, se sont intéressés à la population de couleur. »[105]
C’est donc en orientant le récit d’énigme vers le roman de mœurs, autrement dit en optant pour un regard empreint de réalisme, que D. de Grandmaison en vient à transgresser le modèle de référence, en imposant le silence à son enquêteur ou plutôt en lui laissant le choix d’un semi-silence : ses révélations parviennent au lecteur sous le sceau du secret, par le biais d’une confession adressée à un personnage, censé soulager l’enquêteur tout en servant de transmetteur vis-à-vis du lecteur.
Dès ses débuts dans la sphère antillaise, le genre policier a ainsi pu révéler sa capacité d’adaptation ; un potentiel que les auteurs antillais ne manqueront d’ailleurs pas d’exploiter, tant par souci réaliste que par désir ludique, mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
Notons que, sur le modèle de D. de Grandmaison, cette forme de peinture sociale, réalisée sur fond de canevas policier, a également été expérimentée par les Martiniquaises Claude[106] et Marie-Magdeleine Carbet, notamment dans un recueil de nouvelles, publié en 1957 et intitulé Braves gens de la Martinique[107]. Tandis que le récit « Le Chat jaune » relate un cas de sorcellerie, sur le modèle des histoires extraordinaires d’Edgar Poe, « L’Accident » développe une intrigue policière ayant pour cadre la Guyane et mettant en avant, un peu comme l’avait fait D. de Grandmaison, « la complicité des fonctionnaires coloniaux, l’originalité de leurs rapports, leur mentalité particulière et, parfois, leur dégénérescence physique et morale »[108].
C’est précisément cette tonalité critique que l’on retrouve dans le second roman policier de Daniel de Grandmaison, publié en 1976 : Le Bal des créoles.
L’intrigue de ce roman est tissée autour d’une vaste histoire de famille, faite d’héritages, de mépris, de vengeances, de terribles secrets ; autant d’éléments communs à l’intrigue policière classique. Une certaine originalité marque néanmoins ce deuxième roman de D. de Grandmaison. Ainsi, le premier cadavre n’est découvert par la police qu’à la page 205, autrement dit vingt pages après la découverte du corps par deux personnages et sous les yeux du lecteur. D’autre part, le premier enquêteur mis en scène, le Commissaire Trêves-Albin, alcoolique chargé de la répression de l’ivresse publique, ne semble ni motivé ni même capable de résoudre quoi que ce soit ; le Commissaire Marin prend finalement l’enquête en charge, à une vingtaine de pages de la fin, en précisant qu’il n’est pas là pour « jouer les détectives de romans policiers »[109]. Or, jusqu’à la découverte du crime -qui se fait attendre pour le lecteur habitué au schéma classique du genre policier- l’intrigue ne manque pas de rebondissements et, sans qu’aucun enquêteur mandaté n’intervienne, les révélations vont bon train. C’est ainsi que D. de Grandmaison semble insister sur le fait que, finalement, les dessous du crime paraissent encore plus sordides que le crime lui-même, procédant de ce fait à une sorte de mise en abyme du rôle de l’enquête. Dans le roman policier classique, l’enquête n’est que le prétexte au récit d’une histoire sordide ; dans Le Bal des créoles, d’une certaine façon, le sordide affirme explicitement ses droits sur l’enquête. Il s’agit dès lors, pour D. de Grandmaison, de porter un regard critique non seulement sur la société créole, mais aussi sur le roman policier lui-même ; objectif que laisse entendre l’un des personnages, amateur du genre :
« Quand
je lis un roman policier, aimait-il à dire, je ne fais aucun effort
intellectuel. L’auteur se charge de penser pour moi et cependant je peux
réfléchir à toutes mes affaires. »[110]
La manière dont D. de Grandmaison s’inspire du genre policier nous paraît ainsi tout à fait intéressante : contrairement aux précédentes tentatives de reprise du genre, sous forme gothique ou plus classique, il choisit d’en faire véritablement un réceptacle des mœurs créoles. Avec D. de Grandmaison, le genre policier perd, en ce sens, de son aspect ludique pour gagner en réalisme et surtout en critique, même si son regard n’est pas toujours totalement fiable et juste. En outre, les libertés formelles qu’il prend à l’égard du genre ont le très grand mérite de susciter la réflexion sur un genre jugé trop rapidement facile, mineur ou sans intérêt, d’un point de vue littéraire.
C’est dans une perspective encore plus approfondie que Michèle Lacrosil s’inspire de la forme policière pour porter un regard critique sur la société guadeloupéenne des années 1950.
1.1.3- Michèle Lacrosil
A l’instar de D. de Grandmaison qui, avec son deuxième roman, s’écarte du modèle de référence du genre policier pour tendre davantage vers le roman de mœurs, Michèle Lacrosil, romancière guadeloupéenne, semble choisir avec son troisième roman intitulé Demain Jab-Herma de s’inspirer de la forme policière pour porter un regard critique sur la société créole des années 1950.
Publié en 1967, aux Editions Gallimard, Demain Jab-Herma prend pour cadre l’habitation de Pâline, dirigée officiellement par Georges Robérieu, officieusement par son sous-directeur Constant Sougès, frère de lait du mystérieux chauffeur noir Jab-Herma. Microcosme de la société guadeloupéenne des années 1950, Pâline va pénétrer au cœur de la tourmente avec l’arrivée d’un envoyé de la Compagnie sucrière, Philippe Bonnier, chargé d’enquêter sur un scandale impliquant, semble-t-il, un employé fourvoyé. Il s’agit, pour l’enquêteur mandaté -qui s’avère être le neveu du tout puissant directeur de la Compagnie Sucrière- de faire la lumière sur le vol de plusieurs barils de rhum, mais également sur la fausse identité du comptable, ainsi que sur une affaire de fétichisme : un employé aurait sollicité les services d’un féticheur africain, Kitsohamy Dinnh, détenteur d’un coffret renfermant un fétiche et un couteau, grâce auxquels Bonnier espère confondre le coupable. Cette triple orientation permet à Michèle Lacrosil d’entraîner son lecteur dans les méandres d’une société encore aux prises avec un passé esclavagiste pesant lourdement sur les relations sociales.
Les liens unissant Sougès, Blanc créole, et son demi-frère de couleur non reconnu, Jab-Herma, nous éclairent ainsi sur la prégnance des inégalités sociales et raciales, un siècle après l’abolition de l’esclavage. En outre, le rapport presque charnel que Sougès entretient avec son habitation et ses ouvriers rend compte de la charge passionnelle pesant sur des relations déjà intensément complexes, et ce, d’autant que les descendants de colons se retrouvent inévitablement pris entre le poids de leur patrimoine, leur lien à la terre natale et l’obligation de rendre des comptes aux instances métropolitaines. Les « ouvriers » eux-mêmes sont, par ailleurs, victimes de ce même genre de schizophrénie imposée : constamment sur la défensive, car conscients de l’injustice de leur position, ils se montrent néanmoins, dans le roman de M. Lacrosil, reconnaissants, voire admiratifs de ces hommes blancs, symboles de la toute puissance à laquelle ils sont inévitablement soumis. Ainsi, heureux des miettes offertes ou ramassées discrètement, tout en étant terrifiés à l’idée de transgresser l’interdit -et c’est en cela qu’ils se révèlent être porteurs de l’héritage colonial- ces descendants d’esclaves s’enferment alors dans un univers particulièrement complexe, régi par une autre forme de soumission, livrée cette-fois à l’autorité de la croyance.
Avec Demain Jab-Herma, et par le biais de l’enquête menée par Bonnier, Michèle Lacrosil parvient ainsi à rendre compte de la complexité de la société guadeloupéenne de l’époque et à en exposer les différents dysfonctionnements. En densifiant l’intrigue, par l’imbrication de multiples évènements, péripéties et agissements, elle témoigne de la complexité d’une société aux multiples ramifications.
Après une disparition et la découverte d’un cadavre, Bonnier, guidé par le pseudo-sorcier Jab-Herma, finit par comprendre toute l’affaire et démasque le coupable en la personne de Cragget, mulâtre schizophrène, incapable d’assumer tant sa « blanchitude » que sa négritude. Auteur du vol des barils, compromis avec le féticheur Kitsohamy Dinnh et meurtrier de deux jeunes femmes, Cragget s’est laissé emporté par sa folie, dans le but de découvrir un trésor enfoui et d’accéder enfin au pouvoir.
C’est précisément l’histoire de ce trésor, autrement dit le mobile du criminel, qui permet de faire le lien entre les différents éléments développés tout au long de l’intrigue. Selon la légende populaire, Louis Delgrès, célèbre Mulâtre libre, devenu marron au moment du rétablissement de l’esclavage en 1802, aurait enterré dans la prairie de Tirêha, une très grande quantité d’or. Avant d’affronter les troupes de Richepanse sur l’habitation Danglemont, Delgrès aurait, en effet, pris le soin d’enterrer une importante réserve d’or volée avec les cadavres de deux hommes, devenus alors les gardiens maudits du trésor ; quiconque tenterait de déterrer le trésor serait alors touché mortellement par la malédiction.
Or, la révélation de la légende de Delgrès, offrant de saisir les tenants et aboutissants de l’intrigue, a été permise par l’intervention de Jab-Herma, le sorcier de l’habitation, ou plus précisément celui qui est reconnu comme tel et dont le seul pouvoir finalement est celui d’être cru et de savoir en jouer ; sa devise est celle-ci : « Qu’importe le dieu s’il y a la foi »[111]. C’est donc Jab-Herma, le faux sorcier, qui fait ici figure d’enquêteur victorieux, doué non de pouvoirs mystérieux, mais simplement de logique, d’une grande capacité d’écoute et d’une influence suffisante sur les autres pour les faire parler. Ainsi, en ce qui concerne la résolution de l’énigme, la présence du commissaire Siguine, sur les lieux du crime, semble davantage tenir du second rôle que de la tête d’affiche, comme c’est traditionnellement le cas dans le roman policier classique, ce dont il semble avoir conscience, lorsqu’il déclare, lucide : « Un commissaire noir ne peut imiter Ponce Pilate »[112].
Il s’agit, pour Michèle Lacrosil, de signaler notamment le cloisonnement instauré par les propriétaires créoles, soucieux de résoudre eux-mêmes leurs propres dysfonctionnements, loin des regards officiels. Cependant, si l’enquête policière semble évoluer en marge du cœur de l’intrigue, elle permet néanmoins de dévoiler l’imposture de Jab-Herma et, par là même, de révéler sa formidable capacité d’adaptation. Jab-Herma s’avère être, en effet, le seul personnage véritablement en phase avec la complexité du monde créole. Frère de lait d’un Blanc créole, dont il est le chauffeur en même temps qu’un conseiller et un guide spirituel, Jab-Herma parvient à allier savoir et croyance, pouvoir et soumission ; il est avant tout celui qui crée le lien au sein de la mosaïque créole, celui qui, en rassemblant les morceaux de vérité détenus par chacun, parvient à reconstituer toute l’histoire.
L’ouvrage de Michèle Lacrosil se révèle donc particulièrement dense, rendant compte d’une réalité sociale et raciale extrêmement ambiguë et problématique. L’enquête criminelle devient le prétexte à l’exploration d’un monde entièrement régi par la fascination exercée par le pouvoir quasi mythique du maître sur l’esclave. Elle souligne également l’impossible rencontre de deux mondes, opposés par leur histoire. Ainsi, Bonnier ne parviendra jamais à véritablement entrer en contact avec le petit peuple :
« Philippe
et le village s’apercevaient de loin, sans entrer en contact. Sans tentative de
rapprochement. Ils étaient sur des orbites différentes. Philippe avait été
paralysé par la misère des cases, et la crainte de rencontrer de l’animosité.
Le village avait été frappé de stupeur par le spectacle de ce jeune monsieur si
dissemblable, venu de si loin. »[113]
L’usage que Michèle Lacrosil fait du genre policier n’a, en ce sens, rien de ludique ; il s’agit avant tout d’exprimer une réalité découlant d’une histoire marquée par le crime ; les insomnies et les cauchemars des uns et des autres, signes du remord, nous paraissent en ce sens particulièrement significatifs. En outre, au-delà de la profondeur du contexte socio-historique décrit, la romancière guadeloupéenne semble suggérer également une mise en abyme de son texte. Recherché par Bonnier et la police, Cragget se retranche finalement sur les lieux du crime, acculé au suicide. Désespéré, il tente de comprendre :
« Quel
était son rôle ? La pièce avait été agencée pour des Blancs, et il avait
eu à jouer le rôle réservé au Nègre, humble, humilié, il est la Laideur, le Mal
et le Crime, il est stupide, et finalement tué. Cragget protesta : Je ne
suis pas LE coupable. Il leva le bras, un geste de circonstance, il était en
scène ; il cria : Je ne suis pas un personnage, je suis une
situation. Il vit l’autre se rapprocher, il baissa la voix : Comme vous.
[…] Mais moi, je suis une situation intolérable, dont il me faut sortir à tout
prix. »[114]
Ayant lui-même composé son rôle dans cette fiction criminelle et se faisant ainsi double de l’écrivain, Cragget est finalement pris à son propre piège. Auteur de cette tragédie, il signe avec sa disparition l’avènement d’une nouvelle perspective, d’une redistribution des rôles, d’une redéfinition des tenants et aboutissants de la fiction et, en somme, en appelle à une nouvelle lecture de la société. Ainsi, bouleversé par le suicide de Cragget, Bonnier part se perdre dans la forêt, « retardant le moment de reprendre en charge son âme »[115], avant de finalement regagner le village, comme s’il y entrait pour la première fois, afin d’engager sa première vraie discussion avec les villageois.
Le roman de Michèle Lacrosil offre donc une perspective très intéressante du genre policier en ce qu’il permet de rendre compte d’une certaine réalité, de témoigner, d’interroger, de mettre en cause, de dénoncer. Tout en étant proche de celle de D. de Grandmaison, son adaptation de la forme policière se fait néanmoins plus marquante, plus pesante, notamment par la prégnance d’un style très travaillé et teinté de touches souvent métaphoriques.
Si D. de Grandmaison et M. Lacrosil s’accordent à orienter le genre policier vers une ambition plus littéraire, d’autres, en revanche, choisissent d’en exploiter l’aspect le moins « glorieux » ; c’est le cas notamment de Bertène Juminer.
1.1.4- Un exemple guyanais de reprise du genre policier : Bertène Juminer
Médecin et romancier guyanais, ami de Frantz Fanon, Bertène Juminer est l’auteur de quelques romans, publiés au cours des années 1960, s’inscrivant dans la perspective d’une littérature engagée et marqués par un certain lyrisme.
Le roman qui nous intéresse, intitulé Les Héritiers de la presqu’île et publié en 1979 aux éditions Présence africaine, se démarque de la production antérieure de l’auteur, par son caractère quelque peu « non conventionnel ».
Prenant pour cadre le Cap Vert et plus particulièrement la médina de Dakar -où « bat véritablement le cœur de l’Afrique »[116]- l’intrigue est tissée autour d’un personnage singulier, nommé Mamadou Lamine N’Diaye, alias Bob Yves Bacon, détective privé de profession. C’est, au demeurant, ce qu’il s’évertue à faire croire, à force d’indices pour le moins éloquents : inscription sur la porte de son bureau indiquant qu’il est « diplômé de l’Académie de Paris et du New Jersey »[117], diplômes encadrés ornant les murs du bureau, acquisition d’une machine à écrire, d’un ouvrage intitulé L’Avenir de la filature, ainsi que d’une photo-montage le représentant au pied de la statue de la Liberté, aux côtés des célèbres inspecteurs de Harlem, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones ; autant d’indices semés à la barbe de ses éventuels clients, susceptibles de l’aider à remédier à ses problèmes d’argent et assez ouverts d’esprit pour préférer ses services à ceux du marabout. Voilà pourquoi cet héritier des plus grandes figures d’enquêteurs anglo-saxons et français, se propose généreusement, par ses enquêtes, de « conjurer le mauvais sort, conquérir ou ne pas perdre un être cher, un poste, une promotion »[118]. Cependant, malgré ses tentatives de racolage, les affaires vont mal ; alors quand un client, un homme d’une cinquantaine d’années, vient lui demander d’enquêter sur sa seconde épouse, Bacon ne se fait pas prier.
C’est l’occasion pour B. Juminer d’explorer les rues de Dakar, marquées par « un incoercible et sourd combat entre modernisme et tradition »[119], ainsi que par une formidable vivacité entretenue notamment par une grande activité artisanale et commerciale. Le récit de l’enquête fait ainsi l’objet de perpétuelles digressions : évocation du rôle des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale, de la condition des femmes africaines, de l’européanisation de l’Afrique, ou encore de l’homosexualité. Autant de sujets de société que l’enquête ne parvient pas véritablement à porter, qui ne trouvent aucune cohésion au sein de l’intrigue et qui, finalement, confèrent au roman une certaine confusion sensible, par ailleurs, dans le dénouement de l’intrigue. En effet, l’enquête confiée à Bacon s’avère être un piège qui lui a été tendu afin de démasquer ses activités licencieuses : Bacon est arrêté, menotté et contraint au repentir. Il s’écrit ainsi au terme de ce roman : « Je suis Sénégalais : je m’appelle Mamadou Lamine N’Diaye ! »[120], revendiquant par là même son identité nègre, bafouée par ses mensonges et son désir d’être un autre.
Le roman Les Héritiers de la presqu’île ne peut être considéré comme relevant totalement du genre policier. Une enquête est effectivement menée, plus ou moins consciencieusement par un personnage sollicité par un client, mais son objet est en fait monté de toutes pièces et l’enquêteur n’en est pas un officiellement ; pire, c’est un usurpateur. Si le roman s’achève sur une révélation finale, ce n’est que dans le but de démasquer l’enquêteur-usurpateur et, par conséquent, de nier la nature policière du récit. Ainsi, la présence du détective privé, loin d’accréditer la constitution d’un récit d’énigme en signe, d’une certaine manière, l’illégitimité. Il s’agit, pour l’auteur, de s’inspirer précisément de ce genre prisé et reconnu en France et aux Etats-Unis -la photographie d’Ed Cercueil et Fossoyeur en atteste- pour accabler son personnage, pris en flagrant délit d’acculturation. Autrement dit, si la reprise du genre policier permet à Bertène Juminer de mener, au niveau du récit, une enquête à vocation sociologique sur Dakar et sa médina, elle constitue surtout, au niveau de l’intrigue, la pièce maîtresse du dossier à charge monté contre son personnage.
Avant de nous intéresser aux prémices du genre policier dans la sphère littéraire maghrébine, ouvrons simplement une parenthèse concernant un autre écrivain guyanais, René Jadfard (1901-1947), auteur, dans les années 1940, d’un roman policier intitulé L’Assassin joue et perd[121]. Bien que parfait connaisseur des profondeurs de son pays natal, R. Jadfard situe l’intrigue de ce roman, paru à Paris en 1941, sous le pseudonyme de Georges Madal : un cambrioleur malchanceux obtient la protection d’un homme mystérieux qui, en échange, lui confie une mission. Peu de temps après, deux candidats à l’Académie, tous deux rivaux du célèbre écrivain Jean Brière, sont assassinés ; l’inspecteur Ralph, grand observateur, silencieux, élégant, qui force le respect, est chargé de l’enquête.
R. Jadfard propose ici un roman policier de forme classique dont l’originalité réside, comme le souligne J. Corzani[122], dans sa manière d’être en prise directe avec l’actualité tourmentée de l’époque. En effet, Ralph est mis sur la voie du criminel par la lecture d’un ouvrage se faisant l’apologie du crime et qui est comparé à Mein Kampf : une intertextualité particulièrement audacieuse en 1941.
Cet aperçu des antécédents du genre policier dans la littérature francophone antillaise nous paraît significatif à bien des égards, et notamment dans la mesure où il rend compte des multiples potentialités et orientations du genre. Les approches gothiques et feuilletonesques de la fin du XIXème et du début du XXème siècles, par des auteurs en grande partie issus de la bourgeoisie blanche, illustrent le genre dans ce qu’il a de moins « noble » : sensationnalisme, fantasmes névrotiques, tendance marquée au préjugé, voire au racisme, valorisation de l’approche romanesque aux dépens de la peinture sociale. Cette perspective, parfois obstinément reprise, sera « relevée » par quelques auteurs plus talentueux et véritablement dépassée avec Daniel de Grandmaison. Ce dernier, tout en s’inspirant largement de la forme policière classique du whodunit et en s’inscrivant, en partie, dans une perspective ludique, fait preuve d’une certaine ouverture d’esprit qui lui permet de brosser un portrait intéressant, car critique, de la société créole des années 1950, tout en se permettant quelques libertés et fantaisies d’un point de vue formel.
C’est également dans la perspective d’une approche approfondie de la forme policière que Michèle Lacrosil propose un roman relativement complexe, qui se fait le miroir des dysfonctionnements propres à la société guadeloupéenne des années 1950. En s’inspirant de la forme policière classique, tout en tenant à distance, de manière tout à fait réaliste, la police officielle, bête noire des milieux blancs créoles fonctionnant davantage en circuit fermé, M. Lacrosil sème, tout au long du roman, les indices nécessaires à la compréhension d’une société profondément marquée par un passé criminel qui ne cesse de la hanter.
Enfin, la démarche de Bertène Juminer semble s’inscrire dans une perspective opposée à celle des deux précédents : tandis que M. Lacrosil et D. de Grandmaison utilisent le genre comme catalyseur d’un regard critique porté sur la société, le Guyanais choisit, d’une certaine manière, d’exploiter la mauvaise réputation du genre et d’en transgresser les règles, afin d’asseoir le ressort principal de son intrigue ; un choix qui, s’il n’est pas exploité de manière efficace et concluante dans Les Héritiers de la presqu’île, relève d’une intention originale et susceptible d’inspirer d’autres tentatives plus pertinentes de détournement de la forme policière.
1.2- Implantation tardive dans la sphère littéraire maghrébine
Si le genre policier amorce son implantation au sein de la littérature francophone antillaise par touches plus ou moins pertinentes ou remarquables dès la fin du XIXème siècle et plus précisément à partir des années 1950, il n’apparaît pas de manière aussi significative dans l’espace littéraire maghrébin, avant les années 1970. Toutefois, bien que tardive, son apparition s’est alors faite de manière remarquée avec l’arrivée sur le devant de la scène littéraire maghrébine du roman d’espionnage, variante du genre policier dont le développement se révèle significatif aussi bien d’un point de vue littéraire que dans la perspective d’une approche sociologique.
Devancé par le roman d’espionnage, le roman policier traditionnel ne tarde pas cependant à faire son apparition ; nous verrons, en effet, qu’après s’être intéressés au roman d’espionnage au cours des années 1970, les écrivains maghrébins se sont progressivement orientés vers une approche plus classique du genre policier, à partir des années 1980. Là encore, nous pourrons nous interroger sur les raisons et circonstances de ce recours à la forme policière et tenter de définir l’influence de ces prémices sur l’ensemble des ouvrages de notre corpus.
1.2.1- Romans d’espionnage des années 1970
Précisons d’ores et déjà que la lecture du travail de l’Algérien Rédha Belhadjoudja, auteur de la première thèse consacrée au roman policier algérien[123], ainsi que de celui de l’Autrichienne Beate Bechter-Burtscher[124], nous ont été précieuses dans le cadre de cette approche du roman d’espionnage algérien des années 1970.
R. Belhadjoudja et B. Bechter s’accordent à faire coïncider la naissance du roman d’espionnage algérien avec la parution des romans de Youcef Khader, dès 1970. Le critique algérien souligne néanmoins l’existence d’un premier roman d’espionnage, paru dès 1967, sous la plume d’Abdelaziz Lamrani, intitulé Piège à Tel-Aviv. Notons que cette affirmation est contestée par B. Bechter, ainsi que par Jean Déjeux[125], qui attribuent à Piège à Tel Aviv la date de 1980, précisant que si le prologue du roman est daté de 1967, l’action, elle, remonte à 1971. L’Autrichienne insiste par ailleurs sur le fait que le prétendu second roman de R. Lamrani, intitulé D. contre-attaque et publié en 1973, a tout l’air d’être en réalité son premier ouvrage.
Quoi qu’il en soit, ne pouvant affirmer ni infirmer l’une ou l’autre de ces déclarations, faute de preuve irréfutable, retenons simplement que R. Lamrani et Y. Khader investissent tous deux le genre policier par la voie du roman d’espionnage et que la portée idéologique de leurs romans relève d’une approche sensiblement identique. Remarquons également que l’impact khaderien sur le public et la presse de l’époque est incontestable, si bien que, de l’avis général, c’est bien Youcef Khader qui est présenté comme le père du roman d’espionnage algérien, devant son succès à la sérialité de ses ouvrages, à la politique éditoriale de l’époque, favorable aux grands tirages et à une large diffusion, ainsi qu’à l’enthousiasme de la presse.
Rédha Belhadjoudja précise, après lecture de certains journaux d’époque, Le Moudjahid en particulier, que les quatre premiers romans de Youcef Khader, publiés en 1970, ont globalement été accueillis favorablement par le public et la critique : par le public, censé être attiré par le goût du mystère, de l’aventure et par le prix modéré fixé par la SNED pour ces ouvrages ; par la critique, séduite par l’élan de nouveauté accompagnant l’éclosion de ce genre, à l’imaginaire fertile, ainsi que par la perspective d’un renouveau de la littérature algérienne.
Comme nous venons de le suggérer, le succès de ces ouvrages tient à plusieurs éléments. A l’instar du roman policier classique, le roman d’espionnage -variante à connotations politiques du genre- participe de la littérature populaire et se plie tout à fait à une production en série, soutenue par la mise en vedette d’un personnage marquant. Globalement, le héros mis en scène par le roman d’espionnage n’est ni un policier, ni un enquêteur privé, mais une sorte de compilation des deux en la figure de l’espion, enquêteur et homme d’action au service de l’Etat. Opérant en marge des sentiers officiels et publics, l’espion est capable d’allier intelligence et force physique, ruse et courage, oeuvrant pour le salut non pas de quelques hommes mais de tout un pays, voire du monde entier ; il s’agit, autrement dit, d’un « super-héros » au service du Bien contre le Mal.
Dans les romans d’espionnage de Youcef Khader[126], le « super-héros » est incarné par le lieutenant Mourad Saber de la Sécurité Militaire Algérienne, alias SM 15. La lecture de deux romans de Khader, en particulier Halte! au plan « Terreur » et Délivrez la Fidayia !, nous renseigne sur ses extraordinaires capacités. Outre « son œil remarquablement aigu », « son esprit constamment en éveil » et sa capacité à « exécuter mécaniquement les gestes nécessaires [pour affronter quatre adversaires] tandis que son esprit continu[e] de vagabonder autour du problème en suspens »[127], Mourad Saber jouit d’une popularité quasi mythique :
« C’était
un des plus brillants éléments de l’A.N.P. Mourad aurait dû être tué cent fois,
durant la guerre de Libération. On disait de lui, à l’époque, dans les Aurès,
qu’il avait la baraka. Il était doué à la fois du courage du lion, de la
prudence du renard et de la ruse du serpent. Ses hommes l’auréolaient d’une
sorte de légende. Ils l’appelaient entre eux “Cham’s el Dine”, le soleil
symbolisant ce renouveau auquel tous aspiraient.»[128]
Cette popularité est légitimée par ses incroyables facultés :
« Ce
garçon de trente-deux ans en imposait physiquement. Un mètre quatre-vingt cinq
de muscles et de nerfs, l’œil et le geste prompts, tireur émérite et rompu à
tous les sports de combat, il donnait une extraordinaire impression de force
souple, d’équilibre. Mourad semblait avoir entraîné son corps d’athlète à ne
réagir qu’à son commandement. »[129]
Précisons enfin que la panoplie du « super-héros » serait incomplète, sans quelques attributs d’ordre esthétique :
« Il
avait un visage ascétique aux pommettes saillantes, un nez long et busqué en
forme de bec d’oiseau de proie, une bouche au pli sévère qu’adoucissait parfois
d’une manière inattendue un sourire empreint de bonté. Bref, il était beau,
d’une beauté virile assez fascinante. »[130]
Youcef Khader brosse ainsi de son héros un portrait plus qu’élogieux, agaçant même d’invraisemblances -signalons pour finir que Mourad Saber vient à bout, dans Halte ! au plan « Terreur », d’un requin tigre de huit mètres de long à l’aide d’un simple couteau- qui n’a rien à envier à la fameuse série française des S.A.S. Entre l’espion mis en scène par Gérard de Villiers et Mourad Saber, peu de différences, si ce n’est un détail non négligeable que souligne Rhéda Belhadjoudja : contrairement aux héros d’espionnage occidentaux, la vie amoureuse de Saber est quasi inexistante. Cette abstinence, valable également pour l’alcool et le tabac, le distingue sensiblement des espions occidentaux :
« L’analyse
du profil sexuel de SM15 et de S.A.S. a permis de mettre au jour la nette
opposition entre un héros asexué et un héros hyper-sexué. Dans la multitude de
combats que mène l’espion algérien, il en est un qui lui tient particulièrement
à cœur : la sauvegarde de la morale arabo-musulmane face à la dépravation
sexuelle occidentale. »[131]
Or cette distinction se révèle être tout à fait significative. Il convient en effet de préciser que l’arrivée du roman d’espionnage, et de Youcef Khader en particulier, sur le marché du livre algérien, loin d’être fortuite, semble répondre précisément à la vague internationalement populaire des S.A.S. qui a, entre autres, déferlé sur le paysage littéraire maghrébin.
En effet, selon Robert Escallier[132], 1/6ème des titres de SAS font référence au monde arabe et lorsque la ville arabe y sert de décor, c’est agrémentée de perspectives stéréotypées que nous la découvrons : odeurs épicées, couleurs, désordre, agitation et autres représentations se voulant caractéristiques du souk et de la ville arabe en général. Aussi, conformément au cadre qui les accueille, les personnages présentés apparaissent davantage sous la forme de « types » que d’êtres humains individuels :
« Pour l’auteur de S.A.S., les sociétés arabes ne sont que l’agrégat d’individus indifférenciés, stéréotypés physiquement et psychologiquement, dont il décrit les caractères, les mêmes que ceux qu’appliquait la propagande à l’égard du juif. Les termes employés -injurieux et virulents, avilissants et ignobles vis-à-vis de l’arabe- appartiennent au vocabulaire des partis racistes et xénophobes d’extrême droite, au langage refoulé et défoulé du café de commerce. Les poncifs éculés les plus racistes sont repris et étalés, véhiculant une pensée sommaire. »[133]
Notons que cette approche présente certaines affinités avec celle proposée par Youcef Khader, car si Mourad Saber est aussi talentueux, c’est bien pour venir à bout de ses adversaires qui, en cette période de conflit israélo-arabe, ne peuvent être autres que les Sionistes. Un des personnages de Délivrez la Fidayia !, le Consul Amar ben Miloud, précise d’ailleurs à propos de l’enlèvement de l’épouse du chef de commando fidayi[134] :
« Ce
qui vient de se passer s’inscrit dans le contexte de violence dont la nation
arabe est victime en permanence de la part des sionistes. Je précise
bien : “sionistes”, et non “Juifs”. »[135]
C’est donc le sionisme qui est visé, défendu ardemment par les services secrets israéliens, c’est-à-dire le Shin Beth. Il n’empêche que lorsque Mourad critique ses adversaires, c’est bien des « Israéliens » -l’usage des guillemets est quasi systématique- dont il s’agit. Pour preuve, certaines de ses déclarations dans Halte ! au plan « Terreur » :
« Il y
avait dans les yeux de l’inconnu, dans sa manière de redresser le menton, cette
assurance de soi faite d’arrogance méprisante qui n’appartient qu’aux
“Israéliens”. »
« Mourad
avait déjà eu l’occasion d’observer chez les “Israéliens” cette tendance à se
croire plus malins que les autres. »
« Les
“Israéliens” s’inspirent des méthodes des immigrants américains dont les lois
avaient été tout entières contenues dans le barillet de leurs
colts. C’était par le meurtre qu’eux aussi prétendaient défendre le bien
qu’ils s’étaient approprié… »[136]
Notons par ailleurs que lorsque la critique se fait plus acerbe, il arrive que le terme « Israélien » soit remplacé par celui d’« israélite », comme dans le passage suivant :
« C’était
un de ces israélites qui mangent le pain arabe et qui mordent la main qui les
nourrit. »[137]
La critique apparaît donc virulente à deux niveaux : d’un point de vue politique, Y. Khader se fait fort de dénoncer ce qu’il désigne comme relevant de l’impérialisme sioniste, soutenu notamment par les Etats-Unis ; sur le plan humain, c’est de l’arrogance et du sentiment de supériorité des « Israéliens » que Y. Khader tente de convaincre, à l’aide de réflexions non tant anti-sionistes que véritablement antisémites, comme en atteste notamment le glissement vers l’usage du terme « israélite ».
Les romans de Youcef Khader ont donc une portée idéologique très forte ; mieux, ils semblent résulter véritablement d’une démarche politique, d’une commande à laquelle Y. Khader a bien voulu répondre. Cette perspective extra-littéraire paraît d’autant plus ambiguë que Youcef Khader, pseudonyme de Roger Vilatimo, dit Vlatino (1918-1980), n’est en réalité pas Algérien.
Citant un article publié dans El Moudjahid[138], Rédha Belhadjoudja rapporte les propos de Youcef Khader qui prétend avoir eu recours au pseudonyme pour des raisons de sécurité ; il paraît plus vraisemblable d’imaginer qu’il s’agissait en fait de paraître plus crédible aux yeux du lectorat algérien et d’avoir, par conséquent, plus de poids dans la propagande ainsi engagée, en assurant, dans le même temps, un certain intérêt du public, propice à l’évolution des ventes.
La portée idéologique, voire propagandiste, sensible dans les ouvrages de Youcef Khader, est également perceptible dans les deux romans d’espionnage publiés par R. Lamrani[139] qui suivent également le schéma traditionnel du genre, en mettant en scène Emir 17, agent des services secrets algériens, formé au combat lors de la guerre de libération et secondé -contrairement à SM 15 qui n’a besoin de personne- par d’autres agents compétents, dont Emir 13 ou Emir 37.
Si ces ouvrages paraissent limités d’un point de vue littéraire, ils présentent néanmoins l’intérêt de rendre compte de l’atmosphère politique algérienne de l’époque, comme le souligne Guy Dugas, qui résume en ces termes l’objectif de ces romans :
« Dénonciation
du sionisme et de ses “alliés objectifs” (Etats-Unis en premier lieu, mais
aussi à l’occasion, France ou Espagne), glorification de l’Algérie nationaliste
[…] et socialiste, solidarité avec les pays opprimés dans une prometteuse
“troisième voie” dont l’Algérie serait à la fois la preuve et le ferment : il apparaît comme une évidence que
c’est l’idéologie du pouvoir en place, particulièrement sous Boumediene
(1965-1978) qui est ici illustrée, selon une stratégie de pérennisation, plus
que de remise en cause, des stéréotypes et topoï préexistants. »[140]
Selon B. Bechter encore, cette politisation de l’objet littéraire témoigne de « l’algérianité des premiers romans policiers algériens »[141] et va de pair avec la mise en place d’une « écriture affirmative et idéologique, écriture conforme au système politique et au pouvoir algérien »[142].
Signalons enfin l’existence de trois romans d’espionnage tunisiens, écrits par Kamel Ghattas, visiblement très inspiré par Y. Khader : Souris blanche à Madrid (1977) ; Peshmerga (1977) ; Mystification à Bérouth (1978)[143]. Toutefois, l’initiative reste sans lendemain, en Tunisie, où la production littéraire d’inspiration policière cesse pendant de nombreuses années, avant de reprendre il y a peu, notamment à l’initiative des Editions Alyssa ; nous y reviendrons ultérieurement.
A l’inverse, le mouvement s’est poursuivi notamment en Algérie, même si, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la vague menée par Youcef Khader n’a pas eu les retentissements espérés sur le paysage littéraire algérien, puisqu’il faut attendre 1981 pour la parution d’un nouveau roman d’inspiration policière ; une coupure qui, selon R. Belhadjoudja, « fait de l’œuvre de Youcef Khader la manifestation patente d’une naissance avortée du genre en Algérie »[144].
1.2.2- Premiers romans policiers des années 1980
Entre 1981 et 1989, cinq écrivains algériens prennent le parti de s’intéresser au genre policier, en s’inscrivant notamment dans la lignée du roman d’espionnage khaderien, mais surtout en amorçant un renouvellement du genre par le recours à la forme du roman noir. Notons cependant que tous n’appréhendent pas de la même façon le genre policier et qu’ils conçoivent également différemment le rapport du genre à la réalité algérienne.
Nous distinguerons donc, d’une part, l’approche relativement conventionnelle et peu novatrice des romans de Larbi Abahri (Banderilles et muleta, 1981), Houfani Berfas (Le Portrait du disparu, 1986 ; Les Pirates du désert, 1986) et Rabah Zeghouda (Double Djo pour une muette, 1988) ; d’autre part, les romans plus critiques, plus imprégnés socialement et plus marquants d’un point de vue littéraire, de Djamel Dib (La Résurrection d’Antar, 1986 ; La Saga des djinns, 1986 ; L’Archipel du Stalag, 1989) et Salim Aïssa (Mimouna, 1987 ; Adel s’emmêle…, 1988)[145].
Avant de nous pencher plus précisément sur ces différents ouvrages, intéressons-nous aux conditions d’émergence du genre policier en Algérie à cette époque-là.
Comme le souligne Beate Bechter et ainsi que nous l’avions signalé à propos du développement du genre aux Etats-Unis, en Angleterre et en France, la modification du paysage urbain et l’industrialisation ont eu un impact considérable sur l’évolution et l’enracinement du genre policier. En ce qui concerne l’Algérie, B. Bechter précise :
« L’urbanisation et l’industrialisation massives des deux décennies d’après l’indépendance ont complètement changé les conditions sociales et économiques en Algérie. Mais ce développement a aussi des côtés négatifs : pauvreté et crimes s’étendent dans la capitale algérienne et créent, avec les changements indiqués ci-dessus, les conditions majeures de la naissance et, dans la suite, de l’enracinement du genre en Algérie, car c’est l’environnement urbain qui, à la longue, garantit l’ancrage du genre en Algérie. »[146]
Le début des années 1980, en Algérie, est donc marqué par des bouleversements socio-économiques qui s’aggraveront jusqu’à atteindre leur paroxysme au moment des émeutes de 1988.
Wadi Bouzar[147] pointe quelques symptômes de la crise à venir apparus dès le début de cette décennie : il évoque par exemple la baisse des revenus des hydrocarbures, en 1982 ; la surpopulation urbaine ; la naissance du trabendo, marché parallèle fondé sur la vente, en Algérie, à prix forts -les bénéfices sont décuplés dans la monnaie locale- de produits achetés en France ou dans d’autres pays étrangers ; les fraudes fiscales, encouragées par une mauvaise organisation des services du fisc ; la multiplication des détournements de fonds, favorisés par un certain laxisme, à l’égard de ces questions, du Président Chadli. W. Bouzar résume :
« D’une
façon générale, les débuts de la libéralisation économique n’ont fait
qu’aiguiser les appétits de la nomenklatura. Pour toutes ces raisons, l’Etat
perd énormément d’argent. »[148]
C’est donc bien l’argent qui devient le moteur essentiel de la société algérienne dans les années 1980 et, tandis que les conditions de vie se dégradent, quelques individus s’enrichissent ; une situation de crise latente tout à fait propice au développement du genre policier et plus précisément à sa variante noire. Les romans de L. Abahri, H. Berfas et R. Zeghouda sont pourtant loin de la veine d’un Chester Himes, par exemple. En effet, si chacun d’entre eux tente d’apporter sa pierre à l’édifice, le discours idéologique de fond se démarque peu de celui de Youcef Khader. La main mise de l’Etat sur la portée idéologique de ces romans est nettement moins perceptible, mais la critique y paraît encore peu autonome et les perspectives de renouveau moins encourageantes. Si L. Abahri s’efforce de porter un regard sur la crise, il ne parvient pas pour autant à ancrer son roman dans la réalité algérienne, dans la mesure où il semble vouloir attribuer, en grande partie, à des pays étrangers, occidentaux notamment, la responsabilité de cette crise. Rhéda Belhadjoudja précise :
« Il
ne s’agit plus de combattre le sionisme, mais de s’attaquer aux crimes
économiques grevant les finances du pays et perpétrés par des opérateurs
algériens et internationaux. En cela, la rupture n’est que partielle, car même
si l’intrigue débute en Algérie, elle se déplace rapidement vers l’espace
extérieur supposé générer et reproduire des fléaux comme des crimes économiques
(la France, l’Espagne et l’Occident d’une manière générale). »[149]
Contrairement à L. Abahri, H. Berfas tente de s’en tenir au territoire algérien, de se libérer de l’inspiration « khaderienne », et par là même, des modèles occidentaux. Or, s’il parvient effectivement à ancrer l’intrigue de ses romans en Algérie, il échoue dans sa tentative de porter un regard véritablement algérien sur son pays ; ses descriptions paraissent peu réalistes voire stéréotypées. Selon B. Bechter, bien que situés en Algérie, les lieux de l’action sont, dans les romans de H. Berfas, toujours artificiels :
« Le Portrait du disparu se passe à Alger
mais pourrait avoir pour cadre n’importe quelle autre ville ; et, dans Les Pirates du désert, les descriptions
idéalisées de Tamanrasset et de la vie dans le sud de l’Algérie paraissent,
dans la plupart des cas, être des extraits de documentaires. »[150]
R. Zeghouda quant à lui, bien qu’intervenant à la fin des années 1980, en pleine période de révolution sociale, signe un certain recul dans l’évolution du genre policier en s’inscrivant dans la perspective « khaderienne », plus moralisante que véritablement critique. R. Belhadjoudja déclare en ce sens, à propos de Double Djo pour une muette :
« Avec
ce roman, la progression plus ou moins sensible dans la thématique et dans la
forme initiée par les jeunes auteurs connaît un recul. Le lecteur replonge dans
les pamphlets moralisateurs et prédicateurs. Le héros réendosse son armure de
preux chevalier sans peur et sans reproche. L’intrigue et l’effet de suspense,
eux, prennent une nouvelle fois la clé des champs, laissant le genre en proie à
une crise d’identité profonde. »[151]
Ainsi, selon R. Belhadjoudja, le roman de R. Zeghouda signe une régression dans l’histoire du genre, à l’opposé des avancées permises par Salim Aïssa et Djamel Dib qui, avec leurs romans d’inspiration noire, semblent véritablement permettre au genre de s’ancrer d’avantage dans la réalité algérienne.
La ville algérienne, en particulier, possède en effet, notamment dans la deuxième moitié des années 1980, quelques caractéristiques propices à l’accueil du roman noir, ce que souligne Hadj Miliani :
« A
partir du milieu des années 80, l’ouverture vers l’économie de marché, les
dernières désillusions du socialisme “spécifique”, la volonté de répondre à une
demande diversifiée du lectorat, la découverte également d’univers sociaux
jusqu’ici pieusement tus et que la presse emblématise : hittiste, tchi tchi, bouhi,
l’univers interlope des boites de nuit et leur cortège de “fléaux sociaux” vont
constituer le cadre socio-économique pour l’émergence du livre policier. Mimouna et Adel s’emmêle de Salim Aïssa racontent très bien ce climat de
déliquescence douce et d’arrivisme clinquant qui annonce le grand chambardement
d’octobre 88. »[152]
Salim Aïssa reprend, en outre, une des grandes perspectives du roman noir traditionnel en mettant en scène des personnages contraints à lutter contre des groupes puissants : il développe le thème de l’individu qui n’est ni parfait ni irréprochable, face au système qui est corrompu. Le Bien contre le Mal cède la place au Meilleur contre le Pire, l’humour et l’ironie étant chargés de pallier ce manque flagrant d’idéalisme. Pourvus d’un sens de l’humour plutôt développé, les personnages de Salim Aïssa notamment acquièrent une certaine indépendance, permettant à l’auteur de tenter une approche plus psychologique de leur profil. Par ailleurs, au-delà d’une évolution dans la densité des personnages, le discours de S. Aïssa se fait beaucoup plus percutant à l’égard du pouvoir qui, s’il n’est pas attaqué directement, n’échappe pas à la critique. Cette dernière approche se retrouve dans l’œuvre de Djamel Dib, sur laquelle nous nous proposons de nous arrêter quelques instants, notamment à la lecture de son dernier roman policier publié en 1989, période de grande crise sociale, et intitulé L’Archipel du stalag.
Djamel Dib[153], ancien membre du réseau des fidayines de Tlemcen, arrêté et emprisonné en 1959 -il s’évade la même année-, étudiant à l’école polytechnique d’El-Harrach après l’Indépendance, puis diplômé de l’Institut français des pétroles -ce qui lui permet d’assumer de hautes responsabilités en tant que cadre à la Sonatrach- est venu tardivement à la littérature : il confie à l’ENAL ses trois romans policiers entre 1986 et 1987. Précisons que L’Archipel du Stalag publié en 1989 semble avoir été écrit en 1987 : en effet, dans une interview accordée à Horizons, en 1988, D. Dib fait référence à ce roman qu’il dit avoir déposé à l’ENAL depuis près d’un an.
Au cours de ce même entretien, il livre, par ailleurs, sa conception du roman policier :
« Le
roman policier met en œuvre des personnages qui sont de nature très variée. Il
y a de l’intrigue, de l’énigme et du suspense. Mon type d’aventures policières
est le mixage, un fond historique, un aspect social très développé, un espace
culturel et géographique qui est beaucoup plus large. Le roman policier est une
architecture rigoureuse où il faut chercher à retenir l’intérêt du lecteur et
de bien doser ses digressions. Il faut une intrigue intelligente. Dans le roman
policier, on n’a pas le droit de divaguer. »[154]
Rappelant la perspective du montage en kit évoqué par J. Dubois, D. Dib présente le roman policier comme relevant davantage de la recette de cuisine que de l’« écriture inspirée », dont participe, à l’inverse, ce qu’il nomme le « roman roman ». D. Dib précise néanmoins, à propos de ces deux types de romans :
« Ils
ont une base commune : c’est une œuvre artistique. Ce qui fait sa valeur,
c’est sa dimension esthétique. Tous les deux doivent s’inscrire dans une
perspective de progrès. J’entends par là que leur devoir commun est la défense
de l’intégrité de la dignité humaine. »[155]
D. Dib semble ainsi tenir à ce que ses romans policiers s’inscrivent véritablement dans une dimension sociale, voire humaniste ; une orientation inscrite d’emblée, dès la première page de L’Archipel du Stalag :
« Que
faut-il de plus qu’un bon parapluie et de bons souliers à un bon
enquêteur ? Une loupe, un imper, des poucettes, son arme de service et une
boule de cristal. Rien de plus en Algérie, où les Droits de l’Homme liguent à
tout va, d’a contrario de prétoire en
épectase à la Monseigneur. Un peu plus loin, vous ajoutez la gégène et la
baignoire. Et plus loin encore, le chalumeau et la tronçonneuse. Vous voyez,
dans le pire des cas, c’est deux fois rien ! »[156]
Cette première approche, vive et cinglante d’ironie, se voit rapidement sous-tendue par la personnalité quelque peu iconoclaste du narrateur, l’inspecteur principal Antar, qui se présente ainsi à ses lecteurs :
« Je
suis l’unique, le valeureux, le bien-aimé de ma pomme, le chéri de plus d’une,
le bourreau des cœurs, la terreur des malfrats, le seul capable de remplacer le
fil à couper le beurre et qui s’en flatte ! Bref, l’inspecteur principal
Antar, le chargé de et de, c’est votre serviteur. »[157]
La manière dont Antar se présente semble l’apparenter au célèbre enquêteur français né sous la plume de Frédéric Dard, partageant avec lui son goût pour l’argot, son esprit gouailleur et sa loquacité. Or, confier le rôle principal du roman ainsi que celui du narrateur à un bavard revient à entraîner le lecteur dans un récit particulièrement touffu et riche en digressions ; d’où cet avertissement adressé au lecteur en tête du premier chapitre :
« Ceux
qui sont pressés, impatients, ceux qui se foutent au cube de savoir pourquoi je
suis là, et qui veulent passer sans tarder aux choses sérieuses, ceux-là
peuvent sauter ce chapitre et le suivant. Les autres, les fidèles, les incons
pas cons, ils ne regretteront pas beaucoup le détour. Je m’en voudrais
d’ailleurs de dissimuler le moindre fait de cette curieuse aventure à ces
braves gens, généreux pour le meilleur, et si indulgents pour le pire. »[158]
Inutile de douter dès lors de l’influence de San Antonio sur Djamel Dib qui semble particulièrement se plaire au jeu de l’interactivité entre narrateur et lecteur. Ainsi, dès l’ouverture du récit, Antar et ses acolytes -l’Apprenti, « le face-de-rat […] le pèse-peu badigeonné en bleu, l’ahuri, l’abruti »[159] et Bendjahel Le Mocco, « l’Hénorme, l’adipeux, l’obèse »[160]- s’en prennent à l’auteur lui-même, ce « marionnettiste qui se prenait pour un auteur et qui nous racontait. Si mal et à son seul profit »[161]. Autrement dit, c’est à une rébellion des personnages que le lecteur assiste, doléances et revendications à l’appui, dont voici un florilège :
« C’est
nous qui allons au casse-gueule, et c’est lui qui veut toucher des droits
d’auteurs ! Mais enfin, c’est de l’exploitation éhontée, du racket, de
l’arnaque ! »
« Question
devises, c’est la dèche noire. Tu nous obliges à tâter du marché parallèle, à
trois dinars le franc, pour une petite virée chez Tati. Parce que t’es infoutu
de nous éditer à l’étranger. Que ça pourrait au moins nous couvrir les frais de
séjour, ya garnebliss. »
« Le
talent, tu n’en as pas, et la contestation, tu n’oses pas, flubard, malgré la
ligue des Droits de l’Homme. C’est tes oignons après tout. Maintenant,
qu’est-ce que c’est que ces façons de nous faire faire que des enquêtes en
Algérie ? On voudrait voyager, voir des pays, merde ! »[162]
L’auteur répond alors :
« Savez-vous
que je vous raconte à perte, moi ? Parfaitement, messieurs, je suis
dé-fi-ci-taire ! »
« Il
n’y a pas que le talent de nos Titans ès lettres pour éditer à l’étranger. Oh
que non ! Il y a mieux, et plus facile […]. C’est d’être porteur d’idées
qui plaisent aux devises […]. Ce n’est pas un hasard si certains succès
littéraires à l’étranger se nourrissent de nos traditions décrites comme des
travers, de nos valeurs montrées comme des horreurs, de nos différences jugées
sur de fausses références. »
« Enquêter
à l’étranger ! Comme s’il n’y avait pas assez à faire ici ! »[163]
Le conflit aboutit finalement à la rupture entre les deux parties et à la prise d’indépendance des personnages, écœurés par le manque de moyens, d’ambition et de perspectives d’avenir que leur propose celui qui les dirige. Comment, dès lors, ne pas envisager un rapprochement de la situation de ces personnages avec celle des Algériens en général : la référence au trabendo, au parisianisme imposé aux intellectuels désireux de se faire entendre hors d’Algérie et à l’exploitation de la main d’œuvre, semblent trahir, d’une certaine manière, l’opinion de D. Dib à l’égard de la réalité algérienne. A un degré évidemment moindre et dans une perspective beaucoup moins tragique, la rupture entre les personnages et l’auteur rappelle, après coup, celle qui se produira lors des émeutes d’octobre 1988, entre le peuple et l’Etat.
Notons cependant que si D. Dib s’interroge sur différents dysfonctionnements inhérents au système algérien, les accusations qu’il porte sont en grande partie adressées aux Occidentaux. Relevons à cet égard quelques passages significatifs :
« Lorsque
les Français ont commis les mêmes crimes en Algérie, et pour les mêmes raisons,
le bourreau avait au moins l’excuse d’être étranger à la victime ! »
« Etrange que les médias occidentaux n’aient jamais dénoncé ces crimes contre l’humanité. C’est vrai qu’ils sont occupés à conjurer un péril autrement plus urgent : l’Islam ! »[164]
Relevons encore la réaction du Mocco lorsque l’Apprenti propose de partir à l’étranger le plus proche, autrement dit la Kabylie :
« Répète
encore, fesse-de-rat, que la Kabylie c’est l’estango, répète donc, sale
maaskri ! Sais-tu combien de martyrs y sont tombés de 1830 à 1962 ?
Un demi-million sur les six du pays. Tu vois, Antar, c’est la preuve que ce
fumier lit l’Express et « Jeune-à-fric». Il croit, ce con, que c’est la
poignée de cavaliers d’Okba et d’Ibn-Noceïr qui ont dépeuplé puis repeuplé le
Maghreb et la moitié de l’Afrique, jusqu’à Zanzibar ! »[165]
Dans ce dernier cas, la colère du Mocco concerne autant les médias français que les Algériens qui méprisent ou ne reconnaissent pas la Kabylie en tant qu’entité culturelle. Rappelons qu’en avril 1980, des émeutes avaient éclaté à Tizi Ouzou pour la reconnaissance de la langue et de la culture berbères.
Notons, d’autre part, que lorsque les Occidentaux ne sont pas visés, la critique se fait moins directe, plus souple. D. Dib procède par allusion, métaphore. Il porte ainsi un regard amusé sur les critiques adressées au gouvernement par des amateurs de sport attablés dans un bar et déçus par la défaite de l’équipe nationale :
« Terrible
le sort que le mollet des uns peut faire à la tête des autres ! S’il faut
mettre sa carrière en jeu sur un gazon, autant porter soi-même le short et les
crampons ! Avec le Commerce en libéro, l’Industrie à l’aile gauche, la
Défense à l’attaque et le Sport sur la touche ! »[166]
C’est encore un regard amusé qu’il choisit, par ailleurs, de porter sur les islamistes qu’il prend plaisir à caricaturer :
« Ils
portent la chemise et le pantalon boutonnés dans le dos, et ils se saluent en
disant “mélas” au lieu de salem […]. Ils professent qu’il faut entrer dans la
mosquée du pied gauche et en sortir du pied droit. Que la chahada se fait avec
le pouce et non avec l’index. Que l’univers est pointu et que les anges sont
“khounaça” [en note, “bissexués”]. Leurs sept péchés capitaux sont : la
cravate, les bretelles, le dentifrice, le shampooing, la plage, la télé et,
évidemment, le suppositoire […]. Laissons-les à leurs complots, ils sont
tellement teigneux, ces intégristes ! »[167]
Au-delà de la caricature, censée illustrer l’intolérance des islamistes, on remarque que D. Dib semble également faire allusion, avec la dernière phrase, au laxisme du gouvernement à leur égard ; un choix qui trouvera ses limites au moment de la suspension des élections de décembre 1991, marquant le début de la vague d’attentats qui s’est répandue sur le pays au cours des années 1990.
Si, de manière générale, le propos de Djamel Dib nous paraît fortement nuancé par l’aspect mise-en-scène, par le caractère exagérément loufoque du personnage principal en particulier, ainsi que par le recours à l’exercice de style, il n’en demeure pas moins porteur d’intérêt. La critique est bien là, pour peu que le lecteur daigne tendre l’oreille, et si, malgré la Ligue des Droits de l’Homme, l’auteur n’ose pas la contestation directe -le peut-il réellement en étant publié à l’Entreprise Nationale du Livre ?-, c’est au lecteur, maître de son interprétation, de faire l’effort.
L’apport de Djamel Dib à l’évolution du genre policier nous paraît, en ce sens, particulièrement intéressant, pour plusieurs raisons : il propose une recherche stylistique, donne véritablement corps à ses personnages qui, au-delà de leurs extravagances, témoignent d’une « algérianité » -à la fois arabe et kabyle- concrète et en laquelle le lecteur peut se reconnaître ; enfin, détail non négligeable, il implique une lecture active, qui permet au genre policier de tendre vers la profondeur du « roman roman ».
Bien que mitigé, par la présence d’auteurs plus ou moins inspirés et créatifs, le bilan du genre policier au Maghreb, jusqu’à la fin des années 1980, laisse néanmoins augurer de perspectives d’avenir fructueuses, succédant à l’avancée prometteuse permise par Djamel Dib.
Précisons, avant de clore ce chapitre, que l’évolution du genre policier concerne, jusque-là, essentiellement l’Algérie. Toutefois, signalons la publication du roman d’inspiration policière de Driss Chraïbi, intitulé Une Enquête au pays, paru dès 1981, aux éditions du Seuil. Nous prenons le parti d’aborder ce roman plus tard et de l’intégrer dans notre corpus de base : d’une part, parce qu’il se distingue des romans que nous venons d’aborder, en ayant été édité en France, et d’autre part, dans la mesure où son auteur a publié d’autres romans policiers au cours des années 1990.
*
L’approche successive des antécédents du genre policier dans les sphères littéraires antillaise et maghrébine, nous conduit à différentes remarques.
Notons en premier lieu que la reprise du genre policier dans la littérature antillaise de la fin du XIXème et du début du XXème siècles s’inscrit dans un contexte social, historique et politique singulier, celui de la colonisation, qui n’est pas sans incidence sur la manière dont le genre a pu être exploité. Précisons en ce sens que si le caractère populaire, ludique et, à certains égards, superficiel du genre policier, ainsi que ses potentialités propagandistes ont pu trouvé écho au sein du cadre colonial, l’approche, propre au hard-boiled notamment, visant à mettre en cause un système jugé inégalitaire et immoral ne s’est logiquement pas vraiment faite entendre. Ce n’est qu’à partir de D. de Grandmaison que le genre policier commence à laisser percer son potentiel dans le cadre d’une approche critique de la société. Avec M. Lacrosil, il révèle par ailleurs la possibilité d’une approche plus littéraire relevant d’un travail d’écriture plus approfondi. Aussi, au début des années 1980, le genre policier semble pouvoir s’inscrire au sein de la sphère littéraire antillaise dans la perspective d’un devenir prometteur.
Notons qu’en dépit de l’apparition plus tardive de la forme policière dans la littérature francophone maghrébine, les prémices du genre semblent relever d’un même développement que celui connu aux Antilles. Initialement conçu dans une perspective propagandiste et souffrant d’une certaine fadeur d’un point de vue littéraire, le genre policier a néanmoins pu révéler, dès le début des années 1980 au Maghreb, quelques-unes de ses potentialités, aussi bien dans le cadre d’une approche de type sociologique que littéraire.
Apparaissant de manière sporadique, souvent maladroite et parfois pertinente, le genre policier s’est distingué au sein des aires littéraires qui nous concernent de manière globalement significative. Les prémices du genre policier au Maghreb et aux Antilles soulignent, en effet, l’adaptabilité de cette forme littéraire si difficile à cerner car capable de s’illustrer dans des registres totalement différents et de se soumettre à des intentions multiples. L’étude de notre corpus nous permettra d’approfondir encore la question de la multi-fonctionnalité du genre policier, à travers un vaste panel d’ouvrages et d’auteurs qui nous permettront d’étayer nos premières réflexions.
2- Délimitation du corpus
Aires maghrébine et antillaise confondues, nous avons choisi de nous intéresser à vingt-neuf romans conçus sur la base d’intrigues policières et à trois autres œuvres que nous qualifierons de romans-enquête. Parmi les vingt-neuf romans de base, dix-huit relèvent de l’espace maghrébin contre onze pour l’espace antillais ; un écart qui s’explique en grande partie par le choix d’une exploitation du genre policier sous forme sérielle, de la part des auteurs maghrébins.
Le Marocain Driss Chraïbi est ainsi l’auteur de quatre romans mettant en scène l’inspecteur Ali, dont le premier se révèle être particulièrement dense et complexe, tandis que les trois autres s’inscrivent davantage dans le ton ludique et distrayant du genre policier classique, à la limite même de la reprise parodique :
Une Enquête au pays, Paris, Editions du Seuil, 1981 ;
Une Place au soleil,
Paris, Editions Denoël, 1993 ;
L’Inspecteur Ali à Trinity College, Paris, Editions Denoël, 1996 ;
L’Inspecteur Ali et la C.I.A., Paris, Editions Denoël, 1997.
L’écrivain algérien Mohammed Moulessehoul, publiant sous le pseudonyme de Yasmina Khadra, est, quant à lui, l’auteur de cinq romans policiers très sombres, mettant en scène les mêmes enquêteurs, et notamment le commissaire Llob et son adjoint Lino, témoins et victimes -d’où la fin du cycle- de l’Algérie tourmentée de ces dix dernières années :
Le Dingue au bistouri, Paris, Flammarion, 1999 ; une première édition de ce roman est parue sous le pseudonyme de Commissaire Llob, à Alger, Editions Laphomic, 1990 ;
La Foire des enfoirés, paru également sous le pseudonyme de Commissaire Llob, Alger, Laphomic, 1993 ;
Morituri, Paris, Editions Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1997 ; édition de référence : Gallimard, « Folio policier », 1999 ;
Double blanc, Paris, Editions Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1997 ; édition de référence : Gallimard, « Folio policier », 2000 ;
L’Automne des chimères, Paris, Edition Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1998.
Nous avons également choisi de nous intéresser à deux romans de Charlotte, pseudonyme d’un écrivain publié en Tunisie, qui mettent en scène, dans un cadre relativement « bon-enfant », l’imposant Commissaire Ayadi :
Le Meurtre de Sidi Bou Saïd, Sidi Bou Saïd, Alyssa-Editions, 1991 ;
Les Vacances du commissaire, Sidi Bou Saïd, Alyssa-Editions, 1992.
Un autre écrivain tunisien publiant dans la même maison d’édition, sous le pseudonyme de Al Sid, a également retenu notre attention avec deux aventures centrées autour de Ched Ok, charismatique détective privé tunisien particulièrement en phase avec les ancêtres américains du genre :
Rouges gorges et souris ravageuses, Sidi Bou Saïd, Alyssa-Editions, « Série Glauque », 1997 ;
Machettes coconuts et grigris à Conakry, Sidi Bou Saïd, Alyssa-Editions, « Série Glauque », 2000.
D’autres amateurs du genre policier nous ont également interpellée, tel Jean-Pierre Koffel, écrivain franco-marocain, auteur notamment de deux polars, l’un particulièrement travaillé, prenant pour cadre le Maroc sous le Protectorat ; l’autre, de forme plus légère, malgré une approche sociale tout aussi prégnante :
Des Pruneaux dans le tagine, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 1996 ;
L’Inspecteur Kamal fait chou blanc, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 1999.
Enfin, nous nous sommes intéressée à trois autres écrivains, occasionnels du genre, tels l’Algérien Boualem Sansal, auteur d’un roman policier particulièrement dense et complexe, centré sur la période obscure des années post-indépendance de l’Algérie ; le Marocain Rida Lamrini, dont le premier roman est construit sur le modèle de base de l’intrigue policière, mettant en scène un couple d’enquêteurs prospectant dans les milieux affairistes casablancais ; et enfin, Jacob Cohen, également Marocain, avec un roman dont l’intrigue se déroule dans les milieux fassis, sous la houlette d’un commissaire ambitieux et peu scrupuleux. Il s’agit, respectivement des trois romans suivants :
Le Serment des Barbares, Paris, Editions Gallimard, 1999 ;
Les Puissants de Casablanca, Rabat, Editions Marsam, 1999 ;
Les Noces du commissaire, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 2001.
En ce qui concerne le domaine antillais -et c’est là l’une des différences majeures avec l’espace maghrébin-, il n’est pas question de reprise sérielle du genre, mais davantage d’essais expérimentés par des auteurs déjà reconnus, pour la plupart, dans le domaine du roman dit traditionnel. Seul le Martiniquais Raphaël Confiant, connu par ailleurs pour être particulièrement prolixe, s’est essayé à plusieurs reprises au genre, sous différentes variantes, avec notamment trois textes :
Le Meurtre du Samedi-Gloria, Paris, Mercure de France, 1997 ;
Brin d’amour, Paris, Mercure de France, 2001 ;
La Dernière java de Mama Josépha, Paris, Editions Mille et une nuits, 1999.
Ce dernier ouvrage, présenté comme « récit policier » dans le paratexte, ne sera abordé que brièvement. Nous nous consacrerons, en revanche, largement aux deux autres ouvrages, le premier reprenant fidèlement la perspective classique du genre policier, le second s’en inspirant seulement et se permettant de nombreuses transgressions à l’égard du cadre générique traditionnel.
Cette double approche du genre n’est pas le seul fait de R. Confiant.
Nous constaterons, en effet, que l’espace littéraire antillais laisse apparaître deux types de romans policiers. D’une part, les classiques, pratiqués notamment par Tony Delsham, Janine et Jean-Claude Fourrier, Michèle Robin-Clerc ou encore Fortuné Chalumeau en collaboration avec Alain Nueil. Il s’agit respectivement des ouvrages suivants :
Panique aux Antilles, Fort-de-France, Editions M.G.G., 1985 ;
Morts sur le morne, Paris, Editions Caribéennes, Série « Tropicalia », 1986 ;
Au Vent des fleurs de canne, Pointe-à-Pitre, Editions Jasor, 2000 ;
Pourpre est la mer, Genève, Editions Bompiani Eboris, 1995.
D’autre part, les romans d’inspiration classique, mais plus éloignés du modèle de base, pour diverses raisons que nous aurons l’occasion d’aborder plus précisément ultérieurement, et expérimentés, cette-fois, par Guy Cabort-Masson (à deux reprises), Patrick Chamoiseau ou encore Ernest Pépin :
La Mangrove mulâtre, Fort-de-France, La Voix du peuple, 1986 ;
Qui a tué le béké de Trinité ?, Fort-de-France, La Voix du peuple, 1991 ;
Solibo Magnifique, Paris, Editions Gallimard, 1988 ;
L’Homme au bâton, Paris, Editions Gallimard, 1992.
Nous nous intéresserons enfin à trois autres romans d’inspiration policière, mais délibérément en marge du genre, qui nous permettront de mettre en perspective différentes réflexions inhérentes au genre policier lui-même et à son rapport à l’acte d’écriture. Le premier est signé de l’Algérien Rachid Mimouni, les deux autres de la Guadeloupéenne Maryse Condé :
Tombéza, Paris, Editions Robert Laffont, 1984 ; édition de référence : Pocket, 1996 ;
Traversée de la Mangrove, Paris, Mercure de France, 1989 ;
La Belle créole, Paris, Mercure de France, 2001.
Afin de cerner plus précisément notre corpus dans son ensemble, sans entrer tout à fait encore dans le détail du texte, nous nous proposons de dresser quelques points de convergence entre ces différents textes en abordant trois perspectives qui nous permettront d’engager une première réflexion d’ordre général. Nous nous intéresserons, dans un premier temps, à tout ce qui relève du paratexte de ces ouvrages : le choix du titre, du pseudonyme, de l’éditeur, de la couverture, de la diffusion, mais également, le discours d’accompagnement du texte, en nous intéressant plus particulièrement aux propos tenus par les auteurs à l’égard de leurs œuvres et du roman policier en général. Cette approche nous permettra notamment de déterminer les motivations liées à la reprise du genre policier, dans des espaces littéraires peu habitués à cette forme.
Dans un deuxième temps, nous tenterons de définir les différents types d’enquêtes que ces trente-deux romans nous proposent, en procédant à des rapprochements déjà significatifs entre différents projets, différentes perspectives et ambitions.
Enfin, nous nous attacherons à définir de manière plus précise le contour des intrigues proposées, en évoquant les différents profils d’enquêteurs brossés tout au long de ces romans.
2.1- Approche paratextuelle
Une première approche du paratexte nous permet de distinguer, au sein de notre corpus, deux grandes catégories d’ouvrages : d’une part, ceux qui revendiquent plus ou moins ouvertement leur appartenance au genre policier ; d’autre part, ceux qui, tout en s’en inspirant dans la conception même de l’intrigue, semblent se tenir à distance et tendre davantage vers une reconnaissance non policière.
Nous nous intéresserons, dans un premier temps, aux romans policiers revendiqués, puis, à l’inverse, aux polars sensiblement plus frileux ; une perspective duelle à la lumière de laquelle nous pourrons, par la suite, nous pencher plus précisément sur le cas de deux écrivains en particulier, à savoir Yasmina Khadra et Driss Chraïbi, dont le rapport respectif au genre policier nous paraît significatif. Nous aborderons enfin les romans ouvertement non policiers qui, néanmoins, semblent largement s’inspirer du récit d’énigme.
2.1.1- Les romans policiers revendiqués
Parmi les romans dits ouvertement « policiers », relevons en premier lieu ceux qui, de par le choix du titre, de la dénomination officielle ou de la collection éditoriale, semblent totalement s’offrir au genre.
Une première constatation s’impose : parmi les trente-deux romans de notre corpus, seulement deux sont désignés, par une notification en couverture, comme relevant du genre policier. Il s’agit des romans de la Guadeloupéenne Michèle Robin-Clerc et du Martiniquais Tony Delsham, étiquetés respectivement en couverture : « roman policier » et « comédie policière ».
Cette distinction, indiquant un certain glissement du Martiniquais dans le domaine de la légèreté et du rire, se révèle être également sensible dans le choix du titre et de la présentation de couverture. Ainsi, tandis que le titre proposé par la Guadeloupéenne, Au Vent des fleurs de cannes, tend à projeter le roman dans une sphère à la fois poétique et proche de l’univers lyrique de la saga, l’accrocheur Panique aux Antilles de Tony Delsham semble promettre au lecteur un grand moment de décontraction. De même, la recherche esthétique sensible dans le choix de la présentation du roman de Michèle Robin-Clerc (la reproduction d’un tableau en page de couverture, le choix harmonieux des couleurs et de la graphie), ainsi que la notification en quatrième de couverture de son goût pour la poésie (« Architecte, elle écrit des poèmes depuis l’enfance »), contrastent avec la présentation relativement réductrice du roman de Tony Delsham (le titre s’étend sur la moitié de la couverture, dont l’espace restant est en grande partie occupé par la représentation graphique d’un coutelas ; la quatrième de couverture, quant à elle, reproduit une photographie de l’auteur accompagnée d’un extrait du texte particulièrement parlant et ciblé puisqu’il décrit une scène de sexe ponctuée par la découverte d’un cadavre). Ainsi, malgré leur appartenance revendiquée au genre policier, ces deux romans optent visiblement pour deux perspectives bien distinctes, et ce, pour diverses raisons, dont la principale réside en ce que ces deux romans ont été publiés à quinze années d’intervalle.
Lorsque T. Delsham publie son roman en 1985, c’est à compte d’auteur, avec peu de moyens et surtout à une époque où le genre policier ne cherche pas à exister selon une autre perspective que celle bien connue de genre populaire, distrayant et sans grande prétention. C’est d’ailleurs pour cette raison que Tony Delsham, soucieux de toucher un vaste public et de s’adresser largement aux Martiniquais, s’est essayé au genre[168].
Lorsqu’en 2000, Michèle Robin-Clerc décide d’opter pour le genre policier, elle le fait également par le biais d’une maison d’édition sans gros moyens, Jasor -qui est néanmoins reconnue dans le milieu littéraire antillais- mais alors que le roman policier n’a plus exactement les mêmes ambitions. En quinze ans et face au succès incontournable des ventes, le roman policier aurait, en effet, presque la prétention de faire son entrée dans la « cour des grands » et l’attitude de la Guadeloupéenne et des éditions Jasor vis-à-vis du genre semble en attester.
Or, ce changement de statut est également parfaitement sensible dans les grands groupes éditoriaux qui, sur les traces de la création de la « Série noire » par les éditions Gallimard, ont offert au genre policier et à ses multiples variantes des collections, des formats et des stratégies de vente adaptées. Cette perspective est, par ailleurs, également sensible -et c’est là l’« universalité du roman policier »[169]- à l’étranger, par exemple au Maroc ou en Tunisie, pour rester dans le cadre de notre sujet.
Sept romans de notre corpus ont ainsi été publiés dans des maisons d’éditions locales, spécialisées dans le genre policier. Intéressons-nous, dans un premier temps, aux Editions Alyssa, dont le siège est localisé à Sidi Bou Saïd, en Tunisie et qui sont à l’origine de la publication de quatre romans de notre corpus[170] : Le Meurtre de Sidi Bou Saïd et Les Vacances du commissaire, sous la plume du pseudonyme Charlotte ; Rouges gorges et souris ravageuses et Machettes coconuts et grigris à Conakry, sous le pseudonyme Al Sid.
Ces quatre romans relevent de la forme policière sous deux variantes différentes. Tandis que les romans de Charlotte s’inscrivent dans le cadre du roman policier classique, occupé par l’avènement d’un événement mystérieux, le déroulement d’une enquête sous la houlette d’un enquêteur d’expérience et la révélation finale de la clé de l’énigme, les romans d’Al Sid s’inscrivent davantage dans la tradition de la « Série noire » et de ses détectives privés. Ceci justifie sans doute la création d’une collection spéciale, plus adaptée aux ambitions de l’amateur de détectives privés ; mais là encore, la dizaine d’années séparant les publications de Charlotte datant du début des années 1990, de celles d’Al Sid, peut expliquer ce changement de présentation. Ainsi, Charlotte publie dans la version « blanche » des Editions Alyssa : couverture sur fond blanc et caractère ludique revendiqué en quatrième de couverture, Le Meurtre de Sidi Bou Saïd étant, par exemple, qualifié de « thriller très soft où tout le monde joue ». En revanche, Al Sid hérite de l’étiquette « Série glauque », accompagnée de couvertures particulièrement expressives. Rouges gorges et souris ravageuses est notamment illustré, sur fond noir, par la silhouette d’une femme au regard ravageur à qui il manque simplement le porte-cigarettes adéquat et en phase avec le texte cliché de la quatrième de couverture, dont voici un extrait, vantant les mérites du détective tunisien dépêché pour l’occasion :
« Mais
quand le rififi se déchaîne à Gammarth, ou à Bab El Khadra son seul véritable
ami est le fidèle Beretta (semi-automatique 380) qu’il se garde bien au chaud
sous l’aisselle gauche ! »
Une perspective « prometteuse » rejoignant la définition proposée du roman :
« Joyeux
pastiche des “Série noire” d’antan un “polar livide” made in Tunisia qui vous
fera mourir. De rire. »
L’objectif poursuivi par Al Sid, Charlotte et Alyssa, de manière générale, se veut en effet avant tout ludique. Nicole Ben Youssef, directrice des Editions Alyssa, explique ainsi les motivations de Charlotte, « un très sérieux médecin, gynécologue, Française d’origine mais vivant en Tunisie depuis longtemps » :
« Elle
a eu envie de faire partager son amour pour le “Village” et ses copains de
toujours […]. Craignant de tomber dans trop de cucul-la-praline et n’ayant
aucune prétention à être Flaubert elle a imaginé cette forme policière qui
donne une liberté fantastique, permet le coq à l’âne et les visites inattendues
dans des lieux où l’on n’aurait que faire, avec des personnages qu’il serait
bien difficile d’intégrer dans un “roman” classique. »[171]
Al Sid, un « banquier très sérieux », est quant à lui qualifié de pasticheur de la série noire, version tunisienne, ayant promené son regard sur la société tunisienne à partir d’un fait divers réel.
Concernant les ambitions d’Alyssa-Editions, Nicole Ben Youssef précise :
« Nous
sommes donc des sous-produits de la littérature tout à fait consternants, mais
nous assumons pleinement notre indignité et nous nous amusons beaucoup. Et
contre toute attente, ces polars honnis sont assez lus par leurs
détracteurs… »[172]
L’aspect consternant paraissant plus vraisemblable que la réussite commerciale de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que l’initiative des éditions Alyssa se révèle être significative à bien des égards, et notamment dans le rapport qui s’effectue entre son lieu d’ancrage et son orientation idéologique. Ainsi, parmi les informations données sur les diverses publications d’Alyssa -notamment dans les pages d’après-texte de Machettes coconuts et grigris à Conakry-, l’on constate que cette maison d’édition est spécialisée dans le polar, les contes du folklore, les contes bilingues et les ouvrages consacrés à l’Histoire ancienne de Tunisie ; autant d’orientations qui laissent à penser qu’il s’agit avant tout de rester le plus éloigné possible de tout ce qui concerne l’Histoire contemporaine de la Tunisie, ce qui est également sensible dans les romans qui nous intéressent. Sur les quatre, deux se passent à l’étranger -l’un en Turquie, l’autre en Guinée ; deux pays décrits de manière à suggérer qu’il fait bon vivre en Tunisie- et les deux restants s’étendent peu sur la société tunisienne ou du moins de manière peu objective semble-t-il : l’approche de Charlotte paraît, en ce sens, relativement idyllique. Al Sid se fait plus critique, quant à lui, mais l’amour du pays et le patriotisme prennent en général rapidement le dessus.
En ce qui concerne les éditions Alyssa, l’exploitation du genre policier s’inscrit donc dans une perspective qui se veut beaucoup plus distrayante que critique, renvoyant le genre à son acceptation mineure, ici légitimée.
Outre les Editons Alyssa, remarquons également l’intérêt des éditions marocaines Le Fennec pour le roman policier.
Trois romans de notre corpus ont été publiés dans la collection « Noire » des Editions Le Fennec, localisées à Casablanca : Les Noces du commissaire, de Jacob Cohen ; Des Pruneaux dans le tagine et L’Inspecteur Kamal fait chou blanc de Jean-Pierre Koffel.
Si le choix des titres et l’appartenance à la « Série noire », accréditée par la couverture noire affichée par ces romans, ne laissent aucun doute quant à leur nature policière, l’orientation idéologique des auteurs et de la maison d’édition nous apparaît radicalement différente de celle choisie par les éditions tunisiennes précédemment citées. Le roman noir à la manière de R. Chandler ou de D. Hammett se révèle ici nettement plus sensible, J. Cohen et J-P. Koffel offrant à leur roman un véritable contenu socio-historique, par-delà l’apparente légèreté véhiculée par les titres, notamment chez le second.
Ainsi, l’ambition affichée par le roman de Jacob Cohen, en quatrième de couverture, laisse vraisemblablement peu de champ à la pure distraction. Sur fond de trafic de cocaïne, le roman se propose, en effet, de traiter d’une « lutte feutrée mais âpre pour le pouvoir, entre un ministère de l’Intérieur qui ne veut rien céder de sa toute-puissance, et des hommes d’affaires fassis soucieux d’habiller leurs récentes fortunes des oripeaux de la légalité ». Les propos tenus en quatrième de couverture semblent ainsi promettre au lecteur un véritable contenu socio-politique, émaillé de critiques et de dénonciations pressenties comme audacieuses, et ce, d’autant que le statut de l’auteur, présenté comme « licencié en droit (Casablanca) et diplômé de Science-Po (Paris) », s’y prête volontiers.
Pratiqué par Jacob Cohen, le genre policier, sans pour autant perdre de ses potentialités stylistiques, prend rapidement une valeur extra-littéraire, se transformant en une véritable arme de la critique. Cette approche est également manifeste dans les romans de J-P. Koffel qui ont, d’une certaine manière, inauguré ce terrain-là aux éditions Le Fennec.
Avec Des Pruneaux dans le tagine, publié en 1996, J-P. Koffel -écrivain français du Maroc, né à Casablanca, ayant enseigné au Maroc de 1954 à 1992- semble se situer volontairement entre Histoire et fiction ; choisissant pour cadre de l’intrigue une période charnière de l’Histoire marocaine, il prend bien soin de préciser, en guise d’avertissement :
« L’essentiel
de l’action se passe à Marrakech, dans les dernières années du Protectorat,
mais ce roman, qui n’engage que la mémoire de son auteur, est avant tout une
fiction qui prend des libertés avec l’Histoire. »
La dialectique est également sensible dans la manière dont le texte est encadré par les informations complémentaires et nécessaires à la compréhension, apportées par l’auteur : en avant-texte, la présentation de Marrakech et de ses différents quartiers -de l’ordre du réel- ; après le texte, la présentation des différents personnages circulant dans le roman, de leurs nom, fonction ou qualité et de leur âge -de l’ordre de la fiction. En créant cette forme d’interaction entre fiction et réalité, J-P. Koffel tend à souligner que, tout en participant de l’exercice de style favorisé par l’inscription dans le cadre policier, ses romans noirs dépassent largement cette perspective pour aborder des questions plus profondes, véritablement en prise avec la réalité. Les criminels qu’il met ainsi en scène sont des idéalistes passionnés au point de passer à l’acte et de tuer pour défendre leurs idéaux, en l’occurrence l’intérêt des plus faibles, victimes de la colonisation oppressante (Des Pruneaux dans le tagine) ou de l’inhumanité des puissants (L’Inspecteur Kamal fait chou blanc). J-P. Koffel écrit donc des polars engagés, revenant sur des évènements clés de l’Histoire marocaine, abordant parfois des sujets délicats -la répression policière par exemple- et faisant référence à quelques grands noms de la politique marocaine -Driss Basri, ancien Ministre de l’Intérieur en fait les frais dans un autre de ses romans, intitulé Pas de Visa pour le paradis d’Allah.
Familiarisé avec le genre policier au travers de quelques textes l’ayant interpellé, J-P. Koffel explique en ces termes les raisons de son envie de s’adonner, à son tour, à ce type d’ouvrages :
« Moi
aussi j’avais envie de raconter des histoires s’inspirant du réel que l’on
pourrait lire avec la même aisance qu’on a à lire un Chase. D’autant plus que
j’étais persuadé que le genre -où il y a effectivement beaucoup de médiocre, de
bâclé, d’archétypique, de mauvais, d’ennuyeux, de vulgaire, surtout chez les
Français- a ses chefs-d’œuvre, surtout chez les Américains. J’avais à mon tour
envie d’écrire ce que j’avais eu plaisir à lire, n’osant pas toucher à la vraie
littérature, cette grande dame, à l’exception de la poésie, pour laquelle il
n’y avait pas de lecteurs -et je n’en cherchais pas. »[173]
Parmi les œuvres se revendiquant ouvertement du genre policier, relevons enfin deux autres romans qui se distinguent par un encadrement éditorial singulier : La Dernière java de Mama Josepha, de Raphaël Confiant et Morts sur le morne de Janine et Jean-Claude Fourrier. Le premier a, en effet, été publié en 1999, aux Editions Mille et une nuits, dans un format littéralement de poche, à un prix très bas et selon un objectif bien déterminé, précisé en dernière page, à savoir :
« Mille
et une nuits propose des chefs-d’œuvre pour le temps d’une attente, d’un
voyage, d’une insomnie… ».
L’objectif apparaît quelque peu ambitieux, visant à faire coïncider qualité littéraire, distraction et commodité, prétendant offrir ainsi un juste milieu entre « roman traditionnel » et « roman de gare ».
Le second roman, quant à lui, semble témoigner d’ambitions beaucoup moins audacieuses et si le texte en lui-même se révèle être intéressant et de qualité, le choix éditorial et ce qu’il implique au niveau de la présentation du texte, ne permettent pas d’en espérer autant. Morts sur le morne a, en effet, été édité aux Editions Caribéennes en 1986, dans la Série « Tropicalia ». Les relents d’exotisme -rappelant la série OSS 117- que laisse présager le titre de la collection, sont ainsi parfaitement illustrés dans le choix de la couverture qui représente, sur fond rose et jaune, la photographie de trois femmes, dont une assez découverte, allongées dans un pré, inanimées, sous les nuages du ciel esquissant la forme du crâne d’un squelette. Ce positionnement nous permet une nouvelle fois de constater que si le genre policier semble aspirer désormais, par voie d’orientation éditoriale, à la respectabilité, il n’y pensait guère et faisait preuve de nettement moins de scrupules il y a une quinzaine d’années, lorsque la culture populaire n’avait d’autre ambition que celle d’exister en tant que telle.
Précisons ici que lorsque Chester Himes parachutait ses enquêteurs dans les rues de Harlem, il le faisait évidemment dans la perspective d’une approche critique de la société américaine, creusant par là même un fossé net entre l’orientation de ses textes et celle des romans policiers ludiques de type whodunit ; il apparaît néanmoins qu’il se dispensait alors de vouloir rivaliser avec la « grande littérature ».
Les textes de Chester Himes sont profonds, extrêmement riches et puissants ; ils n’en demeurent pas moins des romans noirs, d’un point de vue tant littéraire qu’éditorial, reconnus comme tels. Or, parmi les écrivains antillais ou maghrébins qui s’inspirent du roman policier, peu daignent ou osent véritablement le reconnaître. Ainsi, de nombreux romans de notre corpus témoignent, d’une certaine manière, de leur appartenance au genre, par le choix d’un titre évocateur ou d’une quatrième de couverture suggestive, sans qu’il ne soit jamais question, ni dans la dénomination de l’ouvrage, ni dans les propos de l’auteur, d’une véritable affiliation au genre.
2.1.2- Les polars « frileux »
Dix romans de notre corpus peuvent être rattachés au genre policier, non qu’ils soient publiés dans une collection spécifique ou que la mention « roman policier » ou toute autre apparentée figure dans le cadre du paratexte, mais simplement parce qu’ils mettent en scène une enquête policière motivée par l’avènement d’un crime ou d’une mort a priori d’origine criminelle et que le déroulement de l’intrigue tend vers l’explication de cet événement mystérieux.
Il en est ainsi des romans des Martiniquais Raphaël Confiant (Le Meurtre du Samedi-Gloria) et Patrick Chamoiseau (Solibo Magnifique) ; du Guadeloupéen Fortuné Chalumeau (Pourpre est la mer), ainsi que de l’Algérien Boualem Sansal (Le Serment des barbares) et du Marocain Rida Lamrini (Les Puissants de Casablanca).
Ces cinq romans, tout en étant indéniablement centrés sur une intrigue policière, n’en revendiquent pas pour autant clairement les attributs. Il est ainsi seulement question, en quatrième de couverture ou dans les propos tenus par les auteurs, de s’inspirer de la forme policière, d’en faire un prétexte.
En quatrième de couverture du roman Les Puissants de Casablanca, Rida Lamrini est ainsi présenté comme un « observateur des mœurs sociales » qui « nous fait vivre une intrigue policière, prétexte à des portraits emblématiques ». Une même perspective est également sensible en quatrième de couverture du roman de R. Confiant, qui précise que « la recherche du meurtrier sera matière à une succession de portraits du petit peuple de Fort-de-France ». Patrick Chamoiseau se défend par ailleurs d’avoir écrit, avec Solibo Magnifique, un roman policier, préférant considérer ce roman comme « un clin d’œil au roman policier »[174], en une prise de position proche de celle de Fortuné Chalumeau qui, s’il ne nie bien sûr pas l’intrigue policière, insiste sur le fait que le recours au genre policier ne constitue qu’un prétexte. Il précise :
« La
trame de l’histoire me semble bien plus intéressante que le fait en soi ;
celui-ci [le meurtre] n’est en sorte rien qu’un faire-valoir qui permet le
déroulement du récit : étude de mœurs, en fait. Dès lors, le “policier”
pur et dur n’est pas mon genre de prédilection. »[175]
Une précision dont Boualem Sansal, haut fonctionnaire algérien[176], auteur du Serment des barbares, parvient à se dispenser. Publié dans la collection blanche des Editions Gallimard, le roman de l’Algérien est qualifié, en quatrième de couverture, d’« épopée rabelaisienne dans l’Algérie d’aujourd’hui » ; il n’est question, à aucun moment, d’intrigue policière ou de roman policier. Or, Le Serment des barbares relève du genre policier, et plus exactement de sa variante noire. Riche d’un cadre et d’une critique socio-historiques véritablement prégnants, le roman qu’il propose paraît très travaillé d’un point de vue stylistique, particulièrement dense et saisissant. Or, il s’agit là de qualités qui ne sont absolument pas incompatibles avec le genre -C. Himes, R. Chandler, D. Hammett, voire W. Faulkner, en sont la preuve-; elles sont seulement relativement inhabituelles.
De même, notons que lorsque Boualem Sansal est interrogé dans la presse, et notamment la presse locale, il est fait référence à la noirceur de l’intrigue, mais relativement peu au genre policier, les questions tournant davantage -en ce qui concerne le cadre littéraire- autour du prestige d’une publication dans la collection blanche de Gallimard. Néanmoins, précisons que lorsque la question du choix du polar est abordée, il parvient à justifier parfaitement ses objectifs. Alain Frachon rapporte ainsi ses propos, à la suite d’un entretien accordé au quotidien Le Monde :
« “Quel
autre genre littéraire que le polar le plus noir serait approprié ?”,
demande-t-il, pour raconter “l’arriération” d’un pouvoir algérien qui a eu, et
a encore, “recours au crime et à la torture”, “aux manipulations de toutes
sortes”. »[177]
Si Boualem Sansal parvient remarquablement bien à justifier son recours au genre policier, d’autres se montrent beaucoup plus évasifs, à l’instar de R. Confiant ou P. Chamoiseau, laissant même transparaître leurs hésitations dans la conception même de l’intrigue.
Il s’agit ici notamment du Martiniquais Guy Cabort-Masson : son premier roman intitulé La Mangrove mulâtre, est ainsi qualifié en couverture de « roman historique martiniquais ». Il y est néanmoins question d’une enquête, mais elle est menée dans un cadre bien précis, en juin 1842, et à l’initiative d’un avocat envoyé faire la lumière sur « une sombre histoire d’empoisonnements, de sévices et de suicides ». Son deuxième roman, quant à lui, présente la particularité de retracer le déroulement d’une enquête policière, survenant à la suite d’un assassinat qui n’intervient dans le roman qu’à la page 148. En outre, en ce qui concerne ce deuxième roman, il nous est d’ores et déjà précisé, en quatrième de couverture, que le crime restera impuni.
Ce genre de retardement, de révélation différée ou reportée est également utilisé par R. Confiant, dans Brin d’amour qui, malgré le fond noir de la couverture choisie et la découverte de deux cadavres, ne semble pas se décider réellement à faire pénétrer le roman dans le cadre de l’enquête policière traditionnelle.
Evoquons enfin le caractère insaisissable de deux autres romans, Une Enquête au pays, de Driss Chraïbi et L’Homme-au-bâton, d’Ernest Pépin qui, tout en se construisant autour d’une intrigue policière, semblent finalement « dérailler » en cours de route, empruntant des chemins peu habituels pour le genre.
Les polars « frileux » dont il est ici question ne semblent donc pas pouvoir/vouloir s’inscrire totalement dans le cadre policier, sans pour autant être en mesure de nier leur parenté avec ce genre. L’indécision affichée des auteurs, refusant de s’en remettre explicitement au genre policier, semble en fait relever de la prudence ; il s’agit, en effet, de prendre le soin de préserver une certaine distance avec un genre médiatiquement aussi populaire que pesant. Or, cette réticence peut paraître presque légitimée, notamment au vu de la médiatisation à double tranchant subie, par exemple, par Yasmina Khadra.
2.1.3- Le cas Yasmina Khadra/Driss Chraïbi
Contrairement aux auteurs de « polars frileux », l’écrivain algérien publiant sous le pseudonyme de Yasmina Khadra semble avoir initialement choisi de revendiquer son statut d’auteur de romans policiers, en publiant dans des conditions éditoriales tout à fait adaptées au genre.
Les ouvrages de Yasmina Khadra ont été publiés, pour trois d’entre eux (Double blanc, Morituri, L’Automne des chimères), aux Editions Baleine, dans la collection « Instantanés de polar » ; bénéficiant de sa forme tripartite, ce qui ne manque évidemment pas d’intérêt d’un point de vue commercial, cette trilogie policière a, en outre, été largement valorisée par la rapidité de publication -trois romans en deux ans- ainsi que par le format poche peu coûteux. Le lecteur et la critique en viendraient presque à oublier ses deux précédents romans policiers, dont l’un (La Foire des enfoirés) a été publié en Algérie en 1993 et l’autre (Le Dingue au bistouri) réédité en 1999, par Flammarion. Remarquons, en ce sens, qu’en publiant ce roman, écrit une dizaine d’années auparavant, Flammarion s’est prêté au jeu de ressusciter le commissaire Llob, assassiné en 1998, dans L’Automne des chimères ; jeu sans doute lucratif, susceptible d’avoir attiré bon nombre de lecteurs nostalgiques attristés par la mort du célèbre commissaire.
En publiant quatre romans policiers reconnus et vendus comme tels, entre 1997 et 1999, Yasmina Khadra s’est assuré l’intérêt du public ; son succès a même été retentissant, du fait de la qualité indéniable de son écriture, de la précision avec laquelle sont abordés des sujets brûlants en prise avec la réalité -alors que la situation algérienne peut paraître confuse, notamment aux yeux du public français- ou encore de par la charge émotionnelle qui émane de son écriture. En outre, il convient de préciser que le succès de Y. Khadra peut sans doute être lié au mystère entourant l’identité de l’auteur, qui choisit d’écrire sous un pseudonyme « pour échapper à la censure », comme cela est notamment indiqué en quatrième de couverture de la réédition de la trilogie, chez Gallimard, dans la collection « Folio policier ». En effet, la perspective de la femme algérienne, écrivant des romans policiers profondément marqués par la noirceur de la tragédie se déroulant dans son pays -et dont les journaux français se font régulièrement l’écho, sans donner plus de détails, faute d’informations, qu’un nombre approximatif de morts-, ne peut que sensibiliser le public français, d’autant mieux s’il sait que, ce faisant, elle risque la censure et craint pour sa vie. Or, l’arrivée de Yasmina Khadra sur le marché du livre français a bénéficié d’une large couverture médiatique, dont le point culminant a sans doute coïncidé avec l’émission télévisée française de Bernard Pivot[178], au cours de laquelle Yasmina Khadra est apparu sous son véritable visage : celui d’un homme ; mieux, ou pire, celui d’un soldat, ex-officier de l’Armée algérienne. Autant dire que l’impact médiatique de l’auteur a connu à ce moment-là son second souffle, même si la critique s’est faite alors plus précise, parfois plus sournoise et, quoi qu’il en soit, beaucoup plus méfiante. La pauvre Algérienne menacée par les intégristes est alors devenue le soldat douteux, à la mine austère et mystérieuse.
Parallèlement, et après deux romans non policiers, mais toujours profondément ancrés dans la tragique réalité algérienne (Les Agneaux du Seigneur ; A quoi rêvent les loups ?), l’auteur de romans policiers est devenu L’Ecrivain (roman éponyme publié aux éditions Julliard, en 2001), traînant parfois difficilement derrière lui son passé d’auteur de polars. On remarque, en effet, qu’au moment de la parution de ses romans, Yasmina Khadra a très souvent été interrogé sur les raisons de ce choix littéraire. En 1998, à la question « Comment êtes-vous venue au roman policier ? », Yasmina Khadra répond :
« Par choix pédagogique. Nos grands auteurs
plaçaient la barre très haut. Les autres vacillaient entre l’exercice de style
et le chauvinisme. L’engouement pour la lecture en prenait un coup. J’ai pensé
joindre l’utile à l’agréable dans l’espoir de réconcilier le lecteur algérien
avec sa littérature. Le roman noir m’a semblé le plus indiqué dans ce
sens. »[179]
Deux ans plus tard, et après avoir dû répondre des dizaines de fois à cette même question, Yasmina Khadra commente une nouvelle fois sa venue au polar :
« Je suis venu au polar par fantaisie,
histoire de jouir de la grande liberté que me procurait la clandestinité.
L’ambition du Dingue au bistouri
était d’abord de divertir, de tenter de réconcilier le lectorat algérien avec
la littérature. Celle-ci était devenue de plus en plus ésotérique, de moins en
moins enthousiasmante. Si on m’avait dit, à l’époque, que mon commissaire Llob allait
franchir les frontières du bled et séduire des dizaines de milliers de lecteurs
en France, puis en Europe, jamais je ne l’aurais cru. Mais de là à me
considérer comme un auteur de polars, il y a erreur. Je suis avant tout
romancier, à l’aise dans tous les genres, comme en témoignent Les Agneaux du Seigneur et A quoi rêvent les loups. J’aime le polar
pour son humilité, qui est la plus belle des générosités chez un
écrivain. »[180]
Sans renier ce qu’il doit au genre policier, Yasmina Khadra se montre légèrement agacé par cette tendance de la critique à ne retenir de lui que ses expériences policières ; car il est un fait indéniable, en ce qui concerne l’étiquette d’écrivain de polars : il est particulièrement difficile de s’en défaire. Rien d’étonnant alors à la distance prise progressivement par l’auteur vis-à-vis de cette « mauvaise habitude » passée, craignant sans doute d’être enfermé à jamais dans la sphère de ce genre dit « mineur ». Ainsi, lorsque B. Bechter lui demande « Comment s’explique le choix du roman noir et pour quelle raison as-tu changé de genre pour continuer à analyser la crise algérienne ? », Yasmina Khadra répond habilement:
« Je n’ai pas choisi le roman noir. Ce sont mes personnages qui m’imposent le genre dans lequel ils voudraient évoluer. En réalité, je ne suis que le “nègre” de mes personnages. »[181]
Puis, une nouvelle fois confronté à l’incontournable « Pourquoi le polar ? », face à un journaliste algérien, il resitue arithmétiquement la place du phénomène dans sa carrière, avant d’opter pour une interprétation plutôt positive de son expérience du genre :
« J’ai écrit 14 romans dont 5 polars pas plus. J’ai choisi le polar parce que c’est une forme d’expression qui a ses mérites et ses influences. Je ne fais pas de ségrégation littéraire. L’écrivain, c’est la générosité et le talent et on peut trouver ces qualités partout, y compris dans le polar. »[182]
Il ajoute :
« Le
polar m’a permis de réussir là où j’avais échoué auparavant […]. Il
m’a permis de me découvrir et dire pleinement ce que j’avais à dire. Le
commissaire Llob a été un personnage extrêmement attachant et… coopératif. Et
je suis très fier de constater que mes polars ont réveillé un genre qui
sommeillait en beaucoup d’Algériens, puisque nous constatons avec plaisir que
de nombreux talents, jusque-là timides, se sont éclatés dans le genre policier.
Tout le monde écrit des polars. L’Algérien a découvert une partie de son
identité dans le polar. Qu’est-ce qu’un Algérien sinon un homme aigri, cynique,
controversé, mais qui reste très vigilant quand il s’agit de vérité et
d’engagement. »[183]
Remarquons que livrée aux médias algériens, cette revalorisation du rôle du polar prend une résonance singulière, imprégnée de fierté, marquée, semble-t-il, par une volonté de ne rien renier et qui échappe parfois à l’auteur, plus sec à répondre aux questions qui, quatre romans plus tard, ne cessent de lui rappeler son passé dans la sphère littéraire policière. Ainsi, lorsque Josephine Dedet, journaliste de Jeune Afrique/L’intelligent, lui demande « Votre dernier livre était un livre autobiographique ; celui-ci est un récit. Auriez-vous abandonné le polar ? », Yasmina Khadra répond :
« Tout
d’abord, sur quinze livres, je n’ai écrit que cinq polars. Ensuite, je n’écris
pas des récits, mais des romans. Et je vais là où mon inspiration me demande
d’aller. J’écris un polar lorsque mes personnages parviennent à me persuader
d’être leur nègre. Je veux pouvoir travailler sur tous les genres sans
complexe. »[184]
L’exemple de Yasmina Khadra se révèle être particulièrement parlant en ce qui concerne le risque de catégorisation encouru par tout écrivain se revendiquant comme tel qui choisirait de s’exercer au polar, de s’y faire remarquer et, pire, de plaire à un nombreux public. Nous remarquons, en outre, que si Boualem Sansal a pu éviter ce genre d’étiquetage, c’est en grande partie dû au prestige de la collection blanche de Gallimard, ainsi qu’à son choix de faire mourir son enquêteur in fine, coupant court à toute perspective sérielle.
En ce qui concerne Yasmina Khadra, en revanche, le syndrome de Conan Doyle, contraint de ressusciter son héros ne semble pas si loin et si l’Algérien a vraisemblablement des chances d’en réchapper, fort d’un véritable grand talent d’écriture, d’autres préfèreront sans doute ne pas s’y risquer.
L’expérience médiatique de Y. Khadra en matière de polar peut expliquer les réticences de certains auteurs de notre corpus, visiblement inspirés par le genre, mais soucieux de ne pas véritablement l’ébruiter. Or, si tel est le cas pour la plupart des auteurs du corpus, notons que l’un d’entre eux semble néanmoins échapper à la règle. Il s’agit du Marocain Driss Chraïbi qui, d’une certaine manière, se situe aux antipodes de l’expérience problématique vécue par Yasmina Khadra.
Avec son passé littéraire à la fois riche en œuvres et mouvementé du point de vue de la critique -notamment à la suite de la publication du roman très controversé, intitulé Le Passé simple, en 1954- Driss Chraïbi fait figure d’exception au sein de notre corpus, d’une part du fait de ce bagage médiatique pré-instauré et, d’autre part, au vu de la manière apparemment choisie pour se lancer dans le genre. En effet, les trois romans policiers du Marocain, Une Place au soleil, L’Inspecteur Ali à Trinity College et L’Inspecteur Ali et la C.I.A., publiés respectivement en 1993, 1996 et 1997 se veulent désopilants. D. Chraïbi le précise dans les premières lignes de la quatrième de couverture du premier de la série :
« Voici la première enquête de l’inspecteur Ali, aussi abracadabrante que lui. Il y en aura d’autres, si du moins ce ouistiti ménage quelque peu ma santé. »
En réalité, il ne s’agit pas là de la première enquête de l’inspecteur Ali, si l’on tient compte de la première esquisse de roman policier proposée par D. Chraïbi, avec Une Enquête au pays, publié en 1981, mettant en scène pour la première fois l’inspecteur Ali, dans un roman complexe, profond et critique à l’égard de la société marocaine et de son administration en particulier. Si D. Chraïbi prétend néanmoins qu’Une Place au soleil signe la première aventure d’Ali, c’est que, nous explique l’auteur, toujours en quatrième de couverture d’Une Place au soleil, l’inspecteur Ali lui a, depuis, échappé :
« Je
l’ai créé un beau jour de printemps, pour ma plus grande joie. Et puis, au fil
des semaines et des pages, il a acquis sa propre vie, tel le monstre de
Frankenstein. »
Effrayé par les facéties, la marginalité et l’indépendance de son personnage, responsable d’enquêtes à la fois parodiques et anti-parodiques par excès, D. Chraïbi prétend reconnaître finalement les vertus de l’expérience :
« Avec
du recul vis-à-vis de moi-même, je me demande si cet inspecteur Ali de malheur
ne m’a pas rendu service à mon insu. Oui : le temps n’est-il pas venu en
effet de dérouter, de faire dérailler vers d’autres voies cette littérature
dite maghrébine dont je suis l’ancêtre en quelque sorte ? Et, par voie de
conséquence, notre culture française
qui risque de devenir un produit d’économie de marché ? Bref, de mettre
carrément les pieds dans le monde réel où nous écrivons ? »
Nous remarquons ici que D. Chraïbi semble se plaire à jouer le rôle -la notion de jeu est déterminante- de l’écrivain humble, conscient des mystères de la création et soucieux de s’en expliquer auprès d’une critique attentive. Cette intervention souligne également qu’il est un adepte de la dérision, puisqu’il s’agit tout de même d’expliquer pourquoi il écrit des romans policiers, tout en prévenant du risque de la culture de sombrer dans l’économie de marché et enfin qu’il est incroyablement doué pour parvenir à évoluer dans un système tout en le décrédibilisant. Mais ce qui paraît encore plus saisissant, c’est que Driss Chraïbi pourra écrire autant de polars désopilants qu’il voudra, il ne sera jamais considéré comme un auteur de romans policiers ; il semble jouir pleinement de la situation. Lorsqu’on attend de lui toujours plus de profondeur, de provocation, de dénonciation, il se livre aux errements de son « ouistiti » d’inspecteur Ali, tout en prétendant vouloir, par ce biais, pénétrer au cœur de la réalité. Or, les romans policiers de D. Chraïbi ne manquent pas d’intérêt, ne serait-ce que dans la manière dont le stéréotype y est développé et dont le genre policier y est adapté ; ne serait-ce encore que par l’effet produit par une telle production au sein d’une œuvre littéraire particulièrement dense.
La confrontation des cas Khadra/Chraïbi nous conduit alors à deux suppositions : la première est que pour remédier, d’une certaine façon, à l’étiquetage néfaste et collant du polar, il s’agit d’avoir pris la précaution d’être déjà un marginal, au sein de la « vraie littérature », tant il est vrai qu’on pardonne plus facilement aux éléments perturbateurs leurs errements ; la seconde consiste à penser que pour être aujourd’hui reconnu et médiatisé sous l’étiquette d’auteur de roman policier, il est nécessaire de donner dans le polar sérieux, profond et grave. L’une engage la personnalité, la réputation et le statut de l’écrivain ; l’autre, la perception de la critique. Autrement dit, aujourd’hui et contrairement aux apparences, n’est pas auteur de polars -et surtout reconnu comme tel- qui veut.
2.1.4- L’enquête policière en filigrane
Afin de clore cette première approche de notre corpus, abordons les trois derniers romans que nous avons choisi d’étudier et qui, du point de vue du paratexte en tous cas, paraissent le plus éloigné de la forme policière traditionnelle. Il s’agit des romans de la Guadeloupéenne Maryse Condé (Traversée de la Mangrove ; La Belle créole) et de l’Algérien Rachid Mimouni (Tombéza). Trois romans non policiers qui, cependant, reposent sur un même socle, celui de l’enquête, selon trois perspectives différentes.
Dans le roman de l’Algérien, il s’agit de reconstituer l’histoire de Tombéza, cet être répugnant qualifié en quatrième de couverture de « noiraud, bancal et rachitique, mais hargneux et tenace », né d’un viol et témoin de l’avènement de l’Algérie de l’Indépendance, marquée par « les bassesses, les lâchetés, les exactions » ; un être maudit qui choisira de devenir maléfique « pour prendre sa revanche et gagner enfin à son tour un peu de pouvoir et de considération ». Or, lorsque le roman s’ouvre, Tombéza ressasse son amertume sur un chariot d’hôpital, paralysé et aphasique, abandonné aux cafards d’un placard rebutant. Parallèlement à l’histoire de son agression -que le commissaire Batoul tente par ailleurs de découvrir- c’est toute sa vie que Tombéza nous propose de comprendre, dans un récit où les voix du personnage et de l’auteur se confondent au cœur d’une profonde noirceur. R. Mimouni déclare en ce sens :
« Mon
roman est volontairement poussé au noir par la concentration de tous ces
évènements dans la vie d’un seul personnage… On ne doit pas y chercher une
image objective de la société […]. J’ai délibérément mis l’accent sur la
corruption, les insuffisances, les injustices, les abus. Mon propos est de
contester, de dénoncer… »[185]
L’introduction de l’enquête policière, censée déterminer les circonstances et les raisons de « l’accident » de Tombéza, permet à l’auteur de soutenir, au sein de la fiction, l’introspection muette engagée par la victime. Elle offre également la possibilité d’émettre une critique à l’encontre des pouvoirs publics et de l’autorité de l’Etat, illustrant finalement l’épigraphe choisie qui suggère l’impossible dissociation du Bien et du Mal (« Et celui qui a les mains blanches n’est pas indemne des actes du félon ») ainsi que l’idée d’une responsabilité collective à tout dysfonctionnement (« Et quand le fil noir vient à se rompre, le tisserand vérifie tout le tissu, et il examine aussi le métier »). Le genre policier s’exprime donc, au sein de Tombéza, par le biais d’une approche rétrospective, engagée par un mouvement introspectif.
C’est un même type d’approche que nous retrouvons dans les deux romans de la Guadeloupéenne Maryse Condé qui, contrairement à R. Mimouni, prend par ailleurs le soin d’éliminer toute trace policière au sein de ses romans. Ainsi, alors que le cadavre du mystérieux Francis Sancher est retrouvé face contre terre, dans des circonstances plus qu’étranges, Maryse Condé choisit d’éviter l’intervention de la police, coupant court aux interrogations par l’annonce d’une mort par rupture d’anévrisme. Incrédules, les proches de Sancher et le lecteur à leur suite mènent, d’une certaine manière, leur propre enquête, livrant par voie de monologue leurs témoignage, confession et autres révélations. C’est pourquoi, malgré le démenti apporté dès la page 23, la perspective de l’intrigue policière semble néanmoins s’inscrire en filigrane, comme le remarque un(e) journaliste, interrogeant Maryse Condé sur la forme singulière de Traversée de la Mangrove :
« Il est difficile de donner un genre à ce roman qui commence comme une intrigue policière et qui évolue vers une étude des mœurs et caractères de divers personnages. Cela vous plaît de brouiller les pistes ? »
Maryse Condé répond :
« J’aime bien ça, j’adore ça ! Là encore, enfin quand j’ai commencé à écrire, j’avais du roman une vision assez simple, voire simpliste. Pour moi, on racontait une histoire qui devait servir à l’édification du lecteur […]. Et puis après, je me suis rendu compte que c’était absolument faux et qu’il fallait surtout apporter au lecteur du plaisir, du divertissement, de la fantaisie, et que même si on avait une chose sérieuse à dire, il fallait toujours la dire avec une sorte d’humour et d’ironie. Je crois qu’à partir de “Traversée”, j’ai commencé comme ça à brouiller les pistes jusqu’à mon dernier roman qui est devenu carrément fantastique. »[186]
Il s’agit donc, pour Maryse Condé, de surprendre le lecteur, de brouiller les pistes, de présenter au lecteur un puzzle incomplet. Suggérer l’installation d’une intrigue policière avant de la démentir, tout en préservant un certain mystère, permet à Maryse Condé de réaliser un parfait contre-pied, perturbant, dans le même temps, des attentes de lecture fortement conditionnées de surcroît par le recours -même suggéré- à un genre aussi codifié.
Avec La Belle Créole, publié douze ans plus tard, Maryse Condé choisit à nouveau d’inscrire son texte sous le sceau de la mort et de l’enquête, mais à nouveau l’enquête policière est soigneusement évitée puisque le roman s’ouvre sur l’acquittement du présumé coupable. Inscrit, comme les précédents, dans le cadre de la rétrospective permise par l’introspection du héros, le roman parviendra progressivement à nous livrer les clés de cette affaire tragique jugée superficiellement. Remarquons néanmoins la présence de traces du genre policier au sein de l’avertissement d’avant texte :
« La Belle Créole est un ouvrage de
fiction. Toute ressemblance avec des personnages vivants ou des évènements
survenus dans la réalité est pure coïncidence. »
Cette formule, communément utilisée par le genre policier ainsi que par tout récit revendiquant son caractère fictif, semble, par ailleurs, appuyée par le choix de l’épigraphe en référence à Arthur Rimbaud (« Voici le temps des assassins »).
Dans ces trois romans, l’enquête policière n’apparaît qu’en filigrane, suggérée par la présence d’un enquêteur ou moins directement par l’évocation d’un contexte mortuaire ou simplement énigmatique. Elle plane au-dessus de ces romans, ne serait-ce que dans l’esprit d’un lecteur sensibilisé généralement aux attentes bien particulières suscitées par le genre.
Cette rapide approche paratextuelle nous permet de constater à quel point le genre policier, malgré son déclassement au seuil de la littérature, ne cesse d’interroger, d’attirer, de plaire et d’effrayer. Ouvert à tous et à tout, codifié par tradition, tout en ne disposant plus de véritable « code d’honneur », le genre policier tient lieu aussi bien d’espace ludique plus ou moins réussi, que de défouloir idéologique ou encore de laboratoire stylistique.
Or, si d’aucuns recourent au roman policier sans grande réticence, la plupart préfèrent garder leurs distances vis-à-vis de l’étiquette encombrante d’un genre dont la réputation laisse encore sceptique une partie de la critique. Toutefois, en dépit des réticences de certains, le genre policier ne manque pas d’inspirer de nombreux écrivains, dont quelques-uns bénéficient au préalable d’une certaine reconnaissance auprès du public comme de la critique. Indécis, méfiants, distants à l’égard du roman policier ou, à l’inverse, totalement ancrés au sein de ce cadre générique qu’ils assument pleinement, les auteurs de polars témoignent parfois, par leur positionnement vis-à-vis du genre, d’orientations et d’ambitions qui peuvent dépasser leur stricte volonté ; le poids de la critique ou encore les stratégies éditoriales se laissent en ce sens parfois ressentir sur les choix de présentation de l’ouvrage ou encore sur le discours d’accompagnement tenu par l’auteur, directement ou indirectement[187].
Remarquons enfin que la distance affichée dans le discours, à l’égard du roman policier, semble par ailleurs totalement assumée dans la forme puisque finalement peu de romans de notre corpus relèvent strictement du schéma policier traditionnel. Dans la plupart des œuvres qui nous intéressent, en effet, le recours au genre policier fait ouvertement figure de prétexte ; prétexte tant à la peinture sociale, qu’au désir créatif, ouvrant un large panel de schémas narratifs, certains s’inscrivant dans des configurations relativement conventionnelles au sein de la tradition littéraire policière, d’autres optant pour des perspectives plus originales, dépassant à certains égards les limites de la fiction ou, à l’inverse, s’y répandant allègrement.
2.2- Différents types d’enquêtes
Les romans de notre corpus illustrent différentes orientations possibles vis-à-vis du genre de référence, reconnaissant plus ou moins clairement leurs affinités avec une forme littéraire à la fois populaire et controversée. Cette position souvent frileuse à l’égard de l’« étiquette » générique, ne les empêche pas néanmoins d’exploiter les multiples variantes du genre, oscillant notamment entre roman policier classique et roman noir. Or, il semble que cette oscillation dépende en partie de la manière dont le roman parvient à se positionner entre fiction et réalité : nous constatons en effet que le glissement de la forme classique vers la variante noire signe, d’une certaine manière, le désir d’un ancrage dans l’univers de la réalité tendant finalement à grignoter le cadre fictionnel ou du moins à l’éclipser aux yeux du lecteur.
Le whodunit rassure, prouve que tout est contrôlable, maîtrisable, que le mal n’est pas une fatalité, qu’il existe encore quelques hommes, dotés de qualités supérieures, capables de contenir la folie du monde. Son mode de fonctionnement, alloué à la démarche rationaliste de l’enquêteur, fait de la crédibilité sa pierre angulaire ; il n’en demeure pas moins créé de toutes pièces et parfaitement imaginaire. A l’inverse, l’univers dépeint par le roman noir demeure plus trouble, plus confus : il ne peut rien garantir, ni la happy-end, ni même la survie de l’enquêteur ; il plonge ses personnages, et à leur suite le lecteur, dans l’univers du possible ; l’issue y demeure incertaine, imprévisible. A cet égard, le mode de fonctionnement du roman noir relève d’une démarche plus réaliste, renforçant par là même la portée de l’approche référentielle qui y est généralement revendiquée.
Cette oscillation entre roman policier classique et roman noir est sensible au sein de notre corpus et semble manifester dans le même temps la manière dont chaque auteur perçoit la fiction policière et plus précisément le rôle qu’il entend lui faire jouer. Différents types d’enquêtes nous sont ainsi proposés, certaines demeurant aveuglément soudées au déroulement de l’intrigue et au cadre fictionnel, d’autres utilisant l’intrigue comme simple prétexte à un discours sous-jacent tendant à transcender les frontières de la fiction, d’autres enfin émargeant de manière encore plus marquée l’intérêt de l’intrigue au profit d’une critique masquant finalement une intention essayiste sous les dehors d’une fiction populaire.
2.2.1-
Enquêtes au service de la fiction
Certains romans de notre corpus, fidèles à la forme du whodunit, relèvent d’une construction close sur elle-même : un crime est commis suscitant la mise en œuvre d’une enquête qui, en s’achevant, clôt dans le même temps le texte ; structure classique qui vise à faire coïncider le déroulement du récit avec celui de l’enquête.
Au Vent des fleurs de canne, de Michèle Robin-Clerc, figure de ce point de vue parmi les schémas les plus conventionnels. Le canevas du roman est ainsi méthodiquement exposé dans les trois premiers chapitres : une femme, Patricia, mariée à Joël, entretient une relation adultère avec Sacha, un homme d’affaires qui a perdu la présidence des PMI justement par la faute du mari cocufié qui possède, en outre, d’autres ennemis, dont les mobiles nous sont brièvement exposés. On découvre, par ailleurs, que le commissaire Boucher s’ennuie et qu’il espère davantage d’activité. Tous les éléments en place, le meurtre de Joël intervient au chapitre suivant. L’enquête se déroule alors autour de la collecte d’indices, de témoignages, de suppositions jusqu’à ce que le meurtrier se décide à passer une nouvelle fois à l’attaque, provoquant par là même sa perte. Le roman s’achève sur l’arrestation du coupable -un collaborateur de Joël mis en difficulté financièrement et privé de sa maîtresse par la faute de ce dernier- ainsi que sur les bonnes résolutions du commissaire, déterminé à ne plus tromper sa femme. Sans pour autant être dénué d’intérêt -l’approche du monde affairiste créole retient notamment l’attention-, la portée du roman ne dépasse pas le cadre ludique de la fiction ; il n’aspire d’ailleurs sans doute pas à le faire.
Le Meurtre du Samedi-Gloria de Raphaël Confiant, bien que traînant quelque peu en longueur, participe d’un schéma tout aussi classique : au cours des fêtes de Pâques de l’année 1966, le cadavre de Romule Beausoleil, valeureux combattant de damier[188], est retrouvé près des latrines publiques, la gorge transpercée par un pic à glace. L’inspecteur Dorval, originaire de la Martinique mais tout juste débarqué de métropole, mène l’enquête, redécouvrant dans le même temps son île natale. Les interrogatoires se multiplient, les pistes fusent, mais face à l’imbroglio relationnel régissant la vie communautaire du Morne-Pichevin, Dorval peine à comprendre que c’est finalement l’épouse du principal rival de Beausoleil -une marchande de poisson, adepte du pic à glace- qui l'a assassiné, dans le but de protéger son mari. Après de multiples détours, l’enquête se clôt finalement en laissant dans son sillage quelques portraits, quelques tableaux, sans toutefois susciter de véritable questionnement, sans inciter particulièrement à la réflexion : R. Confiant donne l’impression d’avoir tout dit et la clôture de l’enquête le confirme.
Dans ce genre d’enquêtes, comme dans le roman policier classique illustré notamment par Agatha Christie, rien n’est laissé au hasard ; chaque indice, chaque piste, chaque rebondissement a un rôle à jouer et tout le talent de l’auteur consiste à laisser entendre le contraire, à faire croire au hasard, à la spontanéité, à l’incertain. Autrement dit, à aucun moment le lecteur ne doit sentir la présence du scripteur ; un contrat parfois rompu par un manque d’originalité et de finesse suscitant un certain ennui chez le lecteur. La surprise suscitée par le dénouement de l’intrigue ne suffit pas, en effet, à garantir la réussite du roman ; l’attention du lecteur doit demeurer sans cesse en éveil. S’il « décroche », le lecteur de roman policier ne peut évoluer qu’en marge de l’intrigue, parvenant alors rapidement à en percevoir les ficelles. C’est précisément dans cette perspective que nous serions tentée d’appréhender les romans de Charlotte qui semblent parfois relever davantage de la recette de cuisine appliquée scrupuleusement que d’un véritable acte d’écriture. Cousue de fil blanc et souffrant d’un certain manque d’originalité, la portée de ces romans se limite au strict cadre romanesque. Maintenant difficilement l’attention et l’intérêt du lecteur, ces romans par trop prévisibles ne parviennent pas vraiment, en outre, à répondre aux critères de « production-consommation » prêtés au genre policier classique, tels que les définit notamment Jacques Dubois :
« Dès
l’origine, le récit policier se voue à l’obsolescence, à la rapidité d’usage et
d’usure qui est propre à chacun de ses exemplaires. Vite lu et vite oublié.
Laissant peu de traces […]. Le coupable n’a même pas droit à son procès. A
peine dénoncé, c’est-à-dire énoncé,
il est renvoyé au vide par une machine à narrer qui s’interrompt et coupe. Au
suivant. Car la machine repart, mettant en train une autre unité de la série,
de même principe. Tout cela, on le voit, est très adapté à une certaine
conception moderne de la production-consommation. Nul doute que nous soyons,
avec la lecture policière, dans la littérature de marché. »[189]
Il convient, dès lors, de préciser que la « littérature de marché » n’est en rien synonyme de la « littérature facile ». Pour qu’il puisse susciter une lecture rapide, le roman policier doit nécessairement captiver le lecteur et lui proposer des schémas parfaitement compréhensibles, tout en parvenant à le surprendre, ce qui exclut la reprise trop flagrante de « grosses ficelles » ayant déjà fait leur preuve auprès du public. Or, cette restriction paraît parfois occultée, comme en atteste notamment les romans d’Al Sid, peu avare pour sa part en matière de poncifs. Au-delà des « pépés », du whisky et des altercations avec son ex-épouse qui colorent le récit, rien n’est, semble-t-il, refusé au détective privé Ched Ok : ébats charnels en compagnie d’hôtesses de l’air et vie de rêve dans des hôtels luxueux ponctuée, métier oblige, par quelques situations dangereuses souvent agrémentées par une pincée d’exotisme. Notons ici que les Huttus, tueurs à la machette présents dans son deuxième roman, semblent participer d’une approche folklorique de l’Afrique noire relativement malsaine, tandis que la confrontation de Ched Ok avec la mafia new-yorkaise, dans Rouges gorges et souris ravageuses, donne lieu à quelques scènes largement inspirées d’une filmographie ayant fait date, notamment aux Etats-Unis, avec quelques productions dont par exemple Le Parrain[190].
Sexe, action et poncifs éculés fonctionnent ici comme autant d’ingrédients qui tendraient à rapprocher les romans d’Al Sid non tant du roman noir que, plus vraisemblablement, du roman d’espionnage.
Précisons, par ailleurs, que dans le cas des romans de Charlotte, le lecteur se retrouve effectivement confronté au « vite oublié », d’autant plus volontairement que la lecture se fait, en réalité, plus laborieuse que rapide. Voici un sentiment qui, notons-le, peut également se dégager de la lecture du Meurtre du Samedi-Gloria dont l’intrigue menée au ralenti -l’enquête s’étend sur plusieurs mois- cadre finalement assez mal avec l’ambition habituelle du genre policier ; un effet sans doute recherché par R. Confiant, éventuellement désireux de prendre à contre-pied l’orientation traditionnelle du genre, mais qui pèse finalement trop lourdement sur le roman. En somme, si Charlotte et Al Sid « donnent trop » dans le roman policier traditionnel, ficelles apparentes à la clé, R. Confiant, lui, ne semble pas se plier assez à ses exigences.
Avec plus de finesse que Charlotte ou Al Sid et visiblement moins de scrupules que R. Confiant, Fortuné Chalumeau propose, quant à lui, un roman de qualité néanmoins pourvu d’une intrigue relativement classique. Une femme, agacée par les constantes humiliations infligées par son mari, décide de s’adjoindre ses deux amants pour assassiner son époux. Laprée, nouvel inspecteur de la SRPJ de Basse-Terre mène l’enquête, au péril de sa vie -son adjoint aura moins de chance-, usant de ruse, de courage et de logique pour finalement démasquer les coupables et savourer son succès dans les bras d’une belle suspecte innocentée. Rien de bien original à cela hormis le fait que la veuve criminelle se révèle être fascinée par la mise en scène et le milieu cinématographique ; un détail qui va servir de prétexte à l’auteur pour se livrer à une mise en abyme de la propre mise en scène de son intrigue. Doublement scellée en son creux, la fiction policière n’en devient que plus saisissante.
Exploitant de manière encore plus poussée ce droit à la fiction, ce caractère ludique et déconnecté de la réalité propre au whodunit, laissant primer le jeu sur la portée de l’intrigue, certains auteurs choisissent d’entraîner leurs enquêteurs dans des univers résolument fictionnels où, pour le coup, même la raison ne peut rien. Certaines enquêtes glissent alors de la forme policière dans le registre fantastique, comme c’est le cas par exemple avec Solibo Magnifique, Brin d’amour et, de manière plus évidente encore, avec L’Homme-au-bâton.
Volontairement ou non et avec plus ou moins de subtilité, ces romans jouent parfaitement le jeu de la fiction policière proposant un récit totalement voué au déroulement d’une intrigue, se déroulant au rythme de l’enquête mise en scène et s’achevant en même temps qu’elle ou se renouvelant en son sein ; d’autres romans, apparemment construits sur le même modèle, procurent un tout autre sentiment en donnant notamment l’impression d’aspirer à un dépassement des limites purement textuelles.
2.2.2- L’enquête de fiction aux prises avec le contexte référentiel
Sans toutefois opter pour un réalisme pur et dur et verser complètement dans le cadre du documentaire, certains auteurs parviennent néanmoins à inscrire leurs intrigues au sein d’un contexte référentiel précis, offrant à leur texte un intérêt dépassant le strict cadre du déroulement de l’intrigue, tout en se conformant à la forme la plus basique du genre policier.
A la différence de Charlotte, Al Sid ou même Raphaël Confiant, Tony Delsham semble se situer dans une position intermédiaire, parvenant à tenir son lecteur en éveil, tout en proposant une intrigue qui, du point de vue du genre policier, se révèle être des plus conventionnelles.
Alors que la disparition de plusieurs hommes et l’assassinat de deux d’entre eux agitent la communauté du village de Marguaguy, Pierre Corneille, ex-policier ayant démissionné pour protester contre la corruption sévissant au sein des pouvoirs publics, mène l’enquête. Espérant pousser le coupable à la faute en se faisant passer pour un quelconque villageois, Corneille va jusqu’à mettre sa vie en danger pour arriver à ses fins, démasquer et finalement livrer le criminel à la police.
Ne reculant devant aucun cliché ni ressort à succès, T. Delsham propose un roman mêlant sexe, action et humour, fidèle à une certaine ambition du polar et proche en ce sens des intentions d’un auteur comme Al Sid. Cependant, à la différence de ce dernier, il ne s’agit pas pour T. Delsham de se limiter à la simple réalisation d’une fiction policière ; il s’agit de « faire passer un message » et si le roman est clos sur lui-même par l’aboutissement de l’enquête, la résolution de l’énigme et la neutralisation du coupable, la critique, elle, demeure. Corneille ne réintègre pas la police au terme du roman : son combat se poursuit, sa révolte perdure. Tandis que les enquêtes de Ched Ok semblent pouvoir se renouveler à l’infini sur le même schéma, l’action de Corneille s’inscrit dans une perspective appelant une suite, aussi bien pour l’enquêteur que pour l’homme lui-même. Ched Ok ne représente pas autre chose qu’un rôle ; Corneille, lui, est un symbole.
Interrogé sur le caractère de son personnage, Tony Deslham déclare en ce sens :
« Pierre
Corneille est le personnage qui a fasciné les années 70. L’un de ceux qui
commençaient à ne plus être traumatisés par le viol et qui avaient appris à
faire avec. On ne peut pas dire qu’il soit aliéné. Aliéné par rapport à quoi
d’ailleurs ? A partir de combien de siècles la répétition des gestes
empruntés à l’autre cesse d’être aliénation pour devenir gestes naturels ?
Pierre
Corneille a un comportement très identique à l’inspecteur martiniquais de
l’époque, est né dans un département sous influence coloniale. Cette influence
coloniale se joue sur un terrain extrêmement original, puisque la colonisation
martiniquaise ne peut en aucun cas être comparée à la colonisation africaine ou
asiatique […]. Pierre Corneille est le Martiniquais des années 70. »[191]
Naturellement, Pierre Corneille est trop beau, trop intelligent, trop fort, trop parfait pour être vrai et ses aventures trop rocambolesques pour paraître concevables dans la réalité, mais sa typologie, elle, n’a rien de fictionnel : il est une représentation du réel porteur d’un discours critique extra-fictionnel, quand Ched Ok n’est qu’un fantasme incapable de survivre à la fiction qui l’emprisonne. Corneille semble donc, à l’inverse, pouvoir dépasser le simple cadre de la fiction, du fait de son statut de non-policier ; statut hors-cadre offrant visiblement d’autres perspectives, comme le signale notamment le roman de Guy Cabort-Masson, La Mangrove mulâtre.
Dans ce roman, le propos de G. Cabort-Masson consiste à faire la lumière sur un fait divers remontant à quelques années avant l’abolition. Le schéma de l’enquête se prête à cette ambition dans la mesure où le fait divers en question concerne une succession de crimes sanglants commis par un homme nommé Brafin, promu béké et s’étant laisser griser par le pouvoir et emporter dans une violence primitive à l’encontre de ses esclaves. En somme, comme le résume l’un des personnages : « Brafin a voulu être béké mais il n’avait pas l’estomac de l’emploi »[192].
Pour enquêter sur ces crimes commis en 1840, G. Cabort-Masson choisit ainsi de mettre en scène Dampierre, avocat originaire de Martinique mais totalement ignorant du pays de ses ancêtres, mandaté par les abolitionnistes parisiens, dont Bissette et Schoelcher. Chargé de « suivre l’évolution des évènements », alors que Brafin a été acquitté par la justice, Dampierre va progressivement découvrir un peuple déchiré par la haine et la violence. L’enjeu de l’enquête, s’effectuant en marge des instances officielles dont le jugement intervient dans un cadre esclavagiste, et par là même inégalitaire, prend alors une toute autre résonance : Dampierre n’intervient pas en tant que fonction, mais en tant qu’homme, ignorant de ses racines et confronté à un univers criminel. Si Dampierre relève de la fiction, le contexte socio-historique décrit, lui, est bien réel, d’autant que l’affaire Brafin s’inspire d’évènements ayant réellement existé : différents témoignages historiques évoquent l’existence d’un négociant de Saint-Pierre, propriétaire d’une sucrerie, acquitté en justice, après avoir été accusé, en 1838, d’avoir poussé certains de ses esclaves au suicide, en raison de la dureté des châtiments qu’il leur imposait.
L’inscription de l’intrigue au cœur d’un contexte historique précis et autour d’un événement inspiré de la réalité confère à la fiction cette vraisemblance qui pousse au questionnement et à la réflexion, au-delà même du strict déroulement de l’intrigue. Au travers de l’affaire Brafin ce sont, en fait, les méandres des discussions et négociations engagées autour de la question de l’abolition que G. Cabort-Masson propose d’illustrer.
L’illustration d’un contexte socio-historique précis participe également du mode de fonctionnement du deuxième roman de G. Cabort-Masson intitulé Qui a tué le béké de Trinité ? dont l’action se situe dans les années 1940, alors que la Martinique est placée sous le régime de Vichy. Découvrant par le biais de pensées, de réflexions, de souvenirs, l’histoire et l’identité profonde des différents protagonistes, le lecteur obtient ainsi un aperçu de la mentalité martiniquaise sous le règne de l’Amiral Robert, représentant du régime de Vichy. Autrement dit, c’est par la mise en fiction d’une famille représentative de la société de l’époque -avec ses pro-vichyssois et ses Résistants- que l’auteur nous permet de percevoir de manière plus précise une période trouble de l’Histoire martiniquaise, marquée par de profonds dysfonctionnements y compris au sein de la caste békée.
On comprend alors que la fiction joue, dans ce contexte, un rôle de révélateur, d’illustrateur de l’Histoire, dépassant ses propres frontières par la charge historique dont elle s’inspire. Le cadre colonial se prêtant à cet objectif, il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que cette orientation historique, permise par le biais de l’enquête de fiction, apparaisse également dans certains romans de littérature maghrébine.
Revenant sur une période mouvementée de l’Histoire marocaine, dans le roman intitulé Des Pruneaux dans le tagine, J-P. Koffel illustre, à son tour, parfaitement la manière dont le genre policier parvient à véhiculer un discours prenant pour référent une période historique précise. Avec ce roman, J-P. Koffel choisit, en effet, d’installer l’intrigue policière sous le Protectorat, recrutant ses protagonistes essentiellement au sein de deux partis rivaux de l’époque : les partisans de la Résistance d’une part, ceux du pouvoir autoritaire français, d’autre part. Si, encore une fois, le déroulement de l’intrigue relève de la fiction, le contexte socio-historique décrit -l’évocation des tortures et des attentas par exemple- s’inscrit quant à lui dans une peinture pouvant, de manière plus ou moins cohérente et fiable, s’inscrire dans la perspective du documentaire.
De même, avec L’Inspecteur Kamal fait chou blanc, J-P. Koffel propose un roman relevant de la plus pure tradition du genre policier proche d’Agatha Christie ou de Conan Doyle, tout en parvenant à inscrire son texte dans une démarche critique et dénonciatrice à l’égard de la société des nantis marocains : le criminel, influencé par ses lectures « hugoliennes », joue ainsi les justiciers volant au secours des multiples « Cosette » exploitées par les riches citadins. Au-delà du strict déroulement de l’intrigue, le roman laisse ainsi percer le discours de l’auteur qui, dans ce type d’ouvrages, ne se comporte pas en simple scripteur ayant la charge d’orchestrer une intrigue en s’attachant prioritairement à l’aspect technique du récit, mais se pose en tête pensante, porteur d’une opinion se servant de la fiction comme vecteur d’un discours critique. Or, si dans certains ouvrages de notre corpus cette démarche s’accomplit dans la coexistence équitable du cadre fictif d’une part et du contexte référentiel d’autre part, l’équilibre paraît plus délicat à maintenir dans certains cas où le poids du contexte référentiel finit par l’emporter sur la justification du cadre romanesque, le roman policier cédant finalement le pas à ce que l’on pourrait qualifier de « fiction documentaire ».
2.2.3- Vers une « fiction
documentaire »
Prenant pour cadre un contexte référentiel précis, relevant éventuellement d’une approche de type historique, certains romans de notre corpus semblent finalement faire de l’enquête policière de fiction le prétexte à une peinture et à une critique relevant d’une représentation se voulant en prise avec la réalité. Il s’agit ici des enquêtes de fiction trouvant des points d’ancrage saisissants au sein de la réalité, d’autant que les sujets qui y sont abordés relèvent de l’actualité et s’avèrent être également traités dans les journaux aussi bien locaux qu’internationaux.
Rida Lamrini, par exemple, choisit d’ancrer son roman au cœur de la campagne d’assainissement des marchés, décrétée par le gouvernement marocain à la fin des années 1990. Dans son cas, l’intérêt de la fiction pâtit quelque peu de l’écrasement de l’enquête sous le poids d’un contexte politico-financier lourdement exposé : l’enquête y apparaît trop comme un prétexte, souffrant d’un certain manque de finesse non dans les rouages du crime, mais dans le cheminement même de la déduction. En revanche, d’autres auteurs parviennent à équilibrer de manière plus subtile le réalisme du contexte et le caractère fictif de l’enquête.
Les romans des Algériens Yasmina Khadra et Boualem Sansal participent largement de cette perspective. Si l’humour n’est pas absent de leurs ouvrages, l’aspect ludique du genre policier en est totalement gommé : le lecteur n’a d’ailleurs aucune envie de jouer à découvrir le nom du coupable. Vissé à l’enquêteur principal, il assiste passif et néanmoins ému au cheminement de ce dernier, évoluant péniblement dans un univers hostile et menaçant. Il n’est, en outre, pas utile à Yasmina Khadra de doter son commissaire Llob d’une fiche d’état civil trop détaillée, pour que le lecteur « croie » en lui : plus que par son statut ou par son histoire personnelle, Llob existe, à nos yeux, par son amertume, sa ténacité et surtout par sa peur. C’est en grande partie par celle-ci que le personnage parvient à tenir son lecteur, à lui faire oublier la sphère fictionnelle. Or, au fil des enquêtes, Llob nous apparaît de plus en plus terrifié, glissant progressivement de l’enveloppe du personnage de fiction à celle de l’homme, de l’Algérien : il meurt ainsi après avoir été exclu de la police et avoir refusé d’y être réintégré. Perdant sa couverture de représentant de l’Etat, il quitte d’une certaine manière la fiction policière qui l’a fait naître, redevenant un simple citoyen, commun et mortel.
Comme dans les romans de Yasmina Khadra, la réalité se rappelle brutalement à la fiction dans Le Serment des barbares de Boualem Sansal. Le vieil inspecteur Larbi y est à son tour terrassé, ayant finalement choisi de « mourir dans les étincelles plutôt que vivre à petit feu »[193]. Choisissant de tenir informés ses adversaires de ses intentions, par pure provocation et rejet de la passivité et du silence habituels, il cause sa propre perte. Imprudent, impulsif, omettant de protéger ses arrières, il bafoue, d’une certaine manière les règles du bon sens traditionnellement caractéristique de l’enquêteur de fiction. En sortant de la sorte du cadre, il renonce à jouir de la protection de l’auteur : lui aussi redevient alors mortel.
Cette sanction finale, infligée par B. Sansal et Y. Khadra à leur héros, introduit le danger, l’impossible et l’incertain au cœur du roman, prenant par la même des allures de reportage de fiction, de fiction réaliste. Les enquêtes mises en scène dans ces romans ne se limitent plus alors aux simples suppositions : face à la crise gangrenant leur pays, les écrivains mènent l’enquête pour aboutir à des conclusions bien précises. Au terme du cheminement de l’enquêteur de fiction se profilent les propres convictions de l’auteur, tant il est vrai que ce dernier a, seul, la responsabilité du choix du coupable. Si l’enquête de fiction permet, en premier lieu, de témoigner du tragique et de la complexité de la situation algérienne, elle fait en outre office d’argumentation étayant les convictions personnelles d’auteurs, qui, rappelons-le, n’ont rien d’ordinaires : l’un est un ancien officier de l’armée ; l’autre, un haut-fonctionnaire de l’Etat. Cette surdétermination ne manque pas de susciter un intérêt tout particulier, tant du point de vue de l’éditeur que de celui du lecteur, tous deux alors davantage orientés vers la perspective documentaire que proprement littéraire ; une réaction qui semble pouvoir expliquer, en aval, l’insistance avec laquelle Boualem Sansal et Yasmina Khadra ne cessent de clamer leur goût des belles lettres et leur fierté d’être reconnus comme de véritables écrivains.
Pour en revenir à la distinction évidente entre les romans totalement ancrés dans la sphère fictionnelle et ceux qui semblent pouvoir ou pouvoir s’en échapper, nous constatons que tandis que les romans strictement ancrés dans la fiction laissent croire à l’impossible tout en tenant fermement les rênes de l’intrigue, les romans construits sur le modèle de ceux de Yasmina Khadra et Boualem Sansal, s’avèrent tragiquement imprévisibles. Incapables de sauver leurs propres personnages au terme du roman, ils signent par là même le retour de l’absurde au cœur d’un genre qui semblait a priori en être fondamentalement incapable.
Pour finir, relevons enfin, une nouvelle fois, la marginalité de Driss Chraïbi en la matière qui semble en fait parvenir à une forme de dialectique, n’inscrivant ses récits policiers ni totalement dans une transposition du réel, ni entièrement sous le sceau de la fiction.
L’inspecteur Ali est, en ce sens, à la fois un stéréotype, un rôle, un costume et un type humain : la cruauté de son jugement envers les criminels et le sort funeste qu’il choisit de leur réserver, notamment dans L’Inspecteur Ali et la C.I.A. et L’Inspecteur Ali à Trinity College, en attestent. Il est ce policier qu’un coup de fil du chef vient déranger en pleine intimité avec sa femme ; cet homme incapable de séparer plaisir et travail ; celui qui invite sa femme à participer à l’enquête ; celui qui rêve de laisser son rôle de policier pour celui de poète. Il est le personnage par excellence, celui qui semble jouir d’une parfaite autonomie, une créature échappant à son maître, une sorte de Frankenstein. Aussi, entre Une Enquête au pays et Une Place au soleil, Ali n’est plus le même[194] et ce changement semble notamment amorcé dès le terme du premier roman. Ali y doit, en effet, sa survie à la clémence des villageois, autrement dit à la bonté de son créateur, l’auteur lui-même. Autrement dit, ce n’est qu’en tant que personnage soumis au bon vouloir de son créateur qu’Ali demeure -l’interaction entre l’homme et le personnage, et par glissement entre Dieu et l’écrivain est ici flagrante ; une hypothèse qui pourrait expliquer que le roman s’achève sur son recommencement. Ali, sauvé et promu chef par le scripteur, endosse alors un nouveau costume, s’engage dans un nouveau rôle, à la fois automate du scripteur et de l’Etat, et peut dès lors, privé de toute humanité, remonter punir les villageois.
Puisqu’il n’est qu’un pion entre les mains de son créateur, Ali entre, dans les trois romans suivants le mettant en scène, véritablement dans la peau de son personnage ; d’où son extravagance, son génie extraordinaire, ses méthodes hors du commun, défiant d’une certaine manière l’autorité de son créateur. Or, cette prétendue autonomie d’Ali semble pouvoir servir parallèlement de « couverture », de prétexte à D. Chraïbi qui, encouragé de surcroît par la mauvaise réputation du genre policier, ne se refuse aucune extravagance[195].
A partir de l’étude du paratexte, nous avons donc pu établir que les ambitions et orientations de l’auteur mais également de l’éditeur, à l’égard du genre policier, pouvaient diverger en fonction du positionnement de chaque auteur vis-à-vis de cette forme littéraire si singulière, au sillage potentiellement nuisible, du point de vue de la critique et de la réception du lecteur notamment.
Une approche globale des enquêtes mises en scène nous a, par ailleurs, permis de constater une différence assez nette entre les romans évoluant dans une sphère strictement fictionnelle, relevant soit d’une forme purement ludique, soit d’une approche tendant à souligner la structure close du récit d’enquête et des textes qui, par leurs connections avec des évènements, situations ou agissements relevant de la réalité, parviennent à entraîner le lecteur hors du strict champ fictionnel.
Cette approche nous permet de procéder à un premier bilan mettant en évidence, en tout premier lieu, le fossé qui s’établit entre, d’une part, les romans algériens relevant de la forme noire par une approche critique très marquée et par la prégnance de la noirceur du cadre, perdurant au-delà même des limites romanesques et, d’autre part, les romans volontairement « ultra policiers », jusqu’au pastiche, à vocation purement ludique -par choix aussi bien, semble-t-il que par faiblesse- essentiellement expérimentés par les auteurs tunisiens.
Une deuxième constatation nous permet d’établir que, dans la plupart des cas, l’usage de la forme policière fonctionne comme le prétexte à l’expression d’un message à valeur soit socio-historique, soit littéraire et parfois les deux ensemble. On constate, en ce sens, un rapprochement notable entre deux auteurs, l’un Franco-Marocain (J-P. Koffel), l’autre Martiniquais (G. Cabort-Masson), qui choisissent la forme policière pour revenir sur des points précis de l’Histoire, sur des moments-clés souvent obscurs de la constitution de leur société, illustrant par là même l’intérêt d’une telle forme au sein de sociétés marquées par un passé colonial omniprésent dans les consciences.
Notons, par ailleurs, que la fiction policière est abordée par certains auteurs dans une perspective plus littéraire, engageant une réflexion portant sur le fonctionnement même du récit. On constate en ce sens certaines affinités notamment entre l’approche de Driss Chraïbi et celle de quelques auteurs antillais, tels Patrick Chamoiseau, Ernest Pépin ou encore Fortuné Chalumeau, qui, chacun à sa manière, s’interrogent sur la nature, le fonctionnement et les éventuels dérapages d’une construction aussi bien huilée que celle propre à la fiction policière.
Ainsi, les différents types d’enquête proposés donnent à voir les multiples orientations et objectifs possibles du genre policier oscillant notamment, en ce qui concerne les ouvrages de notre corpus, entre fonctions ludique et critique, chaque orientation pouvant se décliner de manière plus ou moins nuancée. Il convient dès lors de pénétrer plus avant au cœur des fictions proposées, en nous intéressant notamment au personnage de l’enquêteur dont l’étude nous permettra de préciser encore plus précisément la singularité et les contours des différentes adaptations proposées du genre policier.
2.3- Différents profils d’enquêteurs
Nous remarquons en premier lieu que, dans le cadre de la fiction policière, le type d’enquête est logiquement constitutif du profil de l’enquêteur et vice versa. En d’autres termes encore, relevant d’une perspective ludique, critique ou créative, le type d’enquête proposé imprime son orientation sur le personnage de l’enquêteur qui se fait parallèlement lui-même le moteur de l’enquête.
En fonction des intentions de l’auteur et selon l’orientation du roman, différents profils d’enquêteurs nous sont donc proposés, oscillant entre figures victorieuses fidèles à la forme classique du genre ; figures frustrées dans la perspective de la variante noire du genre ; ou encore figures névrosées en une adaptation originale du modèle de référence.
2.3.1- Les enquêteurs à succès
Intéressons-nous, dans un premier temps, aux enquêteurs rassurants, à ceux qui grâce à leur ténacité, leur courage et leur « bonne étoile » paraissent infaillibles et ne permettent pas de douter de l’issue positive du roman. Ainsi, comme le soulignent P. Boileau et T. Narcejac :
« Le détective ne peut pas ne pas être infaillible. Il est infaillible, non pas parce qu’il est un surhomme, mais parce que son rôle est de “démonter” un imbroglio qui a été “monté” pour lui. S’il se trompait, il ne fournirait pas la preuve que le mystère le dépasse, mais tout simplement que l’histoire est mauvaise, et, dans ce cas, le romancier renoncerait à écrire celle-ci. Du moment que l’histoire existe, le policier est infaillible. »[196]
Dans cette catégorie de vainqueurs, opérons une distinction entre ancienne et jeune générations, les premiers jouissant de l’expérience de l’âge, quand les seconds mettent à profit leur vivacité physique.
Parmi les anciens, intéressons-nous, par exemple, à trois profils différents illustrés par le commissaire Ayadi, mis en scène dans deux romans de Charlotte ; l’inspecteur Claude Bertrand, à l’œuvre dans le roman de J-P. Koffel, Des Pruneaux dans le tagine ; et enfin l’inspecteur Edmond Laprée mis en scène dans le roman de F. Chalumeau, Pourpre est la mer.
Ces trois enquêteurs types symbolisent les méthodes de la vieille génération par leur approche cérébrale du problème à résoudre : méfiants par nature, instinctifs, adeptes du bluff et usant de psychologie pour venir à bout des suspects les plus récalcitrants, ces trois hommes se comportent en parfaits enquêteurs en ce qu’ils demeurent exclusivement concentrés sur la clé de l’énigme. Seule cette dernière procure en eux quelques frissons, la peur de l’échec et l’exaltation de la découverte se succédant jusqu’à la résolution finale. Ainsi, Laprée et Bertrand illustrent, par exemple, leurs craintes, leur lassitude dans une tendance à la lamentation relativement commune à leur fonction. Désabusé, Laprée s’exclame ainsi :
« Qu’il
est austère et noble, le travail de l’enquêteur ! Il s’était démené comme
un beau diable pour trouver le coupable et il découvrait surtout des
innocents. »[197]
Plus angoissé, Bertrand, lui, désespère :
« Le
sentiment de l’échec, du gaspillage de temps, d’énergie, de matière grise. Et
puis cette immense lassitude physique consécutive à une nuit blanche. »[198]
C’est que, pour réussir, l’enquêteur généralement angoissé par nature sous une confiance apparente a besoin de douter, de se remettre en question, de se plaindre de son triste sort, avant de briller, de renverser une situation présentée au préalable comme désespérée. Ceci justifie les grands moments d’exaltation et d’autosatisfaction coïncidant avec la découverte, allant de la fausse modestie (« Comment lui, Bertrand, le fin limier, l’observateur impeccable, avait-il pu être aveugle si longtemps ? »[199]) à l’ébullition jubilatoire (« Plein d’activité subitement, le commissaire [Ayadi] sauta sur ses jambes, marcha de long en large, nerveusement, s’arrêta soudain, ponctua du geste pour repartir résolument vers sa voiture, qui, impressionnée, démarra au quart de tour »[200]). Si l’attitude de l’enquêteur face à la découverte de l’énigme prend parfois des proportions démesurées, c’est que la réussite de l’enquête est avant tout une question d’honneur. Il s’agit plus de répondre à une ambition personnelle -celle de faire preuve d’intelligence- que de mener une action salvatrice pour la communauté. L’enquêteur fonctionne ici comme une machine à résoudre l’énigme, non comme un justicier ; un rôle mis en évidence, ironiquement, par l’inspecteur Laprée :
« Il
rêvait de dire à son interlocuteur qu’un crime était un crime, et que son
boulot à lui restait de l’élucider. Même si cette affaire se révélait le petit
rouage d’une immense machinerie qui impliquait les barons de la drogue, le roi
des maquereaux, la princesse Stéphanie de Monaco, le FMI, le GATT et le pape,
il fallait qu’il mette un nom sur le visage encore mal cerné du meurtrier de
Beudry. »[201]
Il s’agit, autrement dit, de trouver la vérité coûte que coûte, sans qu’aucune implication personnelle ne soit permise ; un mot d’ordre parfaitement assimilé par Bertrand, dans le roman de J-P. Koffel Des Pruneaux dans le tagine, qui, contrairement à son collègue Perrin, se refuse à tout sentimentalisme, traquant la meurtrière justicière sans aucun scrupule, prêt à tout pour mener son enquête à bien. Professionnel avant tout, Bertrand se distingue, en ce sens, de Laprée, qui n’a aucun scrupule à revendiquer son droit à la faiblesse, au sentiment ou encore au défaitisme. Séquestré dans une usine désaffectée inondée d’effluves alcoolisées, sous la surveillance d’une femme désirable, Laprée perd ainsi facilement sa motivation, voire sa vocation d’enquêteur :
« Sa
propre séquestration lui procurait un agréable sentiment de hors-jeu. Que le
monde se débrouille pour tout arranger, lui il attendrait sur sa
couchette. »[202]
Contrairement au vieil Ayadi, amateur de Luth, bon vivant et ultra-conservateur en matière d’évolution des mœurs -sa vision de la femme est particulièrement vieux-jeu- et au très sérieux et professionnel Bertrand, l’inspecteur Laprée semble parfois peiner à contrôler ses ardeurs : son humour à toute épreuve, son éternel défaitisme et son goût immodéré pour les belles femmes -il n’hésite pas à ruiner son plan « Epargne-Logement » pour quelques nuits dans un palace avec l’une d’entre elles- le rapproche en effet davantage des jeunes générations, par la vivacité dont il témoigne.
Assommé, séquestré, tenu en joue, poursuivi par des chiens, Laprée peut aussi à l’occasion jouer les hommes d’action, qualité plus largement octroyée à quelques-uns de ses cadets, visiblement inspirés par deux grands modèles en la matière : les James Bond et autres héros affrontant les situations les plus dangereuses, le sourire aux lèvres ; les Ed Cercueil et Fossoyeurs Jones, au profil nettement plus grave, voire désespéré.
Parmi les « supers-héros », jeunes, vigoureux et séduisants, intéressons-nous à deux phénomènes issus de romans marocains : l’inspecteur Kamal, mis en scène par J-P. Koffel, et l’inspecteur Ali, héros récurrent des romans policiers de Driss Chraïbi[203]. Tous deux amateurs de mots croisés, de femmes et de bonne cuisine, les inspecteurs Kamal et Ali brillent par leur perspicacité, leur vivacité, autant que par leur spiritualité -avec plus ou moins de finesse en ce qui concerne Ali- ; des qualités communes ne cachant pas, néanmoins, de profondes divergences.
Licencié ès lettres, ayant « appris la langue de Voltaire et de Guy des Cars, tout bêtement, en faisant […] la lecture à un oncle aveugle »[204], Mouhcine Kamal, alias le « fringant inspecteur Kamal »[205], « le chouchou de ses dames »[206], se veut le gendre parfait. Soucieux des convenances et toujours impeccablement mis -arborant, comble de son charme et de sa vigueur, une « petite moustache lisse tirant sur l’acajou »[207], source selon lui de son énergie- Kamal n’a, en ce sens, rien à voir avec les mauvaises manières de son compatriote.
Fier de sa salopette trouée, de ses vieilles baskets et, de manière générale, de son apparente désinvolture, l’inspecteur Ali est avant tout un marginal. Adepte du kif, des femmes -seule la sienne obtient néanmoins ses faveurs- de la musique et de la poésie arabes, Ali se révèle être par ailleurs un enquêteur parmi les plus brillants. Sollicité, moyennant de fortes sommes d’argent, pour enquêter par-delà le monde sur les affaires les plus délicates impliquant des Marocains, Ali semble toujours parfaitement maîtriser son affaire ; c’est qu’il tient sa force, ainsi qu’il le souligne dans L’Inspecteur Ali et la C.I.A., des sardines, des mots croisés et de la parole d’Allah. Une trilogie explosive cadrant assez bien avec l’image de « ouistiti » -selon les propos de l’auteur- qu’il véhicule tout au long de ses enquêtes, auprès d’employeurs et d’adversaires qui généralement le sous-estiment, rendant par là même plus faciles certaines de ses manœuvres. « Columbo à l’orientale » jouant les idiots, Ali concentre sur lui les regards critiques et les préjugés et fait finalement figure de leurre, comme dans la fameuse série télévisée américaine où la réussite de l’enquêteur supposé idiot tend à souligner, de manière assez démagogique, qu’il est plus prudent de se méfier des apparences et de se garder du délit de faciès. Notons cependant une différence majeure : dans la série télévisée, Columbo n’existe que par le stéréotype reposant sur la constante reprise du même costume, des mêmes réflexions, des mêmes attitudes et de la même manière de procéder ; l’inspecteur Ali, quant à lui, paraît nettement plus imprévisible pour le lecteur, ajoutant à sa perspicacité un goût certain pour la provocation.
Bien que fondamentalement différents en tant qu’hommes, Kamal et Ali témoignent, en tant qu’enquêteurs, d’une certaine vivacité d’esprit et d’action qui stimule leurs enquêtes et qui, dans d’autres romans, se manifeste de manière encore plus accentuée, transformant les enquêteurs à matière grise en véritables hommes de terrain.
Deux figures de Privés, nous paraissent ici significatives : il s’agit d’Amédien, détective privé de Fort-de-France mis en scène dans le roman de R. Confiant, Brin d’amour, et de Pierre Corneille, ancien policier martiniquais, à l’œuvre dans le roman de T. Delsham, Panique aux Antilles, tous deux enquêteurs types de la forme policière. Ainsi, Amédien semble s’inspirer de Sherlock Holmes, la décontraction, l’agressivité et la nervosité en plus. Arborant jean, chemise mal repassée et Remington, il déambule dans les rues en posant des questions anodines, l’air de rien, « machouillant » des allumettes, prenant constamment des notes sur des petits carnets verts et marmonnant sans cesse « Intéressant ! Très intéressant… »[208]. Mandaté par la police, contre renouvellement de sa licence, Amédien doit sans cesse défendre son statut. Qualifié de marginal par la mère d’une suspecte (« Vous n’êtes même pas policier ! Vous n’êtes qu’un détective privé et personne ne sait ici pour qui vous travaillez. »[209]), il répond :
« Vous
me confondez sans doute avec l’un de vos chers touristes. Je ne traque ni
coléoptères ni oiseaux rares, moi […]. Sachez que je suis mandaté par le
directeur de la police de Fort-de-France. »[210]
Une justification dont Pierre Corneille, à l’inverse, se passe : ardemment sollicité par ses anciens collègues en plein désarroi dans leur enquête, il fait véritablement figure de sauveur, ajoutant l’efficacité à sa panoplie de « super-héros » déjà largement étayée ; physique ravageur, courageux, impétueux et sûr de lui, rien n’est trop beau pour ce super-héros, « docteur en droit expert en criminologie, champion des armes à feu toute catégorie, expert en karaté, explosif, bilingue »[211]. Il est, en outre, assailli par les femmes et fait véritablement figure d’incorruptible, ayant quitté la police pour protester contre la partialité de la justice dans certaines grosses affaires. Grand homme de terrain, il échappe plusieurs fois à la mort et se sort des situations les plus hostiles, illustrant par-dessus tout la figure du héros chanceux et invincible, tels que les films d’action, de type comédie policière, peuvent en proposer.
Beaucoup moins éclairés par leur bonne étoile, d’autres enquêteurs sont également propulsés sur le terrain, dans des conditions beaucoup plus incertaines, à l’instar, par exemple, des collaborateurs du Commissaire Llob, héros de Yasmina Khadra, à savoir notamment Lino et Ewegh.
Il apparaît, en effet, que dans l’Algérie tourmentée décrite par Yasmina Khadra, les hommes de terrain font finalement rapidement figures de kamikazes.
Le personnage de Lino nous apparaît, dans les premières aventures, comme « un intello binoclard qui passe son temps à bouquiner les polars pour avoir l’air cultivé »[212], prêt à tout pour réussir : « comme tous les ambitieux de sa génération, il n’a pas plus d’amour-propre qu’un chat de gouttière »[213]. Volontaire et dynamique, Lino semble avoir choisi son métier par conviction, se prenant même parfois un peu trop au sérieux :
« A
chaque fois que sa fonction lui monte à la tête, il se prend pour un redresseur
de tort messianique. »[214]
Llob prétend ainsi que lors de sa première arrestation, Lino a lu au prévenu les droits constitutionnels américains. Or, malmenée par la tragique réalité, cette force de conviction pousse progressivement Lino au désespoir :
« Je
pense à tous ces massacres de par la terre et je me demande si les êtres
humains méritent vraiment leur qualificatif. »[215]
De plus en plus marqué au fil des aventures, ce désespoir se transforme en amertume, puis en peur. Toujours prêt à brandir son arme efficacement face aux nombreux adversaires, Lino finit néanmoins par se décourager pour s’effacer progressivement :
« Il
est derrière sa machine à écrire, des cernes sur sa face de Pierrot. Il n’a
plus d’ongles aux doigts, plus d’expression dans le regard. »[216]
Souffre-douleur de Llob, toujours moqueur et autoritaire à son égard, il est finalement réhabilité dans le dernier roman :
« C’est vrai que je le reléguais machinalement au rang des souffre-douleur, qu’à chaque fois que les choses m’échappaient, je l’en tenais pour responsable ; c’est vrai que je le considérais comme menu fretin, refusant de lui trouver du mérite simplement parce qu’on négligeait le mien, mais je l’aime profondément et il le sait. »[217]
A la mort de Llob, Lino demeure, en outre, celui qui reste, illustrant cette phrase dont il est l’auteur :
« La plus raisonnable façon de servir une cause n’est pas de mourir pour elle, mais de lui survivre. »[218]
Il incarne ainsi, d’une certaine façon, l’espoir ; une note presque positive au cœur de la noirceur, également illustrée par la présence d’Ewegh, aux côtés de Lino et Llob, dans les deux derniers volets de la série.
Ewegh Sedig, trente-sept ans, célibataire, tergui et « tête brûlée »[219] joue véritablement le rôle de bouée de sauvetage dans l’univers menacé des policiers algériens. Colosse au revers fatal, il signe vraisemblablement la réponse de Llob face à l’impuissance : si la loi ne peut rien, Ewegh offre néanmoins la possibilité de se défouler. Il est rassurant et offre, en outre, au roman une touche plus drôle en imitant notamment ces héros de « Série B », écrasant tout sur leur passage, avec le sourire et la réplique adéquats. S’inspirant de ces modèles populaires, le narrateur parvient à créer une certaine connivence avec le lecteur en recourant notamment à différents procédés elliptiques, laissant à ce dernier la possibilité d’imaginer certaines scènes : il n’est ainsi pas nécessaire de décrire la manière dont un suspect est neutralisé, dès lors que le lecteur sait qu’Ewegh est sur sa route, le nez cassé étant sa spécialité.
Or, au-delà des effets humoristiques et dynamisants produits sur la lecture, le recours à la violence ainsi pratiqué souligne, en réalité, l’incapacité des enquêteurs à résoudre quoi que ce soit. Lino et Ewegh, malgré leur volonté, leur conviction et leurs différents atouts symbolisent, en effet, l’échec : ni l’un, ni l’autre, ne pourra éviter le meurtre de Llob. La victoire finale, requise d’ordinaire par la forme littéraire et les différents ingrédients dont elle dispose, n’est dès lors plus permise, les figures de fin limiers cédant le pas à la perspective plus réaliste des enquêteurs impuissants.
2.3.2- Les limiers muselés
Dans les sociétés modernes où pouvoir et argent jouent un rôle important, les seules qualités propres aux enquêteurs ne suffisent pas toujours à garantir une issue positive à l’enquête. Parfois contraints au silence, de manière plus ou moins radicale, les fins limiers sont, dans certains cas, rappelés à l’ordre et à leur devoir d’obédience à la hiérarchie.
L’inspecteur Ali d’Une Enquête au pays se voit ainsi contraint de ramper constamment devant les excès autoritaires de son chef, s’autocensurant par crainte des réprimandes et du système et veillant bien à ne pas faire preuve d’initiatives qui tendraient à le faire passer pour un « insectuel ». Comprenant l’ambivalence de sa position de policier exerçant un pouvoir, tout en obéissant aux ordres de ses supérieurs, Ali résume ainsi la logique qu’il est censé appliquer :
« On
te tape sur la gueule et tu tapes sur celle des gars en dessous de toi. »[220]
Face à un système aussi autoritaire et injuste que celui-ci, certains enquêteurs préfèrent s’en remettre à la contestation, laissant d’une certaine manière s’exprimer leur « nature rebelle », avec parfois une pointe de romantisme ; il en est notamment ainsi de l’officier de police Perrin, collaborateur de Claude Bertrand dans le roman de J-P. Koffel, Des Pruneaux dans le tagine.
Etudiant en Droit, ayant choisi la police « un peu par manque d’imagination, un peu par admiration pour un jeune commissaire parisien qui s’occupait d’enfants délinquants »[221], Perrin se voit chargé d’enquêter sur cette affaire opposant Résistants et partisans de l’autoritarisme français, alors qu’il réside au Maroc depuis peu. Confronté aux déchirures d’un peuple soumis, au lieu de baigner dans l’univers exotique qu’il avait imaginé avant sa mutation, Perrin réalise alors les véritables tenants et aboutissants de sa fonction de défenseur de l’Etat français, au service d’un système dérivant de la colonisation. Ecoeuré « de servir les rouages d’une administration coloniale »[222] et las de poursuivre une criminelle dont il comprend et respecte l’action, Perrin finit par se détacher de l’enquête et de ses collègues, dont les méthodes sont jugées particulièrement brutales et arrogantes. Une prolepse nous apprend qu’il quittera ultérieurement la police pour devenir un juriste de renommée mondiale, secondé par sa charmante épouse Mina -un des témoins de l’enquête.
D’autres figures de rebelles nous sont encore présentées, comme celle de l’inspecteur Dorval, mis en scène par R. Confiant dans Le Meurtre du Samedi-Gloria. Sosie de Sidney Poitier[223], Dorval semble véritablement jouer les justiciers idéalistes. Son insistance à poursuivre l’enquête sur le meurtre d’un « nègre va-nu-pieds », alors que son supérieur le somme de s’intéresser davantage aux cambriolages commis dans les villas des riches Blancs créoles, en atteste, relevant toutefois moins d’une profonde philanthropie que d’une motivation personnelle. De retour en Martinique, après quinze ans de service dans un commissariat parisien, il s’agit avant tout pour Dorval de ne pas se laisser « engluer dans le farniente insulaire »[224], autrement dit de trouver le moyen d’assumer cette singularité que ses collègues, non promus en métropole, lui reprochent, en jouant notamment au justicier « pur et dur ». Autorisé, malgré les réticences, à mener son enquête durant plusieurs mois, au détriment d’éventuelles autres affaires, Dorval bénéficie ainsi de la relative compréhension de ses supérieurs ; une opportunité dont d’autres enquêteurs ne pourront pas jouir, comme par exemple le Commissaire Levesque, mis en scène par G. Cabort-Masson, dans le roman intitulé Qui a tué le béké de Trinité?.
Mandaté pour enquêter sur le meurtre du béké Michel de Sainte-Lucie, le commissaire Levesque, « un homme corpulent, aux gestes lents et lunettes rondes cerclées de fer »[225], de passage en Martinique dont il ignore quasiment tout, va être confronté à un « magma politico-sexuel »[226] mettant à rude épreuve ses méninges.
L’intrigue se déroule ainsi sur le domaine de Michel de Sainte-Lucie, où ce dernier vit entouré de sa femme, Marie-Josephe, de Fernand et de sa femme Bernadette ainsi que de quelques domestiques, dont Amédée et Judith. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, hormis le fait que Bernadette est la maîtresse de Marie-Josephe, entretenant elle-même une relation avec Fernand ; que Michel s’octroie un droit de cuissage sur Judith, dont la jeune Prudence est le fruit ; que Judith est elle-même éprise d’Amédée, qu’elle ne peut épouser sans l’accord de Michel ; qu’Amédée, fou de jalousie, rêve d’assassiner Michel ; que Fernand s’est livré à des attouchements sexuels sur Prudence ; qu’il est, en outre, en faillite en grande partie à cause de sa passion pour le jeu ; enfin que Bernadette, fidèle dévouée au Maréchal Pétain -l’action se déroule dans les années 1940- est venue habiter chez les de Sainte-Lucie pour surveiller les actions licencieusement résistantes de Michel : autant de subtilités que le commissaire s’efforce de démêler, non sans un certain dégoût notamment vis-à-vis du droit de cuissage. C’est alors que, tandis que le commissaire s’apprête à découvrir le fin mot de l’histoire, l’enquête est réquisitionnée pour « raison d’Etat », l’Evêché dépêchant un de ses ambassadeurs sur le domaine de Trinité, dans le but d’inviter fermement Levesque à fermer les yeux sur la suite de son enquête. Au-delà de l’intérêt suscité par ce rebondissement au niveau de l’intrigue, notamment par l’effet d’attente produit sur la résolution de l’énigme, il s’agit pour G. Cabort-Masson d’adapter les données de la fiction au contexte de l’époque, en soulignant l’étroite connivence déterminant les relations entre l’Eglise et le régime vichyssois, notamment au travers des activités de la Légion, et en signalant, dans le même temps, l’impossible indépendance de la Justice, à cette époque.
L’Evêque dépêché sur les lieux prend alors Levesque en charge, lui révélant contre son silence la clé de l’énigme : ce serait Thérèse, la jeune fille légitime de Michel, qui aurait tué son père. Assommé par cette révélation impliquant son silence, tant par le contrat passé avec l’Evêque, que par souci de ne pas accabler une enfant déjà perturbée, Levesque met quelques heures à comprendre le subterfuge : le laisser croire à la culpabilité d’une enfant constituait le seul moyen de lui faire lâcher prise. Devant l’évidence du leurre, Levesque comprend que la meurtrière est Bernadette, motivée par des enjeux politiques, au moment où Vichy s’effondre en métropole, justifiant alors l’intervention de l’Evêché et, derrière lui, des hautes instances de la Légion. Une révélation qu’il décide finalement de taire :
« Une
bouffée de sauce au curry envahit l’esprit du policier et de connivence avec le
premier gouvernement provisoire de la France, il enterra sa première affaire
tropicale. »[227]
Autrement dit, garant de lucidité, d’honnêteté et de révolte, Levesque sombre finalement dans les contraintes de la raison d’Etat, la complicité et le laxisme ; un comportement présenté comme représentatif de l’époque, par la portée historique revendiquée par l’ouvrage.
La contrainte au silence et la partialité de la justice font ainsi régulièrement partie du canevas de base de toute enquête policière menée aux Antilles, notamment dans les années 1940-1950. L’expression de cet état de fait au sein de la fiction policière rend ainsi compte de la prégnance des inégalités perdurant plus d’un siècle après l’abolition, au cœur de systèmes post-esclavagistes, et s’exprimant également au sein de sociétés post-coloniales non esclavagistes, impliquant elles aussi un clivage entre puissants et dominés.
C’est ainsi qu’à l’instar du schéma développé par G. Cabort-Masson, le commissaire Nasser mis en scène dans le roman de R. Lamrini, Les Puissants de Casablanca, se voit à son tour contraint au silence, confronté à la corruption sévissant au Maroc. Chef de la brigade criminelle et déterminé à lutter contre toute forme de corruption, il empêche finalement l’inspecteur Bachir de poursuivre son enquête et d’arrêter les deux criminels, fils de nantis, sous le poids des pressions hiérarchiques ; des pressions qui se manifestent, malgré tout, par sa mise en retraite anticipée, pour avoir osé protester contre la fermeture de l’enquête.
Si dans les « affaires antillaises », l’arrangement à l’amiable reste concevable, avec même parfois une promotion à la clé, rien n’est moins évident en ce qui concerne les « affaires maghrébines », où la frustration laisse souvent place au sacrifice. Cette forme de radicalisation des objectifs est particulièrement sensible dans les enquêtes menées en Algérie.
Le commissaire Brahim Llob et l’inspecteur Larbi, héros respectifs de Y. Khadra et B. Sansal, témoignent parfaitement de cette radicalisation, puisque tous deux sont finalement assassinés ; le premier pour avoir décidé de quitter la police, dernier rempart à la mafia politico-financière, ce qui tend à prouver l’existence de connivences entre ces deux univers officiellement adversaires ; le second pour avoir provoqué ses adversaires et s’être résolu à mener son enquête jusqu’au bout. Ces deux enquêteurs meurent donc de leur insoumission à un système présenté comme laxiste et, à certains égards, complice, au terme d’une longue carrière au cours de laquelle ils l’ont néanmoins servi, déchirés entre conscience morale et professionnalisme, réalisme et idéalisme.
Le dénouement fatal intervient donc après de nombreuses années marquées par la cohabitation de sentiments contradictoires tels la peur, le fatalisme ou encore la révolte ; révolte contre la corruption, la déchéance des services publics, l’enrichissement des puissants impudiquement affiché sous les yeux des affamés ; fatalisme face à l’impuissance et à l’impossibilité de se prémunir des outils nécessaires à la résolution des problèmes ; peur de mourir et de rejoindre la longue liste des sacrifiés à la cause affairo-islamiste.
Larbi et Llob évoluent ainsi dans une lutte constante avec eux-mêmes, dont ils parviennent à rendre compte au travers de propos amers en même temps que désespérés :
« Tout
est pourri ! Le vieil homme sentit son moral se déliter et le dégoût
l’envahir. Nous sommes des charognards, putain de nous ! […] Depuis trente
années, installés dans la névrose, nous vivons sur les morts au point que la
vie n’est qu’une contemplation hallucinée. »[228]
« Il
était vieux lui aussi, non par son âge mais d’avoir tardé à vivre en homme, et
sentait venir sa fin dans la même violence, la même indifférence, le même
mépris. Trente années durant, chien de caserne, chien de palais, chien de rue,
il avait servi un système qui du haut de son olympe crachait sur le peuple à
genoux. »[229]
« Et
je reste dans la flicaille, à guerroyer avec la fausse canaille pendant que
l’authentique racaille fait et défait les lois et les convenances au gré de ses
intérêts, au gré de ses fantaisies… au gré de l’impunité. »[230]
« Aujourd’hui
encore, je ne comprends pas. Je marche à tâtons en pleine lumière. Mes lauriers
d’affranchi ne me sont qu’œillères. Mon regard de prophète ne retrouve plus ses
repères. Peu fier de l’adulte que je suis devenu, je guette ma vieillesse comme
l’autre l’huissier puisque toute chose en ce monde ne me fait plus
rêver. »[231]
Seuls, vieux et dépressifs, ils choisissent finalement d’une certaine manière le suicide, non comme pur renoncement mais comme affirmation de leur courage, comme rejet de la compromission, fidèles à la voie tracée par ces mots de Tahar Djaout :
« Si
tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurt. »
Nous remarquons alors que si dans certains cas le rapport au pouvoir se fait dans la douleur, la révolte ou le renoncement, il apparaît, dans d’autres, comme le moteur à une véritable entreprise d’aliénation, se réalisant pleinement dans une forme de quasi névrose.
2.3.3- Les enquêteurs névrosés
Le rapport à l’autorité, dans des sociétés post-coloniales, pose d’inévitables cas de conscience et suscite des comportements souvent faussés par des représentations fantasmagoriques du pouvoir, dont la plupart conduisent à la violence. Le personnage du chef Mohammed, mis en scène dans Une Enquête au pays de D. Chraïbi, en est une illustration.
Fils d’un « simple flic sans pouvoir de décision »[232] au service des Français, le chef a bien l’intention d’exercer son métier en accord avec les changements engendrés par l’Indépendance. Autrement dit, c’est en réaction à la passivité de son père qu’il entend, lui, exercer son pouvoir ; d’où son attitude tyrannique vis-à-vis d’Ali. En revanche, et cette fois en adéquation avec l’expérience paternelle, le chef ne peut concevoir la désobéissance et se veut entièrement soumis au bon vouloir de sa hiérarchie et prêt à tout pour faire respecter l’ordre. Fidèle à son uniforme et à la langue de l’officialité, le français, le chef est souvent victime d’accès de folie furieuse, s’emportant en cris et mimiques terrifiantes, engendrant des actes primitifs voire criminels. Totalement aliéné à une culture matérialiste, vantant les progrès de la technologie et subjugué par la civilisation des « Lamirikanes », il se révèle être totalement incapable de dialoguer avec les Aït Yafelman, représentants de la culture berbère et, de manière générale, du monde traditionnel. En tant que représentant de la civilisation moderne, en même temps que de l’autorité, le chef incarne une menace pour la mémoire des temps anciens ainsi que pour lui même, comme le souligne Michelle Linard-Bene :
« Le
plus grand danger, le seul danger mortel que font courir aux peuples et aux
individus le progrès et la civilisation, derniers sortilèges des dieux ennemis,
c’est de les couper de leurs racines. […] Ce meurtre de l’âme est mis en valeur
par le personnage du chef de police, qui renie avec le plus profond mépris les
traditions ancestrales pour s’efforcer de vivre selon des manières et des modes
de pensée occidentaux, qui va jusqu’à renier même sa propre enfance. » [233]
L’appartenance du chef au corps policier, vestige de l’époque coloniale, scelle en quelque sorte sa détermination dans le reniement de sa culture maternelle, de son identité profonde ; une attitude soulignant l’existence de profonds dysfonctionnements perdurant par-delà l’Indépendance, en une empreinte indélébile laissée au plus profond des consciences. C’est ainsi qu’un même type de comportement, laissant transparaître l’existence d’un conflit entre dominant et dominé au sein même des consciences, caractérise d’autres enquêteurs issus d’autres espaces post-coloniaux.
De profondes affinités lient, en ce sens, le chef Mohammed et le brigadier-chef Bouaffesse, qu’il s’agisse de leurs « coups de chaleur » récurrents, de leur soumission totale à une procédure souvent mal maîtrisée, du reniement de leurs origines ou encore de leur goût pour la violence tant physique que psychologique. Tous deux, faute d’être les représentants de la sécurité civile qu’ils devraient, se révèlent être de véritables dangers, que seul le rappel à la culture ou aux règles de l’autorité françaises parvient à tempérer. Ainsi, tandis que le chef Mohammed se livre à des interrogatoires humiliants et violents -que le témoignage de Raho, innocent torturé par des soldats français pendant la guerre d’Algérie, se charge de mettre en valeur- Bouaffesse et ses acolytes n’hésitent pas à enfreindre les lois, assoiffés de violence tels des « prédateurs à l’envol pour un sang »[234]. Soucieux de faire usage de leur autorité par le seul biais de leurs outils de travail (boutous, couteaux, matraques, machettes), ils rappellent inévitablement aux plus anciens leurs affinités historiques avec certaines grandes figures de l’autorité coloniale, tels les gendarmes-à-cheval ou encore les chiens lancés à la poursuite des Nègres marrons.
En somme, le policier tel qu’il est conçu par Bouaffesse et ses collègues n’est pas considéré comme un simple citoyen au service de la collectivité, mais comme le détenteur des armes, pouvant s’en servir officiellement, comme celui qui exerce un pouvoir non de protection mais de répression.
Les policiers mis en scène par D. Chraïbi et P. Chamoiseau se présentent, en ce sens, comme des shérifs des temps modernes, tout puissants qui, ne possédant pas de compétences justifiant le sentiment de supériorité que leur confère leur uniforme, pratiquent la violence comme un moyen de se rassurer, voire d’exister. Cependant, ce recours à la violence n’est pas sans entraîner quelques changements et adaptations de personnalité. Fermement décidé à exercer son autorité en dehors de toute restriction, le brigadier-chef Bouaffesse semble tout oublier de lui-même, de sa vie, de son histoire, de ses fréquentations, le policier -et en l’occurrence, l’autorité- prenant systématiquement le pas sur l’homme. Face à Doudou-Ménar et à ses vociférations, Bouaffesse ne parvient pas, ainsi, à reconnaître la jeune fille qu’il avait séduite, un soir de bal ; de même, obsédé par la nécessité de trouver un coupable, il reste incrédule devant ces nombreux témoins qui prétendent être restés sur les lieux des heures durant, transportés par le son du gwo-ka, oubliant que lui-même, à une époque, pouvait en faire autant. Refusant de reconnaître en ces « vagabonds », témoins de la déliquescence de la société traditionnelle, une part de son identité, Bouaffesse choisit de se réinventer dans une modernité qu’il ne peut assimiler fondamentalement ; d’où ses incohérences et exubérances :
« Je respecte tout, moi : Jésus-Christ, le Pape, la République mère-patrie, la Sécurité sociale, Air France, la Banque Nationale de Paris et même le Crédit Martiniquais, je respecte la Loi, la Philosophie, la Paix dans le monde, l’O.N.U., De Gaulle, la 604 et même la Deux-Chevaux. »[235]
Incapable de maîtriser son propre système de pensée, Bouaffesse met sur un pied d’égalité la Paix et la Deux-Chevaux, le Pape et la 604, et si son discours se veut preuve de sa tolérance, il signe, en réalité, le ridicule du personnage qui nous rappelle un instant Sganarelle, valet de Dom Juan, dans la pièce de Molière. Bouaffesse semble, en fait, incapable de distinguer ce qui est important de ce qui ne l’est pas, ignorant ce qu’il doit faire et à quel moment, si bien que le choix de la violence s’impose à lui comme le seul palliatif lui permettant de ne pas perdre la face.
Promus subitement à la tête d’un pouvoir dont ils ne peuvent, intellectuellement parlant, maîtriser les tenants et aboutissants, le chef Mohammed et Bouaffesse semblent donc trouver en la violence une réponse à l’incompréhension, à l’impuissance et plus généralement au désarroi. Or, en ce qui concerne la plupart des enquêteurs mis en scène dans les romans de notre corpus, ce désarroi semble s’exprimer de toutes parts, comme en atteste notamment la personnalité complexe de l’inspecteur principal Evariste Pilon, coordinateur de l’enquête sur la mort de Solibo. Rationaliste « à tête bien remplie », Pilon semble, en effet, vivre ses traumatismes identitaires de manière moins dévastatrice que Bouaffesse, mais selon une perspective tout aussi névrotique :
« A
l’heure de l’affaire Solibo, il […] pétitionne pour le créole à l’école et
sursaute quand ses enfants l’emploient en s’adressant à lui, sacre Césaire
grand poète sans l’avoir jamais lu, porte son bakoua de soleil et des
chaussettes d’hiver, vénère l’antillanité du théâtre de Juillet et rêve des
boulevardises de la troupe Jean Gosselin, commémore la libération des esclaves
par eux-mêmes et frétille aux messes schoelcheriennes du dieu libérateur,
refuse le sapin de Noël et enneige son arbuste filao, […] final, vit comme nous
tous, à deux vitesses, sans trop savoir s’il faut freiner dans le morne ou
accélérer dans la descente. »[236]
Par ailleurs, la présence, à ses côtés d’une chabine tiquetée à la peau claire, parsemée de taches plus sombres et aux traits négroïdes, signe d’une certaine manière l’impossibilité de son choix et témoigne, dans le même temps, de son incapacité à réaliser et à accepter le syncrétisme des différentes cultures qui l’habitent inévitablement. En outre, son intelligence et sa culture ne lui permettent pas de maîtriser la folie meurtrière de Bouaffesse, se rendant par là même complice de la mort de Doudou-Ménar et de Congo et de la maltraitance des autres témoins.
Chez les personnages de D. Chraïbi et P. Chamoiseau, le rapport à l’ordre, et plus précisément l’appartenance à la police, joue le rôle de révélateur des troubles identitaires prégnants au sein des sociétés antillaises et maghrébines. La peur éprouvée par la population civile face aux représentants de l’Etat et les dérives autoritaires de ces derniers signent la présence, dans les consciences, de certaines séquelles relatives à la période coloniale ; un message véhiculé par le biais de l’humour et par la mise en scène de personnages extrêmes et caricaturaux, puisque endossant des rôles bien caractérisés. Le genre policier se fait alors propice à l’expression de l’humour, tout en portant un regard sur une société marquée par de profonds dysfonctionnements ; regard accentué, d’une part, grâce à la charge historique véhiculée par l’institution policière elle-même, en dehors de toute considération littéraire et, d’autre part, par les potentialités créatrices offertes par un genre supportant, dans son acceptation moderne, tous les excès.
Cette multiple perspective résume finalement les différents motifs de reprise du genre policier dans les littératures francophones des Antilles et du Maghreb.
***
L’approche de l’évolution du genre policier, dans la littérature « occidentale », et l’étude de ses particularités et potentialités, nous ont permis de mettre en avant la complexité et la richesse d’un genre qui, néanmoins, ne peut se départir d’une réputation parfois mise à mal par la critique. Cette désaffection s’avère être d’autant plus tenace qu’elle semble souvent justifiée par la piètre qualité de certains ouvrages usant à outrance des ressorts les plus simplistes proposés par le genre. Réputé « genre mineur » depuis ses premiers textes et créé initialement selon une perspective de pure distraction, le roman policier peut, en effet, difficilement éviter l’intrusion en son sein d’écrivains aux talents douteux. Il n’en demeure pas moins que le genre policier contemporain, double héritier du récit d’énigme et du roman noir, propose de vastes perspectives, du fait même de ce double ancrage entre fonction ludique et perspective critique, traduisant une oscillation constante entre fiction et réalité et permettant l’intrusion d’une certaine forme de réalisme social, propice à la critique, tout en offrant des perspectives de mise en abyme du texte littéraire lui-même.
Pourvu, en outre, d’un certain pouvoir octroyé par sa popularité auprès du grand public -renforcée par son adaptabilité sur les écrans de télévision-, le genre policier se révèle être, depuis une vingtaine d’années, particulièrement prisé tant au sein des littératures l’ayant vu naître (Angleterre, Etats-Unis, France) que dans le reste du monde ; une expansion en partie liée à la modernité du genre, miroir de la société et par là même vecteur de ses avancées, ainsi qu’à sa capacité d’adaptation. Extrêmement modulable, en dépit de sa codification initiale, le genre policier, pourvu de son cortège de variantes, se révèle être ainsi propice à l’adaptation qui, en ce qui concerne les sphères post-coloniales antillaises et maghrébines, tend finalement davantage à une véritable acclimatation.
DEUXIEME PARTIE
Formes et enjeux
de la
transposition du genre policier
aux
littératures francophones
des
Antilles et du Maghreb
I- Acclimatation du cadre générique
Produit de la littérature dite « occidentale », et plus précisément des espaces littéraires anglais, nord-américain et français, le genre policier répond, dans sa forme originale, à un certain type d’attentes prenant en compte un contexte à la fois social, culturel, historique, économique et à certains égards politique.
Nous avons pu voir notamment en quoi les phénomènes d’industrialisation et d’urbanisation avait pu influencer son évolution ainsi que la portée de son discours. Nous avons également constaté que le genre policier entretenait un rapport ambigu à la critique totalement séduite ou, à l’inverse, agacée notamment par la codification de son mode de fonctionnement. Investi par des écrivains au talent variable, le genre policier nous a également laissé entrevoir un large panel de textes de qualité diverse et suscitant différents effets de lecture. Enfin, la forme policière a globalement pu nous révéler, à travers divers exemples, ses multiples potentialités permises entre autres par son adaptabilité, sa souplesse, sa tolérance aux intentions scripturales les plus transgressives vis-à-vis du cadre générique traditionnel. L’approche globale des différents ouvrages de notre corpus nous a, par ailleurs, permis de constater que cette adaptabilité du genre n’était pas passée inaperçue aux yeux des écrivains qui nous concernent, investissant globalement sans scrupule une forme littéraire déjà largement exploitée et reconnue de par le monde.
C’est précisément cette constatation relative aux ouvrages de notre corpus que nous souhaiterions approfondir ici en étudiant par le détail les adaptations, transformations, voire transgressions, que les écrivains antillais et maghrébins se permettent de faire subir au genre policier dans son ensemble, forts de leur propre bagage social, culturel, historique ou encore politico-économique.
1- Installation du décor : intertexte,
contexte
Avant d’aborder le contenu socio-culturel des romans de notre corpus, notre première approche de la transposition du genre policier aux Antilles et au Maghreb concerne en premier lieu des données relevant globalement, d’une part, de la littérature et d’autre part, de la géographie. Il s’agit de nous interroger sur la manière dont l’histoire et l’évolution propres à la fiction policière, s’étendant sur environ un siècle, ont été prises en considération et importées au sein d’espaces où le genre ne participait pas au préalable d’une véritable tradition littéraire. Il s’agit encore de définir d’une certaine façon en quoi les espaces antillais et maghrébins ont pu constituer des « terres d’accueil » potentielles à un genre accordant une certaine importance au contexte physique encadrant le déroulement de l’intrigue.
En ce sens, nous nous intéresserons dans un premier temps au traitement, dans le cadre de la transposition de la forme policière, du bagage intertextuel véhiculé par un genre affichant près d’un siècle d’existence, avant de rendre compte des atouts géo-spatiaux propices au développement du genre au sein d’espaces a priori peu appropriés à ce genre d’expérience.
1.1-
Le rapport
aux pères
La transposition du genre policier aux littératures francophones du Maghreb et des Antilles implique la double prise en compte, d’une part, de l’histoire et des modèles de référence constitutifs dudit genre et, d’autre part, du contexte littéraire au sein duquel le « nouveau genre » est importé. Dans le cadre de notre étude, cette double perspective témoigne, par glissement, du positionnement de chaque auteur vis-à-vis d’un genre issu de la tradition littéraire occidentale et se fait par là même tout à fait significative. Nous verrons en effet qu’il s’agit la plupart du temps, pour les auteurs de notre corpus, de revendiquer une appropriation entière du genre, en se désolidarisant notamment de manière plus ou moins marquée des modèles d’écrivains et d’enquêteurs ayant largement contribué à la popularité du roman policier.
1.1.1- Interférences avec les modèles traditionnels
Comme nous l’avons souligné dans notre approche générale du genre policier, certains pionniers de la forme classique particulièrement populaires de la fin du XIXème siècle aux années 1940, notamment outre-Manche, ont irrémédiablement marqué le roman policier ; si bien qu’en dépit de la multitude d’essais en la matière et malgré les multiples variantes inspirées par le modèle initial, les mêmes références reviennent inexorablement qui privilégient notamment les inoubliables Sherlock Holmes et Hercule Poirot.
Cette perspective s’avère être particulièrement sensible et significative dans les romans de notre corpus. En effet, à l’intelligence, l’infaillibilité, la rigueur traditionnellement liée à ces deux figures de proue de la forme policière classique, la plupart des romans qui nous intéressent opposent des images régulièrement dépréciatives. C’est ainsi que la comparaison des enquêteurs mis en scène avec leurs illustres prédécesseurs fait souvent figure d’insulte ou, pour le moins, d’objet de plaisanterie. Piétinant dans son enquête, le détective privé Amédien, mis en scène dans Brin d’amour, se voit ainsi ironiquement surnommé « Sherlock Holmes » par un de ses détracteurs, amusé par le désarroi de l’enquêteur[237] ; une dérision de la légende « holmésienne » également opérée dans Le Meurtre du Samedi-Gloria, où l’inspecteur Dorval se voit conspué en ces termes :
« Non seulement il ressemble à Sidney Poitier mais en plus il a le flair de Sherlock Holmes ! »[238]
Ou encore :
« Hé, Sherlock Holmes, fit l’un d’eux, à force de regarder le monde à travers ta loupe, tu vas croire qu’il tourne à l’envers. Ha-ha-ha ! »[239]
Certains enquêteurs n’hésitent pas, eux-mêmes, à ironiser sur les capacités extraordinaires des policiers de fiction. Se prêtant au jeu de la fausse modestie, le commissaire Ayadi déclare ainsi, dans Le Meurtre de Sidi Bou Saïd :
« Sherlock trouverait certainement l’âge du capitaine dans ma collection de mégots, mais j’espère au moins voir s’ils datent bien de la nuit dernière. »[240]
L’ironie d’Ayadi et des personnages en général, à l’égard des modèles de référence du genre policier, tend, d’une certaine manière, à conférer aux enquêteurs mis en scène un caractère plus réaliste. La perfection de la méthode holmésienne n’étant plus crédible dans un monde où le scepticisme est de rigueur, il s’agit de détruire la légende pour espérer convaincre et donner l’illusion que si les enquêteurs n’ont plus rien à voir avec ces êtres de génie extraordinaires, c’est que l’univers où ils évoluent n’a désormais rien d’artificiel.
C’est ainsi que, de la même manière, l’inspecteur Ali prend explicitement ses distances vis-à-vis de la fiction policière. Il s’exclame ainsi :
« Je
ne suis pas un détective de roman policier, commença-t-il, mais un inspecteur
de police dans la vie réelle, ici et maintenant. »[241]
Ou encore :
« Je
n’ai rien d’un Sherlock Holmes qui ne mangeait que dalle, dans aucune de ses
enquêtes, ni d’un Hercule Poirot qui trempait sa moustache dans une tasse de
chocolat épais. Et ils n’avaient même pas de femme, vous vous rendez
compte ? »[242]
L’argumentation nous éclaire quelque peu sur l’origine de certaines « manies » d’Ali, comme son avidité des plaisirs charnels ou encore sa tendance à toujours faire savoir bruyamment qu’il est repu ; fier de son matériel hormonal et de son système digestif, Ali peut ainsi signifier, de manière certes terre-à-terre mais crédible, qu’il est bien incarné.
Il s’agit, pour la plupart des auteurs de notre corpus, de transformer les prétendus fins limiers, représentés notamment par Sherlock Holmes, en purs personnages de fiction et de donner l’impression de promouvoir, à l’inverse, de manière plus ou moins raffinée, leurs enquêteurs dans la « vraie vie ». Aspirant, avec l’inspecteur Ali, à « mettre carrément les pieds dans le monde réel »[243], D. Chraïbi opère en ce sens un glissement entre la première mouture d’Ali et les suivantes, ces dernières correspondant à un ancrage plus marqué de l’auteur dans l’univers de la fiction policière. Prenant soin, dès Une Enquête au pays, de distinguer Ali des populaires enquêteurs de fiction, le narrateur déclare ainsi :
« L’inspecteur
Ali était un Arabe de père et de mère et d’ancêtres, et non un de ces
détectives américains des feuilletons TV de série B. »[244]
La distinction, prenant pour point de repère le détective américain de feuilleton télévisé, n’est cependant pas tant liée, ici, à une quelconque opposition entre réalité et fiction, comme c’est le cas dans la comparaison précédente avec Holmes ou Poirot, qu’à une mise en avant des origines de l’enquêteur ; une manière d’indiquer qu’avec l’inspecteur Ali, le Maroc possède enfin son représentant local. De l’ancrage dans la culture locale, D. Chraïbi semble ainsi glisser, au fil des aventures de l’inspecteur Ali, dans une forme de « crédibilisation » du personnage. Or, plus D. Chraïbi prétend entrer dans le monde réel et plus il affuble son personnage de caractéristiques loufoques pouvant nuire à sa vraisemblance. Ali nous apparaît, en effet, trop cru, trop incontrôlable et surtout trop inconvenant pour correspondre au rôle d’enquêteur traditionnellement attendu ; il est en outre trop ingénieux, trop inébranlable et trop souverain dans ses enquêtes pour être véritablement crédible. Autant dire qu’Ali, personnage beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, s’inscrit résolument dans l’extrême : à la fois trop « humain » et trop fictif, il donne finalement à voir cet espace singulier que représente le « réel de l’écriture », caressant dans le même temps une notion clé de la littérature, la vraisemblance, véritable pont entre l’être et le sembler, entre le vrai et l’apparence et, par glissement, entre le réel et l’imaginé.
Or, en ce qui concerne le roman policier, fortement caractérisé, réputé et codifié, la vraisemblance passe nécessairement par le stéréotype, l’apparence par le cliché et l’imaginé par l’intertextualité. C’est ainsi que, fatalement, le médecin légiste mis en scène dans le roman de B. Sansal se voit affublé du très conventionnel attirail du légiste de télévision :
« Cheikh Dracula, alias Doc Tarik pour les innocents ; la petite cinquantaine débraillée, cynique, assoiffé de sang ; conforme à l’image du légiste imposée par la télé. Mais qui a jamais vu de vrai un légiste pour se porter en faux contre le cliché ? Il ne lui manquait que le sandwich dégoulinant de ketchup qui réveille l’intérêt du téléspectateur. »[245]
Cette réflexion à caractère méta-discursif semble souligner qu’il s’agit, d’une part, d’asseoir le cliché comme recours ou palliatif à l’ignorance, tout en soulignant, d’autre part, l’importance de ne pas voir trop rapidement le cliché là où se joue une représentation de la réalité. Cette mise en abyme de la représentation stéréotypée soulève à nouveau, par ailleurs, une réflexion mettant en perspective réalité et fiction, en ce renversement qui consiste à établir que ce qui est marginal dans la réalité peut paraître cliché dans la représentation qui en est faite. Le phénomène est particulièrement sensible en ce qui concerne le genre policier en ce qu’à travers la figure singulière de l’enquêteur, il permet justement de réunir singularité et stéréotypie. C’est ainsi que Larbi craint de relever, dans l’image donnée, davantage de la fiction que de la réalité :
« “Peut-être fais-je flic de série ?” se dit-il en s’efforçant d’oublier l’image gélatineuse qu’en donnent les feuilletons égyptiens de dix-neuf heures dans le but d’inculquer aux masses le goût de s’éloigner du civisme et de s’abandonner à la mollesse criminelle. »[246]
Autrement dit, si le lecteur ne peut se départir de certaines références relatives au genre policier et inspirées par ses précédentes lectures, le personnage de fiction lui-même ne peut guère échapper à certaines comparaisons encouragées notamment par le développement du genre sur les écrans de télévision.
Dans certains romans, l’image prend ainsi le dessus sur le texte, les références télévisuelles supplantant les modèles purement littéraires et inscrivant, de ce fait, le personnage dans une représentation d’autant plus vulgarisée. De cette approche naît une déconsidération accentuée des enquêteurs mis en scène dès lors non plus comparés aux illustres modèles de référence, mais à leurs pâles doublures télévisuelles ; c’est ainsi que le héros de Yasmina Khadra, le charismatique commissaire Brahim Llob, se voit assimilé à Navarro[247], personnage télévisuel -de production française de surcroît- par un suspect qui, au moment de son arrestation, quelques pages plus loin, s’exclame :
« C’est à vous de descendre de votre nuage, Navarro. Vos séries ne marchent qu’en Europe. »[248]
Réduisant le pouvoir policier au domaine de la fiction, le coupable, un pilier de la mafia politico-financière, semble révéler par là même le sentiment d’impunité animant les puissants corrompus algériens. Or, Y. Khadra choisit précisément de s’opposer à ce sentiment d’impunité, dans le cadre de la fiction, à défaut peut-être de celui de la réalité, en permettant à Llob de procéder à l’arrestation de cet « intouchable » qui, incrédule, sombre dans l’hystérie. Endossant le costume du justicier victorieux, Llob s’engouffre alors, en un sens, dans un roman s’achevant sur la victoire traditionnelle et démagogique de l’enquêteur. Cependant, Llob ne tarde pas à comprendre que cette issue s’avère être la conclusion d’un scénario écrit par le véritable instigateur de toute l’affaire, un autre pilier de la mafia politico-financière, désireux de neutraliser la concurrence. Réalisant la supercherie, Llob décide finalement de quitter son attirail de « policier comme il faut », à l’instar de Navarro, pour opter pour une parure moins politiquement correcte, en obtenant le suicide du metteur en scène coupable. Proposant finalement une issue moralement plus contestable, Yasmina Khadra souligne l’impossibilité d’une fin propre et acceptable, dans le scénario algérien, et propose par là même d’ancrer son roman dans le réel, attaquant dans le même temps les éventuels liens de parenté qu’il pourrait encore entretenir avec les habituels scénarios de la fiction policière.
Cette volonté de s’éloigner du scénario ou des personnages récurrents de la fiction policière traditionnelle fait figure de leitmotiv, dans la plupart des romans de notre corpus, s’exprimant de diverses manières.
C’est ainsi que Fortuné Chalumeau choisit d’adjoindre à son enquêteur blanc métropolitain, un inspecteur noir local, tout en se défendant clairement de verser dans le scénario traditionnel du couple Blanc/Noir, hostiles initialement l’un à l’autre avant de devenir inséparables. Dans Pourpre est la mer, les deux enquêteurs ne dépasseront jamais, en effet, le stade du conflit initial, d’où cette réflexion désabusée de Laprée :
« Toi
et moi, on est vraiment le contraire des flics américains de cinéma. Au début
le Blanc et le Noir ne peuvent pas s’encadrer. Ils vivent des aventures palpitantes
et se retrouvent copains à la vie, à la mort. »[249]
Il s’agit ici, semble-t-il, de souligner que contrairement au schéma simpliste de l’amitié insubmersible entre Noir et Blanc, qui se révèle être déterminant dans toute production cinématographique visant le grand public, le roman de F. Chalumeau semble revendiquer son droit à échapper à cette forme de facilité, improbable, qui plus est, en ce qui concerne la société guadeloupéenne, marquée par des conflits raciaux relativement prégnants. Autrement dit, il n’est pas question, pour F. Chalumeau, de couler dans les habitudes des comédies policières américaines qui, par leur propos démagogique, prétendent gommer le racisme primaire bien réel, quant à lui, au sein de la société. Cette prise de distance vis-à-vis de la fiction populaire, vulgarisée par les écrans de cinéma ou de télévision, on la perçoit encore dans d’autres propos tenus par Laprée. Séquestré face à un écran de télévision allumé, il réalise ainsi les nuisances imposées par le petit écran :
« Laprée
dut tout ingérer : Santa-Barbara, les informations locales avec leur lot
quotidien d’empoignades entre les politiciens insulaires, un show de réalité où
des quidams exposaient leurs problèmes d’en dessous de la ceinture, et un film
dans lequel d’audacieux policiers arrêtaient de méchants trafiquants de
cocaïne. Dieu, que c’était mauvais ! La drogue nuit autant au cinéma et au
roman qu’à la santé de ses accros. »[250]
Le lecteur peut, en ce sens, se réjouir de recevoir l’enquête somme toute traditionnelle que Laprée lui propose, dans la mesure où, lui aussi, aurait pu avoir à ingérer une affaire rocambolesque de trafic de drogue.
Dans la quasi totalité des romans de notre corpus, l’évocation des modèles traditionnels d’enquêteurs, qu’ils relèvent d’un paradigme littéraire ou télévisuel, semble s’inscrire dans une double perspective. Au niveau de l’intrigue, il s’agit de dénigrer l’invraisemblance de la perfection des illustres fins limiers, de manière à accréditer la portée réaliste de romans censés être en prise directe avec la société moderne et ses dysfonctionnements. Dans une perspective plus large permettant une considération globale du genre policier, il s’agit de s’inscrire dans une tradition littéraire populaire depuis plus d’un siècle, tout en signant une rupture avec l’archaïsme des premiers modèles ou, à l’inverse, l’extrême modernité de certains héros télévisuels, en soulignant par là même l’évolution remarquable de cette forme littéraire.
Clin d’œil aux anciens, recherche de complicité avec le lecteur ou volonté de valoriser les nouvelles générations en dénigrant les anciennes, l’évocation des modèles de référence s’inscrit la plupart du temps dans une certaine perspective d’innovation et d’appropriation d’un genre déjà mondialement connu. Le recours à l’« intertexte local » semble notamment participer de cette orientation.
1.1.2- Ancrage dans un intertexte local
Bien que le genre policier ne soit pas véritablement ancré dans la tradition littéraire maghrébine malgré le développement du roman d’espionnage dans les années 1970, Yasmina Khadra semble néanmoins vouloir inscrire ses enquêteurs dans la perspective d’une « filiation naturelle », en insérant notamment au sein de ses textes différentes références au romancier Djamel Dib, dont il a été question plus haut, et à son enquêteur, l’inspecteur Antar, véritable modèle de l’adjoint du commissaire Llob. Relevons quelques-unes de ces références directes à D. Dib :
« L’enquête piétine. Lino a bien dévoré un tas de polars, y compris ceux de Djamel Dib ; pas moyen d’avancer. »[251]
« Lino a le nez dressé pareil à une hampe de guerrier numide. C’est de sa faute après tout. Il passe son temps à confectionner son personnage dans les bouquins de Djamel Dib ensuite, quand je le rappelle à l’ordre, il n’est pas content. »[252]
De même, lorsque Llob se voit confronté à deux agents du Bureau de la Surveillance et des Investigations, il est aussitôt question de Youcef Khader et de son célèbre agent secret Mourad Saber :
« Je
déboutonne le haut de ma chemise pour me mettre à mes aises, croise les genoux
et détaille, à mon tour, les deux intrépides Mourad Saber. »[253]
Remarquons, en premier lieu, que ce genre de recours à un intertexte local intervient dans les deux premiers romans de Yasmina Khadra, tous deux édités d’abord en Algérie ; ce procédé se verra par la suite, d’une certaine manière, recyclé et adapté, dans les romans édités en France, par le recours à des modèles plus francophones, tels Navarro ou San Antonio. Notons toutefois qu’en dépit de ce glissement de point d’ancrage, l’évocation du modèle de référence, qu’il soit « local » ou « étranger », s’inscrit dans une même perspective : il s’agit de suggérer le poids des modèles fictifs sur la conception des personnages et d’inviter, par là même les personnages aliénés et avec eux le lecteur, à dépasser le conditionnement pour accepter de croire en la nouveauté, l’incertain, l’imprévu. Autrement dit, la déconsidération des modèles de référence tend à inaugurer l’avènement d’une ère nouvelle, garantissant originalité, suspense et crédibilité ; objectif particulièrement sensible dans les romans de Yasmina Khadra en ce qu’ils semblent prôner une certaine forme d’autonomie.
C’est ainsi qu’augurant de la fidélité du public, Yasmina Khadra opte progressivement pour une forme d’autocitation qui se manifeste de manière plus ou moins évidente. En dehors des notes en bas de page, soulignant directement l’existence de connexions entre les différentes enquêtes du commissaire Llob et par glissement entre les différents romans de Y. Khadra, on remarque, en effet, la volonté de l’auteur de tisser de véritables liens entre ses différentes œuvres, comme si tous ses textes ne faisaient qu’un.
Chaque roman de Yasmina Khadra s’inscrit ainsi dans la lignée du précédent. Llob est par exemple reconnu, dans La Foire des Enfoirés, comme « le flic au DAB »[254], avec en note une invitation à lire Le Dingue au bistouri, aux éditions Laphomic. Le lecteur découvre, par ailleurs, dans Morituri, que Llob est écrivain ; élément repris dans Double blanc où l’on apprend que la victime a décidé d’agir contre la mafia politico-financière, après avoir lu le dernier roman de Llob. C’est enfin à la suite de l’écriture de son roman intitulé Morituri que Llob est mis aux arrêts dans le dernier volet de la série, L’Automne des chimères. Dans ce dernier volume, Llob fait par ailleurs, avant de mourir en tant que personnage, ses adieux d’écrivain, par une série d’échos à ses précédents romans. Il en est ainsi de quelques propos apparemment anodins, tels que cette question : « Pourquoi m’avez-vous convié à cette foire des enfoirés ? »[255] ; il en est de même en ce qui concerne le recours à la citation. Ainsi, un personnage déclare notamment, dans Morituri : « Je fais exactement ce qu’aurait fait Goebbels devant Thomas Mann : je sors mon flingue »[256] ; or, on peut lire dans L’Automne des chimères : « Goebbels avait raison. Il faut sortir son revolver dès qu’un type sort un bouquin »[257], la citation faisant foi et avalisant finalement la supposition imaginée initialement.
Ces échos intertextuels fonctionnent comme autant de clins d’œil annonciateurs de la fin du cycle, et ce, d’autant que le lecteur découvre que le dernier manuscrit de Llob, intitulé Magog, a été dérobé par des malfaiteurs.
Les enquêtes du commissaire Llob et les romans de Yasmina Khadra semblent donc s’inscrire dans une sphère fermée sur elle-même, se renouvelant en son sein jusqu’à épuisement. C’est ainsi que le commissaire-écrivain se voit confronté intra-textuellement à la critique de son roman intitulé Morituri, Yasmina Khadra reproduisant au sein de ses textes le discours extra-textuel tenu à l’égard de ses romans. Or, les critiques adressées à Llob s’avèrent être des plus virulentes :
« J’espère ne rien vous apprendre en vous disant que le dernier des cancres situerait votre gribouillage au stade anal de la littérature. Votre exercice de style relève beaucoup plus de la masturbation pédantesque que d’une réelle impulsion intellectuelle. »
« J’ai toujours su que vous n’étiez qu’un phraseur déconnecté, un écrivaillon zélé, mais de là à vous soupçonner d’une telle foutaise ! »
« Espèce d’enfoiré, fumier,
connard ! T’as rien trouvé de mieux à faire que nous ridiculiser devant
nos ennemis ? Tu espérais amuser la galerie avec tes bouffonnerie de vendu,
c’est ça ? Si le bled te dégoûte, tire-toi fissa. Va rejoindre ces bandes
de déserteurs et de bâtards de l’autre côté de la mer. »
« Si les foudres du ciel n’osent pas nous effleurer, c’est pas ton bouquin à la con qui va nous désarçonner. »[258]
Prenant le parti d’opposer une critique favorable à la virulence des propos tenus à l’encontre des romans de Llob, Yasmina Khadra fait intervenir le sage Da Achour, ami du commissaire et amateur de ses romans :
« Un poète, ça ne fait pas de bêtise. Ca dévoile celle des autres. Forcément, ça fait des mécontents. J’ai lu ton bouquin. Ça vaut la peine, fais-moi confiance. »
« Ton bouquin est dans le vrai. C’est ce qui compte par-dessus tout. Le reste : les emmerdes, les polémiques, les menaces, enfin toute cette gesticulation angoissante que tu soulèves ne doit pas t’intimider. »
« Tu surplombes ton monde, comme un dieu, et c’est formidable. Si tu n’avais pas osé crier sur les toits ta rage et ton écoeurement, si tu t’étais écrasé pour laisser ces fumiers s’adonner à leurs fantasmes en toute impunité, j’aurais été terriblement déçu. »[259]
Au-delà de la simple intrigue policière et de la prise en compte, sur le mode réaliste, de la crise algérienne, les romans de Yasmina Khadra proposent donc visiblement une réflexion sur l’écriture et plus précisément sur le statut de l’écrivain algérien. C’est ainsi que la question du recours au pseudonyme est abordée directement dans L’Automne des chimères, où l’on découvre que le commissaire Llob a publié sous le pseudonyme de Yasmina Khadra. Les moqueries de ses détracteurs quant à ce choix permettent ainsi à Llob/Khadra de justifier sa position :
« Alors,
comme ça, tu t’appelles Yasmina Khadra, maintenant ? Sincèrement, tu as
pris ce pseudonyme pour séduire le jury du prix Fémina et pour semer tes
ennemis ?
- C’est
pour rendre hommage au courage de la femme. Parce que, s’il y a bien une
personne à les avoir en bronze, dans notre pays, c’est bien elle. »[260]
Cette volonté de rendre hommage à la femme fait, par ailleurs, écho à la dédicace du roman :
« Aux
absents, à la femme, au soldat et au flic de mon pays. »
Autrement dit, par l’entremise de cette dédicace, il s’agit de rendre hommage à toutes les composantes du personnage de Llob : l’« absent » qu’il devient à la fin du roman en se faisant assassiner, comme de nombreuses autres victimes du terrorisme ; la « femme » que son pseudonyme représente ; le « flic » que le personnage principal incarne ; et enfin le « soldat », qui ne trouve pas de justification directe jusqu’à ce que l’on découvre la véritable identité de l’auteur. On remarque que l’intrusion du soldat aurait pu ici éveiller les soupçons, d’autant que, comme le précise Yasmina Khadra[261], ce dernier roman donne d’autres indications orientées dans la même direction, comme par exemple le fait que Llob soit convoqué non au Ministère de l’intérieur, mais à la Délégation, siège de l’Armée. Notons, par ailleurs, que d’autres indices étaient déjà semés par Yasmina Khadra dès les premières aventures du commissaire Llob, dans lesquelles il est fréquemment question, entre autres, des romans de Mohamed Moulessehoul. Relevons par exemple cette réflexion de Llob à la mort du Dingue au bistouri :
« J’ai
brusquement du chagrin pour ce cinglé qui me fait penser au personnage de
Mohamed Moulessehoul, ce personnage qui disait à son reflet dans le
miroir : “j’ai grandi dans le mépris des autres, à l’ombre de mon
ressentiment, hanté par mon insignifiance infime, portant mon mal en
patience…” »[262]
Relevons encore cette citation reprise par Llob, dans La Foire des enfoirés :
« Tout philosophe devient irresponsable au moment où il commence à se prendre au sérieux, a écrit quelque part Moulessehoul. »[263]
Si l’on considère que la vie de l’auteur était effectivement menacée durant toutes ces années d’anonymat forcé[264], ces différentes pistes laissées volontairement ou non par Yasmina Khadra semblent témoigner de sa difficulté à renoncer à la reconnaissance publique. Le recours à l’autocitation semble trahir une certaine frustration ; il en est de même de l’autonomie d’existence dont semble jouir le commissaire Llob, qui paraît pouvoir s’affirmer au-delà de toute référence intertextuelle relative à ses prédécesseurs en matière de roman policier, et qui, par sa prestance semble pouvoir prétendre à les effacer. Précisons, en ce sens, que si Llob/Khadra a pu être comparé à San Antonio, il serait erroné de ne voir dans la production de l’Algérien qu’un simple calque de la démarche empruntée par Frédéric Dard. Bien qu’usant du même recours au pseudonyme que son prédécesseur français, l’indépendance de Llob et son existence en tant que personnage à part entière, ne font aucun doute ; si le commissaire Llob s’inspire nécessairement de ses prédécesseurs, il se révèle être néanmoins résolument original et sans doute destiné à devenir, à son tour, un modèle.
La position de Yasmina Khadra nous paraît significative à bien des égards et notamment en ce qu’il semble s’orienter vers une valorisation de l’univers littéraire dont il émerge. Ainsi, au-delà de l’autocitation favorisant la constitution d’un univers proprement « llobien » voué à lui survivre, Yasmina Khadra revendique fièrement une intertextualité locale, située non plus dans le domaine réduit du roman policier, mais dans celui de la « grande littérature ». Si Lino se révèle être un amateur de Djamel Dib, le commissaire Llob peut, quant à lui, se targuer de quelques références hautement plus valorisantes, qu’il s’agisse de Tahar Djaout, Mouloud Feraoun, Malek Haddad, Nabile Farès, Rabah Belamri ou encore Naguib Mahfouz ; qu’il s’agisse encore d’artistes peut-être moins connus en France, comme Abdelakader Allalou (dramaturge algérien assassiné en 1994, à Oran), Moufdi Zakaria (considéré comme un « poète révolutionnaire », auteur des paroles de l’hymne algérien), Djamel Amrani (écrivain et poète), Amar Laskri (réalisateur), ou encore le dessinateur Slim (auteur de bandes-dessinées et de caricatures). Il s’agit-là, pour Yasmina Khadra, d’offrir davantage de relief à son propos, dans la mesure où ces artistes se révèlent être des pièces maîtresses de l’engagement intellectuel dans le devenir du pays -quelques-uns sont d’ailleurs des martyrs-, tout en palliant, d’une certaine manière, la catégorisation du genre policier dans le registre mineur. Cette double perspective contribue, par ailleurs, à ancrer ces romans au cœur de la littérature maghrébine, et ce, bien qu’ils s’inscrivent dans un circuit de diffusion francophone.
Au-delà de la mise en scène du contexte social, le recours à l’intertextualité locale semble donc permettre au genre policier, de tradition occidentale, de s’adapter, voire de s’ancrer, au cœur de la littérature maghrébine. Une telle orientation est également perceptible chez d’autres écrivains qui, sans forcément recourir à des auteurs relevant de leur espace géographique, parviennent néanmoins à extrader, d’une certaine manière, le genre policier.
1.1.3- Quête d’un « intertexte noir »
Comme le souligne l’auteur[265] d’un article paru dans l’hebdomadaire martiniquais Antilla :
« Le roman policier est de par son origine et son mode de constitution la plus “exotique” des littératures pour nous autres Antillais. En effet, ses personnages, ses intrigues, ses couleurs, son atmosphère générale sont ceux des mégalopolis euro-américaines […]. » [266]
Pour de nombreuses raisons, sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement, cette remarque nous paraît justifiée dans le sens où elle semble pouvoir légitimer le recours de certains auteurs, notamment Patrick Chamoiseau, à une intertextualité policière faisant appel à des modèles certes américains, mais présentant néanmoins des affinités certaines avec le monde noir. On remarque, en effet, que Chester Himes demeure particulièrement présent, en filigrane, dans Solibo Magnifique.
Bien que n’étant pas revendiqué comme relevant de la stricte forme policière, le roman de Patrick Chamoiseau se construit véritablement autour de la mise en place d’une intrigue policière qui présente la particularité de faire apparaître des enquêteurs hors du commun aux prises avec leurs démons et par là même incapables de résoudre quoi que ce soit. Cette caractéristique, s’exprimant notamment par le biais d’un recours systématique à la violence, n’est pas sans rappeler le profil singulier des enquêteurs mis en scène par Chester Himes. C’est ainsi que l’on remarque l’indéniable proximité s’établissant entre certains passages de Solibo Magnifique et quelques scènes consacrées aux enquêteurs de Harlem.
La première affinité remarquable entre ces deux auteurs réside dans la caractérisation patronymique, riche de sens, des différents personnages mis en scène. Ainsi, avec Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, C. Himes ne laisse aucun doute quant à l’efficacité de ses « nettoyeurs du crime ». Cette caractéristique est également propre aux policiers mis en scène par P. Chamoiseau qui, créolité oblige, prend le soin d’ancrer, par ailleurs, cette caractérisation dans un registre spécifiquement antillais : ainsi, Figaro Paul, est surnommé « Diab-Anba-feuilles, à cause de sa rancune légendaire et de ses vengeances sournoises »[267], et Salamer Cyprien, devient « Jambette, peut-être à cause de son aptitude à manier un couteau dissimulé dans un mouchoir »[268]. Tous ces surnoms assurent un effet garanti dans l’assistance, parcourue irrémédiablement par l’effroi à l’approche de l’une de ces figures légendaires, comme nous le laisse entendre ce passage consacré à Ed Cercueil:
« Son
apparition déclenchait la panique, la terreur, la mâle rage. Des types qui se
planquaient sautèrent par les fenêtres ; des tenanciers le menacèrent de
faire appel à la police ; des épouses en rupture de bans se cachèrent sous
des lits, tandis que des truands farcis de drogue se jetaient sur lui, le
couteau à la main […]. Il laissa derrière lui une traînée d’hystérie, de crises
de nerfs, de bosses aux fronts et de saignements de nez. Et tout ça pour rien.
Il ne recueillit pas le moindre indice, n’apprit rien de neuf. Le néant. »[269]
Produisant un effet dévastateur, à la limite de l’absurde, Ed Cercueil laisse indubitablement son empreinte sur P. Chamoiseau, et plus exactement sur le brigadier-chef Bouaffesse dont un simple regard suffit à plonger les témoins de son enquête dans un terrible effroi :
« Le
brigadier-chef se métamorphosa. Ailes du nez à l’envol, rides arquées autour
des lèvres, ventre retenu, dos redressé au fil à plomb, il nous jeta ô Seigneur
un regard dont il vaut mieux ne pas parler […]. Oh manman ! on peut ainsi
transpirer sans escalade vers le Gros-Morne. Nos cœurs pompaient une
culpabilité inexplicable, avec des accélérations quand le brigadier-chef
examinait telle ou telle cochonnerie, et marquait kritia kritia on ne sait
quoi. »[270]
Une simple apparition de ces hommes hors du commun et entourés des histoires les plus terrifiantes suffit, en fait, à susciter une véritable vague de terreur :
« C’est
qu’Ed Cercueil avait tué un homme pris sur le fait dans une affaire de mœurs et
que Fossoyeur avait crevé les deux yeux d’un type d’un seul coup de revolver.
Et la légende courait dans Harlem que les deux inspecteurs noirs auraient tué
un mort dans son cercueil s’il avait fait mine de broncher. »[271]
« On
disait couramment à Harlem que le pistolet d’Ed Cercueil pouvait tuer une
pierre et celui de Fossoyeur l’enterrer. »[272]
Une réelle perspective fantasmagorique s’installe ici, soulignant avec humour le caractère extraordinaire de ces personnages, véritables légendes dans leur quartier, comme Bouafesse a pu lui aussi le devenir après avoir ouvert un cercueil sous l’objectif d’un photographe de France-Antilles:
« Alerté
par un Syrien qui venait de découvrir ce quimbois devant son magasin, le
Brigadier Bouaffesse (pas encore chef) avait là aussi calmé l’agitation en
ouvrant le cercueil à coups de talon et en répertoriant d’une main sereine son
contenu. Cette affaire lui valut une réputation de demi-quimboiseur qu’il
utilisa par la suite pour appréhender quelques récalcitrants. […] Lorsque nous
nous enfuyions, il nous criait sans lever le pied : Tombez ! Et quant Bouaffesse avait dit Tombez !, que tu le veuilles ou non, l’effet par là était le
même qu’ici : tu tombais, oui. »[273]
Si ce portrait paraît pour le moins édulcoré, P. Chamoiseau, censé se laisser lui-même prendre au jeu de la rumeur, l’accentue quelques pages plus loin en évoquant, dans un paragraphe situé en marge, le pouvoir des « calottes de Bouaffesse » :
« Permettez-moi
un quart de mot sur les calottes de Bouaffesse. Elles sont connues jusqu’à
Grand-Rivière où un nègre archaïque, qui n’a pourtant jamais connu la ville,
peut en dire quatre paroles. Il prétend que notr’homme a passé une nuit de
vendredi saint, étalé tout au fond d’un caveau avec (kyrié éléison) les mains
trempées dans un pourri de cercueil. Il dit aussi qu’à l’aube, Bouaffesse les a
saupoudrées d’encens, et que depuis, quand il lève la main, c’est un cimetière
qui te donne la calotte. » [274]
Nous remarquons que cette légende, certes créolisée par le quimbois, semble digne d’un Fossoyeur Jones et de ses « calottes » d’une violence sauvage, imprimant sur le visage de ses victimes le contour de la main vengeresse en une « ecchymose violette veinée de jaune orangé »[275].
La proximité de ces différents portraits laisse peu de doute quant à l’influence de C. Himes sur l’écrivain martiniquais qui, par le biais de scènes pour le moins rocambolesques, semble vouloir donner à Fort-de-France des airs du Harlem de C. Himes ; un Harlem qui, sous la plume avertie et originale de l’auteur noir américain, prend des allures véritablement clownesques, comme le souligne Claude Mesplède :
« Dans un monde aussi burlesque que le ghetto noir de Harlem, ceux qui sont chargés d’y maintenir l’ordre doivent aussi relever du genre bizarre, voire monstrueux. Les deux inspecteurs noirs Ed Cercueil Johnson et Fossoyeur Jones […] ne peuvent passer inaperçus. Longs, déguingandés, vêtus de pardessus élimés et coiffés de feutres cabossés, ils pourraient presque être assimilés à des personnages de cirque. » [276]
Par l’entremise de cette représentation « clownesque » de justiciers censés régir les rues de Harlem, C. Himes exprime le chaos d’un monde confronté à la misère et au crime, sur fond de conflit racial. Car, comme le précise Marcel Duhamel, dans sa préface au roman L’Aveugle au pistolet[277], c’est bien de la peur d’un peuple soudainement livré à lui-même, au lendemain de l’abolition de l’esclavage, que sont nés les deux enquêteurs noirs de Harlem, créés pour combattre l’exploitation du peuple noir par le système des Blancs, mais également pour dénoncer la roublardise de certains membres de cette communauté miséreuse, bien décidés à tirer, à leur tour, leur épingle du jeu. C’est, semble-t-il, dans une perspective identique que Bouaffesse imagine la Compagnie des proches de Solibo sous les traits d’un véritable réseau de comploteurs ; hypothèse, faisant état du mépris du policier pour le petit peuple, qui sera la cause de la répression engagée par les représentants de l’ordre.
Personnages de cirque, univers burlesque, peur, violence, absurdité sont autant d’éléments fondateurs des romans de C. Himes et semblent également participer de l’univers dépeint par P. Chamoiseau dans Solibo Magnifique, où ils trouvent notamment leur paroxysme dans une scène désopilante décrivant l’échauffourée provoquée par l’arrivée fracassante, sur les lieux du « crime », des pompiers brusquement attaqués par des policiers affolés et engagés au cœur d’un quiproquo sanglant. Notons cependant que cette orientation se démarque quelque peu des objectifs avancés par C. Himes, dans la mesure où si ce genre de scènes illustrant l’« échauffement » des policiers aux prises avec d’autres représentants de l’ordre -le corps des pompiers par exemple-, apparaît également dans certains romans de l’Américain[278], la conscience professionnelle des deux enquêteurs de Harlem semble toujours devoir primer, ce qui est loin d’être le cas en ce qui concerne les policiers mis en scène par P. Chamoiseau. En d’autres termes, si la « bavure » se révèle être inévitable dans un monde aussi gangrené par le mal que peut l’être l’univers des quartiers de Harlem, elle n’en demeure pas moins conçue comme telle, c’est-à-dire comme une erreur aux conséquences graves, par rapport au respect des lois. En revanche, cette conception de la fonction de représentant de l’ordre est étrangère à Bouaffesse et ses hommes, capables des pires horreurs en toute conscience et convaincus d’être légitimés par l’autorité officielle qu’ils incarnent.
Si P. Chamoiseau semble s’être largement inspiré de l’univers burlesque dépeint par C. Himes, soucieux de rendre compte du chaos régissant une société aux prises avec des dysfonctionnements sociaux et raciaux, issus d’un système post-esclavagiste, il s’est néanmoins efforcé d’exprimer la singularité du phénomène créole, notamment par le fait que ses enquêteurs ne sont pas en rupture avec le système post-esclavagiste, mais au contraire insérés, voire recyclés, par ce dernier. Ainsi, tandis qu’Ed Cercueil et Fossoyeur Jones oeuvrent à un changement de la condition noire, Bouaffesse et ses hommes se révèlent être, quant à eux, totalement en marge d’un quelconque engagement social, tant ils sont englués dans leur propre condition d’aliénés vis-à-vis de cette représentation fantasmagorique du pouvoir héritée de l’Histoire coloniale. Notons que C. Himes a, lui aussi, fini par céder à cette forme de pessimisme en faisant mourir ses deux héros, dans le roman intitulé Plan B ; roman marqué par un regain de violence, de peur et de noirceur, à l’origine de quelques passages sombres et défaitistes:
« Un
flic c’est un flic, pas un employé des services sociaux ni un sociologue. Après
tout, si les Noirs vivent dans des taudis, ce n’est pas de la faute des
flics ; leur devoir, c’est de faire en sorte qu’ils filent droit, pas
d’analyser leurs conditions de vie. »[279]
Cette perspective justifie l’« acharnement sauvage » de la police sur certains individus notamment de couleur et attise les tensions entre Blancs et Noirs, ces derniers ne pouvant alors plus échapper ni à la rage ni à la peur :
« On
sentait la rage monter en eux, on les devinait outrés et on avait l’impression
que seule la terreur hypnotique qui s’était abattue sur eux les retenait d’un
déchaînement de violence vengeresse ; elle semblait les abrutir, leur lier
les muscles, comme si l’idée du lynchage, vieux souvenir incrusté dans la
mémoire nègre, avait sur eux un effet paralysant. »[280]
C’est ce revirement de situation qui semble définitivement ancrer le texte de P. Chamoiseau dans la lignée des enquêtes mises en scène par Ch. Himes ; la filiation permet à Solibo Magnifique de s’inscrire judicieusement, en filigrane, dans la sphère du roman noir, sans en revendiquer l’étiquette, mais en se réclamant de la sensibilité d’un des plus grands auteurs du genre.
Précisons enfin que le recours intertextuel est une des particularités de l’écriture de P. Chamoiseau ; à cet égard, d’autres auteurs ont également pu inspirer le Martiniquais, tels que William Faulkner, Carlo Emilio Gadda[281] ou encore Jorge Amado. Nous nous sommes concentrée sur l’écriture de Chester Himes, car la proximité des textes de P. Chamoiseau avec ceux de l’auteur noir américain est véritablement frappante, si bien que certains passages de Solibo Magnifique donnent l’impression d’être adaptés de différents extraits des ouvrages de Chester Himes.
Ainsi donc, le rapport que les romans de notre corpus entretiennent avec les modèles de référence du genre nous permet de déceler une certaine volonté de se démarquer de tout ce qui constitue le classicisme de la forme policière, à la manière d’Agatha Christie ou de Conan Doyle. Il s’agit en quelque sorte de procéder à une mise à jour du genre en prenant soin, dans un premier temps, de rompre avec les héros marquants du début du siècle, avec ces êtres de génie trop parfaits pour être crédibles et espérer retenir l’attention d’un lecteur désormais davantage sensibilisé à des formes fictives véritablement en prise avec la réalité. Ceci explique le recours privilégié, aux dépens de la forme classique aujourd’hui dépassée, à la variante noire du genre, plus en adéquation avec l’atmosphère des sociétés décrites. Il s’agit donc d’adapter la forme policière à l’évolution sociale, comme cela a été le cas aux Etats-Unis dans les années 1930, tout en procédant à une forme d’extradition du genre, par le biais notamment du recours à un intertexte local ou de sensibilité idéologique partagée. C’est bien d’une acclimatation du genre dont il est ici question et elle trouve, par ailleurs, appui sur une autre forme d’ancrage dans l’univers local, à travers la mise en place d’un cadre géo-spatial bien particulier.
1.2-
Transposition
du cadre à la géographie locale
Les sphères antillaise et maghrébine présentent la particularité de véhiculer, pour le regard extérieur, toute une imagerie fantasmatique découlant, en partie, de l’attrait suscité par les espaces dits « tropicaux » et « orientaux ». Cette singularité relève en tout premier lieu, et au-delà de l’aspect strictement culturel, du paysage qui, dans le cadre du genre policier, nous intéresse selon deux perspectives : celle de l’insularité et celle de l’urbanité.
1.2.1- Cadre insulaire
La transposition du roman policier, genre du crime, de la violence, de la noirceur, à la sphère insulaire antillaise, inévitablement porteuse de l’a priori de la carte postale, nous paraît particulièrement significative ; et ce, d’autant que ce même cadre, riche en exotisme, se révèle être paradoxalement propice à la charge fantasmatique accompagnant nécessairement le bien-fondé de tout récit en prise avec la mort, la violence ou encore le crime. Autrement dit, à la lumière du genre policier, le cadre insulaire se pare d’une double fonction : miroir grossissant du crime, par contraste, catalyseur de la charge imaginaire de l’intrigue, par fantasme.
L’évasion, le divertissement, l’aventure, atouts les plus élémentaires du genre policier, sont particulièrement adaptés à une certaine imagerie insulaire faite de plages de sable fin, de cocotiers et de parfums épicés. Cette imagerie se fait d’autant plus « exotisante » que la plupart des romans de notre corpus sont édités et diffusés en métropole et que les enquêteurs mis en scène se révèlent être, très souvent, eux-mêmes métropolitains ou de retour au pays après un exil suffisamment long pour que le regard permette le dépaysement ou, en l’occurrence, le « re-paysement », phase de (re)découverte de l’île qui se fait, en tout premier lieu, sensitive. C’est donc à coup de parfum d’ylang-ylang, de saveurs sucrées, de poudre à colombo ou encore de vapeurs fortement « rhumisées », que l’île tropicale peut nous apparaître, en guise de toile de fond de la plupart des romans qui nous intéressent. Mais on aurait probablement trop vite fait de qualifier péjorativement cette vision d’exotique -d’autant que la forme policière s’y prête parfaitement-, alors qu’il est évidemment impossible de prendre pour cadre les Antilles, en occultant les plages, la végétation luxuriante et tout ce qui constitue la singularité de l’espace tropical. Le genre policier aurait donc, a priori, tort de se priver d’un cadre naturel aussi favorable, dans la mesure où l’espace antillais dispose d’atouts non négligeables notamment dans la mise en valeur du suspense, clé de voûte de tout récit d’énigme.
De même que le roman policier classique a pu bénéficier des mystères en lieux clos et le roman noir de la sordidité des rues des grandes villes industrialisées, le roman policier antillais peut jouir d’une grande diversité d’espaces, particulièrement propices à l’inspiration créatrice, tels la mer, la mangrove ou encore les abords du volcan, avec leur lot de mystère et de dangers.
C’est ainsi que dans le roman Brin d’amour de R. Confiant, la mer, communément synonyme de beauté, d’apaisement, de détente pour les continentaux, prend brusquement un caractère résolument négatif :
« Massée au bordage de cette mer que tous abhorraient de génération en génération depuis une éternité de temps, sans que quiconque fût en mesure de fournir une raison plausible à semblable détestation, la figure dévorée par l’inquiétude, la population du bourg attendait. En son for intérieur, elle accusait la mer de tous les maux : de happer les bambins innocents, de scander le sommeil des humains de ses vagues fracassantes, de noircir l’argenterie avec ses embruns plus salés qu’ailleurs et, surtout, d’être bréhaigne. […] Cette mer d’ici était synonyme de maudition. »[282]
Il n’y a rien d’étonnant alors à ce que les deux cadavres soient découverts sur la plage et que la principale suspecte soit la seule capable d’aimer cette mer maudite. C’est peut-être une manière, pour R. Confiant de remédier à une certaine forme d’exotisme traditionnel en substituant à l’imagerie fantasmatique occidentale une perspective locale, ancrée dans une tradition remontant à la traversée originelle. L’introduction de l’intrigue policière permet ainsi à R. Confiant d’abonder dans le sens d’une certaine perception locale en s’opposant, dans le même temps, à la douceur des clichés occidentaux.
Cette orientation semble également manifeste dans l’approche proposée d’un autre lieu propice aux divers fantasmes du touriste : la mangrove. Bien qu’elle constitue le berceau d’une profusion de vie micro-organique et végétale, et en dépit des fantasmes aventuriers qu’elle véhicule, la mangrove nous apparaît, notamment dans deux romans de notre corpus, comme un véritable lieu de mort. Dans le roman de G. Cabort-Masson, La Mangrove mulâtre, elle devient même un des principaux lieux de crime, habité pour l’occasion en espèces particulièrement dangereuses, telles que les crabes cyriques, véritables ciseaux flottants, auxquels l’enquêteur Dampierre sera jeté en pâture par l’instigateur de toute l’affaire. De la même manière, la mangrove se fait également meurtrière dans Traversée de la mangrove de M. Condé, où une nouvelle fois, elle se voit proposer le rôle central de lieu du crime ; c’est, en effet, dans la boue saumâtre de la mangrove que le cadavre de Sancher est retrouvé, illustrant parfaitement les propos d’une des protagonistes qui déclare :
« On
ne traverse pas la mangrove. On s’empale sur les racines des palétuviers. On
s’enterre et on étouffe dans la boue saumâtre. »[283]
Ce renversement de perspective tend à gommer les aspects les plus attrayants de l’a priori de la carte postale que la reprise de la forme policière semble logiquement favoriser par l’introduction de la thématique mortuaire, mais également par le simple recours à l’obscur, comme le souligne ce passage du roman d’E. Pépin, L’Homme-au-bâton :
« Dans
la nuit, le paysage avait quelque chose d’irréel. Les phares déchiraient avec
peine un épais brouillard qui montait de la terre et recouvrait des formes
étranges. Les arbres avaient des allures de grands prêtres occupés à célébrer
des cérémonies rituelles. Une force angoissante habitait l’espace torturé par
d’invisibles présences. La voiture naviguait entre d’obscurs précipices. […] Il
eut la chair de poule et, tout à coup, il se sentit étranger à ce pays qu’il
croyait aimer. »[284]
Après la découverte du cadavre de sa maîtresse, le personnage -un Préfet au regard « étranger »- se retrouve soudainement confronté au versant obscur de l’île, à cette partie absente des cartes postales, en une révélation qui le saisit au fur et à mesure qu’il se rapproche du volcan :
« La
Soufrière était là, menaçante et narquoise, et dans la nuit elle prenait des
allures de pyramide égyptienne. De temps à autre, des feuilles émettaient
l’éclat lustré de leur message. Elles trépignaient sur leur tige, pleines de
colère et de refus. Un grondement continu montait des entrailles du volcan.
Tout cela qui le jour paraissait si accueillant se liguait contre lui dans le
complot des odeurs fortes des racines et de la terre boueuse. […] La végétation
l’écrasait, rendait insupportable sa présence. Il y a trop de sang dans la
mémoire de cette terre, se dit-il. »[285]
Au-delà du versant merveilleux et burlesque développé tout au long du roman d’Ernest Pépin, on relève ici une des clés à la fois du roman et de la société antillaise, en ce poids du passé nécessairement absent d’une approche dépaysante et idyllique des Antilles.
Sans occulter l’aspect distrayant et léger de certains romans de notre corpus, relevons que le recours à la forme policière offre ainsi la possibilité d’un renversement de perspective par le noircissement du cadre qui, s’il reste inscrit dans les limites de la fiction, suggère néanmoins l’existence d’une vie complexe, sous le simple décor. Notons, par ailleurs, que le prisme de l’intrigue policière, en se heurtant à une forme d’idéalisation de l’espace tropical, peut inviter à une démarche herméneutique. Ainsi, comme dans tout roman policier, l’enquête menée devient le prétexte à une exploration de la société troublée par le crime, démarche nécessairement valorisée, dans le cadre insulaire, par la clôture du lieu.
Limites d’un espace généralement restreint, les frontières insulaires sont, en ce sens, propices à la structure circulaire du récit policier :
« La structure d’énigme a pour effet d’enfermer le récit d’enquête dans une parfaite clôture, de le boucler impeccablement sur lui-même. Ce récit produit par excellence le texte autonome, le texte confiné, le texte insulaire. »[286]
Le récit d’énigme, conçu sur le schéma meurtre/enquête/résolution, se veut ainsi clos et de logique circulaire, favorisant dans le même temps l’avènement d’un questionnement réflexif. Cette perspective paraît tout à fait intéressante dans le cadre du récit insulaire puisque la littérature antillaise, de formation post-coloniale et de problématique identitaire -entre autres-, est inévitablement orientée vers une démarche favorisant le questionnement et la quête d’un certain équilibre social. Précisons, par ailleurs, qu’au-delà de la démarche réflexive opérée en lieu clos et susceptible d’assurer une parfaite compatibilité entre récit d’énigme et roman insulaire, le genre policier s’avère être, paradoxalement, propice à un mouvement d’ouverture du cadre insulaire.
En effet, lorsque le récit d’énigme s’ouvre sur la découverte d’un cadavre, c’est que le meurtre a nécessairement eu lieu dans un avant-texte ; toute l’entreprise de l’enquête consiste alors à mettre au jour cette scène manquante et, d’une certaine manière, à dépasser les limites textuelles. L’enquête a effectivement lieu au sein d’un espace clos qui se révèle à lui-même au terme d’une démarche réflexive, mais son objet aspire, quant à lui, à une forme de transcendance des frontières.
Dans le cadre du texte insulaire, cette démarche prend une résonance singulière dans la mesure où le renouvellement du roman policier, genre universel, semble également pouvoir offrir ce genre de transcendance. De popularité mondiale, le roman policier se présente, en effet, à la littérature antillaise, sous les traits d’un vecteur essentiel à la quête d’universalité plaidée notamment par les auteurs de la créolité. Le mode de fonctionnement du récit d’énigme semble donc d’une part, pouvoir insuffler une perspective herméneutique censée permettre un questionnement interne des plus significatifs au sein de la littérature antillaise et, d’autre part, engager un mouvement d’ouverture, de transcendance des frontières permis par la structure analeptique du récit d’énigme ainsi que par l’universalité du genre policier.
La clôture insulaire semble donc pouvoir s’inscrire dans une double perspective, à la fois réflexive et tendant à l’universel, qui permet au roman policier antillais d’exprimer de manière plus marquée sa singularité. La clôture de l’espace y est ainsi vécue comme un frein à toute tentative criminelle nécessairement dépendante d’un schéma placé sous le sceau du secret ; un élément qui, avec le suspense, n’a qu’une valeur relative dans l’espace réduit des Antilles, comme le souligne l’auteur d’un article publié dans l’hebdomadaire Antilla :
« Le
suspens, c’est un truc qui est complètement étranger à notre réalité pour la
bonne raison que dans un pays de 1000 km2, on a vite fait de
retrouver qui a fait quoi même s’il se cache dans la Montagne Pelée. » [287]
L’ouverture à l’universalité y est, quant à elle, permise non par un quelconque déplacement géographique, mais par l’adaptation locale du schéma traditionnel : plus le genre policier est ancré dans la sphère antillaise, plus il véhicule de perspectives de renouvellement, de perméabilité, de créativité, offrant par là même davantage de marge à l’universalité.
Ainsi, la transposition du genre policier à la sphère insulaire tropicale offre de multiples possibilités : renversement de l’éclairage fantasmatique suggéré par l’a priori de la carte postale ; installation de l’intrigue au cœur d’un espace clos mais nécessairement en marge du modèle occidental, en partant du présupposé que le crime sous les Tropiques ne peut être qu’exubérant et marginal ; ou encore, utilisation du vecteur de l’universalité pour véhiculer une adaptation du modèle soumis, non sans conséquences, au « farniente insulaire »[288].
Il s’agit en fait, notamment pour les auteurs de la créolité, tels P. Chamoiseau, R. Confiant et E. Pépin, d’opérer un renversement de la charge exotique traditionnellement constitutive de l’imagerie véhiculée sur l’espace tropical insulaire, par le recours à des genres de mauvaise réputation et qui, dans sa version la moins glorieuse, celle du roman d’espionnage notamment, a fortement contribué à l’ancrage du stéréotype dans les consciences occidentales.
L’implantation du récit d’énigme dans l’espace local paraît, dans cette perspective, véritablement centrale ; comme dans le texte antillais, elle joue ainsi un rôle également déterminant dans la plupart des romans maghrébins de notre corpus.
1.2.2- Cadre urbain
Cadre privilégié des romans maghrébins de notre corpus, la ville, confrontée à une forte criminalité liée pour partie à la montée des islamistes, nous apparaît logiquement dans toute sa noirceur, propice en ce sens à un développement de la variante noire du genre policier. Cette orientation est, à l’inverse, peu adaptée au cadre urbain antillais, non seulement du fait de ses proportions réduites, mais également en raison de la singularité du regard porté sur lui par quelques-uns des écrivains antillais.
Se référant à la Martinique des années 1950-60, P. Chamoiseau et R. Confiant notamment, proposent une vision fragmentée de la ville, portant en substrat la multiplicité de ses composantes culturelles. Le quartier est ainsi conçu comme un des noyaux de la ville, lui-même divisé en différents foyers, différents îlots culturels, sinon ethniques. Dans un ouvrage consacré à « la mangrove urbaine », Alexandra de Cauna[289] met en évidence à la fois la richesse -profusion de vie, d’activités, de cultures, d’échanges- et la fragilité -insalubrité, concentration étouffante, pauvreté, exclusion- de certains quartiers martiniquais de Fort-de-France, tel le Morne Pichevin, lieu de prédilection de quelques romans de R. Confiant, dont Le Meurtre du Samedi-Gloria.
Dès les premières pages de ce roman, le « redoutable quartier du Morne Pichevin » nous est ainsi présenté comme une véritable « zone de non-droit » :
« Ce
repaire d’honnêtes dockers, de charpentiers et djobeurs émérites vivait sous le
joug d’habiles manieurs de couteau à cran d’arrêt et de voleurs à la tire. La
maréchaussée n’y poursuivait jamais ceux qui avaient eu le temps de se réfugier
dans l’une de ces cahutes en tôle ondulée. »[290]
Cette perception est accréditée par le discours de certains policiers :
« Au
commissariat central, ses collègues évoquaient ce quartier avec un certain
effroi parce que y vivaient les derniers fiers-à-bras, les majors comme l’on
disait, ainsi que les combattants du damier, une danse-combat d’origine
africaine que les autorités avaient décrétée hors-la-loi. »[291]
Le climat de terreur ambiant témoigne d’une certaine activité criminelle urbaine que l’on retrouve encore, en filigrane, dans Solibo Magnifique où il est notamment question, en cette période de carnaval, de « l’inépuisable afflux des victimes balafrées pour des affaires de regards, de querelles au serbi, de concubinages où l’amour s’agrément[e] en toute éternité de brûlures à l’acide… »[292].
Il convient néanmoins de souligner que la manière dont cette « criminalité urbaine » est évoquée se voit largement imprégnée, là encore, d’une perspective fantasmatique en cette forme de « westernisation » quasi systématique des personnages présentés. Le tableau noir se voit ainsi inévitablement re-coloré par la fantaisie des créolistes, contrairement à l’orientation choisie par d’autres auteurs antillais, comme M. Condé qui, dans La Belle créole, donne à la ville de Port-Mahaut des allures apocalyptiques. Le contraste nous apparaît d’autant plus saisissant encore à la lecture des textes des auteurs maghrébins.
Nous remarquons, en premier lieu, que si le récit policier se permet parfois de visiter la campagne antillaise -le plus souvent dans le cadre d’une opposition entre l’espace rationnel de l’En-ville et le cadre superstitieux des mornes, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir-, il demeure exclusivement urbain dans les romans maghrébins se voulant résolument tournés vers la variante noire du genre : il s’agit essentiellement ici des ouvrages de Yasmina Khadra, Boualem Sansal, Jean-Pierre Koffel ou encore Rida Lamrini.
L’orientation urbaine répond aux usages de la forme policière et se révèle, par ailleurs, parfaitement adaptée au cadre maghrébin témoin d’une urbanisation marquée, comme le souligne Jean-François Troin[293] :
« L’urbanisation
croissante du Maghreb peut être mesurée de diverses façons. La plus empirique,
celle de l’urbanisation des paysages, vérifiable par le simple regard, est
peut-être la plus frappante. D’un bout à l’autre du Maghreb jaillissent des
chantiers urbains, s’étoffent des quartiers, poussent des excroissances de
faubourgs ; des constructions parsèment les campagnes, des usines se
dressent sur l’horizon, des tours viennent rompre le profil urbain jadis
sagement aligné au cœur même des métropoles. La ville est partout présente et
partout renforcée. »[294]
Conformément au modèle américain, Y. Khadra, B. Sansal, J-P. Koffel et R. Lamrini semblent ainsi considérer le cadre urbain comme propice au développement de la variante noire, en ce qu’il implique une critique liée à l’avènement de la modernité ; une donnée invitant le cadre urbain à s’engager bien au-delà du simple décor. Chez ces auteurs, la ville occupe ainsi une place privilégiée puisqu’elle se fait finalement le réceptacle de la situation globale du pays. C’est donc une approche singulière qui est ici proposée de la ville algérienne, située entre vestige colonial et modernisation, « suspendue entre le souvenir et l’utopie »[295].
Dans les romans de Yasmina Khadra, la mythique Alger « la blanche » devient ainsi la triste Alger « la noire » ; un contraste souligné entre le faste passé et la déchéance urbaine actuelle que commente notamment B. Bechter :
« Ces “tristes gouaches” (La Foire, p.28) que Yasmina Khadra peint dans ses romans noirs sont à l’opposé des images et des descriptions ensoleillées de la “ville blanche” comme on appelait Alger pour sa lumière particulière, descriptions que nous trouvons dans les récits de voyage ou dans les romans d’auteurs “pieds noirs”, mais aussi dans la littérature algérienne. Ce n’est que rarement -et seulement dans les descriptions de l’Alger réelle- que la lumière typique de la capitale algérienne apparaît dans les romans policiers de Yasmina Khadra. Mais, dans la plupart des cas, ce sont le ciel gris et pluvieux et le demi-jour, des images symboliques donc, qui dominent la ville torturée. »[296]
Sous la plume de l’auteur algérien, la capitale, ravagée par quarante années de griserie désenchantée, « cuve son chagrin comme un clodo son vin frelaté »[297] et son aura mythique devient alors pathétique :
« C’est
très beau, la Blanche, lorsque le lointain est si limpide qu’on reconnaîtrait
un chêne d’un caroubier à des lieues à la ronde. S’il n’y avait pas ses
attentats incongrus et cette colonie d’illuminés qui mite les rues et les
esprits, on n’échangerait pas Alger contre mille féeries. »[298]
Cette peinture noire de la ville accueille généreusement l’intrigue policière au cœur de ses rues engorgées par une cohue de véhicules dangereusement indisciplinés, souillées par les immondices oubliés des services publics ou encore englouties par un bétonnage massif. Ce délabrement de l’espace urbain est présenté comme relevant à la fois d’une faillite des pouvoirs publics et d’un décalage existant entre le mode d’urbanisation occidental, pratiqué sous la colonisation et reproduit après l’Indépendance, et certaines pratiques culturelles algériennes, comme le souligne l’architecte Abdenour Djellouli :
« Dans la pratique culturelle traditionnelle de l’Algérien, son habitat commence à la porte de sa maison, la rue s’arrête à cette porte. Le palier, l’escalier, l’entrée de l’immeuble appartiennent à la rue. Il n’y a donc aucune raison de prendre en charge ces espaces. Très logiquement, le décalage entre cette pratique culturelle et l’organisation de l’habitat, qu’il s’agisse des logements laissés vacants par les Français, ou de ceux nouvellement construits aux normes occidentales, a conduit à une dégradation très sensible de tous ces espaces immédiatement connexes au lieu d’habitation. Aujourd’hui, lorsqu’on rend visite à un ami dans un immeuble, mieux vaut prendre sa lampe de poche et faire attention où on met les pieds dans l’escalier. Il n’y a jamais d’électricité ni de porte d’accès, les ordures s’entassent dans l’indifférence. »[299]
Marquée par le mode de fonctionnement occidental, la ville algérienne a ainsi été soumise, après l’Indépendance, à la reprise des mêmes schémas d’organisation urbaine. A. Djellouli tente de retracer l’évolution de la politique urbaine algérienne en mettant en lumière différentes étapes charnières : l’occupation anarchique de l’espace urbain par les ruraux dans les années 1960 qui a stoppé la construction de nouveaux logements ; les ventes, hors de toute législation, de terrains à la périphérie d’Alger où ont été construits des logements individuels « sans permis de construire, sans cohérence, sans équipement, sans route, sans assainissement, sans eau ni électricité »[300] ; la reprise de la construction de logements dans les années 1970, par l’Etat et toujours dans la périphérie d’Alger où se sont notamment regroupées les populations rurales en transit ; l’accentuation de la relance de la construction par une « “industrialisation” de la politique de l’habitat »[301] qui, d’une part, n’a pas tenu compte des avancées technologiques de l’époque et qui, d’autre part, n’a pas pu pallier le déficit de logements ; ou encore la construction de nouveaux logements, dans les années 1980, hors de la zone d’Alger et avec l’aide d’entreprises étrangères ; et enfin le désengagement de l’Etat, avec la suppression du Comédor[302] en 1980, dans l’organisation de l’espace urbain. Selon A. Djellouli, la politique d’urbanisation semble donc avoir échappé aux instances du pouvoir tant par négligence, ignorance, que par maladresse. Cette situation a été aggravée par la crise économique qui a connu son apogée dans les années 1980-90 et qui a contribué à substituer à la répartition raciale des quartiers, favorisée par le système colonial, une forme de ségrégation sociale. Ceci semble pouvoir expliquer le sentiment d’injustice et de gâchis inévitablement ressenti par la population algérienne des bas-quartiers -la majeure partie-, sans aucun doute frustrée et incrédule face à une telle instabilité de la politique urbaine ; un sentiment que l’on croit percevoir au travers de l’amertume caractérisant les propos régulièrement tenus par le commissaire Llob. Désolé et fataliste face au délabrement des rues d’Alger, il nous apparaît presque haineux quand, au gré de ses enquêtes, il est soudain confronté aux beaux quartiers de la ville, à ces morceaux de paradis perdu. Ainsi, à la vision morose du quartier Haï El Moustaqbal, s’oppose par exemple le faste de certaines villas démesurément luxueuses :
« Haï
El Moustaqbal -« Cité de l’avenir »- un épouvantable ramassis de
baraques putrescentes, amoncelées pêle-mêle sur un terrain vague débordant de
rigoles pestilentielles et de misère […] n’ose même pas espérer. Ses horizons
sont maudis. Ses lendemains ont peur. On le croirait surgi d’une dépression
nerveuse. Pas un lampadaire, pas une fondrière ; rien qu’un no man’s land sinistré en étau entre la
lâcheté des uns et le lâchage des autres. »[303]
« Sur
sa fiche de paie de fonctionnaire virtuel, le gendre de monsieur Ghoul Malek a
juste de quoi se nourrir de sandwiches et s’acheter une douzaine de slips par
plan quinquennal. Pourtant sa nouvelle demeure n’a rien à envier au Club
Med : plus de trois mille mètres carrés pavoisés de lampions, de
guirlandes, de ballons obèses comme des montgolfières. […] Je reste un chouia à
admirer le palais du pistonné : un rez-de-chaussée à faire saliver un émir
du Koweit, deux étages à me faire crever plutôt deux fois qu’une. »[304]
A propos d’Hydra, où les « nababs du bled » prospèrent, il déclare encore :
« Jamais
barbe d’intégriste n’a effleuré ses mimosas, jamais odeur de poudre n’a faussé
les senteurs de sa félicité. »[305]
Il ajoute, cynique :
« La
guerre qui ravage le pays n’a pas assez de cran pour se hasarder jusqu’à leur
fief. Pour eux, c’est juste de la subversion. »[306]
Il y a là un contraste saisissant étendu à la plupart des villes maghrébines, comme le souligne J-F. Troin :
« Les
quartiers datant de la colonisation conservent toute leur importance :
immeubles surélevés, vides comblés, villas remplacées par des bâtiments à
plusieurs étages, poussée des “tours” de bureaux, déménagement des entrepôts
ont contribué à accroître leur densité. Les excroissances récentes sont d’une
très grande variété. On y reconnaît des cités de recasement ayant précédé
l’Indépendance, de grands ensembles de logements sociaux particulièrement
nombreux et massifs en Algérie […]. Plus à l’écart, mais très étendus, sont les
lotissements de villas où s’affrontent tous les volumes architecturaux, tous
les styles et tous les modes du “paraître” […], formes particulièrement
voyantes du “placement” immobilier qui n’épargne aucun des trois pays,
transgressant frontières, régimes politiques et idéologies. Enfin les zones de
bidonvilles […] étalent tous les types de bâtis depuis la pauvre baraque en
tôle ondulée jusqu’aux petites maisons de briques ou parpaings […]. »[307]
Cette forme de ségrégation sociale s’exprimant au sein de l’espace urbain, s’avère être une constante dans la plupart des romans de notre corpus : au-delà des nombreuses occurrences présentes dans les textes algériens, les « quartiers huppés de Casablanca » contrastent avec « les petits réduits où s’entassent les familles nombreuses et les taudis des bidonvilles d’où se dégagent des odeurs qui prennent à la gorge »[308]. Relevons encore, en ce qui concerne la Tunisie, cette opposition entre Gammarth, « véritable Beverley Hills de la banlieue nord aux mœurs occidentales et passablement dissolues » et Lahouache « l’intégriste, la prolétaire »[309].
Nous constatons que cette segmentation de l’espace urbain donne à voir, chez Yasmina Khadra, deux images opposées de la ville : d’une part, la blafarde martyre et, d’autre part, non plus tant « la noire » que « la rouge » maléfique.
Les tableaux de la ville moribonde abondent dans les romans de Yasmina Khadra. Ainsi, sous l’œil désabusé de l’amer commissaire Llob, la Casbah, cœur de la vieille ville, nous apparaît sous les traits d’une martyre maudite :
« Je
vois la Casbah crucifiée dans le parjure, pareille à la carcasse d’une
sauterelle que turlupinent les fourmis. »[310]
« Dépotoir
de toues les infortunes, la Casbah subit le siège de ses épopées comme une
veuve les amours d’un époux crucifié dont les enfants martyrisent la mémoire à
chaque coin de rue. »[311]
Le Maqam Ech-Chadid, monument aux martyrs érigé dans le parc de Riad el Feth, symbole de la victoire et de la libération, prend quant à lui véritablement des allures de mausolée engloutissant le reste de la ville :
« Je
vois la ville renfrognée et, au loin, le Maqam debout dans son linceul,
semblable à un fantôme revanchard venu nous botter le cul pour nous secouer un
peu. »[312]
Amer, Llob ajoute :
« C’est
ça, le Maqam : les mirages d’un peuple cocufié, les bijoux facétieux d’une
nation réduite au stade de la prédation, concubine quelquefois, séduite et
abandonnée le plus souvent. Le Maqam ? C’est cet arbre éhonté qui refoule
arbitrairement, au tréfonds des coulisses, une humanité trahie, vilipendée, une
jeunesse désenchantée, livrée au néant, au vice et aux chimères de l’utopie
[…]. Le Maqam Ech-Chadid se moque éperdument des martyrs. Son allure martiale a
l’assurance des fortunes. »[313]
A travers l’aigreur des propos du commissaire, c’est tout un pan obscur de la ville qui nous est révélé et si Alger la moribonde, la blafarde, l’impuissante, saute aux yeux, Alger la sournoise n’en demeure pas moins vivace, aiguisant les appétits et les ambitions les plus démesurés, comme le souligne cet hommage rendu par un des « pontes » de la mafia politico-financière :
« Cette
ville est à moi. J’ai toujours refusé de la voir se faner. […] Ma blanche n’est
pas une odalisque ; elle n’est pas non plus une tavarich ; elle est sultane à part entière. Elle a besoin de
faste et de fantasia. Elle a besoin d’amants et de courtisans. Elle exige que
l’on se sacrifie pour elle, que l’on ose, que l’on profane, que l’on fonce et
que l’on défonce pour elle. C’est la seule façon de la servir, la seule façon
de la mériter… Elle est une œuvre d’art. On la fait ébauche par ébauche, et
après, c’est elle qui nous fait maîtres, qui élève notre talent au rang de la
consécration. »[314]
A la fois maudite et muse maléfique, Alger se pare ainsi d’un voile sombre et délirant pour revêtir les apparats de la ville de polar telle que la définit J-N. Blanc :
« Si
la ville est devenue un cadavre de ville, si elle est devenue un lieu plus fait
pour y mourir que pour y vivre, c’est parce qu’elle est la ville d’un système
social inhumain et invivable. Inhumaine et invivable, elle l’est d’abord parce
qu’elle s’impose aux hommes comme quelque chose qui leur échappe. En tant que
métaphore du système social, elle apparaît comme un mécanisme autonome, mettant
en branle des rouages ignorant les individus et les consciences. Elle semble exister
au-dessus d’eux, et indépendamment d’eux […]. Cette ville anonyme, abstraite,
vide, et cependant efficace, ce n’est rien d’autre que l’image de la grande
mécanique sociale. Monde implacable, société anonyme, système clos. Pire
encore : comme tout y repose sur l’argent et sur les rapports de force,
cette ville-société sans pitié est injuste et brutale. Tel est son mode de
fonctionnement, sa loi et sa norme. Rien de plus normal, dans ce système, que
la corruption, la prévarication et la violence. »[315]
Nous remarquons un même type d’approche dans le roman de Boualem Sansal qui, en choisissant comme cadre principal la ville de Rouiba, symbole de l’industrialisation des villes algériennes, parfait le portrait noir de la ville de polar :
« De
nos jours, trente années après l’indépendance, elle est regardée comme le
fleuron de l’industrialisation du pays. Par décret, elle a été classée “ville
industrielle” […]. On l’a voulue impressionnante, digne du génie du Dictateur.
Elle est fébrile, morne et inquiétante comme une cité qui se prépare à la
guerre. Elle est une verrue cancéreuse sur le flanc oriental de la
capitale. »[316]
La noirceur de la ville est encore accentuée par l’ancrage de certains passages dans une perspective fantasmatique qui témoigne, comme chez Y. Khadra, d’une certaine perception névrotique du pays par quelques puissants ambitieux :
« Au
commencement était l’ivresse. Puis vint le désenchantement. On implora le ciel,
oubliant qu’il avait été nationalisé avec la terre et livré aux orties. […]
Alors, dans le secret de son cœur, on appela le Sauveur. […] A son avènement,
il prit le nom de Raïs, ce qui signifie Dictateur. Voyant que le pays était
pauvre et les jours sans éclat, il dit : qu’on me construise un pays digne
de moi et de ma descendance ! Une immense clameur résonna dans les
campagnes et les djebels. On fit des plans, on leva des armées, on donna de la
trompette. Pharaon, dans toute sa splendeur, n’avait osé voir si grand. »[317]
L’ambition pharaonique du « Raïs » donne alors naissance à la ville immonde :
« La
ville explosa dans un tonnerre de poussière. Rageusement, elle avala les jolies
fermettes qui l’environnaient, puis se rua sur les douars qui creusaient leur
trou loin des regards. »[318]
A l’image de la ville gangrenée en son sein, répond alors celle de la ville tentaculaire, déversant son fiel sur le reste du territoire par le biais d’une industrialisation et d’une urbanisation massives et désordonnées. A l’origine de la transformation de certains villages agricoles en véritables villes autonomes, cette urbanisation forcée, réalisée le plus souvent en dehors de toute cohérence et rendant impossible toute forme de cohésion entre les anciens villages agricoles et les nouvelles implantations, est à l’origine, selon A. Djellouli[319], des violences gangrenant ces régions trop rapidement transformées.
Boualem Sansal évoque précisément cette situation et décrit en ces termes ce qu’est devenue une ancienne propriété coloniale :
« Ce
domaine a disparu. La région a été urbanisée, si on peut qualifier ainsi cet
envahissement de cités poubelles, de palais surgis de cauchemars princiers, de
taudis nains, de mosquées pirates, de maisons secrètes, d’ateliers clandestins,
de commerces illicites, de décharges sauvages, de mares à pneus, de casemates
terroristes, d’écoles squattées par les déportés, de charniers à ciel ouvert,
et que sais-je encore qu’il vaut mieux ignorer. »[320]
La représentation de l’espace urbain joue donc un rôle déterminant, notamment dans les romans algériens, en ce qu’elle se fait le réceptacle de la déchéance générale du pays.
Si les romans de notre corpus choisissent la ville comme décor principal, en tant que foyer de l’infection, ils nous donnent néanmoins également un aperçu de la situation dans les profondeurs du bled. Ainsi, de retour pour quelques jours dans son village natal, Llob promène un regard désabusé sur la souffrance de l’Algérie rurale :
« Je regarde les vergers déshydratés, les mamelons chauves et les rivières fantomatiques en train de façonner leur propre déréliction. Au pied de la montagne, retranché derrière ses gourbis, Igidher se faisande au soleil, aussi impénétrable que les voies du Seigneur. Mon bled n’est plus qu’une immense douleur… »[321]
Nous retrouvons cette impression d’écrasement du paysage sous le poids du soleil, par ailleurs, chez D. Chraïbi.
En effet, bien que la dimension tragique liée à la menace terroriste ne participe pas du contexte décrit par le Marocain D. Chraïbi, la perspective de l’abandon de la zone rurale, soumise à la rudesse du climat, demeure quant à elle centrale dans son roman Une Enquête au pays. Livrés à eux-mêmes, les Aït Yafelman, paysans de l’Atlas donnent l’impression de vivre en univers clos, totalement oubliés d’une quelconque assistance de l’Etat, sans pour autant pouvoir échapper à leurs devoirs fiscaux et légaux. Au-delà de l’aspect relatif à la question terroriste, l’incursion de Llob, d’Ali et du chef Mohammed, dans les profondeurs du bled tend véritablement à souligner, voire à dénoncer, le désintéressement de l’Etat vis-à-vis de zones potentiellement exploitables, mais totalement laissées à l’abandon, notamment d’un point de vue agricole.
Notons, par ailleurs, que l’isolement du village des Aït Yafelman constitue, pour le roman, un cadre idéal à la mise en scène d’une intrigue policière, si bien que, comme dans les romans inscrits dans le cadre insulaire, Une Enquête au pays semble prétendre à une construction inspirée du modèle classique de la forme policière -en ce sens, une grotte est réaménagée en salle d’interrogatoires.
Précisons enfin que l’approche du cadre urbain proposé par le Tunisien Al Sid nous renseigne sur l’importance du rôle joué par la détermination du contexte sur le choix de la forme policière et de la variante déclinée ; sa perception de l’espace urbain se fait, en effet, particulièrement élogieuse :
« Drôle
de pays quand même que la Tunisie […]. Pas de mendiants en haillons dans les
rues, de marchands ambulants crasseux. Des rues propres. Des trottoirs bien
pavés. Des maisons blanchies à la chaux, des fenêtres en fer forgé, des jardins
plantés de citronniers et de bougainvilliers multicolores. »[322]
Inscrite de la sorte dans un cadre aussi lumineux et sain, la reprise de la variante noire du genre policier ne peut se faire que sous forme parodique, sans prise aucune sur le réel.
Soulignons que la plupart des romans maghrébins, algériens en particulier, visent un objectif totalement opposé puisqu’ils s’inscrivent largement dans une perspective urbaine réaliste, renforçant en ce sens leurs affinités avec la variante noire de la forme policière. Ainsi, la caractérisation de l’espace joue donc un rôle déterminant dans le rapport au genre policier ; une perspective grandement exploitable par les sphères littéraires qui nous intéressent et qui, parallèlement à leur singularité géo-spatiale, bénéficient en outre d’atouts culturels particulièrement propices à une profonde acclimatation du genre policier.
2- Ancrage dans la spécificité culturelle
locale
Transposé aux littératures francophones des Antilles et du Maghreb, le genre policier n’est pas seulement déplacé au sein d’espaces marqués par la spécificité d’un décor pouvant se faire, à certains égards, dépaysant ; il se voit véritablement investi par ces espaces qui n’ont dès lors plus une simple valeur ornementale, mais qui véhiculent une richesse culturelle qui, dans quelques romans de notre corpus, vient à envahir et à se saisir véritablement du cadre générique ainsi adapté. Il s’agit, pour quelques-uns des auteurs qui nous intéressent, de s’approprier le genre policier afin d’en faire le vecteur d’un discours ciblé et d’une intention littéraire bien déterminée, mais également d’adapter la fiction policière à une réalité socio-historique proprement locale, sans craindre de bouleverser quelques lieux communs et perspectives traditionnellement véhiculés par le genre.
2.1- Orientations du discours social
Ainsi que nous l’avons souligné plus haut, la plupart des romans de notre corpus ne se revendiquent pas ouvertement du roman policier classique, préférant manifester leur volonté de procéder à une véritable peinture sociale. Dans bon nombre de romans, l’introduction du cadre policier sert en effet de prétexte à l’élaboration du tableau de mœurs, parfois même aux dépens de l’intrigue ; dépassant le simple cadre de la fiction, l’investigation menée par le détective se fait alors avant tout enquête sociale, comme le postule notamment l’inspecteur Ali :
« Mon
enquête ne concerne pas seulement l’intrigue policière. Elle concerne aussi
nous autres. »[323]
Or, parmi ces « autres » évoqués par Ali, il nous semble intéressant de mettre en avant le personnage féminin, en ce qu’il constitue un point de rencontre singulier entre le genre policier et la littérature francophone du Maghreb comme des Antilles, notamment en sa qualité de « victime » d’un rapport prégnant à la stéréotypie. Soumis à la représentation machiste potentiellement constitutive tant du genre policier que d’un certain discours émanant d’une approche stéréotypée des cultures maghrébine et antillaise, le personnage féminin se révèle être ainsi déterminant au sein de notre étude.
A travers quelques textes essentiels de notre corpus, nous pourrons établir un portrait de la femme et une approche globale des pratiques sociales et culturelles selon une triple perspective : si la peinture des auteurs algériens, en particulier, se fait sombre, dans un souci de réalisme et sans guère laisser de traces des traditionnels relents « exotisants » prônant, entre autres, la sensualité de la femme orientale, l’approche des créolistes dont relèvent P. Chamoiseau, R. Confiant ou E. Pépin se propose de se positionner elle aussi en porte-à-faux vis-à-vis de certains clichés occidentaux, mais selon une perspective beaucoup plus enthousiaste, colorée et valorisante. Face à cette forme de bipolarisation, censée contrecarrer l’imagerie occidentale traditionnelle, sans toutefois pouvoir éviter une autre forme de caractérisation de l’approche culturelle locale, émerge une troisième perspective, à l’initiative notamment de Maryse Condé et Driss Chraïbi, qui valorisent la caractérisation humaine aux dépens de toute forme de régionalisme, soit par le biais d’un approfondissement d’ordre psychologique, soit par diversion et dérision.
2.1.1- Assombrissement du tableau :
perspective réaliste
Revendiquant ouvertement leur caractère parodique, les romans policiers tunisiens de notre corpus, et notamment ceux du Tunisien Al Sid, reflètent largement la double perspective stéréotypée de la femme, à la fois personnage de polar et représentante de la société musulmane traditionnelle. Oscillant entre la blonde décolorée en quête de pension alimentaire ou la jeune secrétaire dynamique, peu farouche et entièrement dévouée à son Privé de patron, et la bonne épouse, musulmane, douce et soumise, mais capable de mener son époux à sa guise sans toutefois déroger aux convenances, la femme tunisienne telle qu’elle nous apparaît dans ces romans se révèle être particulièrement adaptée à l’univers policier : entre la femme libérée -ce qui, dans ces romans, signifie délurée- et la naïve bourgeoise, elle ne laisse que peu de chances à la nuance.
Cette sur-caractérisation du personnage féminin n’est pas le seul fait d’Al Sid et participe en fait de bon nombre de romans, comme ceux de Y. Khadra ou encore de B. Sansal, où elle s’exprime néanmoins dans une toute autre configuration. Il s’agit dans ces romans et selon une approche beaucoup plus sérieuse et approfondie que celle choisie par Al Sid, de rendre compte, à travers des portraits souvent caractérisés à l’extrême, de la rudesse de la condition féminine dans l’Algérie en crise.
Parmi les personnages féminins mis en scène dans les romans de Yasmina Khadra, intéressons-nous tout d’abord à la première d’entre elles, bien que la plus discrète au sein du texte : Mina, l’épouse du commissaire Llob. N’occupant que quelques lignes de chaque roman, Mina nous est présentée, d’une part, à travers le regard de Llob, comme la mère de ses enfants, une femme lettrée, douce, belle et attentionnée ; et, d’autre part, dans le cadre de l’Algérie contemporaine où elle n’est dès lors plus que l’ombre d’elle-même, terrorisée, défraîchie et amère. Dans le premier volet de la série, le portrait dépeint par Llob se fait ainsi flatteur, béat, teinté d’une certaine naïveté amoureuse :
« Ma
Mina, il n’y en a pas deux comme elle dans tout le quartier. Elle sait lire et
écrire. Elle sait être belle, rien que pour moi. Elle sait tenir une
conversation mondaine. Mais elle a choisi d’élever ses gosses et de chérir son
ours mal léché de mari avec un sens aigu de l’abnégation. Beaucoup de ses
voisines émancipées s’étonnent de la voir flétrir stoïquement dans un taudis
comme le mien, elle qu’elles trouvent jolie comme une boucle de soleil, elle
qu’elles disent instruite et présentable, elle qu’elles voient détrôner
l’actuelle patronne de l’UNFA sans coup férir…Ma modeste Mina à moi, elle leur
rétorque qu’elle n’a qu’une seule ambition : être bien avec Dieu et avec
son héros de mari qui la tient en laisse depuis vingt-huit ans, qui ne sait pas
lui gazouiller des vers, qui ne sais pas lui offrir des bijoux, pas même des
fleurs pour son anniversaire, qui ne lui paie pas des voyages pour les centres
commerciaux d’outre-mer, qui grogne quand elle lui demande l’autorisation
d’aller rendre visite à ses parents qui languissent d’elle à deux pâtés de
maisons seulement, qui n’apprendra jamais à laisser ses prises de bec avec son
patron au commissariat, qui rentre chaque soir le cœur gonflé de dépit, l’œil
brasillant d’animosité, la tête crépitante d’invectives retardataires, qui
abhorre les pique-niques, la plage, la foire et le manège, qui ne vit pas
vraiment, qui ne fait qu’exister un peu comme ces ornières sur les chemins de
traverse que les ondées de l’hiver et du déplaisir effacent dédaigneusement,
qui n’a pas plus de look qu’une botte de foin… et qu’elle aime quand même d’un
amour débridé. »[324]
Ce portrait étiré et particulièrement significatif fait ou, plus précisément, veut faire de Mina un être totalement à part : isolée syntaxiquement des autres femmes (par la construction « elle qu’elles » répétée à trois reprises), elle est dotée d’atouts présentés comme essentiels qui en font un modèle : elle sait lire, écrire ; elle est belle et peut tenir une conversation mondaine. Or, Mina a décidé de ne pas en jouir et de s’offrir au rôle traditionnel de mère et d’épouse, privilégiant ses instincts naturels aux dépens de ses atouts culturels. Ce « choix » soulève une certaine ambiguïté en ce que Mina semble jouir d’un statut ambivalent, à mi-chemin entre liberté et soumission : liberté conférée par ses nombreux atouts et par l’admiration que lui voue son mari, et soumission attestée non seulement par l’usage de l’adjectif possessif « ma », accolé à son prénom, pouvant aussi bien relever d’une tournure affective que de la dépossession, mais également par le recours à différentes expressions significatives, telles « son héros de mari qui la tient en laisse » ou « elle lui demande l’autorisation ». Précisons enfin que ce portrait censé décrire Mina est entièrement régi par la personne du commissaire Llob, sujet de la série de propositions relatives et point de référence de la description. Le statut de Mina vis-à-vis de l’autorité de son époux demeure, en ce sens, quelque peu ambigu et il l’est d’autant plus, quelques pages plus loin, lorsque Llob lâche finalement : « Des fois, je me demande si j’ai bien agi en t’interdisant de travailler »[325].
Aussi, ce portrait, écrit par certains aspects à la manière des Caractères de La Bruyère, se révèle à double tranchant : vantant les mérites de Mina -qui, outre la lecture et l’écriture, ne dépassent guère le simple cadre de la parfaite épouse-, il vise en fait à décrire le « Musulman type », mais sur un ton qui se veut, par-delà l’amertume, quelque peu enfantin, naïf, voire teinté de sensiblerie et par là même peu crédible. C’est ainsi qu’après avoir brossé un portrait si élogieux de sa brave épouse, Llob ne peut retenir un « Bonne nuit, chérie », suivi de « Fais de beaux rêves mon adorée », ce qui ne manque pas d’interpeller Mina qui « sursaute, croit avoir mal entendu », avant de s’exclamer : « Sûr que tu n’es pas normal, ce soir, toi ! ». C’est assurément là une manière pour Y. Khadra de brouiller les pistes, de rester en demi-teinte, d’éviter les désignations trop simplistes et schématiques, et cela, d’autant plus que la société algérienne dans son ensemble souffre de la complexité de nombreux dysfonctionnements.
Confrontée à la peur face au terrorisme, la bonne épouse se désagrège progressivement si bien qu’au fil des aventures, Mina offre une image décrépie :
« Aujourd’hui,
ma pauvre bête de somme a régressé comme les mentalités. Elle n’a pas plus
d’attrait qu’une remorque couchée en travers de la chaussée. »[326]
N’intervenant plus que sous forme de regards désespérés, Mina finit par disparaître en se réfugiant chez un cousin, loin de la cible que représente son époux. A la douceur, la sensualité et la dévotion succède alors la noirceur se voulant représentative de la condition féminine algérienne dans son ensemble ; en témoignent les autres portraits de femmes brossés par l’écrivain algérien, à côté desquels la Mina du premier volet de la série prend des allures quasiment mythiques.
Prostituées, jeunes délurées occidentalisées, secrétaires à la « crinière flamboyante », dotées d’attributs remarquables (« bouche pluridisciplinaire et […] poitrine vachement émancipée »[327]), épouses en mal d’amour (« Je devine Mme Athmane sur son balcon, une entaille à la place de la bouche et les orbites chargées de lave incandescente »[328]) ou encore danseuses de cabaret, les figures féminines, témoins de la déchéance urbaine, ne manquent pas dans les romans de Y. Khadra.
Cette perspective est également sensible dans les romans d’un autre auteur algérien, B. Sansal, comme en attestent certains passages très sombres :
« Passé
les jours de miel, viendront les temps de l’amertume ; puis ceux de la
désagrégation et de la violence. Les épouses, rabaissées au rang de
paillassons, en pâtiront. Elles feront des mioches et bande à part avec eux et,
peu à peu, coincées entre la soumission et la révolte, elles se feront une
raison : elles cesseront d’exister. Etrange destin qui promet tant et fait
si vite le contraire. Avec les gosses qui leur arrivent comme les jours se
suivent, nos femmes ont autant de raisons de tenir à la vie que d’en appeler à
la mort. »[329]
Face à une jeune mariée, le regard se fait non moins acéré :
« Un
homme l’a épousée ; youpi ! elle n’a plus rien à prouver sur son état
de santé physique et mentale, sa virginité, ses qualités morales, la réputation
de sa famille ; il était temps. […] Finis les chuchotements derrière
les portes, les regards des marieuses si pénétrants […], les menaces de mort du
benjamin […] ; finis les histoires de lapidation de l’oncle imam, les
cadeaux corrompus de l’épicier de l’immeuble, les attaques fulgurantes des
hittistes du quartier, les mises en garde des vieilles filles dont
l’ambivalence est source de troubles tenaces, les ruminations infernales des
répudiées qui, ô paradoxe du sexe maudit, cultivent le goût du martyre chez les
jouvencelles […]. »[330]
Mêlant amertume, incompréhension et colère, ce tableau s’étend sur plusieurs pages pour s’achever sur cette conclusion de Larbi :
« Les
islamistes jurent de lutter jusqu’à la mort pour la libérer de la modernité et
parlent de la rattacher à la plus vieille coutume qui soit. Les modernistes
clament avec une solennité vieux jeu de lui restituer, une fois le calme revenu
en la demeure, des droits qu’elle n’a jamais eus. […] Certains soirs, quand il
l’avait à plat, Larbi se flattait de n’avoir fait que du mâle. »[331]
Totalement et irrémédiablement prisonnières de leur condition, les femmes mises en scène par B. Sansal n’ont, de ce fait, pas accès à la parole. Y. Khadra, affiche, quant à lui, une position plus nuancée. Ainsi, il laisse percer deux personnages féminins parmi la foule : Jo, la prostituée mise en scène dans Double Blanc et Malika, une journaliste rencontrée par Llob dans un café, dans L’Automne des chimères.
Avant de pratiquer « le plus vieux métier du monde à l’iranienne : elle porte le tchador, et rien en dessous, c’est pratique et ça préserve du mauvais œil »[332] et de jouer les « indics » occasionnels pour le commissaire Llob, Jo a d’abord été Joher, « la dame impeccable, la coiffure sévère et les lunettes carrées »[333] rêvant d’une grande carrière, riche de ses bagages universitaires, jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à ce que Llob présente comme une fatalité :
« Dans
une société phallocentrique, le seul critère promotionnel qu’on lui proposait
était le canapé. A la longue, elle a fini par lever les jambes en l’air -ce qui
équivaut chez le mâle à lever les mains par-dessus la tête. Tout de suite ça a
été la queue leu leu ; du directeur au chef de service, et du comptable au
planton. La demande devenant de plus en plus importante, Joher a été contrainte
de passer des bouchées doubles au cycle à trois pistons, frôlant des fois
l’overdose. Avachie, déchue, elle fut congédiée et livrée aux ressacs des
trottoirs où la police lui faisait des misères inimaginables. Puis, un soir,
pour les besoins d’un traquenard, elle a accepté de jouer la chèvre pour
moi. »[334]
Tandis que l’agencement fluide des phrases révèle la logique des étapes de la déchéance de Jo, la simplicité teintée d’humour de certaines illustrations visuelles (jambes en l’air, mains par-dessus la tête, queue leu leu) donne à l’ensemble un air de pantomime d’autant mieux perçu que le récit livré par Llob est placé sous le sceau de l’humour ; l’histoire de Jo n’en demeure pas moins tragique, exprimant en outre un fatalisme certain à l’égard de ce qui est présenté comme étant le drame vécu chaque jour par la femme algérienne. Ce fatalisme, cette forme de résolution au malheur, apparaît comme une constante en ce qui concerne le personnage féminin tel que le représente Y. Khadra qui met encore en scène Malika, personnage de L’Automne des chimères victime de ce qui est alors présenté comme autre « fatalité » : le terrorisme.
Ainsi, c’est sous les traits d’un « visage meurtri », « joues creusées au burin », « bouche qui ne doit pas rire souvent », « bouffées de détresse giclant par ses pores »[335], que Llob retrouve cette ancienne journaliste avec qui il a autrefois travaillé sur quelques affaires de « chasse aux sorcières et aux réactionnaires »[336] et qui hante désormais les endroits publics en quête de dialogue :
« La
maladie me chiffonne (elle tape du doigt sur sa tête). Deux dépressions, deux
années au pavillon des bêtes foraines. Je me foutais à poil dans la rue. Ça à
été dur, très dur… J’ai perdu mon mari dans un attentat et une bonne partie de
ma raison dans l’Association des victimes du terrorisme où je milite
encore. »[337]
Le passage laisse peu de doutes quant à la fragilité mentale de cette femme, tant victime du terrorisme que des structures de soutien mises en place par la collectivité, ce dont le commissaire Llob fait, par ailleurs, les frais : l’aide qu’il propose à Malika, dans l’espoir de la réconforter, bouleverse la jeune femme transformée par la folie en « loque échevelée, la bouche écumante et les yeux révulsés »[338], qui s’enfuit en l’insultant.
Victime d’une société machiste et extrémiste -tant dans son modernisme que dans son traditionalisme- la femme, telle que décrite dans les romans de B. Sansal et Y. Khadra, semble totalement dévorée par la société algérienne.
« Volontairement poussé au noir »[339], le roman de R. Mimouni propose logiquement une version tout aussi sombre de la femme, si ce n’est plus encore :
« Chez
nous, une femme n’a qu’un statut : celui d’épouse. Hors cela, point de
salut pour elle. Etudes, métier ne sont que passe-temps, moyens de patienter.
Il n’y a de respectable que la femme mariée. »[340]
Au-delà de ce « statut » traditionnel, tragiquement incarné, par ailleurs, par la mère de Tombéza, bannie après avoir été violée, les portraits de femmes se multiplient dans le roman de R. Mimouni. Ils oscillent, en fait, entre différentes figures marquantes : de la vieille paysanne, seule, sans ressources, ayant offert sa vie et son corps au travail, à la serveuse de tripots reconvertie en femme de ménage hargneuse, en souvenir d’une enfance difficile ; de la jeune épouse ambitieuse et sans scrupules, à la jeune juge idéaliste cédant, la mort dans l’âme, aux trafics d’influence ; de l’infirmière philanthrope à l’infirmière misanthrope ; de Désirée, la fille aînée du colon Biget, « une sylphide égarée dans la campagne »[341] à sa sœur cadette, capricieuse et sournoise, obtenant de Tombéza, par chantage, qu’il lui montre son sexe ; ou encore de la femme du commissaire Batoul « qui n’ouvre la bouche que pour […] dire qu’elle est à court d’huile, de sucre, de café, de patates ou de lait en poudre pour son dernier-né… Si obéissante qu’il ne lui viendrait jamais à l’idée de critiquer [s]on comportement »[342], à la douce Malika, épouse aimée et respectée de Tombéza, tantôt comparée à un « jeune moineau recroquevillé sur sa blessure »[343], tantôt à un « oiseau pépiant sur sa branche »[344].
On remarque ici que, plus présentes que dans les romans de ses compatriotes, les femmes mises en scènes par R. Mimouni ne se limitent pas aux rôles de victimes et participent à certaines « dérives » comportementales, tant par goût de la méchanceté (Louisa) que comme moyen de défense (Amria) ; si bien que c’est Tombéza lui-même, l’être immonde et détesté, que l’on croit retrouver à travers ces différents portraits.
Résolument noirs et désespérés, ces portraits de femmes traduisent la tonalité recherchée par ces trois auteurs algériens, soucieux de rendre compte de la situation tragique de la femme algérienne, selon une double orientation : il s’agit, d’une certaine manière, de dénoncer les excès de la société musulmane traditionaliste et conservatrice, tout en s’attaquant, par ailleurs, aux travers d’un modernisme alimenté essentiellement par une occidentalisation outrancière des mœurs. Il s’agit pour ces auteurs de contrecarrer, volontairement ou non, toute perspective « exotisante » de la femme orientale vue par les Occidentaux -l’image de la femme soumise ayant, médiatisation de la condition féminine oblige, supplanté celle, passée, de la sensualité- tout en renvoyant à ces mêmes Occidentaux une perception caricaturée de leurs propres agissements. Le commissaire Llob se fait en ce sens particulièrement virulent, à la limite du discours réactionnaire :
« Il
y a cette secte constipée qu’on appelle Tchi-tchi et qui croit dur comme fer
que le seul moyen d’être de son temps est d’imiter les ringards décadents de
l’Occident. Et ça roule des épaules. Et ça déporte les lèvres sur le côté quand
ça patatipatatasse. Et ça se serre le croupion dans des jeans étriqués. Et ça cause
français sans accent et avec des manières de pédale. Ecoeurant ! »[345]
Llob déplore encore la popularité du Raï, envahissant les « neight-kleb » après validation du public français :
« De
la véranda, nous parvient une musique bâtarde. Quelqu’un est en train d’aboyer
dans un haut-parleur qu’il a fait l’amour dans une baraque mal foutue. Ça
s’appelle le Raï, ou la confession paillarde d’une génération châtrée. Les
Français disent qu’il s’agit là de l’expression majeure de la culture
algérienne ; et les nôtres se pâment de fierté. Des voyous défilent à la
télé […] pendant que les Souheib Dib, Bouzar, les détenteurs de toutes les
vertus, s’enlisent dans la pénombre inconfortable de l’indifférence et de
l’ostracisme. »[346]
Par le biais de la représentation féminine, l’objectif des écrivains algériens de notre corpus nous apparaît de manière précise en ce qu’ils tentent de s’engager dans une perspective réaliste tendant au pessimisme et à la noirceur et rendant compte ainsi des dysfonctionnements d’une société prise entre traditionalisme et modernisme. Cette perspective est également de mise dans quelques-uns des romans marocains de notre corpus soucieux de témoigner d’une certaine réalité sociale : le roman de Rida Lamrini, par exemple, insiste également sur l’occidentalisation des mœurs, en brossant notamment un portrait sévère des riches épouses, adeptes des parfums parisiens et des grands couturiers, vaniteuses et sans scrupules.
Si le personnage féminin occupe un rôle secondaire et superficiel dans la plupart des fictions policières de forme classique, il se révèle, à l’inverse, déterminant dans la majeure partie des romans qui nous intéressent, en ce qu’il se fait véritablement le réceptacle de l’état, du mode de fonctionnement et des orientations de la société dans son ensemble. La femme occupe dès lors une place significative au sein de la société musulmane contemporaine, tout en pouvant susciter, notamment chez le lecteur occidental, une forme de compassion, de sensibilisation profonde au tragique de la situation.
Ce type d’orientation paraît également sensible au sein de l’univers antillais où le personnage féminin se fait non plus le témoin d’une situation tragique, mais bien le vecteur d’une perception édulcorée de la société, le fantasme supplantant alors la compassion.
2.1.2- Mise en valeur d’une contre-culture :
perspective fantasmée
Si par souci de réalisme et dans la perspective de dire l’horreur vécue par la société algérienne, les auteurs algériens proposent des tableaux sombres, amers, voire désespérés et contrastant avec une certaine imagerie fantasmatique occidentale, la perspective amorcée par les écrivains de la créolité semble relever d’une toute autre ambition. En d’autres termes, si le réalisme semble primer dans la littérature algérienne, c’est bien l’expression du désir de contrecarrer une certaine imagerie occidentale qui est en revanche la principale source de motivation des créolistes.
Avant même de prétendre décrire leur société de manière réaliste, il s’agit, pour ces derniers, de « réhabiter le monde », de réinvestir l’espace exotique par des images, des langages, des sentiments et une imagination qui se revendiquent créoles, comme l’indique ce passage extrait d’Eloge de la créolité :
« Notre situation a été de porter un regard extérieur sur la réalité de nous-mêmes refusée plus ou moins consciemment. En littérature, mais aussi dans les autres formes de l’expression artistique, nos manière de rire, de chanter, de marcher, de vivre la mort, de juger la vie, de penser la déveine, d’aimer et de parler de l’amour, ne furent que mal examinées. Notre imaginaire fut oublié, laissant ce grand désert où la fée Carabosse assécha Manman Dlo. Notre richesse bilingue refusée se maintint en douleur diglossique. Certaines de nos traditions disparurent sans que personne ne les interroge en vue de s’en enrichir, et, même nationalistes, progressistes, indépendantistes, nous tentâmes de mendier l’Universel de la manière la plus incolore et inodore possible, c’est-à-dire dans le refus du fondement même de notre être, fondement qu’aujourd’hui, avec toute la solennité possible, nous déclarons être le vecteur esthétique majeur de la connaissance de nous-mêmes et du monde : la Créolité. » [347]
Il y a ré-appropriation identitaire, chez P. Chamoiseau et R. Confiant, et elle se manifeste par la mise en scène de personnages incontestablement hauts en couleur, de par une multiple caractérisation : « appartenance ethnique », distinction physique, singularité de l’usage linguistique, activité culturelle, situation matrimoniale, pour ne citer que les traits les plus essentiels.
Dans Solibo Magnifique, Le Meurtre du Samedi-Gloria et Brin d’amour, le réinvestissement du regard porté sur la culture créole s’exprime de diverses manières. Ainsi, d’un point de vue « ethnique », il ne s’agit plus, pour eux, d’opposer simplement Noir et Blanc, mais de mettre en évidence « multiculturalité » et « pluricolorité », en peuplant leurs textes de chabines, chabines tiquetées, chabines dorées, chabins rouges, câpresses, nègres, négresses bleues, négrillons, mulâtresses, coulis, etc. Il s’agit-là d’une désignation « ethnique » qui engage une perception poétique, voire fantasmatique, supplantant d’une certaine manière toute forme de caractérisation sociale -puisqu’en tout état de cause, la plupart des personnages sont issus du petit peuple- et qui s’accompagne, la plupart du temps, de différentes particularités physiques. Là encore, P. Chamoiseau et R. Confiant s’adonnent à une vision fantasmée du corps, se répandant en descriptions largement consacrées à ses parties les plus suggestives (fesses, seins, sexe), comme le souligne R. Burton, à propos de Raphaël Confiant :
« Si
l’imagination confiantesque est attirée par les protubérances, elle l’est
encore plus par les fentes : aucun auteur ou marqueur de paroles
antillais, en effet, qui n’ait chanté avec autant d’ardeur et de lyrisme la
poésie de la coucoune. »[348]
Ce procédé d’érotisation de la représentation du corps se veut probablement aussi provocateur que poétique, et relève manifestement des techniques utilisées, par le conteur, au temps de la colonisation ; c’est, en tout état de cause, ce que suggère P. Chamoiseau en évoquant la fonction salvatrice du rire pratiqué par le conteur :
« Le
conteur créole a utilisé le rire, l’ironie, la moquerie, la dérision -enfin
tout l’effort de la distanciation moqueuse- de manière exemplaire, et je ne
peux que m’inscrire là-dedans. […] C’est très utile dans ma manière de regarder
les choses. Un peu d’ironie, un peu de distance, un peu de moquerie, le rire
défait l’ordonnance du réel. Le rire défait les cadres, les murs, les lignes
habituelles. Ce qu’on respecte, ce qu’on crée, ce qu’on vénère, ce qui nous
paraît juste, tout ça est ébranlé par le rire. »[349]
A partir de ce principe, apparaît non seulement une série de portraits moqueurs entre tafiateurs, kokeurs, et autres zoukeurs, censée contrecarrer toute une imagerie raciste développée de manière fantasmatique autour de certains thèmes « porteurs », tels le rhum, la sexualité, la musique, mais également une forme de typologie de la femme qui n’échappe pas à la catégorisation en oscillant variablement -en fonction des besoins- entre doudous, maquerelles, bondieuseuses, femmes-poteau-mitan ou à graines, prostituées, chabines prétentieuses en quête de bons partis et affublées de la marâtre veillant au grain. Ces multiples désignations prétendent, semble-t-il, mettre en valeur une certaine vitalité féminine antillaise qui, si elle repose sur un fond de réalisme, est largement exploitée et accentuée. Il s’agit, pour les créolistes, d’assurer l’enracinement de l’écrit dans une culture locale vivace, malgré l’usure de certaines de ses composantes. Il n’y a rien d’étonnant alors à ce que la doudou mise en scène par P. Chamoiseau dans Solibo Magnifique, sous les traits de Doudou-Ménar, n’ait de « doudouiste » que le nom, notamment si l’on se réfère à cette définition proposée par Régis Antoine :
« Le personnage de la doudou, ou chérie, édulcorait les problèmes raciaux ou sociaux, mettant en avant la tendresse de l’Antillaise comme représentative des îles, associée à une célèbre rengaine sentimentalement et politiquement aliénante : “Adieu foulards adieu madras”. »[350]
Principale opposante aux forces de police, Doudou-Ménar surnommée « la Sauvage », « la Redoutable», et qui, face à la menace, se jette corps et âme dans la bataille, armée de seins « plus destructeurs que des sacs de graviers »[351], tient un rôle diamétralement opposé à cette définition. Dans l’imaginaire de P. Chamoiseau, la doudou docile devient en effet une véritable « majorine »[352], conforme, en quelque sorte, à l’image de la femme virile telle que la conçoit l’auteur :
« Je
sais qu’il y a des critiques américains qui m’ont accusé d’être machiste, mais
la réalité sociologique de la Martinique, c’est que les femmes sont très
présentes, et ce sont de fortes femmes. Ma mère, c’est une femme d’une autorité
incroyable, puissante, qui régentait le monde, qui se battait contre la misère.
Cette femme-là, c’est pas une femme européenne […]. C’est une femme-à-graines,
une femme virile, et toutes les femmes antillaises sont comme ça. »[353]
Ernest Pépin choisit également d’illustrer, dans un registre néanmoins différent, cette vigueur féminine : à la puissance physique déployée par la Sauvage, répond ainsi, dans le roman du Guadeloupéen, une forme de résistance psychologique. Loin de les accabler, le spectre de l’homme-au-bâton va ainsi constituer, pour les femmes, un moyen de pression et de vengeance sur les nombreux hommes les ayant abusées, trompées, bafouées. Il s’agit donc, pour E. Pépin, d’inscrire les femmes au cœur d’une « culture oppositionnelle »[354], au sein d’une histoire qui se veut le contrepoint d’années de soumission à une conception machiste des rapports humains :
« Dans
L’homme-au-bâton […], en fait il s’agit de la femme. Pourquoi ? Parce que
ce sont les femmes qui sont les victimes supposées ou réelles de l’homme au
bâton. Ce sont elles qui vont subir cette situation et ce sont elles qui vont
aussi réagir. Par une sorte de retournement (et cela s’est réellement produit
en Guadeloupe à l’époque de l’homme au bâton), elle vont utiliser l’homme au
bâton à travers ce mythe pour régler des comptes envers une société
profondément machiste à l’époque des faits. »[355]
Or, cette volonté de renverser la situation (pour E. Pépin), de redéfinir des référents à la fois raciaux et culturels (pour P. Chamoiseau et R. Confiant notamment) va logiquement de pair avec une volonté de réajuster certains piliers de la culture créole dans l’inconscient collectif et, dans la perspective de l’esthétique de la créolité, avec la valorisation de toute une culture présentée comme étant celle, fondamentale, du petit peuple, conformément au projet développé dans l’Eloge de la créolité :
« La
littérature créole à laquelle nous travaillons pose comme principe qu’il
n’existe rien dans notre monde qui soit petit, pauvre, inutile, vulgaire,
inapte à enrichir un projet littéraire. Nous
faisons corps avec notre monde. Nous voulons, en vraie créolité, y nommer
chaque chose et dire qu’elle est belle. Voir la grandeur humaine des djobeurs. Saisir l’épaisseur de la vie
du Morne Pichevin. Comprendre les marchés aux légumes. Elucider le
fonctionnement des conteurs. Réadmettre sans jugement nos “dorlis”, nos “zombis”, nos “chouval-twa-pat”, “soukliyan”. Prendre langue avec nos bourgs, nos villes. »[356]
C’est ainsi qu’à travers les textes de R. Confiant et P. Chamoiseau, le lecteur découvre -quand il s’agit d’un lecteur métropolitain- et revisite -en ce qui concerne le lecteur local- différentes pratiques censées illustrer la richesse de la culture créole à laquelle participent tant les contes, veillées, combats de coqs, de damier, vidés de carnaval, que certains rituels tels ceux du kalieur, du traditionnel punch occupant une fonction singulière selon le moment et le rang de la prise, ou encore de la préparation et de la dégustation de certains repas et mets culinaires particuliers. Cependant, ces pratiques culturelles sont mises en avant par les créolistes de manière si prégnante que, dans ces romans, toute action, toute parole, toute référence culturelle ne se manifeste que dans une logique de valorisation de l’identité créole telle qu’elle est conçue par les créolistes. Cette logique, par définition, se heurte à toute forme d’aspiration, de représentation strictement réaliste. Il est ainsi question, dans certains propos tenus par les fondateurs de l’esthétique de la créolité, de « chercher nos vérités »[357] -l’adjectif possessif induisant la subjectivité du propos-, de rendre compte d’un « miroitement entre l’imaginaire et le réel, entre le merveilleux et le réaliste, entre le poétique et le prosaïque »[358], ou encore de pratiquer le « rêver-pays »[359] :
« Il ne s’agit point de décrire ces réalités sous le mode ethnographique, ni de pratiquer le recensement des pratiques créoles à la manière des Régionalistes et des Indigénistes haïtiens, mais bien de montrer ce qui, au travers d’elles, témoigne à la fois de la Créolité et de l’humaine condition. »[360]
Mettre en avant la spécificité de la culture créole tout en « témoign[ant] de l’humaine condition » n’est évidemment pas l’objectif des seuls créolistes. Il est intéressant, à cet égard, de considérer la manière de procéder d’un autre Martiniquais, Tony Delsham.
Si T. Delsham, assumant parfaitement le caractère populaire du genre policier -qu’il choisit, de surcroît, de décliner sous la forme de la « comédie policière »-, se laisse aller au stéréotype en mettant en scène un policier surnommé « l’Antillais », aussi doué en matière de sexe que de sports de combat, il évite néanmoins d’étendre l’exercice à la description de la société créole dans son ensemble. Limitée à son personnage principal et légitimée, d’une certaine manière, par le cadre policier, la perspective fantasmatique n’intervient que minoritairement dans son roman qui, s’il témoigne d’une certaine vitalité imaginative en ce qui concerne le scénario, ne s’éloigne guère de la démarche réaliste, traditionnellement de mise dans l’écriture du journaliste qu’il est par ailleurs.
Tout en étant
soucieux de rendre compte de la réalité martiniquaise, Tony Delsham et Patrick
Chamoiseau, collaborateurs et amis, s’inscrivent ainsi dans des perspectives
essentiellement divergentes. A travers ses romans, T.
Delsham souhaite, en effet, « capter l’atmosphère martiniquaise, la saveur
martiniquaise, à la fois dans la forme et dans le fond, traduire tout cela par
des mots et par des phrases accessibles au plus grand nombre »[361]. Il prétend encore « partir à la reconquête d’une
image niée », c’est-à-dire reconstruire un miroir jugé brisé ; miroir
indispensable à la société martiniquaise afin qu’elle puisse exister et se
reconnaître dans sa propre littérature. C’est ainsi que chacun de ses romans
s’avère être sous-tendu par une certaine profondeur, une certaine finesse, dans
l’analyse psychologique. Il s’agit de dire au peuple « je nous regarde de
l’intérieur et voilà ce que cet intérieur provoque en moi ». En outre,
s’il se reconnaît écrivain populaire, il ne se proclame pas défenseur du
peuple : « je suis peuple, je ne parle pas au nom du peuple ».
Son écriture se veut profondément enracinée en terre martiniquaise et n’aspire
à s’étendre à l’extérieur qu’après s’être nourrie de l’intérieur,
T. Delsham affirmant rejeter toute forme d’aliénation, prenant ses
distances par rapport à la domination française tout en ne tenant pas de
discours haineux à l’égard d’une des composantes de sa personnalité. Ainsi, le
caractère composite de Pierre Corneille, héros de Panique aux Antilles, reflète cette perspective. Pierre Corneille
est certes un être extraordinaire dans son rôle d’enquêteur, d’aventurier, de
justicier, mais ses qualités humaines, son vécu, son métissage culturel font de
lui avant tout un Antillais en qui le lectorat local peut se reconnaître avec,
de surcroît, une certaine fierté.
Comme le laisse entendre le discours créoliste, P.
Chamoiseau semble lui aussi prétendre décrire la société martiniquaise de
l’intérieur ; une ambition dont relève, notamment, la mise en scène du
« marqueur de paroles », autrement dit de P. Chamoiseau
lui-même, au sein du texte. La distance est néanmoins sensible entre ce
personnage chargé de retranscrire les paroles et sentiments des exclus du
système, des représentants de tout un pan de la société traditionnelle
martiniquaise, et ceux qu’il prétend représenter. Cette distance se ressent,
par ailleurs, dans les réticences du lectorat antillais à l’égard de ses romans
et de son écriture qui se veut inscrite dans la réalité de la créolité du
peuple martiniquais, mais qui, du fait même de cette orientation, s’inscrit en
marge de la réalité : la complexité de sa perception du peuple et le
travail de création effectué sur la langue font de P. Chamoiseau non pas
un observateur de l’intérieur, mais un créateur d’une réalité conceptualisée.
Il n’est pas un porte-parole du peuple, il se veut son chantre : il
poétise le discours de ses personnages, il en fait des symboles. Alors que
T. Delsham, riche de sa formation journalistique, prétend informer,
décrire le quotidien, P. Chamoiseau semble vouloir dire au monde ce qu’est
le peuple martiniquais et veiller à ce que ce dernier s’engage dans la voie de
la créolité, porté par son chantre, le « marqueur de paroles »,
retrouvant là, d’une certaine manière, sa sensibilité d’éducateur.
Ainsi, tandis que T. Delsham prétend offrir à la société
martiniquaise un miroir lui renvoyant son reflet, c’est un portrait de cette
même société que P. Chamoiseau semble proposer au monde. Il déclare en ce
sens :
« Dans un pays comme la Martinique, qui subit des dominations
silencieuses, il faut déchirer le réel.
C’est comme une toile d’un tableau qui est devant nous, et qu’il faut déchirer
pour voir ce qu’il y a derrière. Mais si on déchire tout le tableau, les gens
ont l’impression qu’on fait de la fiction et qu’on invente des histoires. Par
contre, si on déchire un petit bout du réel pour laisser entr’apercevoir ce
qu’il y a derrière, un petit bout du ciel, et que ça se mélange avec le reste
du tableau, et que l’on ne sait plus le réel ou l’irréel, je crois qu’à ce
moment-là on fait une œuvre de déshallucination. De déshallucination,
c’est-à-dire que, par l’hallucination entre le réel et l’irréel, on met en
doute le réel, on déplace le positionnement du réel pour le situer dans une
perspective qui permet de reconsidérer le réel autrement. La finalité, c’est de
faire en sorte que nous puissions nous regarder autrement nous-mêmes. »[362]
Si une telle position paraît tout à fait concevable dans l’absolu, elle se heurte néanmoins à quelques limites et contradictions. Ainsi, le recours au fantasme ou au « rêver-pays » ne peut s’accompagner, sans que cela prête à confusion, de certains objectifs affichés dans l’Eloge, prônant une démarche visant à « entrer dans la minutieuse exploration de nous-mêmes »[363], à « surprendre le vrai »[364] et, plus globalement, à partir en quête de l’authenticité créole. Si vérité et authenticité peuvent effectivement surgir du fantasme, de l’imaginaire et de la déformation du réel, cette démarche implique une certaine prise de précautions préalable vis-à-vis du public, ce que le caractère provocateur et vindicatif du manifeste de la créolité ne semble pouvoir permettre. Il nous paraît évident, en effet, que l’interaction du discours des créolistes et de la mise en texte de leur esthétique est propice à la confusion. Face au dépaysement inévitablement suscité par la créolisation de la langue et le pittoresque[365] de certains tableaux, l’on ne sera pas surpris, en effet, que les romans de la créolité soient susceptibles de combler des horizons d’attente métropolitains -rappelons que les œuvres de P. Chamoiseau et R. Confiant sont publiées respectivement chez Gallimard et Mercure de France- déjà sensibilisés aux représentations exotiques. Autrement dit, si les créolistes s’efforcent de renverser les traditionnels stéréotypes exotisants métropolitains, c’est pour leur en substituer de nouveaux, en une conception « ségalenienne » de la « saveur du Divers »[366]. Les créolistes se font alors eux-mêmes exotes de leur propre espace :
« L’exote,
du creux de sa motte de terre patriarcale, appelle, désire, subodore des
au-delà. Mais, habitant ces au-delà -tout en les enfermant, les embrassant, les
savourant-, voici la Motte, le Terroir qui devient tout à coup et puissamment
Divers. De ce double jeu balancé, une inlassable, intarissable
diversité. »[367]
Or, en ce qui concerne les textes des créolistes, il s’avère que l’intarissable sombre parfois dans le « catalogage » -les mêmes thèmes et les mêmes personnages s’échangent d’un roman à l’autre, notamment chez R. Confiant- et que la sensation du Divers, autrement dit la confrontation avec l’Autre, dans ce qu’il a de plus exubérant, se fait ici quelque peu malsaine, ce que différents critiques se sont courageusement efforcés de souligner. En 1996, Priska Degras déclarait ainsi :
« La vision stéréotypée de
l’univers antillais, quand elle se trouve sous la plume d’un auteur
revendiquant hautement sa spécificité créole témoigne peut-être d’une intention
parodique, d’une volonté de dérision mais l’on frémit à la pensée qu’il
pourrait aussi s’agir, plus cruellement, d’une incapacité à échapper au regard
de l’Autre, à l’image qu’il s’est forgée et à laquelle, finalement, on se
résout à se conformer afin d’être reconnu et de lui plaire. » [368]
Toutefois, cinq années plus tard, elle revoyait son jugement et nuançait son propos :
« Si nombre de romans récents, en tentant d’en montrer l’irrémissible et riche altérité, n’échappent pas à la tentation de “folkloriser” la culture antillaise, il convient toutefois de moduler la sévérité de ce jugement et souligner que c’est par le traitement original de ces thèmes communs et la grâce d’une écriture neuve que l’écrivain peut espérer échapper au piège de ressassement douloureux de la blessure historique et au danger de la représentation exotique. » [369]
Sans tirer de conclusion hâtive ou infondée sur les raisons de ce revirement, précisons simplement que toute prise de position à l’égard de la démarche des créolistes est incontestablement problématique, d’une part, en raison de la sensibilité du lectorat, aussi bien local que métropolitain, vis-à-vis d’un mouvement s’efforçant d’occuper massivement le devant de la scène littéraire ; d’autre part, en raison de l’incontestable susceptibilité, souvent porteuse d’agressivité, des créolistes à l’égard de toute critique trop virulente émise à l’encontre de leur travail[370]. C’est ainsi que les prises de position à l’égard des textes de la créolité oscillent souvent entre admiration sans borne, adhésion totale au principe de la créolité, accréditation de la réalité antillaise décrite à travers le prisme de cette esthétique, et sentiment de duperie ou encore dénonciation d’une forme de « folklorisation » de la culture antillaise, et ce, que le point de vue émerge tant des D.O.M. que de métropole.
Autant dire que curiosité « ségalénienne » et rire moqueur du conteur assurent, dans les écrits créolistes, une alchimie qui, si elle ne peut être condamnable en principe, se révèle être véritablement risquée, parce qu’offerte à un public non ou trop averti.
A l’opposé de la démarche adoptée par les créolistes qui prétendent livrer une peinture fiable et, à certains égards, catégorique de la société martiniquaise, certains auteurs optent pour une approche plus nuancée du discours de fond, et ce, en dépit de certaines apparences trompeuses.
2.1.3- Désenclavement, par dérision (D. Chraïbi),
par affirmation (M. Condé) : quête de neutralité
Il peut paraître totalement aberrant de parler de quête de neutralité en ce qui concerne D. Chraïbi et en particulier en ce qui concerne ses romans policiers ; or, il nous semble que c’est justement parce qu’il donne dans la démesure, notamment avec le personnage de l’inspecteur Ali, que sa perception de la société marocaine, et en particulier des femmes, nous paraît relativement sobre, sans pour autant sombrer dans le « politiquement correct », encourageant une certaine ouverture d’esprit contre toute catégorisation rapide et sans profondeur.
Les femmes mises en scène dans Une Enquête au pays sont des montagnardes ignorantes des pratiques culturelles citadines et porteuses, à l’inverse, de toute la richesse du monde traditionnel berbère. Loin de la civilisation urbaine qui « abîme les gens », selon les termes d’Ali, les villageoises n’ont rien de ces « femmes teigneuses au-dehors et sèches à l’intérieur, sans jus » [371] qui peuplent les villes, des « femmes d’aujourd’hui » que décrit le chef Mohamed et qui « ne sont plus ce qu’elles étaient, obéissantes et travailleuses », qui « ne sont qu’une source d’empoisonnements »[372], encouragées en cela par les progrès techniques et la matérialisation de la société urbaine.
A travers Hajja, c’est la figure de la mère qu’Ali retrouve en ce qu’elle a de tendre, d’attentionné, de protecteur, de nourricier, mais également dans la mesure où elle joue un rôle déterminant au sein de la communauté. Aux côtés de cette « reine », nous découvrons également les nombreuses « ouvrières » de la famille des Aït Yafelman que sont ces femmes reproduisant les gestes traditionnels de la préparation du couscous et auxquelles Ali propose son aide, transgressant les règles sociales qui délimitent clairement les rôles des hommes et des femmes au sein de la communauté. Cette attitude semble témoigner de l’amour d’Ali pour les femmes et de son désir de les considérer en égales, tordant le cou à « “ce vieux machisme” stupidement souverain en terre arabe et qui faussait le sens des relations entre sexes opposés »[373] ; un désir de se rapprocher de ces femmes qui, de même qu’au moment de sa rencontre avec Hajja, le conduit à se replonger dans son enfance, en ce temps presque oublié d’« avant le football et la police ». C’est en effet au contact des femmes qu’Ali semble retrouver son moi profond : sa rencontre avec les jumelles à la peau de cannelle, Yasmine et Yasmina, va en ce sens se révéler déterminante. Le désir et la brutale vitalité suscités en lui par la perspective d’épouser de si belles créatures détermine sa décision de changer de vie, de quitter la police, de s’installer au village, autrement dit de donner libre cours à « l’expression même de ses vraies tendances et de ses vrais désirs »[374]. En réalité, une fois le chef assassiné, Ali sera d’une certaine manière partagé entre sincérité et instinct de survie, et sombrera finalement dans l’hypocrisie, le désir de répression et le culte de la chefferie. Les femmes du village auront néanmoins réussi à éveiller en lui des sentiments et émotions oubliés, suscitant par là même une réflexion profonde sur son existence qui, si elle avorte dans ce roman, se réalise finalement dans les romans policiers ultérieurs dont l’inspecteur Ali sera le héros.
Entre Une Enquête au pays et Une Place au soleil, Ali semble, en effet, être parvenu à changer de peau, à trouver la voie d’un épanouissement possible dans l’accomplissement d’une salutaire liberté de penser. Cette transformation est validée d’une certaine manière par la rencontre de l’inspecteur Ali avec Sophia et la répudiation de sa première femme, Zoubida.
Dès les premières pages d’Une Place au soleil, Zoubida nous est présentée comme une jeune personne oisive, doublement soumise au Roi et à son époux, esclave sexuelle de ce dernier -condition dont elle se satisfait, à la stupéfaction d’Ali- et « jérémiant » sans cesse en quête d’électroménager. Or, c’est en policier autoritaire qu’il décide de s’en débarrasser -il la fait emprisonner- et c’est en « bon musulman » qu’il choisit de s’en séparer, en obtenant du cadi, après entretien, sa répudiation.
Avec la disparition de Zoubida, c’est tout un symbole de la condition féminine, à la fois soumise, violentée et acceptant de l’être, qui disparaît ; une nouvelle palette de « femmes libérées » peut alors voir le jour, avec à sa tête celle qui rendra le cœur d’Ali monogame : Sophia. Rencontrée au gré d’une enquête, cette jeune et belle servante est d’emblée livrée aux différents fantasmes mi-charnels mi-culinaires si chers au corps de l’inspecteur Ali et si propices à l’écriture à la fois talentueusement suggestive et grossièrement explicite de D. Chraïbi. Séduite car, comme elle le lui confiera plus tard, traitée en femme -attouchements dès la première approche, déflorée brutalement à la deuxième rencontre avant d’obtenir une invitation à poursuivre, selon une approche caricaturale du mâle dominant arabe-, Sophia signe l’entrée d’Ali dans le monde de la sagesse, selon Chraïbi, c’est-à-dire dans le monde de la monogamie conçue dans le désir inextinguible. Véritable esclave de cette sagesse, Ali ne parvient plus à se passer de son épouse qui, de ce fait, se voit réquisitionnée auprès de lui pour le seconder dans ses enquêtes et parfois même le devancer, à son grand émerveillement :
« Se
pouvait-il que, tout en étant épris d’une femme pour sa féminité, on l’aimât
doublement pour son intelligence ?
“Diable
de diable ! se dit-il, va falloir que je révise mes idées de
Maghrébin”. »[375]
Le propos de D. Chraïbi consiste en effet à proposer une révision de certains stéréotypes portant sur la femme maghrébine, notamment ceux qui se manifestent dans ses romans policiers selon deux perspectives : il s’agit, d’une part, de caricaturer l’extrême sensualité féminine en mettant notamment en scène un homme aux appétits sexuels débordants, rendant tout leur sens aux différentes acceptions de la « chair » ; et, d’autre part, de dénoncer de manière plus directe, les stéréotypes véhiculés généralement sur le monde arabe. De retour d’un voyage aux Etats-Unis où elle a donné une conférence sur le pain, pour les besoins de l’enquête, Sophia ne peut ainsi que déplorer la multiplicité d’idées reçues auxquelles elle a dû faire face, et ce, devant Ali qui ne peut s’empêcher, l’air de rien, de lui donner des indications censées la rendre plus attirante et auxquelles elle se prête sans broncher. Cette perspective paradoxale est encore renforcée par le caractère ambivalent de la démarche de Sophia : en offrant aux Américains un exposé sur le pain, agrémenté de chants traditionnels, elle s’est elle-même positionnée dans une forme d’« exotisme absolu »[376], récoltant en une série de questions relevant de propos féministes présentés comme inadaptés ce qu’elle avait semé ; elle rapporte ainsi à Ali un extrait des questions auxquelles elle a pu être confrontée :
« Comment
peut-on être une Marocaine ? Existait-il une ligue féminine pour l’égalité
des sexes ? Mes cheveux longs étaient-ils préconisés par le Coran, tout
comme le port de la barbe chez les hommes ? Et quelques allusions sur nos
mœurs spéciales qui tournaient toutes autour du sexe sans jamais les nommer.
Elle avait l’intuition que j’avais des problèmes de blocage. »[377]
Il s’agit, pour D. Chraïbi, de souligner l’absurdité de certaines idées reçues sur le Maghreb, tout en suggérant la responsabilité de certains intellectuels maghrébins peu inspirés quant au choix de leurs sujets d’études.
Remarquons cependant que c’est sous cette « couverture exotique » que Sophia, reprenant la méthode favorite de l’inspecteur Ali, parvient à mener son enquête sans attirer la méfiance de ses interlocuteurs ; la méthode est, par ailleurs, définie par Ali qui explique de quelle manière il a résolu son enquête, dans L’Inspecteur Ali à Trinity College :
« J’ai
marqué en toutes circonstances ma différence d’Arabe, dans mon habillement, ma
façon de manger et de m’exprimer, le regard torve, l’esprit dans la culotte
-bref, l’Arabe tel qu’on l’imagine dans les séries B. Le personnage que j’ai
joué avec délectation a endormi beaucoup de gens. Et ainsi j’ai eu toute
latitude de résoudre l’énigme. »[378]
Contrairement à Sophia qui n’a pu lever sa couverture face à ses interlocuteurs, Ali peut jouir de sa fonction d’enquêteur, maître par définition générique du terme du roman, pour dénoncer la supercherie in fine et prendre au piège tout regard « exotisant ».
On remarque que, là encore, le point de vue de D. Chraïbi ne se veut pas unilatéral ; les contradictions apparentes qui émaillent ses romans en attestent. Sa perspective se veut large, insaisissable, aux contours incertains jouant à la fois sur les clichés -dans les portraits de femmes, on peut encore trouver une princesse « aussi belle qu’un poème romantique »[379], ou une scientifique frigide outrée par les propos salaces de l’inspecteur- et sur un désir de brouiller les pistes. En tout état de cause, les femmes ne sont pas réduites, dans les romans policiers de D. Chraïbi, à un seul modèle et si Ali est sensible à chacune d’elles -même les femmes du cadi, malgré l’interdit, suscitent en lui le désir, et ce, d’autant qu’il partage avec elles la préparation d’un plat- c’est qu’elles sont toutes différentes. Plus la femme est habillée du voile de la sensualité et perçue à travers les fantasmes d’Ali, plus cette caractérisation est discréditée par la surabondance du systématique recours au fantasme, qui finit nécessairement par régir le point de vue tout entier. C’est en répondant exagérément aux préjugés que la femme nous apparaît finalement autre et insaisissable.
L’approche du personnage féminin chez D. Chraïbi témoigne de sa volonté de prôner une ouverture d’esprit qui se fait ici par autodérision, de manière voyante, provocante et pouvant induire en erreur ceux qui se livreraient à une lecture au premier degré.
Chez d’autres auteurs, en revanche, une même volonté de parvenir à un désenclavement du personnage féminin et, par glissement, de la culture locale en général, se manifeste de manière plus discrète, par la volonté de s’en tenir aux faits, de combattre les clichés par une peinture tendant à s’approcher du vrai. Loin de certains tableaux volontairement édulcorés des créolistes, Maryse Condé propose ainsi une approche relativement sobre de la culture antillaise qui nous apparaît non tant dans la revendication de sa spécificité, que dans une détermination portant sur la diversité humaine. La dimension spectaculaire favorisée dans la plupart des romans créolistes est alors supplantée, chez Maryse Condé, par une démarche nettement plus introspective, d’où le recours au prisme de la veillée mortuaire sous-tendant le déroulement de l’intrigue de Traversée de la mangrove, ainsi que la mise en scène, dans La Belle créole, d’un héros solitaire, retraçant sa véritable histoire au gré de ses souvenirs.
Une des principales différences sensibles entre les romans des créolistes et ceux de Maryse Condé réside en une indépendance affichée de la romancière guadeloupéenne vis-à-vis du recours à la langue créolisée revendiquée notamment par P. Chamoiseau et R. Confiant. C’est ainsi que P. Chamoiseau s’est permis d’adresser différentes critiques à M. Condé, concernant son choix de ne pas recourir de manière systématique à une langue véritablement imprégnée de créolité. Félicitant, d’une certaine manière, M. Condé pour l’emploi de quelques expressions et usages linguistiques jugés proprement créoles, P. Chamoiseau se permet néanmoins de faire la leçon à la romancière guadeloupéenne, quelquefois, selon lui, beaucoup moins inspirée quant au choix de son vocabulaire :
« Other words of your vocabulary,
still numerous, fail to invoke in me anything besides the flavor of other
places and other cultures. For instance, saying île, a word we never say or think. Saying village instead of bourg
since there are no villages here.
This vocabulary reminds me of the time when we used to say colline for fear of writing morne.
It seems to me that the writer’s lexicon must feed itself primarily from what I
call our verbal subconscious, in order for the literary fabric to touch us
intimately and to release evocative bursts. Also, all the footnotes that
explain what we already know make us think, dear Maryse, that you are not
addressing us, but some other people. »[380]
Ce manque de « conscience créole » dénoncé par P. Chamoiseau, révèle en fait le désir de M. Condé de ne pas enfermer son texte au sein d’une grille linguistique spécifique, prônant un « An sé on kréyòl », en guise de marque de fabrique.
Refusant un type d’écriture enfermé dans une idéologie jugée réductrice car délimitée, la romancière guadeloupéenne ne peut que rejeter de la même façon la mise en place d’une typologie des personnages exclusivement centrée sur leur créolité, et en particulier si cette créolité se fait sélective. On a ainsi pu reprocher aux créolistes de négliger certaines composantes pourtant bien réelles de la société martiniquaise[381].
Si, comme nous l’avons suggéré précédemment, leur conception du personnage féminin se trouve fortement caractérisée et enfermée dans une typologie bien particulière, la perception de M. Condé se veut, quant à elle, plus globalisante, comme le constate notamment P. De Souza :
« Dans
Traversée de la Mangrove, Condé […]
célèbre les multiples rôles de la femme. Femmes âgées, d’âge moyen, jeunes
filles, issues de la classe aisée ou défavorisée, noires, indiennes,
chabines : le lecteur du roman est confronté à un kaléidoscope d’âges, de
positions sociales et d’origines ethniques. »[382]
Or, ce qui constitue la particularité de M. Condé, par rapport à un auteur comme Raphaël Confiant qui s’efforce également d’offrir un panel ethnique relativement large, c’est qu’avant d’exister dans une perspective ethnique, les personnages de la Guadeloupéenne nous apparaissent prioritairement dans leur humanité. Si, dans les premières pages de Traversée de la Mangrove, les personnages sont décrits selon leur rôle au sein de la communauté, et par là même d’après des données ethniques et sociales, la construction de la partie centrale du roman divisée en une succession de monologues permet, d’une certaine manière, de les restituer au lecteur dans leur dimension humaine.
Inscrit dans la perspective du monologue, autrement dit livré à sa conscience, Loulou Lameaulnes, descendant d’« un béké de la Martinique, chassé par sa famille parce qu’il s’était marié avec une négresse »[383] et propriétaire d’une importante pépinière, devient alors cet homme marqué par le désamour de sa mère, se sentant à l’étroit dans une Guadeloupe trop petite pour lui et incapable de gérer la liaison incestueuse entretenue par ses enfants[384]. Sylvestre Ramsaran, le coolie malabar prospérant dans les affaires redevient, de la même façon, « celui-qui-avait-fait-honte-au-papa » quand, enfant, il s’était mis à hurler en assistant à son premier sacrifice hindou[385]. Les femmes elles-mêmes sont perçues, grâce à Francis Sancher, dans toute leur féminité et leur quête d’amour, de tendresse, de passion. L’arrivée de l’étranger, de celui dont on ne sait rien, dans leur vie réglée, déterminée et strictement conçue dans la collectivité du petit village de Rivière au Sel, leur offre le rêve, la liberté, l’occasion de sortir du cadre communautaire et des rôles imposés. La jeune fille revêche, la mère de famille, l’épouse modèle, l’institutrice vieille fille, toutes se laissent porter par l’amour et le désir, oublient les barrières sociales pour redevenir simplement femmes.
L’introspection permise par la veillée funèbre leur permet alors de concrétiser cette libération dans l’expression, dans la reconnaissance en conscience de leur identité bafouée par le poids de la collectivité, des règles, des convenances, des rôles sur mesure, des destins tout tracés. Réalisée collectivement, la veillée leur offre paradoxalement la possibilité de s’isoler du reste de la communauté, de donner libre cours à leur véritable nature, en toute transparence. Leur identité sociale laisse alors place à leur humanité, à leur diversité, comme le précise Françoise Lionnet :
« Traversée de la Mangrove est un livre
dont l’histoire est racontée “in pieces”, sans intervention ni médiation de la
part de l’auteur qui ne juge ni explique ses personnages : ils nous sont
donnés comme exemples de la diversité du réel. L’esthétique narrative du roman
fait appel à une conscience fragmentée, dispersée, répartie entre les
différents personnages. Chacun donne son point de vue particulier sur une
réalité changeante et diverse. La somme de ces points de vue ne représente pas
une vision totalisante de la réalité guadeloupéenne : bien au contraire
elle met en lumière les contradictions, les discontinuités et les limites mêmes
de la narrativisation du réel à partir des évènements de la vie de Francis
Sancher. »[386]
A première vue, les différents témoignages donnent l’impression de restituer les pièces du puzzle que représente la vie mystérieuse et mouvementée de Sancher ; mais finalement, rien n’est totalement élucidé au terme de la veillée et le mystère de l’identité de Sancher reste entier. En revanche, réunis autour de la dépouille de l’étranger, chaque personnage plonge en lui-même en quête de son moi profond, si bien que le phénomène de reconstitution se fait finalement réflexif. En assistant à cette veillée, chacun parvient à retrouver et à s’approprier sa propre pièce du puzzle : recomposée autour de la dépouille de Sancher, réunie devant la mort, la mosaïque demeure alors inexorablement « diffractée », insaisissable, indéfinissable car toute entière inscrite dans la nature humaine. Comme le remarque Christiane Ndiaye :
« Le
texte de Condé […] suggère que la source nouvelle qu’il faut découvrir pour
faire revivre le pays natal, il faut la chercher dans le cœur des êtres
humains. »[387]
Le regard porté par Maryse Condé sur la société antillaise se fait en ce sens beaucoup plus universalisant que celui des Créolistes. Si la Guadeloupéenne ne nie pas la singularité culturelle créole -marquée notamment par le traumatisme d’un passé esclavagiste douloureux, induisant une certaine détermination comportementale et s’exprimant au travers de la pression exercée par le jugement collectif, de la moralisation de la vie communautaire, ou encore du recours aux croyances et aux fantasmes pour échapper à l’inconnu, au non maîtrisable- elle met en scène des personnages aspirant à échapper, d’une certaine manière, à une créolitude conçue comme pure fatalité.
Si « marquer les paroles » de ces personnages soumis à la déveine pour les faire exister dans leur créolité, autrement dit dans leur différence, semble être, pour les créolistes, la réponse faite à la fatalité de la condition d’un peuple descendant d’esclaves, ouvrir la voie de la liberté est celle que propose par M. Condé. Quand le « marqueur de paroles » prétend livrer un témoignage inscrivant les personnages dans le texte, l’écrivain mis en scène par Maryse Condé sous les traits de Francis Sancher, laisse, quant à lui, une multitude de questions, d’incertitudes suscitant l’envie de chercher.
Le traitement du personnage féminin et plus largement l’approche sociale menée dans la plupart des romans de notre corpus, nous permettent d’appréhender trois orientations, trois modes d’ancrage dans le lieu bien distincts : l’un totalement submergé, accablé, noirci par une réalité tragique et meurtrière ; un deuxième véritablement imprégné par une approche fantasmée, exubérante, emphatique et provocante d’une peinture se voulant néanmoins représentative d’une certaine réalité sociologique ; un dernier s’inspirant d’une réalité perçue dans sa mouvance et son caractère universel, insaisissable. A la surdétermination des deux premiers modes, fortement caractérisés tant par un excès de réalisme que par un recours immodéré au « rêver-pays », s’oppose ainsi l’approche « universaliste » proposée par M. Condé et D. Chraïbi, l’un et l’autre affirmant encore leur volonté de briser les carcans par un recours singulier à la forme policière, l’une refusant de s’y conformer, l’autre jouant le jeu exagérément. Cette volonté de désenclavement se veut néanmoins porteuse d’un regard profond sur la société décrite, notamment à travers la prise en compte de facteurs socio-culturels déterminants. Quelles que soient l’orientation choisie et la démarche empruntée, la reprise de la forme policière veut coïncider, chez ces auteurs, avec une peinture de la société et plus précisément avec la représentation de la singularité de l’espace culturel d’où ils s’expriment. A la caractérisation propre au cadre générique s’ajoute alors la prise en compte de la spécificité du lieu nécessairement marquée dans le cadre de sociétés post-coloniales.
2.2-
Influence de
la spécificité du cadre post-colonial
L’approche du personnage féminin nous a semblé intéressante dans la mesure où elle a pu se révéler représentative de la manière dont les auteurs de notre corpus choisissent d’aborder le traitement de la culture locale. Dans les sociétés antillaises et maghrébines en général, l’une marquée par une détermination des relations sociales -et du rapport homme/femme en particulier- directement dérivée du mode de fonctionnement de l’habitation coloniale, l’autre impliquant, dans le cadre de l’Islam, une conception traditionaliste du rôle social de la femme, le traitement du personnage féminin se révèle être, en effet, particulièrement significatif et porteur, dans une certaine mesure, de l’orientation du discours social de l’écrivain. Or, que le positionnement s’inscrive dans une perspective réaliste ou fantasmée, il implique nécessairement un discours en porte-à-faux avec le cliché, l’idée reçue, autrement dit avec le regard de l’Autre, ce dernier étant essentiellement représenté par la figure de l’Occident. C’est pour cette raison que la quête de neutralité amorcée notamment par D. Chraïbi passe par la mise en scène de figures féminines occidentales, auxquelles se mêlent des figures plus traditionnelles, le tout s’harmonisant sous le regard aimant d’un homme essentiellement agi par ses désirs sexuels.
L’expression du rapport à l’Autre paraît d’autant plus fondamentale que les sociétés décrites se révèlent être irrémédiablement marquées par un passé colonial traumatisant et à certains égards non révolu, ce que le genre policier, censé mettre en scène le pouvoir de la loi, de la Justice, de l’Etat face au crime, par l’action de représentants de l’ordre au statut historiquement et idéologiquement ambigu, ne manque pas d’accentuer.
2.2.1- L’héritage de la violence
De même que les habitants de Harlem ne peuvent s’empêcher, dans les romans de C. Himes, de craindre le lynchage à l’approche de représentants de l’ordre menaçants, arme au poing, les Foyalais mis en scène par P. Chamoiseau voient inévitablement planer, au-dessus de leur triste sort et à l’approche de Bouaffesse et de ses hommes, le spectre des gendarmes-à-cheval[388], reconnus dans la culture populaire comme étant à l’origine de sanglants mouvements de répression contre le peuple. C’est ainsi que le bureau de Pilon, salle de torture du vieux Congo, prend rapidement des airs de « champ de mulâtre après une battue de gendarmes-à-cheval »[389]. Le narrateur nous dit encore de Doudou-Ménar, devenue folle furieuse face à la meute de policiers, qu’elle « massacrait sa proie avec la rage d’un gendarme-à-cheval dans une grève agricole »[390]. Par le biais de ces deux exemples, il semble que la figure du gendarme-à-cheval trouve une double représentation à travers, d’une part, la répression menée contre les esclaves marrons au cours de la période coloniale esclavagiste -le terme « battue » nous suggère le rapprochement- et, d’autre part, une autre forme de répression, menée cette fois contre les ouvriers grévistes martiniquais, au début du siècle[391], après l’abolition de l’esclavage. Il s’agit pour P. Chamoiseau, selon un point de vue purement subjectif, de suggérer la constance, de tout temps, de la violence répressive exercée par les représentants de l’ordre martiniquais et d’illustrer la cruauté des garants de l’ordre inexorablement inscrits dans la lignée d’un système esclavagiste véritablement prégnant. Reportons-nous, en ce sens, à un passage significatif, extrait de Solibo Magnifique :
« Ô
amis, qui est à l’aise par-ici quand la police est là ? Qui avale son rhum
sans étranglade et sans frissons ? Avec elle, arrivent aussi les chasseurs
des bois d’aux jours de l’esclavage, les chiens à marronnage, la milice des
alentours d’habitation, les commandeurs des champs, les gendarmes à cheval, les
marins de Vichy du temps de l’Amiral, toute une Force qui inscrit dans la
mémoire collective l’unique attestation de notre histoire : Po la
poliiice ! »[392]
Il n’y a rien d’étonnant alors à ce que Solibo Magnifique, présenté comme le récit du « marqueur de paroles », autrement dit l’un des protagonistes de l’affaire se définissant de surcroît comme récolteur des histoires du peuple, se fasse l’écho de ce genre de dérives attribuées aux forces de l’ordre :
« La
réalité s’imposa pour certains avant même d’être clairement formulée : ils
s’enfuyaient, en épouvante silencieuse, abandonnant nos futurs témoins,
quatorze nègres, dont trois madames, tous certainement imbéciles tant il est
notoire qu’avec un mort la loi s’en mêle, et qu’alors-hector ta vie devient une
manière de la danse haute-taille (celle où tu bouges aux ordres d’un
commandeur). »
« L’oreille
fine de Congo perçut le car de police bien avant qu’il ne soit audible. Mi la
hopo, voici la police ! dit-il avec le ton que l’on emploie pour signaler
les chiens. »
« Obéissant
à un signe de Pilon, un inspecteur s’avance et commence à photographier. Là même,
bien que l’appareil ne soit nullement pointé sur eux, quelques zouaves de la
foule s’enfuient, d’autres se détournent, nous-mêmes, dans le car, quittons
l’angle de la vitre : les photos de la police n’ont jamais nourri de
souvenirs heureux. »[393]
Les réactions et réflexions
suscitées à l’approche des forces de police se présentent comme autant de
craintes justifiées, dans le roman, par toute une série de
« bavures » accumulées par les policiers chargés de l’affaire Solibo,
recourrant systématiquement à la violence en cas d’obstacle à la bonne marche
de leur enquête, c’est-à-dire dans l’éventualité d’une quelconque tentative de
remise en cause de leur autorité. Ainsi, tandis que les témoins de la mort du
conteur confondent police et loi, les policiers mis en scène par P. Chamoiseau
voient une inévitable coïncidence entre loi et force, entre respect de l’ordre
et répression, entre autorité et tyrannie, fidèles, peut-être malgré eux, à ce
qui nous est présenté comme une tradition voire une fatalité locale ; d’où
cette terrible dérive vers ce qu’un cri d’effroi issu du peuple résumera en une
exclamation : « La Lwa ka
senyen moun !… » (« La Loi saigne les gens ! »)[394],
profil « westernisé » et susceptibilité exacerbée des policiers à
l’appui.
Il est intéressant de rapprocher ce genre de discours critique à l’égard des pouvoirs publics et des représentants de la métropole dans les D.O.M. de certains propos tenus par P. Chamoiseau et d’autres Martiniquais, et ce, dès les années 1970. Nous nous proposons ici de nous pencher un instant sur une bande-dessinée intitulée Le Retour de Monsieur Coutcha, parue aux Editions M.G.G., en 1984.
Publiées dès 1972, sous la forme d’un journal[395], les aventures de Coutcha sont l’œuvre de trois Martiniquais : Tony Delsham, Kako et Abel, ce dernier étant le pseudonyme de P. Chamoiseau. Cette bande-dessinée nous intéresse, tout d’abord, dans la mesure où elle met en scène des personnages que nous retrouverons, quelques années plus tard, dans Solibo Magnifique. Il en est ainsi du brigadier Bouaffesse -pas encore chef- ou encore d’une marchande de fruits-à-pain dont la corpulence, notamment mammaire, et le caractère révolté ne sont pas sans rappeler Doudou-Ménar. Elle nous permet, en outre, de découvrir une figure symbolique du paysage culturel martiniquais, à travers le personnage de Coutcha, un Major au grand cœur.
En préambule de la bande-dessinée, le lecteur peut découvrir un texte signé Abel, présentant les principales caractéristiques de Coutcha, « vieux-nègre », portant bakoua, « papa-moustache » et « coutelas de six pouces » :
« Coutcha est susceptible, coléreux, amateur de bagarres, de punchs-quatre-doigts, de football. Son comportement avec les femmes est celui d’un macho. Il serait détestable s’il n’était d’une générosité sans égale. Enclin à protéger les zokliks-fêbo (les faibles), il se comporte dans les situations dramatiques avec toute la droiture du héros classique. »[396]
Or, ce « vieux-nègre » se révèle être précisément la terreur des policiers, en bon Major qu’il est. Afin de mieux cerner la personnalité de Coutcha et la fascination du public pour ce personnage, Abel/Chamoiseau prend soin de rappeler, toujours en préambule de la bande-dessinée, le rôle du Major :
« Le Major cristallisait la révolte de tous face à la déveine quotidienne de la vie coloniale. Chaque quartier avait son Major, et ce dernier considérait comme un défi qui lui était personnellement lancé, tout acte agressif, tout vocal mal placé, toute présence hostile (policiers, gendarmes, autre major) dans les limites de son territoire. »[397]
On constate ici que, dans la mesure où le Major se présente à la fois comme un révolté vis-à-vis de l’oppression coloniale et comme un opposant aux forces de l’ordre jugées hostiles, il ne fait guère de doute qu’Abel et ses collaborateurs perçoivent fatalement les représentants de l’ordre dans une filiation découlant de l’époque coloniale. Cette perspective est, par ailleurs, également sensible dans d’autres « planches » signées Abel, comme celles mettant en scène les Frères Déhohême[398].
Remarquons, en outre, que si Pilon, le supérieur de Bouaffesse nous est présenté, dans Solibo Magnifique, comme un être de raison en qui les suspects voient un allié susceptible de les protéger, les supérieurs de Bouaffesse mis en scène dans Le Retour de Monsieur Coutcha, se révèlent être, à l’inverse, les dignes représentants de l’oppression coloniale. Le chef de la police, un vié-blan, nous est ainsi présenté comme un parfait colonialiste, admirateur de Bigeard et de Massu, ignorant des réalités du pays tout en profitant allègrement des « 40% à la prime de chaleur…[de] la prime d’éloignement, [de] la prime d’échelon, [de] la villa de fonction, [du] yacht de fonction »[399].
Représentant un Etat méprisant les réalités locales, ce vié-blan voulant exercer la/sa loi, se heurte alors aux figures de résistants que sont Man Courbaril/Doudou-Ménar ou encore Coutcha, ainsi qu’aux figures de semi-résistants dont Bouaffesse est l’exemple criant. Comme l’illustrent explicitement certaines vignettes, Bouaffesse, homme de couleur au service de la loi et, dans ce cas précis, sous les ordres du vié-blan colonialiste, se voit irrémédiablement pris entre deux feux[400].
Dans Solibo Magnifique, si la figure du Blanc colonisateur a disparu concrètement, elle n’en demeure pas moins partie prenante de la personnalité même de Bouaffesse, renvoyant à la question de la coexistence, à la Martinique, du dominant et du dominé. Richard Burton souligne cette perspective problématique :
« Bien
qu’il n’y ait pour Chamoiseau aucun doute que la source ultime du pouvoir ne se
trouve en France métropolitaine, il ne se préoccupe pas uniquement, ou même
surtout, des “Français de France” qui peuvent l’exercer sur place, ou même des
békés-pays qui leur sont tantôt opposés tantôt alliés : un des thèmes
fondamentaux de son œuvre, c’est plutôt le rôle joué dans l’agencement du
pouvoir par ces Martiniquais (et, plus rarement, Martiniquaises) de couleur
qui, depuis l’époque esclavagiste jusqu’au présent, ont d’une façon ou d’une
autre collaboré avec le système et, débrouillards eux-mêmes, ont su le
retourner à leur avantage en s’immisçant dans ses rouages. »[401]
Or, si Bouaffesse est parvenu à obtenir le grade de brigadier-chef, de manière plus ou moins réglementaire -« toute question visant à éclaircir comment il était devenu sous-brigadier, puis brigadier, enfin brigadier-chef, sans voir accompagner ces promotions de l’exil habituel dans le givre des commissariats parisiens resterait sans réponse »[402]-, il n’en demeure pas moins confronté à des situations face auxquelles la philosophie, mise en lumière par E. Burton, du « débrouya pa péché » (« il n’y a aucun péché à se débrouiller »), se voit quelque peu malmenée. Ne maîtrisant que très partiellement les subtilités de la procédure à suivre sur le lieu d’un crime, Bouaffesse finit ainsi par transformer le périmètre de sûreté en véritable champ de bataille.
Nous remarquons ici qu’une telle perspective a déjà largement été exploitée, quelques années auparavant, par le romancier marocain Driss Chraïbi, dans son roman intitulé Une Enquête au pays. Parmi les nombreuses affinités sensibles entre Solibo Magnifique et Une Enquête au pays, nous pouvons, en effet, relever la manière dont les représentants de l’ordre conçoivent, en pays post-colonial, leur rapport au pouvoir.
Lucide, Ali se définit comme « le dominant et le dominé à la fois », « le doigt entre le clou et le marteau »[403]. Dans une perspective largement moins réfléchie, il est par ailleurs intéressant de constater que le brigadier-chef Bouaffesse, d’une part, et le chef Mohammed, d’autre part, s’inscrivent véritablement, l’un comme l’autre, dans une attitude proche de la schizophrénie. Fils d’un « simple flic sans pouvoir de décision » qui « gardait la loi des Français »[404], le chef Mohammed croit ainsi pouvoir symboliser l’évolution positive de son pays, libéré après l’Indépendance, en ce qu’il peut se targuer d’être, à l’inverse de son père, un des détenteurs de l’autorité, vestige de l’occupation occidentale qu’il choisit de reprendre à son compte afin d’optimiser ses méthodes policières :
« L’homme
à la symphonie policière abandonna sans plus tarder le premier mouvement de
l’interrogatoire pour sauter au final à pieds joints : un crescendo de
décibels qui était l’expression des vraies relations humaines en cette fin de
XXème siècle. Dominants-dominés, et rien d’autre. Les salamalecs
avaient pétrifié l’Orient, oh oui ! »[405]
En réalité, seul Ali se voit soumis à cette autorité qui, face à la démultiplication hiérarchique ne vaut rien ; c’est, en outre, par le recours à la force, tendant à la folie furieuse sous le soleil marocain, autrement dit à la kouriyya[406], que cette autorité parvient à s’exprimer, et ce, de manière stérile, puisque aucun villageois n’accepte de s’y soumettre. Soumis à la kouriyya, impuissant car loin du système de fonctionnement de la société citadine, transformé en véritable bête sauvage, hargneuse et dangereuse, le chef Mohammed se met alors à tirer à tout va sur un suspect récalcitrant, rappelant finalement les « coups de chaleur » de Bouaffesse. Dangereusement sensible du boutou, fort d’une expérience physiquement engagée dans « sa guerre coloniale » en Algérie[407], admirateur d’une certaine « prestance » coloniale -« Sur la kodak, […] il pose un pied sur le cercueil comme dans les vieilles chasses coloniales (objets probables de ses émerveillements) »[408]- et irrépressiblement violent, Bouaffesse présente, en effet, des affinités certaines avec son prédécesseur marocain.
Témoignant du caractère malsain de leur rapport au pouvoir et de leur soif de violence, et usant de méthodes plus que contestables et symboliques d’une époque -la torture participe de leur mode opératoire-, Bouaffesse et Mohammed illustrent l’incohérence d’un système recyclant paradoxalement ce contre quoi il s’est fondamentalement érigé. Driss Chraïbi et Patrick Chamoiseau soulignent, en ce sens, la persistance de certains traits caractéristiques de l’organisation coloniale, en cette forme de pathologie du pouvoir dont semblent souffrir les représentants de l’ordre, si tant est qu’ils jouissent d’une quelconque autorité.
Sans recourir, comme D. Chraïbi ou P. Chamoiseau, à des représentations aussi poussées, voire caricaturales, de l’influence de l’histoire coloniale sur les comportements, d’autres romans de notre corpus soulignent néanmoins la persistance de certaines vues et considérations probablement héritées de l’époque coloniale.
En mettant en scène un enquêteur ayant dû s’exiler plusieurs années dans le « givre parisien » afin d’obtenir une promotion, et exerçant sous les ordres d’un commissaire davantage préoccupé par les cambriolages commis dans les grandes villas des Blancs créoles que par la mort d’un « nègre va-nu-pieds », R. Confiant tend, par exemple, à souligner la prégnance de la soumission au dominant, en l’occurrence, le Blanc. En accentuant l’ignorance de certains représentants de l’Etat dans les « affaires de nègres » et l’incrédulité dont ils font preuve face à l’ampleur de l’affaire de l’homme-au-bâton, E. Pépin suggère, quant à lui, le décalage existant une nouvelle fois entre le peuple (dominé) et la métropole (dominant).
La mise en scène de représentants de l’ordre et par extension le recours à la forme policière semblent donc s’inscrire dans la lignée d’une démarche nécessairement engagée idéologiquement, voire politiquement. Pour les créolistes en particulier, il s’agit de mettre en évidence les dysfonctionnements inhérents à la manière dont les pouvoirs publics investissent et gèrent l’espace antillais, en argumentant selon diverses stratégies. L’absurdité et l’incohérence de certaines situations nous apparaissent ainsi notamment par l’entremise du grotesque, de la caricature, du burlesque. L’injustice caractérisant la prégnance des inégalités raciales perdurant au cœur du système est également suggérée par le recours à un discours largement démagogique : Dorval est un brave policier au service du petit peuple contre l’avis de ses supérieurs ; l’enquêteur mis en scène par T. Delsham a démissionné de la police pour protester contre les failles d’un système judiciaire « à la carte ». Le propos se fait enfin globalement cynique et ironique à l’égard de la métropole et du « pouvoir blanc », non sans, là encore, une certaine démagogie. Le parti pris idéologique affiché par les auteurs ayant recours au roman policier n’est évidemment pas le seul fait des créolistes : il s’agit-là d’un des principes du genre découlant de la variante noire. Dans le cadre de notre corpus, nous remarquons ainsi notamment l’engagement partial de certains auteurs, tel Jean-Pierre Koffel, dont le propos consiste à mettre en scène des personnages de justiciers, afin de contrecarrer le pouvoir des « méchants » :
« Je n’écris pas pour empêcher quoi que ce soit. […] Pourquoi écrire plutôt un roman noir ? Tout simplement parce qu’un roman noir, c’est comme un conte de fées, c’est le seul moyen de rétablir un équilibre, d’exercer une vengeance, de restituer l’ordre du bonheur : le méchant ogre s’est transformé en souris ; le chat l’a mangé. »[409]
Lorsqu’il met en scène, dans Des Pruneaux dans le tagine, Virna Carlie, tueuse redoutable liquidant un à un les membres d’une organisation pour la défense anti-terroriste, c’est donc logiquement en la présentant malgré tout comme une pacifiste luttant contre la répression raciste exercée sur les partisans de l’autonomie, tout particulièrement dans les dernières années du Protectorat marocain. L’action menée par Virna Carlie est ainsi jugée salvatrice pour le peuple et justifiée par la description d’un contexte socio-historique marqué par les tortures et diverses violences exercées par quelques partisans extrémistes d’un pouvoir colonial oppresseur. C’est donc la violence et l’oppression du système colonial qui sont ici dénoncées. Cependant, tout en raisonnant selon une logique manichéenne, J-P. Koffel se garde d’assimiler « bons » et locaux, « mauvais » et colons. Lui-même est franco-marocain et Virna est, selon les dires de l’auteur[410], une « colon italo-américaine ». En revanche, les représentants de l’ordre français sont directement visés dans ce roman : de nombreux gradés, de l’armée et de la police, comptent parmi les volontaires de l’organisation anti-terroriste. Par ailleurs, seul Perrin s’émeut des méthodes brutales répandues dans les commissariats ; il quittera la police après son expérience sous le Protectorat marocain.
Dans une perspective se voulant moins burlesque que celle développée dans les romans des créolistes ou de D. Chraïbi, c’est une nouvelle fois l’Etat français qui est ici mis en cause, et ce, logiquement sous les traits de l’instance le représentant encore, non tant par le droit que par les armes : la police.
Inscrite dans la même lignée, l’orientation choisie par B. Sansal et Y. Khadra semble, quant à elle, relever d’une logique encore distincte. Leurs enquêteurs, dispensés de souffrir d’une quelconque forme de pathologie à l’égard du pouvoir, se révèlent être néanmoins tous deux issus des maquis. Loin de les conditionner paradoxalement à la reproduction des mécanismes coloniaux, cette position leur permet de réaliser la dérive poursuivie par leur pays.
Quelle que soit la représentation choisie, la plupart des enquêteurs mis en scène n’échappent pas à l’inconfortable situation d’entre-deux que leur impose fatalement leur position de représentants de l’ordre au service d’un système construit dans un contexte post-colonial ; c’est sur l’ambivalence de cette position que nous nous proposons de revenir ici.
2.2.2- Les représentants de l’ordre post-colonial : entre désillusion et aliénation
La situation d’entre-deux à laquelle se voient confrontés la plupart des représentants de l’ordre qui nous sont présentés se manifeste selon un double point de vue : tandis que Bouaffesse (Chamoiseau) et le chef Mohammed (Chraïbi) témoignent de l’ambiguïté de leur position de manière quasi pathologique, en intériorisant le conflit, Larbi (Sansal), Llob (Khadra) ou encore Bahri (Lamrini) perçoivent le malaise au travers de leur propre appréhension du pays. Les uns se font le réceptacle de la dérive et intériorisent le malaise, d’où les excentricités émaillant les comportements décrits ; les autres en témoignent, se font les spectateurs de cette dérive et procèdent à une mise en question de leur propre fonction.
Llob et Larbi ont en commun d’avoir contribué à la libération de l’Algérie, par leur action dans le maquis, d’où le patriotisme émanant de leur discours.
Guidé par l’enthousiasme paternel (« La patrie, fiston, c’est la fierté d’appartenir »[411]), Llob se révèle être ainsi un fervent défenseur de la cause patriote, à la limite parfois du fanatisme ; il déclare notamment : « J’ai vu des mouchards se faire égorger derrière les buissons desséchés et j’ai pleuré de ne pouvoir les saigner de mes propres mains »[412]. Choqué par la trahison du Directeur du CNRS envers le pays, dans La Foire des enfoirés, Llob en vient ainsi à lui tirer, gratuitement, une balle dans la jambe, « comme si quelqu’un d’autre s’était introduit dans ma peau pour prendre les commandes »[413]. C’est, par ailleurs, en hommage au combat indépendantiste d’un ancien moudjahid que Llob en vient à menacer les témoins d’une affaire de mœurs : « Au plus profond de mon être, je refusais catégoriquement de soupçonner un moudjahid de la trempe du sous-préfet capable de couver un quelconque béguin pour un morveux de quatorze ans »[414].
Cet « enthousiasme » se fera progressivement nostalgique, au fil de sa carrière, sans qu’il puisse néanmoins oublier, d’une part, l’amour voué au pays tel qu’il le rêvait alors (« L’Algérie, Monsieur Faïd, c’est comme de l’or, plus on s’y frotte, plus elle brille »[415]) et, d’autre part, ses souvenirs douloureux d’enfant sous la colonisation (« A cette époque, c’était toujours le colon qui avait quelque chose à célébrer. […] C’est pourquoi, jusqu’au jour d’aujourd’hui, là où il y a de la joie je me découvre aussitôt un coin d’exclu »[416]). C’est sans doute là que demeure la blessure la plus profonde de Llob, celle expliquant sa constante amertume : le rêve des libérateurs algériens, loin de se réaliser, est devenu cauchemar.
Tandis que, face à cette réalité, Llob se réfugie dans le cynisme, Larbi, quant à lui, ne peut que s’en remettre à un certain fatalisme :
« Il
avait fait le maquis comme on fait son service militaire, une feuille de route
à la main et la tête farcie de réclames, aimé la vie au grand air comme on
court les femmes, supporté les corvées avec courage, couvert les copains sans
contrepartie, fait le coup de feu sans haine. Depuis l’indépendance, il n’avait
jamais fait de discours haineux ni jamais œuvré à détruire des gens, mais il
avait passé sa vie à écouter un seul son de cloche. »[417]
Propulsés avec leurs idéaux dans les rouages du pouvoir, Llob et Larbi ont progressivement décelé les failles du système qu’ils servaient, l’un devenant alors aigri, l’autre résigné :
« J’observe
une minute de silence à la mémoire des serments maquisards des martyrs du
savoir et de mes idéaux. Ensuite, avec le courage des fuites en avant, je
gravis un perron hollywoodien tel un supplicié l’échafaud. »[418]
« Désespéré
de voir mon monde s’étioler dans le souffle des chimères ; désespéré de
constater, à mon âge finissant, que rien ne subsiste des espoirs que je
m’escrimais à entretenir, malgré l’adversité, malgré l’avancée hunnique de
l’opportunisme et de la boulimie des arrivistes. »[419]
« Ils
m’ont foutu à la porte. Après trente-cinq ans de corps à corps avec les
imbéciles. Trente-cinq années à subir toute sorte de vexations, à croire dur
comme fer à l’ordre, aux principes, à la loyauté malgré les mensonges, les
manœuvres démagogiques, les saloperies. »[420]
Quant à Larbi :
« Tout
est pourri ! Le vieil homme sentit son moral se déliter et le dégoût
l’envahir. Nous sommes des charognards, putain de nous ! […] Depuis trente
années, installés dans la névrose, nous vivons sur les morts au point que la
vie n’est qu’une contemplation hallucinée. »[421]
« Il
était vieux lui aussi, non par son âge mais d’avoir tardé à vivre en homme, et
sentait venir sa fin dans la même violence, la même indifférence, le même
mépris. Trente années durant, chien de caserne, chien de palais, chien de rue,
il avait servi un système qui du haut de son olympe crachait sur le peuple à
genoux. »[422]
L’amertume de ces propos témoignent de l’extrême désillusion de ceux qui, patriotes et anciens maquisards, victorieux de la guerre d’Indépendance, se voient irrémédiablement désormais tenus en échec face aux nouveaux puissants tenant à la gorge le reste du pays ; échec d’autant plus cuisant qu’il place les représentants de l’ordre au cœur de la cible terroriste. A l’aigreur, s’ajoute alors la peur, là encore vécue cyniquement par l’un, de manière fataliste par l’autre :
« Je
passe un bon quart d’heure à faire le guet derrière ma fenêtre au cas où un
terroriste s’aviserait de me faire péter ma tirelire-à-préjugés. »[423]
« A
Rouiba, on s’habitua à le voir aller et venir, toujours d’un pas tranquille,
malgré la certitude sur le temps d’être la cible d’un intégriste en maraude et
de figurer sur la liste secrète des policiers abattus à l’air libre d’un
carrefour. »[424]
Ce renversement de perspective paraît d’autant plus pervers qu’il place symboliquement les anciens moudjahidin dans la ligne de mire de ceux qui occupent aujourd’hui clandestinement le maquis. A l’inverse de la position adoptée par D. Chraïbi ou P. Chamoiseau, les policiers mis en scène par les romanciers algériens de notre corpus se retrouvent au centre de la cible, visés tant par les islamistes que par la mafia politico-financière, l’oppresseur colonial ayant été supplanté par un nouveau dominant.
C’est donc par le biais des représentants de l’ordre que le sentiment de peur inévitablement ressenti par la population algérienne à l’égard du terrorisme nous apparaît dans ces romans, révélant par là-même l’impuissance des pouvoirs publics dans ce qui se présente comme une guerre civile ; une impuissance, symbolisée par Llob ou Larbi et accentuée, semble-t-il, par la complicité de certains représentants de l’ordre. L’assassinat de Llob, après qu’il ait refusé de réintégrer la police, laisse entendre l’existence de connexions entre les pouvoirs publics et les terroristes. Adoptant presque fatalement une position tendant à la schizophrénie, Llob et Larbi se voient ainsi contraints de lutter contre le terrorisme, au sein et au moyen d’un système lui-même gangrené. Cette perspective apparaît encore nettement dans le roman de R. Mimouni, Tombéza, notamment avec la mise en scène d’un policier redoutable et plus que douteux, le commissaire Batoul.
Si Llob voit en son patron et en Bliss des « ennemis » potentiels, à l’intégrité douteuse, il accepte néanmoins de reconnaître le courage de l’un -Llob apprécie le geste de son patron qui lui adresse un vibrant et public hommage au moment de son départ de la police- et l’efficacité de l’autre -non sans une certaine amertume, Llob ne peut que s’incliner ponctuellement devant la perspicacité de Bliss. Le personnage du commissaire Batoul, mis en scène par R. Mimouni, se révèle être, à l’inverse, résolument négatif car entièrement déterminé par son enrichissement personnel, et ce, à n’importe quel prix.
Notons par ailleurs qu’en mettant en scène des représentants de l’ordre définis comme des rêveurs déçus de l’Indépendance, Y. Khadra et B. Sansal semblent suggérer le caractère illusoire du sentiment de libération car, comme le remarque Llob : « Que peut-on attendre d’un système qui, au lendemain de son indépendance, s’est dépêché de violer la veuve de ses propres martyrs ? »[425]. La mise en évidence d’un système corrompu, inégalitaire, violent et inébranlable souligne, quant à elle, la conservation de certains traits propres au mode de fonctionnement colonial.
Nous remarquons que tandis que B. Sansal et Y. Khadra insistent sur la violence et l’installation d’une véritable mafia politico-financière au cœur du système, en écho à l’actualité meurtrière de l’Algérie contemporaine, Rida Lamrini choisit d’axer son propos sur la corruption généralisée au sein de l’économie marocaine et J-P. Koffel dénonce encore la toute puissance d’une « bourgeoisie puante qui tient le haut du pavé [et] a mis en otage tout un peuple et en esclavage des enfants »[426]. Autrement dit, il s’agit pour ces auteurs de mettre en évidence, de manière subjective, les stigmates d’un système colonial que l’accès à l’Indépendance n’a pas permis d’enrayer totalement, favorisant l’instauration d’un système profondément pervers et inégalitaire. Cette constatation rejoint dès lors celle que nous avions précédemment émise en évoquant la mise en scène d’enquêteurs névrosés, tels Bouaffesse ou Mohammed. Il convient néanmoins de préciser que chez ces deux derniers, le malaise résultant de la confrontation de leur fonction à leur identité profonde, se manifeste également par un rapport problématique à la langue française.
Llob, Larbi ou encore Bahri et Perrin font véritablement figure de révoltés aigris, face au constat impuissant de l’injustice et de la perversité du système qu’ils servent. A l’inverse, d’autres, dont Bouaffesse et le chef Mohammed, intégrant sans discussion la fonction attribuée par la hiérarchie, nous apparaissent comme profondément aliénés à ce système. Cette situation témoigne du refus ou de l’incapacité à réaliser les tenants et aboutissants d’un pouvoir exercé dans la violence et la répression, tout en s’inscrivant officiellement dans une perspective post-coloniale de désaliénation et dont l’absurdité transparaît dans le rapport entretenu par ces hommes avec la culture française, avec la langue de l’ancien dominant. Précisons tout d’abord qu’en dépit des affinités sensibles entre le discours de P. Chamoiseau et celui de D. Chraïbi, il convient de souligner la différence de statut entre la Martinique, devenu département français en 1946 et le Maroc, sous protectorat français à partir de 1912 et indépendant depuis 1956. En outre, la Martinique décrite par P. Chamoiseau est celle des années 1950, celle de la politique d’assimilation. Le Maroc dépeint par D. Chraïbi est, quant à lui, daté de l’été 1980, autrement dit plus de vingt ans après l’Indépendance.
Deux points essentiels de la critique menée par ces deux auteurs nous paraissent néanmoins très proches : d’une part, la langue française est perçue par les deux enquêteurs comme une arme du pouvoir et un symbole d’autorité, l’une par rapport au créole, l’autre par rapport à l’arabe dialectal ; d’autre part, le rapport de Bouaffesse et Mohammed à l’institution policière et à ses méthodes rend compte de la bureaucratisation et de l’étatisation de l’administration, soumise à un fonctionnement rigide et à certains égards autoritaire.
Soumis à des accès de folie furieuse, leur conférant des airs de dictateur chaplinesque, Bouaffesse et Mohammed se révèlent être néanmoins contrôlables par le simple recours à la langue française. Prêt à s’abattre sur le vieux Congo osant braver son autorité, Bouaffesse se voit ainsi subitement raisonné par la simple énonciation du terme « procédure », le mot faisant alors à la fois sens et symbole :
« Je
vous en prie, Brigadier, ne gênez pas la procédure !… Le mot procédure avait toujours de l’effet sur
le brigadier-chef. Douché, il fit signe à ses hommes d’étouffer leur boutou
puis se brancha en direction des pompiers […]. »[427]
Reprogrammé par l’invocation à « l’officialité », Bouaffesse troque alors ses élans de sauvagerie primitive contre les bienséances obligées de la procédure, dans une attitude de soumission quasi hypnotique, soulignant non tant les bienfaits de l’encadrement réglementé imposé aux représentants de l’ordre, que la totale aliénation du brigadier-chef, véritable automate de la fonction publique. Totalement assimilé, voire aliéné, au système qu’il sert, le brigadier-chef se conforme intégralement à son rôle de représentant de l’Etat métropolitain, reniant sa culture profonde, occultant sa créolité. Il est intéressant de relever à cet égard une remarque de Richard Burton :
« Le
pouvoir non seulement régit le comportement extérieur du dominé mais s’implante
jusque dans son for intérieur et, de ce fait, rend la résistance, dans le sens
d’une négation totale du pouvoir, littéralement impensable. Désormais toute contestation aura lieu sur le terrain
de l’Autre, en employant contre lui des armes que lui-même a forgées, notamment
la langue française et l’idéologie assimilationniste qu’elle relaie. »[428]
Cette perspective paraît totalement subvertie par Bouaffesse, en ce que l’Autre n’est plus le dominant traditionnel, le Blanc, mais le dominé, c’est-à-dire le créole du petit peuple, autrement dit lui-même. C’est ainsi que Bouaffesse tente de se servir du français contre les témoins de la mort du conteur :
« Afin
de coincer ce vieux nègre vicieux, il fallait le traquer au français. Le
français engourdit leur tête, grippe leur vicerie, et ils dérapent comme des
rhumiers sur les dalles du pavé. En seize ans de carrière, le brigadier-chef
avait largement éprouvé cette technique aussi efficace que les coups de
dictionnaire sur le crâne […]. »[429]
Le passage est intéressant dans la mesure où il suggère un rapprochement entre la violence des méthodes policières et celle, moins physique mais tout aussi traumatisante, développée notamment auprès de jeunes écoliers convertis de force au français, le traditionnel annuaire étant supplanté par un dictionnaire pouvant faire écho à la politique d’assimilation appliquée notamment au cœur du système scolaire.
Handicapé, entre autres, par une expérience marquante de la colonisation vécue sous les ordres du dominant -par sa participation active à la guerre d’Algérie-, Bouaffesse se révèle ainsi incapable de renverser la politique assimilationniste contre l’Autre/Blanc. Cela ne l’empêche pas, néanmoins, de faire ponctuellement preuve d’une certaine lucidité. Il constate par exemple amèrement que « les officiers de police judiciaire étaient des Français de France, et les uniformes, des bougres natifs-natal »[430] ; il déplore encore que les procès-verbaux ne soient pas écrits en créole, puisque son chef considère que c’est une langue à part entière ; il reconnaît enfin que le gwo ka peut avoir des effets envoûtants expliquant la passivité des témoins de la mort de Solibo. Toutefois, ces brefs éclairs de génie ne suffisent pas à susciter une quelconque résistance en lui, laissant alors libre cours à la phagocytose de son identité créole. C’est alors l’occasion pour P. Chamoiseau de s’attaquer, d’une certaine manière, à cette phagocytose, en révélant un personnage débordant de créolité malgré lui, ce dont témoigne la truculence de certaines réflexions du personnage :
« Tu
ne sais pas parler français ? Tu n’es jamais allé à l’école ? Donc tu
ne sais même pas si Henri IV a dit “Poule au pot” ou “Viande-cochon-riz-pois
rouge” ?… »[431]
Ou encore :
« Bouaffesse
a perdu pied : trop de témoignages, trop d’anecdotes, les bords du puzzle
ne s’emboîtent pas dans sa tête. Il dit : Faudrait tirer le canari du feu
et goûter la sauce pour voir s’il n’y a pas trop de sel…
-
Tu veux faire le point ?
-
Ou la virgule, si tu veux… »[432]
Autant d’effets témoignant, en fait, non tant de la créolité débordante de Bouaffesse que d’une certaine volonté de l’auteur de rendre compte du caractère inexorable de cette créolité. P. Chamoiseau semble ainsi doter son personnage -de manière certes vivace mais néanmoins artificielle- de la résistance dont, seul, il ne parvient à faire preuve.
A l’inverse, dans le roman de D. Chraïbi, Une Enquête au pays, le chef Mohammed ne semble capable d’exprimer sa « marocanité » qu’à travers l’usage d’un langage ordurier, contrairement à Ali qui dispose d’une véritable culture maternelle. Cachée par le vernis d’officialité imposé par le chef, la culture profonde d’Ali fait rapidement surface au contact des Aït Yafelman, détenteurs de la culture ancestrale. Doublement occidentalisé -exerçant son autorité au travers de l’usage de la langue française et ayant bénéficié d’un « stage de superfectionnement »[433] chez les « Lamirikanes »[434]-, le chef Mohammed révèle, par son extrême vigilance à l’égard des « insectuels », la clé de voûte de tout système autocratique reposant sur la négation de la pensée. Le corps engoncé dans un uniforme, l’esprit prisonnier d’une pensée unique, le chef Mohammed se révèle être le produit désastreux de trois facteurs : la volonté de briller, en réaction au sentiment d’infériorité née de la colonisation ; la rigidité du nouveau pouvoir, en l’occurrence celui de Hassan II, traquant le moindre signe d’opposition ; la modernité et de manière générale l’occidentalisation, poussant à délaisser la culture marocaine traditionnelle.
Comme nous l’avons suggéré plus haut, Bouaffesse et ses hommes, tout comme le chef Mohammed, ne sont pas en rupture par rapport au système colonial ; ils ont été recyclés par lui, d’où la négation de leur identité ante-policière et leur soif d’autorité. Ce « recyclage », s’il avère être aliénant pour certains (Bouaffesse, Mohammed, mais aussi Pilon « le rationaliste »), se fait lucratif pour d’autres (Batoul, par exemple) et, à l’inverse, destructeur pour les idéalistes (Llob et Larbi, notamment). Loin d’être anodine, l’introduction, dans ces romans, du corps policier implique une réflexion, plus ou moins approfondie, sur les stigmates d’un système colonial prégnant ayant introduit ses propres méthodes de fonctionnement. Menée par des personnages aux prises, de manière plus ou moins flagrante, avec l’histoire coloniale du pays, l’enquête de fiction se transpose alors logiquement dans une réflexion engageant un questionnement de fond sur le pays lui-même.
II- Tenants et aboutissants par-delà l’enquête de fiction
Quelques romans de notre corpus pratiquent la forme policière dans une acceptation essentiellement ludique : c’est le cas par exemple des œuvres tunisiennes qui, outre le jeu construit autour de l’énigme, s’évertuent, de manière générale, à souligner la qualité de vie tunisienne, notamment en regard de son voisin algérien ; c’est le cas encore des romans tels que Morts sur le morne et Au vent des fleurs de canne, dont les auteurs, tout en proposant une peinture sociale de l’univers antillais, ne semblent pas véritablement charger leurs intrigues d’un contenu ou d’une ambition permettant de dépasser la perspective ludique. En revanche, la plupart des romans de forme policière qui nous intéressent affichent, de manière plus ou moins appuyée, des objectifs dépassant largement le simple cadre de l’énigme de fiction. Comme nous l’a laissé entendre l’étude consacrée à l’héritage colonial perdurant tant au sein de l’inconscient collectif qu’au niveau des instances administratives, la reprise de la forme policière, en proposant une mise en évidence du crime, suscite logiquement la réalisation d’une enquête. S’inscrivant dans le cadre de sociétés post-coloniales, soumises, de surcroît, à de nombreux dysfonctionnement inhérents à l’ère moderne, l’enquête de fiction semble alors permettre un glissement du propos dans une sphère extra-romanesque, vers l’univers du réel. Dépassant les limites de la fiction, le roman entre, en effet, dans une véritable exploration du monde réel, conformément à la variante noire du genre ; c’est l’occasion, pour le décor, de passer à l’avant-scène, pour le contexte, d’occuper plus largement le texte.
1- Etat des lieux
Il est frappant de constater que la plupart des crimes commis, dans les romans de notre corpus, le sont non par des « illuminés » isolés répondant à leurs seules pulsions, mais par des individus socialement conditionnés à ce genre d’agissements, soit qu’ils cherchent à se défendre ou à se protéger, soit qu’ils tentent de s’affirmer, de s’enrichir ou de se positionner socialement. Dans les deux cas, la société et ses dysfonctionnements se retrouvent au cœur du problème, en ne parvenant pas à préserver les individus, voire en les incitant au crime.
Avant de tenter de comprendre le fonctionnement des sociétés décrites, nous nous proposons d’en brosser un rapide état des lieux qui nous permettra notamment de distinguer trois grandes aires, nous donnant à voir différents tableaux, différentes tonalités.
1.1-
Le chaos
algérien
Axée sur le crime, l’obscur, l’instabilité ou l’incertitude, la variante noire du genre policier semble pouvoir proposer au discours algérien une tribune parfaitement adaptée à la noirceur de la situation sociale contemporaine du pays, ainsi que le souligne notamment Guy Dugas :
« Dans
un pays soudain en proie à tous les excès et à toutes les dérives, quand les
intellectuels se taisent ou sont bâillonnés […] -la fonction fantasmatique
prenant le pas sur la dépendance idéologique- le cri ne paraît plus pouvoir émaner que de formes d’expression
jusqu’alors inusitées ou marginalisées. »[435]
Il s’agit-là vraisemblablement d’une sorte de stratégie du désespoir, à la fois nourrie et nourrissant toute une perspective contextuelle sanguinolente.
1.1.1- Rappel de quelques évènements clés
Avant de nous pencher plus précisément sur le contexte sanglant dépeint notamment dans les romans de Y. Khadra et B. Sansal, il convient de rappeler quelques éléments relatifs à la situation algérienne contemporaine, à la lumière de quelques ouvrages et articles d’histoire politique.
Remarquons tout d’abord qu’il n’y a rien de très étonnant à ce que la variante noire de la forme policière se soit développée en Algérie, à la suite des Salim Aïssa et Djamel Dib, au cours des années 1990. Cette décennie a en effet subi, de la manière la plus radicale, les effets de trois évènements en particulier, qui nous paraissent fondamentaux dans ce contexte : les émeutes d’octobre 1988, l’interruption du processus électoral en décembre 1991 et l’assassinat du Président Boudiaf en 1992. Ceci explique que, contrairement aux romans de B. Sansal et Y. Khadra, le roman de R. Mimouni, Tombéza, publié en 1984, ne soit pas marqué par un contexte aussi sanglant -bien qu’anticipant déjà, d’une certaine façon, sur la tragédie à venir ; nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
L’automne 1988
est marqué, en Algérie, par une amplification des mouvements populaires contestataires dont la jeunesse se fait le
principal porte-parole, au cours du mois d’octobre, dans des manifestations
dont la virulence va aller croissant. Dans un article paru dans Le Monde
diplomatique[436],
Akram Ellyas fait état de l’« incroyable violence » des émeutes du 4
octobre, dont l’intensité s’amplifie lourdement le lendemain et les jours
suivants. Manifestant sa colère notamment contre la hausse des prix et la
raréfaction des produits de première nécessité, la jeunesse algérienne plonge
alors Alger et d’autres villes du pays dans « un chaos sans égal depuis
l’indépendance »[437] ;
chaos d’autant plus profond que l’armée, pour rétablir l’ordre, fait plusieurs
centaines de victimes et que, aux dires de certains observateurs, des jeunes
« sont sauvagement torturés après leur arrestation »[438].
Le 5 octobre, la rue principale d’Alger est saccagée ainsi que le luxueux
complexe socioculturel de Ryad El-Feth, les émeutiers répondant aux
humiliations et à l’oppression quotidiennes, comme le souligne
« Pendant
des jours entiers, ces jeunes vont parcourir les rues, détruisant tout ce qui
symbolisait la hogra [définie plus
haut comme « la violence feutrée, insidieuse et méprisante »] qu’ils
subissaient jusque-là. Sans Dieu ni maître serait-on tenté de dire. Sans autre
but que celui de casser. Ce n’est qu’au bout de quelques jours que les
dirigeants islamistes comprendront (seuls ou leur en a-t-on soufflé
l’idée ?) qu’ils peuvent se mettre à la tête du mouvement. »[439]
L’état de siège est ainsi décrété le 6 octobre ; les autorités civiles et administratives sont placées sous le commandement militaire ; des blindés envahissent Alger, alors qu’un Comité national contre la torture est créé, à l’initiative des universitaires. Le 7 octobre, 6000 à 8000 islamistes défilent dans le quartier de Belcourt ; le 10, les islamistes défilent à nouveau, à Bab-el-Oued, mais en se heurtant cette fois-ci à une répression sanglante de l’armée faisant une trentaine de morts. Comme le souligne Wadi Bouzar, cet événement va se révéler déterminant pour l’assise des islamistes sur le pays :
« Ils vont disposer après octobre 1988 d’atouts uniques. En effet, ils s’imposent à la faveur d’un événement dont ils n’ont pas pris l’initiative : octobre 1988 mais où, il est vrai, ils laissent des victimes. Le pouvoir leur « donne » des martyrs. De plus, se substituant aux carences de l’Etat, les islamistes s’efforcent de prendre en charge la question sociale. »[440]
Le 10 octobre, le Président Chadli Bendjedid annonce des réformes ; le 11, un premier bilan paraît, faisant état de quatre cent cinquante à cinq cents morts depuis le début des émeutes ; le procès des émeutiers débute : des milliers d’arrestations marqueront les jours suivants.
Au-delà de la perspective strictement politique et des bouleversements occasionnés dans l’organisation sociale du pays, les évènements d’octobre 1988 marquent un tournant dans la conception même de la violence :
« Plus
que tout, c’est l’irruption de la violence qui marquera les journées d’octobre.
Ce pays où le nombre de hold-up dépassait à peine la centaine en vingt années,
où les armes à feu -fusils de chasse exceptés- étaient inexistantes, va
redécouvrir la mort par balles et assister à la propagation incontrôlée de
fusils automatiques aussi bien dans les zones rurales que dans les centres
urbains. »[441]
Ainsi, malgré les efforts consentis -adoption d’une nouvelle constitution par référendum en février 1989, ouverture au pluralisme politique, autorisation de la création d’associations à caractère politique, émergence d’une presse plurielle indépendante, suppression de la Cour de Sûreté de l’Etat, ou encore ratification de la Convention internationale contre la torture, en avril 1989-, le gouvernement ne parvient pas à enrayer la crise durablement. Le succès du Front Islamique du Salut[442] au premier tour des législatives -48% des voix, après une première victoire, en juin 1990, aux élections municipales-, le 26 décembre 1991, entraînant la suspension des élections par la coalition politico-militaire et l’arrestation de nombreux militants du F.I.S., plonge à nouveau le pays dans le chaos. Chadli Bendjedid démissionne, le 11 janvier 1992, le processus électoral est suspendu et Mohamed Boudiaf[443] est appelé à la tête du Haut Comité d’Etat. L’année 1992 est néanmoins marquée par une série d’attentats et de troubles publics violents : en janvier, des « éléments armés » attaquent un poste militaire à Rounda faisant un mort ; en février, des échauffourées à Batna font cinq morts ; le 8 février, des troubles dans une vingtaine de villes font près de quarante victimes ; au cours des mois de février et mars, plusieurs policiers et gendarmes sont blessés ou tués.
A l’origine de la dissolution du F.I.S., le 4 mars 1992 et affichant sa volonté de « démocratiser le régime et de s’en prendre à la corruption militaire et politique »[444], Mohamed Boudiaf est finalement victime d’un attentat meurtrier, le 29 juin 1992. Un assassinat dont les commanditaires demeurent mystérieux et qui se révèle être doublement symbolique en ce qu’il signe le terme de la vague de démocratisation espéré par Boudiaf, privant par là même le régime de « sa légitimité historique essentielle, celle de la “révolution algérienne”, par la disparition de la figure d’un de ses fondateurs »[445]. Une féroce répression militaire s’engage alors contre les mouvements islamistes clandestins, comme l’A.I.S. (Armée Islamique du Salut, bras armé du F.I.S.), entraînant une nouvelle vague d’attentats et la formation de plusieurs groupes islamiques et plus précisément les Groupes Islamiques Armés (G.I.A.), regroupant des intégristes favorables à la lutte armée, des anciens combattants de la guerre d’Afghanistan et quelques maquisards islamistes ; le Mouvement de l’Etat Islamique (M.E.I.), implanté dans les montagnes ; ou encore le Front Islamique du Djihad Armé (F.I.D.A.), spécialisé dans l’assassinat d’intellectuels. Cette « spécialisation » sera particulièrement mise en oeuvre au cours de l’année 1993, marquée par de nombreux assassinats, comme celui de l’écrivain Tahar Djaout, le 26 mai -il meurt le 2 juin au terme d’un profond coma-, du psychiatre Mohammed Bousebsi et de l’universitaire Mohammed Boukhobza, en juin, ou encore du poète Youcef Sebti, le 28 décembre.
L’« engrenage de la violence et de la contre-violence »[446] devient alors l’unique règle : au printemps 1994, l’Armée multiplie les opérations dans les maquis, allant jusqu’à mener des bombardements au napalm ; parallèlement, les attentats terroristes se multiplient -le dramaturge Abdelkader Alloula est assassiné le 16 mars 1994 ; de nombreux civils sont encore exécutés, les terroristes s’attaquant aux hommes, femmes, enfants, hommes et femmes d’église, personnalités politiques, coopérants, etc. ; un Airbus d’Air France est détourné le 24 décembre 1994. Devenu chef de l’Etat le 30 janvier 1994, Liamine Zéroual est réélu en novembre 1995. Les attentats à la voiture piégée se multiplient dans les grandes villes algériennes : la guérilla s’installe à la périphérie urbaine, dans les banlieues de Blida ou d’Alger. Par ailleurs, des actions terroristes sont également menées en France, notamment dans le métro parisien, en 1995. Commençant à refuser leur aide aux G.I.A. au cours de l’année 1996, des villageois sont alors assassinés. Les massacres se répandent en 1997, comme à Raïs, aux portes d’Alger, le 29 août, faisant près de trois cents victimes, puis le lendemain, provoquant la mort d’une quarantaine de personnes, ou à Beni Messous, le 8 septembre faisant quatre-vingt-dix morts, ou encore à Benthala, le 22 septembre où quatre cent dix-sept corps sont suppliciés dans un massacre qui dure six heures, ce qui a soulevé une immense polémique sur la responsabilité, voire la complicité de l’Armée.
Les élections municipales du 23 octobre 1997 donnent vainqueur le parti de Liamine Zeroual, le Rassemblement national démocrate (R.N.D.), mais la plupart des partis dénoncent une fraude électorale. Une marche de protestation est alors menée par le Front des Forces Socialistes (F.F.S.)[447], suivie par plusieurs milliers de personnes. Malgré cela, les élections législatives de décembre 1997 donnent encore plus nettement la victoire au parti de L. Zeroual. Au cours des mois d’août et septembre, les massacres se multiplient dans les villages autour de la capitale.
Le 11 septembre 1998, L. Zeroual annonce sa démission. Le 16 avril 1999, A. Bouteflika remporte l’élection présidentielle au premier tour, après que les six autres candidats se soient retirés, dénonçant des fraudes. Le 5 juin, l’A.I.S. annonce sa reddition et un accord secret est signé entre ses chefs et le gouvernement. Le 8 juillet, le projet de loi sur la concorde civile[448] est adopté, puis approuvé par référendum le 16 septembre.
L’année 2001 est marquée par une série de manifestations et souvent d’émeutes notamment en Kabylie, du 25 au 29 avril, faisant plus de quarante morts. Alger est, par ailleurs, touché par différents attentats à l’explosif. Le début de l’année 2002 est marqué par de nouvelles vagues de contestation en Kabylie ; la tension est à son comble entre forces de l’ordre et manifestants. Le 8 avril, le Parlement algérien vote le tamazight langue nationale, mais les manifestations se poursuivent. D’autre part, les GIA pousuivent leurs actions meurtrières dans le pays.
Le bref survol que nous proposons de la situation algérienne de ces quinze dernières années, se révèle être nécessaire à la compréhension du discours de fond véhiculé dans les romans de Y. Khadra et B. Sansal. Non exhaustif, il insiste plus particulièrement sur les éléments relatifs à l’Histoire contemporaine de l’Algérie, les plus nettement perceptibles au sein des textes étudiés.
1.1.2- Le « noir » pour dire la guerre
Sous la plume d’un ancien officier de l’Armée algérienne et d’un haut fonctionnaire de l’Etat, ces éléments sont nécessairement traités avec un certain parti pris, donnant à voir un point de vue engagé et précis sur une situation qui, notamment perçue de l’extérieur, avec les lacunes médiatiques qui caractérisent le traitement de l’information en provenance d’Algérie, se révèle être particulièrement complexe. Ainsi, comme le souligne Farida Boualit :
« La
littérature algérienne des années 90 se conçoit comme une écriture-témoignage
dont la caractéristique principale est la vraisemblance. C’est, comme on peut
le constater à la lecture des textes, une littérature réaliste qui fonctionne
comme un compromis entre l’exactitude historique et la liberté de l’écrivain
(sans souci du pacte social qui le lie à ses lecteurs). »[449]
Nous nous proposons donc de donner à voir les prises de positions de Yasmina Khadra et Boualem Sansal notamment, en regard des informations dont nous aurons pu nous munir, à la lecture de différents ouvrages politico-historiques traitant de la question.
Conformément au constat général, les romans de Y. Khadra donnent différentes prises de vue de la flambée de violence qui a marqué la dernière décennie en Algérie. Il est notamment intéressant de constater l’évolution perceptible dans le traitement du meurtre même, au fil des cinq romans noirs écrits entre 1990 et 1998.
Le Dingue au bistouri, initialement publié en 1990, en Algérie, met ainsi en scène des meurtres particulièrement sanglants (victimes éventrées, cœur arraché), exprimant l’extrême détresse d’un homme, victime des dysfonctionnements de la société, se sentant trahi par elle et par les rêves qu’elle lui avait laissés caresser. Ce profil de serial killer, assoiffé de vengeance, laisse place dans le roman suivant, à une autre perception du crime ; si les meurtres perpétrés renvoient encore des images d’horreur parfois insoutenables, ils ne relèvent plus de la folie des criminels, mais, à l’inverse, d’une démarche tout à fait réfléchie. Là, le crime se fait plus pragmatique, répondant à un projet animé non par un quelconque désir de vengeance, mais bien par une quête d’enrichissement. De passionnel, le crime se fait alors professionnel, les tueurs agissant « proprement » (balles à bout portant, enlèvements, témoins gênants abattus systématiquement), et relevant d’un profil quelque peu mafieux -le caractère symbolique de l’un des meurtres, commis d’une balle dans l’œil, semble ici en attester.
Publiés en France, dans le cadre éditorial d’une « trilogie », les trois romans suivants -dont les deux premiers paraissent en 1997, au moment où la violence atteint son paroxysme en Algérie-, poursuivent la perspective du « meurtre professionnel » et par intérêt, en accentuant, d’une part, la toile de fond mafieuse -la mafia politico-financière est, dès lors, ouvertement montrée du doigt- et, d’autre part, le caractère sanglant des meurtres, un peu comme si l’extrémisme de la détresse populaire s’était mise au service des puissants. Le changement de perspective ici suggéré, rendant compte de l’évolution de la nature des crimes, est également repris par B. Sansal. Evoquant les différents trafics régnant au cœur de l’activité marchande de Rouiba (« un saint troquerait son auréole pour un étal »[450]), Larbi précise :
« Ainsi
était Rouiba ; il y a peu.
Or voilà
que le terrorisme a ajouté les couleurs du feu de l’enfer, le vacarme des
explosions, l’odeur du sang et de la poudre, et semé dans les têtes de
nouvelles maladies. »[451]
De même, faisant directement référence au contexte marqué par les actions terroristes, Y. Khadra choisit de dépeindre un tableau particulièrement sombre et agité, le crime dépassant le strict cadre de l’enquête. Il est ainsi constamment question de diverses actions criminelles, commises en marge des affaires dont Llob se voit chargé : voiture piégée devant le commissariat[452] ; attaque d’une Poste par des terroristes, avec prise d’otages, à laquelle Llob et Lino se voient confrontés par hasard[453] ; attaque de terroristes dans un village voisin de celui où Llob est venu passer quelques jours[454] ; ou encore « bataille rangée entre les flics et un groupe de terroristes » qui oblige Llob a faire un détour[455]. Dans ce dernier cas, la scène ne nous est pas décrite, l’habitude de tels affrontements prenant, d’une certaine manière, le pas sur la curiosité, l’indignation ou même la peur.
En effet, dans les romans de Y. Khadra, comme dans celui de B. Sansal, et conformément à l’orientation traditionnelle du genre, la mort devient cyniquement presque familière. Un renversement de perspective s’opère néanmoins : tandis que dans le roman noir traditionnel, les personnages témoignent d’un certain effroi face à la mort, la peur et la menace, sous les yeux d’un lecteur globalement insensible au crime, dans les romans noirs algériens, les personnages adoptent, à l’inverse, un certain fatalisme face aux atrocités meurtrières commises, et ce, non sans susciter l’émoi du lecteur, conscient que la fiction proposée s’inscrit dans une perspective tragiquement réaliste ; un réalisme attesté dans le texte notamment par des passages perçus comme de véritables témoignages sur l’horreur quotidienne, et ce, d’autant que le lecteur, notamment le lecteur français, à qui s’adressent d’un point de vue éditorial ces romans, manque de ce genre d’informations. L’évocation concrète de l’activité quasi mécanique régnant au sein du cimetière musulman, « grouillant et vindicatif, en passe de ravir la palme au souk qui se meurt »[456], participe de l’impression amère laissée au lecteur :
« Le cimetière n’a plus cette sérénité qui savait
recevoir le respect, apaiser les douleurs, exhorter à une vie meilleure. Il est
une plaie béante, un charivari irrémédiable ; on excave à la pelle
mécanique, on enfourne à la chaîne, on s’agglutine à perte de vue. Les hommes
meurent comme des mouches, la terre les gobe, rien n’a de sens. »[457]
Cette forme d’accoutumance à l’horreur et à l’état d’alerte permanent contraste néanmoins, d’une part, avec l’horreur des crimes évoqués (victimes égorgées, écorchées, décapitées, dépecées, brûlées) et, d’autre part, avec la menace permanente pesant sur les policiers. Des collègues de Llob sont ainsi assassinés, lui-même est menacé par le biais de coups de fils anonymes, de menaces écrites, d’envois de colis contenant le nécessaire de la toilette mortuaire ; il est même attaqué et échappe de justesse à la prise en chasse de son véhicule ponctuée par une importante fusillade.
Directement en prise avec la situation réelle, cette approche évoque le sort réservé aux policiers, dès les premières vagues d’attentats terroristes en Algérie, au début des années 1990. Dans une perspective identique, B. Sansal déclare ainsi que Si Larbi « a été construit à partir d’un policier réel assassiné dans des conditions similaires à ce personnage assis entre deux chaises, entre deux époques »[458]. Luis Martinez nous apporte quelques précisions sur cet acharnement meurtrier exercé par les terroristes sur les forces de police en Algérie :
« Alors
que les forces de sécurité se sont concentrées sur les militants du FIS
répertoriés à la DGSN (Direction générale de la sûreté nationale), émergent des
moudjahidin de quartier qui s’élancent à mobylette à l’assaut des patrouilles
de la gendarmerie, ou des jeunes gens heureux d’assouvir leur envie de revanche
contre des forces de sécurité qui n’ont pas hésité, en octobre 1988, à réprimer
les émeutiers. Les “émirs” de bandes armées qui structurent cette violence et
la canalisent contre les forces de sécurité émergent comme de nouveaux meneurs
et leur ennemi s’incarne dans la figure de “l’inspecteur”, honni en dépit du
succès de la série télévisée “Tahar l’inspecteur”, téléfilm comique dont le
héros est un officier de police sympathique. »[459]
Prises régulièrement pour cibles par des groupes autonomes, les forces de police ont ainsi rapidement été marginalisées, comme le souligne, au sein de la fiction, le commissaire Llob :
« J’étais
le bon flic du quartier, constamment disponible et désintéressé, et mon gourbi,
à défaut de faire figure de confessionnal, accueillait sans distinction de
mœurs ou de race d’interminables cohortes de marginaux. Je n’étais pas le
prophète, cependant, me semblait-il, je disposais d’un contingent d’ouailles,
de quoi ravitailler dix révolutions. Puis on s’est mis à canarder mes
collègues, et mon univers s’est subitement dépeuplé. Dans la rue, on fait comme
si on ne me connaissait pas. Être proche d’un poulet, c’est s’exposer
bougrement. Surtout quand ça mitraille tous azimuts. »[460]
Cette marginalisation de la police en général se manifeste de diverses manières, du regard apitoyé des civils, au mépris soulignant, à certains égards, l’influence du discours et de l’action islamistes sur la population -le terme de « taghout » est ainsi utilisé pour désigner les policiers et traduit par l’auteur, dans l’avant texte de Morituri, par : « dictateur. Mot employé par les islamistes pour désigner tous les employés du gouvernement jusqu’aux petits flics ».
Ainsi, à propos du gardien de son immeuble, Llob constate :
« Je
lui fais de la peine. Dans sa modeste conception des choses, il me considère
comme mort. Il est même étonné de me voir survivre aux jours. »[461]
Par ailleurs, s’adressant à Llob qui tente d’obtenir des informations, un cafetier s’exclame :
« T’es
pas le bienvenu, le flic. Je suis tellement allergique aux poulets que la vue
d’un œuf me fait dégueuler. »[462]
En partie responsable de l’aigreur du commissaire Llob, le dénigrement des forces de police traditionnelles est par ailleurs accentué par la création de différentes unités spéciales, chargées de rétablir l’ordre par la répression. Dans leur article, Olivier Mongin et Lucile Provost évoquent notamment la mise en place, après les attaques ayant touché la police traditionnelle, de différentes sections : un corps d’armée spécialisé antiguérilla, créé en septembre 1992 et chargé de coordonner les actions anti-terroristes, sous l’autorité du général Mohamed Lamari ; ou encore les Groupes d’intervention et de surveillance (G.I.S.), « les plus convaincus et les plus opportunistes qui, sous une cagoule, sont prêts à tout », incluant les ninjas chargés de « ce que le corps d’armée ne peut pas faire à visage découvert »[463].
Dans les romans de Y. Khadra, il est ainsi question de la difficile coopération entre la police, mise à l’écart, et l’Observatoire des Bureaux de Sécurité (O.B.S.), chargé de superviser les missions délicates ; l’auteur algérien évoque encore les ninjas, dirigés par le lieutenant Chater et qui manquent de tirer sur Llob et ses hommes dans une embuscade tendue par leurs adversaires.
L’épisode relatant l’incident entre les ninjas et les hommes du commissaire Llob nécessite quelques précisions : prenant un suspect en filature, Llob et ses hommes sont conduits aux portes d’une villa dans laquelle l’homme s’introduit ; ne le voyant pas ressortir, les policiers décident d’entrer et sont alors surpris par Chater et son unité, alertés par un coup de fil anonyme les ayant prévenus de la présence de malfaiteurs dans la villa. Ce n’est qu’à la grâce d’un cri désespéré de Lino annonçant leur identité, que Llob et ses hommes échappent aux armes des ninjas, réalisant qu’ils ont été piégés. Ce scénario prend un relief tout à fait intéressant à la lumière de certains témpignages, rapportant notamment le recours du G.I.S. au même type de procédé :
« Les
policiers sont parfois utilisés comme des appâts par le G.I.S. (Groupe
d’intervention et de surveillance), unité spéciale chargée de la lutte
antiterroriste, qualifiés de “ninjas”, en raison de leur visage dissimulé par
une cagoule. Des policiers sont “placés” dans des quartiers connus pour la
présence de “partisans du djihâd”, les hommes du GIS embusqués à
proximité attendent que ces derniers se manifestent en attaquant les policiers
en fonction, et les neutralisent. »[464]
L’épisode de l’incident entre les ninjas de Chater et les hommes de Llob n’est probablement pas anodin et rend compte du danger engendré par la multiplication des forces répressives évoluant en marge les unes des autres, se télescopant parfois.
L’évocation de ces forces spéciales émaille également le texte de B. Sansal. Il est ainsi fait référence, de manière particulièrement critique, à la mise en place des ninjas :
« Les
gens sont tordus autrement, ils se divisèrent, chacun ne voulant voir qu’un
aspect de l’affaire […] ; ils ergotent, ils ergotent, en supporters
chauvins qu’ils sont, mais ils sont loin de savoir où passe la ligne de
démarcation entre terrorisme et contre-terrorisme. Ils virent se multiplier les
barrages, les vrais et des faux, et les abus les plus incompréhensibles ;
ils durent obtempérer et soumettre leur résidu de dignité à la rudesse de ces
troupes d’un genre nouveau que la rue appelle les “ninjas”. Ainsi furent-ils
baptisés à leur première apparition ; c’était à Alger, en juin 91, lorsque
les islamistes, charmés par leurs succès de rue, s’étaient mis en tête de se la
faire courte et de prendre d’assaut la forteresse du régime. »[465]
Tour à tour « félins », « Rambos » ou « extraterrestres »[466] dans l’imaginaire populaire confronté à ces hommes cagoulés, les ninjas apparaissent, sous la plume de B. Sansal, comme des automates violents au service d’un pouvoir autoritaire et répressif. L’émoi de Larbi, découvrant les restes d’une opération menée par les ninjas, en atteste :
« Les
ninjas n’avaient rien laissé à la chance. Ils l’ont joué à pot de fer contre
pot de terre ; l’art de la guerre étant la suprématie et celui du ménage
le harcèlement de jour comme de nuit. Après les avoir débusqués de leur cache,
[…] les darkis les avaient rabattus vers la pinède où les ninjas campaient à
plat ventre. Le tonnerre des armes avaient duré pour soudainement céder la
place à un silence que même les oiseaux n’osaient rompre. »[467]
Si, comme nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, les policiers traditionnels mis en scène, tels Larbi ou Llob, font figure de victimes, d’idéalistes déçus et pacifistes en regard du contexte général, les forces spéciales créées pour répondre aux attaques terroristes nous sont décrites selon une perspective nettement moins conciliante[468]. Présentées comme des organes de répression exerçant leur autorité violente, tant sur les « véritables terroristes » que sur les éventuels suspects, autrement dit la population civile, ces nouvelles forces suscitent, dans le discours de B. Sansal notamment, des rapprochements avec les méthodes criminelles employées pendant la guerre d’Algérie :
« Les
corps des terroristes gisaient sur le dos, côte à côte, arrangés pour la prise
de photos que réalisait un opérateur dépêché sur les lieux par le bureau du
commandement militaire. Il y avait dans ses manières comme un engouement qui
donnait à la scène une atmosphère de retour de la chasse. Larbi se remémora sa
jeunesse, le fossé qui se creusait, les morts qui le comblaient, les journaux
des ultras qui étalaient des cadavres de dangereux fellagas et prônaient un
traitement plus radical, et la “voix des Arabes” qui menaçait de s’étrangler à
force de harangues dans la nuit. Rien n’avait changé, ni le bleu du ciel, ni la
litanie des jours, ni la teneur des communiqués. »[469]
C’est donc bien d’une nouvelle guerre qu’il s’agit, comme le laisse entendre Hamidi, l’ami de Larbi, historien :
« La
guerre d’Algérie, commencée il y a quarante ans, se poursuit et va vers un
terrible dénouement. L’histoire se venge, elle s’écrit désormais seule, sur nos
décombres à tous. »[470]
Nous retrouvons le même type de remarque, hors fiction, notamment dans un article rédigé par l’anthropologue Gilbert Grandguillaume :
« La violence d’aujourd’hui est la suite de celle d’hier. A partir des années 1990, les mouvements islamistes ont utilisé contre l’Etat une violence qui s’enracinait dans la haine de l’Etat sécrétée par celui-ci. A l’heure actuelle, elle s’origine à trois sources. Le pouvoir exerce une répression contre les islamistes armés, mais en même temps contre ceux qui veulent le remettre en cause, et contre les populations qu’il soupçonne de sympathies islamistes. Les groupes islamistes armés (GIA) luttent contre le pouvoir, en utilisant les moyens, jadis utilisés par le FLN, pour contraindre la population par le terrorisme ; ils semblent de plus largement manipulés par le pouvoir. Enfin, une violence trouve son origine dans la délinquance généralisée, qui conduit des individus et des groupes à profiter de l’anarchie régnante pour se livrer à des crimes crapuleux. A la faveur de cette situation, beaucoup de haines passent à l’acte, des milices de tous bords s’arrogent droit de vie et de mort sur les citoyens. » [471]
C’est précisément cet ancrage de la violence dans l’Histoire qui conduit les enquêteurs à se tourner vers le passé pour mener à bien leur réflexion, fidèles en cela au principe fondateur de l’enquête de fiction.
Dans le roman noir traditionnel, l’atmosphère générale est à la morosité ; l’enquêteur n’a rien d’un être parfait, mais au-delà du pessimisme, de l’aigreur et du cynisme qui le caractérisent en surface, il se révèle être animé d’un profond idéalisme, caressant secrètement le rêve d’un monde meilleur. Cette perspective apparaît dans les romans noirs algériens de B. Sansal et Y. Khadra qui nous invitent à suivre les pérégrinations de deux anciens maquisards, épris fièrement de leur pays ou plutôt de la manière dont ils l’ont rêvé, et confrontés à des crimes aussi sanglants que prémédités, pensés et conçus à des fins lucratives. L’introduction de forces de l’ordre évoluant en marge de l’univers de ces deux policiers, dont le point de vue guide largement la narration, accentue par ailleurs le caractère marginal de ces idéalistes et par là même la portée de leur discours critique.
Les différents ressorts propres au roman noir classique, tel qu’il s’est notamment développé à ses débuts, sont également repris : présence d’une organisation mafieuse à l’origine du mal ; scènes d’actions, filatures, courses poursuites ; confrontation de l’enquêteur miséreux avec le faste des villas des corrompus et des profiteurs du système ; et bien évidemment, peinture sombre de la ville et de ses habitants. Cette dernière caractéristique est ainsi largement exploitée par B. Sansal et Y. Khadra, mais également par un autre Algérien, Rachid Mimouni ; tous trois semblent dépasser le stade du crime pour entrer, d’une certaine façon, dans une phase autrement plus répugnante : celle de la putréfaction.
1.1.3- Du sang à la putréfaction
Plongés au cœur de ce qui nous est présenté comme une guerre civile, les romans de B. Sansal et Y. Khadra, en illustrant de manière à la fois sanglante et pragmatique les dégâts résultant de la spirale meurtrière du terrorisme/contre-terrorisme, nous donnent logiquement à voir une société en état de décomposition ; c’est en quelque sorte à l’autopsie du cadavre de la société algérienne que ces auteurs procèdent.
Témoins des premiers pas de l’Indépendance, comme de la flambée de violence de la fin du siècle, Y. Khadra et B. Sansal dénoncent globalement les mêmes dysfonctionnements, en une faillite avérée des pouvoirs publics dans des secteurs essentiels. Il est ainsi question, dans ces romans, de la dégradation du système de santé[472]. C’est par exemple en raison d’une erreur médicale due à un manque de moyens et d’effectifs, que meurent l’épouse et le nouveau-né de celui qui deviendra, par vengeance, le « Dingue au bistouri », poussant le commissaire Llob à s’exclamer :
« Après
tout, qu’est-ce qu’un criminel sinon le crime parfait, toujours impuni, de la
société elle-même… »[473]
Boualem Sansal insiste également sur cette dégradation du secteur sanitaire, en multipliant notamment les métaphores, assimilant l’hôpital de Rouiba à la fois à « une usine à l’étroit dans ses murs »[474], « une usine en grève »[475], « une usine en faillite dédiée à la casse »[476], « un souk inhumain »[477] et à un « chantier perpétuel »[478], un « drame architectural » dégageant une « atmosphère carcérale »[479]. B. Sansal propose ainsi une vue d’ensemble particulièrement glauque suggérant, d’une part, le manque de moyens et le danger par là même suscité et, d’autre part, la responsabilité de ceux qui s’efforcent de tirer profit du système :
« Le souk de l’hôpital est inhumain ; les incubes et succubes qui le régentent font dans ce qui leur sied et désespère le client ; ils empochent sur l’hospitalisation des malades, leur pitance anémique, le médicament périmé, le sang contaminé, le fil chirurgical grenu, le film brûlé, les seringues brisées ; ils grappillent sur les menus services comme veiller un opéré à l’occasion, répondre à ses SOS quand il émerge de la mort chimique, aérer sa literie à défaut de la brûler au phosphore, tempérer le vent infernal des gogues, prolonger son séjour jusqu’à ce que la guérison devienne une hypothèse crédible. Mais gaffe ! ce qui se conclut la veille se renégocie le lendemain à l’ouverture de la Bourse. »[480]
Ou encore :
« L’hôpital de Rouiba n’est pas seulement une usine en faillite, un lupanar clandestin, un marché noir. C’est un merdier pour les vivants qui s’y aventurent et le plus malencontreux des enfers pour qui y trépasse. La santé n’a pas sa place dans cette auberge. »[481]
La critique de ces deux auteurs s’étend encore au système scolaire. L’un des fils de Larbi « végète », nous dit-on, dans l’enseignement, avec néanmoins une « maigre consolation » en ce que « sept élèves sur dix manquent déjà à l’appel »[482]. Cette perspective à la fois désespérée et fataliste est également de mise en ce qui concerne le fils aîné de Llob, Mohamed, 26 ans, au chômage bien que titulaire d’un doctorat en histoire-géographie et recyclé, grâce aux relations de son père, comme secrétaire dans une entreprise à la dérive. Si de jeunes diplômés ne parviennent pas à s’épanouir et à évoluer au sein de la société, l’avenir réservé aux exclus du système scolaire ne laisse, dès lors, guère d’espoir[483]. Le commissaire Llob ne cesse ainsi de se lamenter sur le sort de ces « teneurs de murs », les hittistes, qui hantent les rues de la ville. Dès le premier roman policier de Y. Khadra, les constats du commissaire se font à cet égard particulièrement amers :
« Ils
ne savent plus où aller, ni quoi faire de leur existence. Leur horizon est
obstrué par les nuages des interdits. Hier, c’était les mégots et le ballon
ficelé. Aujourd’hui, c’est peut-être le kif. Et demain, c’est pas facile à
prédire. Ils sont là, à empêcher les murs de s’écrouler, un œil sur les
tristesses environnantes, un autre errant dans des rêves impossibles ; et
ils rigolent pour tromper la désillusion, et ils font semblant d’être malins,
et ils crèvent de frustration chaque jour un peu plus. […] Jeunesse perdue, je
compatis. »[484]
Le regard porté par B. Sansal sur la jeunesse algérienne se fait non moins pessimiste :
« Traquée
par les négriers, enchaînée par la loi sur l’apprentissage, surveillée par la
religion, battue en brèche par la vie qui ne leur passe aucun élan, cette
jeunesse sans rêves d’escapade besogne dans un ennui grave sous la férule de
maîtres artisans madrés dont le seul art est de jouer religieusement du
chasse-mouches en dévisageant avec dédain les passants qui passent et les
prétentieux qui y regardent à deux fois. »[485]
Cette vision désenchantée transparaît également dans la manière dont Larbi considère la jeunesse ; donnant ses instructions à un collègue, il déclare ainsi :
« -
Renseigne-toi sur ce jeune, là-bas. Nom, adresse, réseau d’affiliation, café ou
bar d’attente, mur ou mosquée de ralliement. »[486]
Tout comme Larbi, Llob semble laisser entendre l’activisme potentiel de cette jeunesse livrée à elle-même et gorgée d’amertume :
« Pas
de librairies, pas de salle de cinéma, rien que des nuées de gosses livrés à
eux-mêmes […] ; des gosses amers, agressifs, rancuniers, voués à toutes
les frustrations et qui apprennent -le plus tôt sera le mieux- à braver les
interdits, à singer les lendemains, à forger en silence des représailles
terribles. »[487]
Les représailles de cette jeunesse désespérée, suggérées par Llob, nous apparaissent de manière plus concrète, notamment à la lumière des explications apportées par Luis Martinez, sur le mode de recrutement des groupes islamistes dans la sphère hittiste :
« Inconnus
des différents services de renseignement, non inscrits sur les fichiers de
suspects islamistes, ignorés par les responsables des lieux de culte, les
jeunes “moudjahidin” de quartier sont le produit de la répression et de la
pauvreté. Témoins des arrestations massives perpétrées contre les militants du
FIS, de l’élimination des groupuscules “partisans du djihâd” […], ils demeurent
dans l’expectative jusqu’à ce que leur parviennent les échos des accrochages
menés par les hommes de A. Chébouti[488].
Leur djihâd ne se fera pas dans les maquis mais dans leur quartier où ils
évoluent avec plus d’assurance. »[489]
L. Martinez évoque, par ailleurs, le désir de vengeance de certains hittistes à l’égard des forces de l’ordre, comme dénominateur commun de leur engagement dans la lutte islamiste[490]. Or, la perception de ces jeunes semble relever, dans le discours de Llob, de la compassion, dans la mesure où il considère ces exclus du système comme les victimes de l’incapacité de l’Etat à exploiter ses richesses, celles de la jeunesse ou encore celles de la culture. La description que Llob fait de son ami Arezki rend compte de ce sentiment :
« Arezki
Naït-Wali est un génie. La preuve, il se terre dans un cul-de-sac au fin fond
de Bab El-Oued, enseveli sous les piaillements des mioches et le linge des
familles nombreuses. »[491]
L’ensemble du roman est, en ce sens, placé sous le signe du désespoir d’une culture niée, voire traquée ; Llob y perdra la vie. On remarque ici que si Larbi meurt d’avoir oser braver les puissants trafiquants mafieux, Llob succombe aux représailles succédant à son refus de réintégrer la police en reniant son roman, les deux hommes étant finalement punis pour s’être mis en quête de vérité, pour avoir exprimé leur désir de parler. Le rapprochement entre l’action de la justice et l’acte intellectuel, suggéré notamment par l’activité scripturale de Llob, renvoie à la double action meurtrière menée par les terroristes contre les policiers et le milieu intellectuel. Au-delà des nombreux civils assassinés, Y. Khadra insiste ainsi sur la répression menée à l’égard de l’élite intellectuelle, en choisissant d’aborder cette question essentielle -lui-même a choisi un pseudonyme et a dû quitter l’Algérie par sécurité- sur différents modes. Le sage Da Achour explique ainsi :
« Le
monde se dépoétise. Les beautés toutes simples de naguère n’interpellent
personne. Il n’est de drame que dans la faillite, de foi qu’en
l’investissement. L’homme n’a plus de conscience, mais seulement des idées
fixes : pognon-oseille-fric ; pognon-oseille-fric ;
pognon-oseille-fric… Il est persuadé que les valeurs fondamentales dépendent
exclusivement du baromètre boursier. C’est pour cette raison que la mort d’un
érudit, l’incendie d’une bibliothèque ou l’assassinat d’un artiste l’émeut
beaucoup moins qu’un mauvais placement. »[492]
Mettant au service de cette vision désenchantée le cynisme propre à tout enquêteur de roman noir, Llob explique encore la situation différemment :
« -
Quel gâchis ! pourquoi diable s’acharne-t-on comme ça sur les gens de
lettres, commy ?
-
Ça ne date pas d’aujourd’hui, Lino. C’est une vieille histoire.
Traditionnellement, dans notre inculture séculaire, le lettré, ça a toujours
été l’Autre, l’étranger ou le conquérant. Nous avons gardé de cette différence
une rancune tenace. Nous sommes devenus viscéralement allergiques aux intellos.
Et chez nous, à l’usure, il arrive que l’on pardonne la faute, jamais la
différence. »
Le jugement sévère de Llob renvoie au traumatisme laissé par la colonisation et aux absurdités engendrées par le rejet vindicatif de tout ce qu’a drainé le système colonial. C’est cette même perspective que Llob accentue lorsque Lino lui demande la raison de l’emploi du terme « inculture » :
- C’est à cause d’un regrettable lapsus. Il y a très longtemps, notre ancêtre voulait écrire un bouquin. Comme il ne pouvait pas réfléchir le bide vide, la tribu lui a mijoté un festin incroyable et il a bouffé avec un appétit tel qu’au moment de s’attaquer au manuscrit, il s’est aperçu qu’il avait bougrement envie de piquer une sieste. Le problème, il craignait qu’à son réveil sa muse disparaisse. Un vrai dilemme. Alors saint Ziri, notre père à tous, lui est apparu. Il lui a demandé ce qui n’allait pas. Notre ancêtre lui a expliqué qu’il avait en même temps une insurmontable envie de roupiller et un incommensurable besoin de rédiger ses mémoires. Saint Ziri, qui fut un grand mécène de son vivant, a eu ce malencontreux lapsus. Au lieu de lui dire “rédige”, il a dit “digère”. Et depuis, nous n’arrêtons pas de digérer.
-
Jamais grand-père ne m’a conté une chose pareille.
-
C’est parce qu’il ne pouvait pas parler la bouche pleine… »[493]
Il s’agit pour Llob de restituer aux Algériens leur part de responsabilité dans la dérive du pays en mettant en avant, par le caractère grotesque de l’explication, l’incapacité de l’élite à guider correctement les « bonnes volontés ».
Nous retrouvons ce discours teinté de moralisme dans l’évocation d’autres dysfonctionnements, comme par exemple la pénurie de logements qui touche les milieux urbains ou encore le chômage[494], avec ce que cela comporte de conséquences désastreuses, parmi lesquelles la misère, la multiplication des sans-logis et surtout le développement incontrôlé des trafics en tout genre, et notamment du trabendo[495].
Ces nombreux dysfonctionnements assurent le déséquilibre incessant du pays et constituent ce que B. Sansal nomme :
« La partie visible de
l’iceberg, qui plonge sa masse dans une mer de doutes ténébreux, de remises en
cause sporadiques, de haines lointaines impérissables et d’espoirs
inaccessibles. »[496]
La métaphore employée par Boualem Sansal laisse entendre une certaine confusion entre le symptôme (le visible, le conséquent, le signe) et la cause (l’invisible, l’antécédent, la face cachée) : les nombreux dysfonctionnements énoncés précédemment témoignent de la dérive algérienne en même temps qu’ils l’expliquent. Par ailleurs, si le terrorisme a considérablement accru la crise depuis la fin des années 1980, ses causes/symptômes n’ont rien de nouveau ; ceci explique le retour dans le passé pour comprendre le présent et permet de saisir encore les similitudes indéniables s’établissant entre les romans de B. Sansal et Y. Khadra, d’une part, et celui de R. Mimouni, d’autre part, de dix à quinze ans leur aîné.
L’Algérie décrite par R. Mimouni, dans Tombéza, nous apparaît, en effet, déjà dans un état de décomposition : le rebus dans lequel Tombéza est « conservé » en atteste ; la critique sociale également. Concernant la jeunesse en péril, R. Mimouni écrit :
« […]
les dizaines d’adolescents éjectés du système scolaire à l’âge où l’on veut
conquérir le monde, pour se retrouver le nez contre le mur de l’implacable
réalité et passer toutes leurs journées à traîner devant les portes des
supermarchés d’Etat dans l’attente de la sortie d’un produit inexistant sur le
marché, qu’est-ce que vous voulez on se débrouille comme on peut, les
entreprises refusent de nous recruter, trop jeunes, pas de métier, aucune
expérience, pratiquement analphabètes malgré la dizaine d’années passées à user
nos culottes sur les bancs d’une classe surpeuplée […], comment voulez-vous que
l’instituteur puisse s’occuper de moi, et je reste devant la feuille blanche où
ma pensée patine en pure perte, ma volonté s’érode devant l’indifférence de
l’enseignant qui a lui aussi ses problèmes, […] il faut qu’il aille à la mairie
supplier un bureaucrate pour obtenir une quelconque pièce, je vous le dis, moi,
monsieur, dix ans d’enseignement et un salaire de misère, le marchand de
légumes d’en face gagne trois fois plus que moi […]. »[497]
Ce passage paraît intéressant à plusieurs égards et tout d’abord en ce qu’il se rapporte initialement à la période où Tombéza travaillait pour le colon Biget, pour finalement donner l’impression d’une certaine intemporalité, tant la situation décrite semble avoir toujours été de mise en Algérie, en particulier lorsque le récit est mené par un narrateur qui confond sans cesse les époques et les sujets. Les points de vue se succèdent ainsi, des adolescents éjectés du système, aux élèves délaissés dans des classes surchargées, jusqu’à l’instituteur négligeant car devant faire face à ses propres préoccupations, causées notamment par des dysfonctionnements administratifs -et ainsi de suite- en une spirale remontant de l’effet à la cause, englobant finalement la société dans son ensemble. Si le regard se fait ici quelque peu revendicatif, il apparaît nettement plus désenchanté, voire désespéré, dans d’autres passages où le narrateur n’hésite pas à parler de « clochardisation sociale progressive », de « gangrène gagnant un domaine après l’autre, et finissant par pourrir le pays tout entier », ou encore de « décrépitude des choses et des êtres, partout, dans toutes les villes du pays »[498] ; autant de considérations amères qui s’accompagnent d’un catalogue de preuves à l’appui :
« […]
façades d’immeubles qui tombent en ruine, jamais ravalées, jamais repeintes,
gouttières qui fuient sur les passants, égouts béants qui vomissent sans arrêt
leur liquide pestilentiel, ordures qui jonchent les rues ornées de trous
mystérieux qu’on oublie de signaliser encore moins de combler, lampadaires aux
globes brisés, fils téléphoniques qui pendent, bancs publics aux barres de bois
arrachées, feux rouges aux ampoules grillées, trottoirs aux carreaux descellés
et jamais remis, peinture effacée des passages protégés, latrines publiques qui
tombent en ruine, dont les orifices depuis longtemps bourrés laissent la pisse
surnager sur la merde, collecteurs d’eau bouchés qui voient s’inonder les rues
aux premières averses, […] et des milliers d’autres choses encore, mais
surtout, surtout, ce délabrement moral des êtres qui ne croient plus à rien,
qui ne respectent plus rien, qui ne comprennent plus rien, qui ne savent plus
rien, qui ne veulent plus rien… »[499]
Nous remarquons que ce passage semble fonctionner par a-coups, alternant images rebutantes (égouts, ordures, latrines) et constat de « simples » dégradations (fils, matériaux arrachés, appareils hors service), en une observation mimant les soubresauts provoqués par des haut-le-cœur. Le corps atteint, l’esprit ne tarde pas à suivre, désespérant les uns, « fatalisant » les autres.
C’est encore avec aigreur et crudité que R. Mimouni aborde la pénurie de logements[500], les difficultés du rationnement, les dures conditions de vie dans les campagnes, en particulier pour les femmes, ou encore et surtout le délabrement du système de santé ; autant de dysfonctionnements se faisant l’écho d’une faillite des instances de l’Etat dans la politique d’urbanisation menée après l’Indépendance, comme le remarquent Jean-Claude Brûlé et Georges Mutin :
« La
ville autrefois symbole de la domination étrangère, devient symbole du nouveau
pouvoir algérien. Mais au plan économique, de sérieux problèmes se posent et le
bilan de cette période d’urbanisation est sévère : aucune fonction
nouvelle n’a induit cette croissance. […] L’arrivée massive des néo-citadins
s’est traduite par une densification extraordinaire et une suroccupation des
locaux d’habitation. Au déficit de logement s’ajoute l’insuffisance criante des
équipements collectifs, scolaires, sanitaires, et le problème dramatique de
l’emploi. L’urbanisation, pendant cette période, est subie et n’a pas été
accompagnée par la mise en place d’une politique urbaine. »[501]
Mettant en évidence les conséquences désastreuses de tels dysfonctionnement, R. Mimouni dresse alors un portrait noir de la société, l’hôpital enfermant Tombéza dans un huis-clos propice à la réflexion, à l’introspection, à l’enquête. Largement délabré, tout en hébergeant quelques « quartiers chics » réservés aux fortunés privilégiés, l’hôpital joue ainsi le rôle de synecdoque dans la représentation du pays. Le manque de soins, de moyens, l’injustice, les trafics, les abus de pouvoir, les peines perdues, le désespoir, la souffrance, la vengeance et la quête de profit y règnent en maîtres, sur fond de maladie, de mort, de gangrène, d’insalubrité et enfin de putréfaction.
Alors que le terrorisme et la barbarie islamiste ne dominent pas encore le climat ambiant, le roman de R. Mimouni, volontairement noirci, donne à voir un pays non tant mourant que véritablement déjà mort. A cet égard, intervenant une quinzaine d’années après la publication de Tombéza, le sursaut de Larbi, vieux policier passif subitement décidé à agir, fait d’autant plus figure de réveil, voire de résurrection ; l’issue de son enquête le ramènera néanmoins à la passivité, à l’impuissance et, pour le coup, à la putréfaction. Notons par ailleurs que l’affrontement entre Batoul et Tombéza, qui s’achève par la mort de celui-ci, annonce, d’une certaine manière, les combats à venir autour de la dépouille du pays et les luttes intestines de la mafia politico-financière qui alimenteront notamment les enquêtes du commissaire Llob[502].
Tombéza semble en fait signer une transition au sein de la littérature algérienne des années 1980, en ce que ce roman se fait le témoin non seulement de la souffrance passée mais également de l’horreur présente, annonçant encore, de manière certes pessimiste mais néanmoins visionnaire, les drames à venir. Imprégné de noirceur, il semble inspirer le passage à l’« écriture référentielle », telle que désignée notamment par Charles Bonn :
« L’installation
progressive de l’horreur en Algérie depuis la fin des années 80 semble avoir
induit une autre écriture, plus « plate », plus référentielle, comme
si la trivialité du quotidien excluait soudain la littérature comme plaisir
solitaire et quelque peu détaché. Ecriture référentielle dont il faut préciser
cependant qu’elle n’est pas due seulement à la situation algérienne, mais
peut-être aussi à une évolution plus générale de la production littéraire
mondiale. La fin des années quatre-vingt marque ainsi la fin relative dans la
littérature algérienne, et plus généralement dans tout le champ littéraire maghrébin
francophone, d’une écriture iconoclaste, tant sur le plan de la forme que du
contenu. Les écrivains continueront à produire, mais avec le plus souvent des
ambitions littéraires moindres[503]. »[504]
Il s’avère, en effet, que le souci de témoigner, voire de dénoncer, concerne globalement tout le champ littéraire maghrébin francophone ; une remarque que nous nous proposons d’apprécier à la lumière des romans marocains de notre corpus.
1.2-
Le système
marocain sous la critique
Témoins d’une toute autre réalité, les auteurs marocains de notre corpus semblent opter pour un ton différent, moins tragique, plus moqueur, à une exception près : la démarche de Rida Lamrini s’inscrit globalement davantage dans la noirceur, l’amertume et le désespoir que celle de ses compatriotes. Ainsi, tandis que D. Chraïbi (Une Enquête au pays) donne à ses enquêteurs des airs de Persans, sur le modèle des voyageurs de Montesquieu, que J-P. Koffel (L’inspecteur Kamal fait chou blanc) confère à sa critique une certaine naïveté amusée, R. Lamrini semble davantage s’inspirer du modèle algérien -la qualité littéraire en moins- transmettant ses inquiétudes, angoisses et critiques avec la précision et la gravité du reportage d’actualité réalisé dans une perspective dénonciatrice. C’est cette même orientation que l’on retrouve dans le roman de Jacob Cohen qui semble néanmoins préférer au tragique le constat froid, lucide et corrosif.
1.2.1- Les milieux affairistes passés au crible
Si la position des auteurs marocains se révèle être unanime dans la dénonciation d’un système inégalitaire, marqué par de nombreux dysfonctionnements et gangrené par la corruption et les abus de pouvoir des « puissants » du royaume, l’angle d’approche choisi diffère.
A la vision grave et quasi journalistique de R. Lamrini et de J. Cohen correspond ainsi, dans un premier temps, la volonté de brosser un portrait des principaux artisans et détenteurs du pouvoir, par le biais d’une intrusion dans les milieux affairistes marocains.
C’est dans le but de traiter d’une question précise de politique intérieure ayant marqué l’année 1996, que R. Lamrini choisit d’utiliser le cadre policier. Son enquêteur se voit ainsi confronté à quelques « puissants de Casablanca », aux « intouchables » moyennant finances, et ce, alors que le gouvernement vient de décider la mise place d’une vaste campagne d’assainissement destinée officiellement à enrayer la corruption généralisée au Maroc. Cette situation laisserait supposer la mise en place des ressorts traditionnels de la forme policière classique tels que la puissance des forces de police, le retour à l’ordre, une issue favorable au combat contre l’injustice, le crime, les abus de pouvoir, autrement dit, la victoire du Bien sur le Mal. Or, la perspective développée par R. Lamrini tend à l’affirmation du contraire : en creusant les véritables tenants et aboutissants de cette campagne d’assainissement, l’auteur tente de dénoncer la vanité, l’hypocrisie et la perversité d’un système anti-corruption non seulement globalement inefficace mais également nuisible aux entrepreneurs « honnêtes ».
Engagée au Maroc au début de l’année 1996, la campagne dite « d’assainissement », décidée par le Ministère de l’Intérieur, a engendré l’arrestation de plus de deux cents personnes, dont plusieurs dizaines traduites en justice, parmi lesquels des « trafiquants de drogue, commerçants marrons, douaniers corrompus, policiers “ripoux” »[505]. Cette opération « mains propres », résultait pour partie d’engagements pris sur la scène internationale -et notamment d’accords conclus avec le Gatt- et répondait d’une certaine manière aux critiques émises par l’Union européenne et la Banque internationale à l’égard de la corruption sévissant au Maroc.
C’est ainsi en pleine campagne d’assainissement qu’Amine, personnage de R. Lamrini, revient au Maroc, après dix ans passés au Canada pour affaires. Le chauffeur de son ami lui fait alors un bref compte-rendu de la situation locale :
« On
ne parle que de la lutte contre la contrebande et la corruption […]. La police
judiciaire et les brigades de répression des fraudes organisent quotidiennement
des descentes dans les dépôts de Derb Omar. Pour une fois, les petites gens
s’amusent pendant que les gros rats trinquent. Le reste est toujours pareil. Il
y a un climat d’insécurité en ville. Les agressions se multiplient. Il faut
faire extrêmement attention, même en circulant en voiture. »[506]
Le passage paraît relativement intéressant en ce qu’il signifie la double rupture existant au sein de la société marocaine, d’une part, entre les « petites gens » et les « gros rats » et, d’autre part, entre la vie quotidienne et les décisions prises en haut lieu. De fait, le roman se révèle être marqué à la fois de constats désolés engendrés par la misère et l’injustice et de propos, de comportements cyniques adoptés par toute une catégorie de personnes vivant non seulement en marge du peuple mais également en marge des lois.
Ainsi, avant même que la campagne d’assainissement ne soit abordée, dans le roman, selon la perspective avancée par le gouvernement -comme un moyen de lutter contre la corruption-, elle nous apparaît, dans le discours des puissants, comme simple poudre aux yeux. Convaincus de la vanité de cette action et de la préservation de leur statut d’intouchables, Yamani, le grand industriel et Talabi, l’homme politique, donnent en ce sens leur propre définition de la campagne d’assainissement :
« Ce
ne sera ni la première, ni la dernière. Nous avons l’habitude. Tu sais bien,
les campagnes se suivent et se ressemblent. On tape un grand coup sur la table.
Cela amuse les gogos mais ne dure pas bien longtemps. Et finalement tout rentre
dans l’ordre. »[507]
Et tandis que Talabi ne peut s’empêcher de s’inquiéter de la détermination affichée par le gouvernement, Yamani argumente :
« Ne
crains rien, Talabi. Nombreux parmi ceux qui conduisent cette opération dans
l’administration et la politique sont ceux-là mêmes qui mangent dans nos
mains ! Tu sais, depuis que je suis à la tête de la Banque, il y a
toujours eu des ministres qui ont eu recours à mes services. Certains se
comportent comme s’ils avaient des comptes personnels chez moi, avec des
crédits illimités. Je peux te citer au moins une vingtaine de noms de ton
parti ! »[508]
Le discours tenu par Yamani témoigne de l’assurance et du manque de scrupules de ces hommes d’affaires surpuissants que le narrateur accentue en livrant quelques considérations tout aussi choquantes :
« Malika
est obsédée par la réussite professionnelle de son mari. Elle suit avec passion
les luttes feutrées pour le pouvoir qui l’opposent à ses pairs. Elle-même
manœuvre pour influer le cours des choses. Rien ne l’arrête dans la poursuite
de ses objectifs. Les soirées de Yamani sont d’ailleurs des occasions
privilégiées durant lesquelles elle met à contribution ses atouts de femme
prête à exploiter les faiblesses dont dépend l’ascension sociale de leur
couple. […] Elle n’est pas la seule. Les femmes des autres directeurs ne
demeurent pas en reste. »[509]
Les manœuvres de la femme de Yamani, désireuse de neutraliser l’enquête de Bachir, ainsi que la décision en haut lieu de classer le dossier sans suite, en laissant partir les coupables à l’étranger, participent également du dégoût que l’auteur ressent et tente de susciter à l’égard des milieux affairistes, de la bassesse de leurs manœuvres et de la complicité des autorités dans ce genre d’affaires. Déplorant le « tarif préférentiel » systématiquement adopté à l’égard des personnes disposant d’argent et de pouvoir -dans le roman, les « puissants » sont traités différemment dans les administrations et les lieux publics, comme par exemple à l’aéroport où ils évitent les contrôles douaniers approfondis et les files d’attente-, Youssef, journaliste, fait remarquer à Amine, homme d’affaires honnête et irréprochable :
« Tu
connais un moyen de demander à un officier de police de traiter les voyageurs
équitablement, sans risquer de se retrouver devant un juge pour outrage à
fonctionnaire dans l’exercice de sa mission ? Tu sais, je ne crois pas
trop les discours sur les droits de l’Homme et l’égalité des citoyens devant la
loi. Ils sont destinés à la consommation extérieure. La réalité c’est la loi du
plus fort ! »[510]
Comme l’indique ce passage, c’est bien d’une mise en cause virulente des pouvoirs publics dont il est question, dès les premières pages du roman. Au-delà de l’application d’une « justice à la carte », les forces de police se voient ainsi accusées d’arrestations arbitraires et de traitements violents à l’égard de leurs détenus. Ba Lahcen, vieux commerçant ambulant de Derb Talian, est notamment pris dans une « rafle » -titre du premier chapitre- effectuée à la suite d’un contrôle d’identité, alors qu’il a justement oublié ses papiers. Le récit des conditions de sa détention doit émouvoir d’autant plus que l’homme paraît totalement inoffensif, doux, soucieux de sa famille et pauvre :
« Le
fourgon déballa sa cargaison humaine au commissariat central. Ba Lahcen et ses
compagnons y passèrent trois nuits dans des conditions épouvantables, sans
possibilité de donner de nouvelles à leurs familles. Ils furent installés dans
des caves sales. A l’inconfort et à la promiscuité de l’endroit s’ajoutait une
insoutenable odeur de rejets humains. Il n’y avait que le sol nu pour s’asseoir
ou dormir. Les besoins urgents étaient satisfaits le long d’un mur. Rien
n’était prévu pour alimenter les locataires forcés de ces lieux peu
accueillants. Ceux qui avaient de l’argent sur eux se faisaient livrer des
baguettes de pain, des berlingots de lait, des boîtes de conserves et des
cigarettes…à condition de ne pas demander la monnaie, s’il en restait. Ba
Lahcen survécut grâce aux bonbons achetés à Derb Omar. Lundi après-midi, il fut
finalement présenté au procureur qui, après une remontrance pour non-port de
papiers, ordonna sa relaxation. C’était cher payer de sa liberté et de sa
dignité pour écouter les recommandations du magistrat ! »[511]
Cette critique à l’égard des méthodes employées par la police, et de manière générale par l’autorité de l’Etat, se révèle être directement en prise avec les nombreuses dénonciations intervenues notamment dans la presse française, relatives au non respect des Droits de l’Homme au Maroc[512].
Il est intéressant, à cet égard, de nous pencher sur la manière dont la représentation des forces de police est traitée, dans l’adaptation cinématographique qui a été faite de ce roman.
Intitulée sur les écrans « Casablanca, Casablanca », l’adaptation du roman de R. Lamrini, réalisée sous la direction de Farida Benlyazid[513], a en effet bénéficié du soutien de différents organismes d’Etat, ainsi que de la collaboration d’un commissariat de la ville ; éléments mis en évidence par la réalisatrice à l’occasion d’une rencontre-débat qui s’est tenue à Bordeaux, au cinéma Utopia, en octobre 2002. Il n’y a rien d’étonnant alors à ce que l’épisode de la détention de Ba Lahcen, comprommetant vis-à-vis des forces de police marocaines, n’apparaisse pas dans l’adaptation cinématographique du roman. Remarquons, en revanche, que le respect global de la critique émise dans le roman par R. Lamrini, à l’égard des dérives et limites de la campagne d’assainissement, peut davantage surprendre. Le débat engagé en marge de la projection à Bordeaux en a attesté, différents intervenants reconnaissant dans l’aide apportée à la réalisation du film, une volonté du gouvernement marocain d’engager une lutte devenue incontournable contre la corruption, tout en ne masquant pas les difficultés rencontrées ; d’autres y percevant, à l’inverse, une volonté de faire bonne figure vis-à-vis des instances monétaires internationales notamment ; d’autres enfin, dont la réalisatrice, y espérant le signe d’une ouverture du Maroc au débat démocratique et à la liberté d’expression. Si les deux premières remarques participent globalement du propos de R. Lamrini, porteur d’une critique virulente à l’égard du pouvoir, la dernière perspective, plus optimiste et assez largement adoptée au cours du débat, se révèle être beaucoup plus discrète, voire inexistante, au sein du roman. Le départ d’Amine, décidant de regagner le Canada, après que la répression menée contre les hommes d’affaires naviguant en marge des lois ait injustement malmené son entreprise, en atteste.
Si le roman illustre, pour partie, le caractère malsain des milieux affairistes corrompus, il témoigne, par ailleurs, des barrières dressées à l’encontre de ceux qui souhaiteraient y échapper, dans un système où la répression des fraudes ne paraît pas capable de faire preuve de lucidité. Face aux mesures prises par le Ministère de l’Intérieur, Amine s’interroge ainsi :
« Une
étrange sensation d’être épié, harcelé le taraude. Il chasse rapidement ces
pensées et se réconforte à l’idée qu’il n’a rien à se reprocher. Mais il aime
de moins en moins l’ambiance créée par une campagne qu’il a applaudie au
départ. Il se demande si les mesures prises par les autorités pour la lutte
contre la fraude et la contrebande ne vont pas tout bonnement étouffer le
commerce en jetant la suspicion sur les transactions commerciales légales. Avec
en prime, et pour de longues années à venir, l’évanouissement de l’espoir de
sortir la population des ornières de la misère. »[514]
Ses doutes deviennent rapidement amers :
« Il
allume la télévision pour tromper sa fatigue nerveuse. Il reçoit un choc. Le
présentateur du journal du soir vante les retombées bénéfiques de la campagne
d’assainissement. Avec force chiffres et moult pourcentages mirobolants,
recueillis par de mystérieux sondages à travers le pays, il annonce
triomphalement la relance sur les chapeaux de roues de secteurs entiers de
l’économie ! Amine est ulcéré. Mais qui peut contredire le discours
officiel ? »[515]
Puis, le désespoir et le renoncement font place :
« Les
puissants véreux volent pendant que la masse trime, sans pouvoir devant les
abus et les injustices. Non seulement ils ne sont pas inquiétés, mais ils sont
promus. »[516]
Le regard
porté par R. Lamrini se veut sans complaisance : la peinture est sombre,
l’espoir mince et la révolte dominante. Si la critique et le souci de
témoigner, de dénoncer dominent, la préoccupation littéraire se veut, quant à
elle, secondaire -en dépit d’un lyrisme ambiant témoignant de l’émotion de
l’auteur sans pour autant parvenir à véritablement emporter le lecteur-,
confirmant ici la remarque de Charles Bonn, précédemment cité[517],
concernant l’orientation d’une nouvelle vague d’écrivains maghrébins vers la
prise en compte de la réalité, au détriment d’un projet à vocation purement
littéraire.
Egalement engagé dans la perspective du témoignage, J. Cohen parvient en revanche à offrir un texte de meilleure qualité, nous semble-t-il, sans que le statut de l’auteur ne nous permette de douter du projet extra-littéraire sans doute mis en œuvre. Licencié en droit, diplômé de Sciences-Po Paris et maître-assistant à la Faculté de Droit de Casablanca, de 1978 à 1987[518], Jacob Cohen, né à Meknès en 1944 et vivant actuellement à Paris, propose, avec le roman intitulé Les Noces du commissaire, une peinture des milieux affairistes casablancais, non tant en regard des conditions de vie du « petit peuple » que d’un point de vue interne au milieu. Il est ainsi notamment question de la manière dont le pouvoir et l’argent sont répartis entre les hommes et surtout entre les communautés, sur fond de trafics d’influence, de stratégies financières et de luttes intestines.
Loin de fonctionner sur le modèle policier classique, ce roman propose en fait de suivre par touches, révélations, suppositions, l’itinéraire de Rachid Marouani, commissaire de police « aux ambitions énigmatiques »[519]. Ces ambitions nous sont révélées progressivement et trouvent leur aboutissement au terme du roman s’achevant finalement sur la victoire traditionnelle de l’enquêteur. Or, ce succès s’avère être pervers dans la mesure où Marouani n’a rien d’un représentant de l’ordre et possède tout du criminel, d’un extorqueur de fonds ayant, de surcroît, agi avec le soutien du Ministre de l’Intérieur. C’est ainsi au terme d’une stratégie fomentée durant plusieurs mois, que Marouani obtient 30% des parts d’un holding, et qu’il parvient, au terme d’un chantage -à la suite de l’arrestation de nombreux jeunes Casablancais de bonne famille en possession de drogue-, à « extorquer », au profit du gouvernement, de fortes sommes d’argent aux hommes d’affaires les plus puissants, sous couvert du paiement d’une taxe sur les bénéfices. C’est donc en pratiquant des méthodes jusqu’alors réservées aux milieux affairistes, adeptes des bakchichs et des pressions au cœur d’une lutte incessante pour le pouvoir, que le commissaire sombre à son tour froidement dans le crime.
J. Cohen insiste, dans son roman, sur le fait que c’est bien la communauté juive qui semble, plus que toute autre, faire les frais de cette lutte constante pour le pouvoir. C’est ainsi au détriment d’Henri Tolédano, membre influent de la communauté juive, que Marouani obtient les parts du holding, et ce, après que celui-là ait déjà, quelques années auparavant, dû accepter de céder sous la pression -et notamment celle de campagnes de presse malveillantes- 70% de son holding, à un Fassi, Si Alaoui -« un Juif ne pouvait garder à lui tout seul la haute main sur le Holding »[520]. L’illustration des guerres intestines régissant les relations entre communautés et l’évocation de l’implication active du gouvernement marocain au sein de cette course au pouvoir semblent relever d’un constat réaliste, se faisant par ailleurs entendre par le biais d’approches non littéraires. Ainsi Saïd Tangeaoui, titulaire d’un doctorat en Sciences politiques, brosse un portrait de la communauté fassie et de son fonctionnement :
« Les élites économiques fassies, comme une grande partie des élites urbaines […] continuent d’évoluer sur le même registre que le pouvoir. De même que celui-ci continue d’activer des supports traditionnels et communautaires (parallèlement aux mécanismes qui relèvent de l’Etat-nation) pour étendre sa domination, de même de nombreux groupes de la bourgeoisie urbaine continuent de recourir aux relations familiales et clientélistes de leur gestion quotidienne. En outre, une grande partie des réussites économiques d’aujourd’hui n’ont pu avoir lieu sans l’aide de l’administration centrale et de sa bienveillance. »[521]
A travers l’aboutissement du stratagème conçu par Marouani, il s’agit donc, pour J. Cohen, de rendre compte de la pression exercée sur la communauté juive détentrice d’un certain capital, tout en soulignant les liens ambigus existant entre les Fassis et le pouvoir et la manière dont ces relations réagissent aux transformations dues à la modernité et aux changements politiques. Face à Agnouche, le chef des Renseignements Généraux et aux anciens pontes du commissariat central, véritables détenteurs des lois et des trafics organisés pour le salut des riches criminels, Marouani, issu d’un milieu modeste et devant la poursuite de ses études à la générosité du Ministre, semble en fait punir les puissants, après des années de laxisme, en les prenant à leur propre piège et en profitant lui-même du système.
Si les romans de R. Lamrini et J. Cohen relèvent d’une intensité moindre que celle véhiculée par le caractère cruellement sanglant des intrigues des romanciers algériens, la gravité du ton et l’aspect référentiel du propos participent globalement de la mise en place d’une perspective extra-littéraire, relevant, le plus souvent, du domaine socio-politique et servant de tribune à une critique pouvant se faire démagogique à certains égards -il s’agit essentiellement ici du roman de R. Lamrini et de la manière dont il met en relief l’aspect tragique de certaines scènes en les couronnant de critiques largement explicites et s’exprimant selon un schéma de pensée manichéen.
Le recours à la forme policière peut ici revêtir différents aspects : il s’agit, dans l’objectif de R. Lamrini, de dénoncer globalement le Mal (la corruption, l’irresponsabilité, voire la complicité de l’Etat), en mettant en évidence la misère populaire et en opposant explicitement les « bons » et les « mauvais ». Au jeune enquêteur Bachir, qui démissionne devant le laxisme de ses supérieurs et face à l’impuissance du commissaire Nasser contraint de classer l’affaire, s’oppose ainsi l’insouciance cynique des Yamani, Talabi et consorts. A la différence de cette approche relativement conservatrice, J. Cohen opte pour une version moins manichéenne, où « bons » et « mauvais » se confondent au sein d’un système régi par la soif de pouvoir, de puissance et d’argent, s’orientant vers la forme la plus noire et la plus subversive du genre. Nous constatons néanmoins que dans ces deux cas, le recours à la forme policière semble se substituer à l’essai, voire à une critique plus polémique, par souci de vulgariser le propos mais également, sans doute, dans le but d’atténuer la portée de la critique -rappelons que ces deux ouvrages ont été publiés au Maroc.
Pour R. Lamrini et J. Cohen, le texte littéraire se fait ainsi à la fois le vecteur et la couverture d’une critique virulente et s’ils choisissent de s’inscrire, pour ce faire, dans la perspective d’un discours imprégné de gravité, d’autres auteurs, à l’inverse, profitent d’une certaine manière du cadre littéraire, et plus précisément encore de la forme policière, pour inscrire la critique dans un registre plus décalé, l’humour participant largement de la tonalité de leur propos.
1.2.2- Le système tourné en dérision
Dans la plupart des romans de notre corpus, l’orientation et la tonalité de l’enquête se révèlent être directement soumises au profil et à la manière de procéder de l’enquêteur. Compte tenu du caractère relativement insolite, tant de l’inspecteur Kamal que de l’inspecteur Ali, rien d’étonnant alors à ce que les enquêtes proposées par J-P. Koffel et D. Chraïbi ne dérivent parfois dans l’extravagance, le loufoque, voire l’absurde ; une caractéristique ne les dispensant pas pour autant de brosser un tableau incisif de la société marocaine.
Avant même la page de présentation du roman de D. Chraïbi, Une Enquête au pays, le lecteur découvre un texte d’une page, signé « l’inspecteur Ali, personnage principal de ce livre » et faisant état de la stupéfaction du héros face à la manière dont D. Chraïbi lui-même a choisi de mener son intrigue. Outre la réflexion méta-littéraire qu’il implique, ce texte nous renseigne implicitement sur les intentions de l’auteur, comme l’indique ce passage :
« Au
lieu d’avoir pitié de nous et de nous venir en aide, ce maboul de la tête
appelé Driss Chraïbi n’a pas cessé de rigoler de nous avec ses grandes dents.
Il a même mené le travail à notre place, alors qu’il n’est pas un flic de
métier ; il a même fait l’enquête sur nous autres, le chef et moi, sur la
coopération culturelle entre les polices et sur l’Etat lui-même. Et ainsi il a
crevé comme un pneu ce qui nous distingue des administrés : un bon niveau
BEPC mélangé avec une parcelle d’autorité. Et tout ça, il l’a fait rien qu’en
nous regardant manger des tagines du paradis, piquer quelques siestes ou remuer
des palabres.»
Placé en avant-texte, ce compte-rendu des dessous de l’enquête de fiction ne laisse aucun doute quant aux véritables enjeux du roman et suggère l’espèce de fausse naïveté à la fois consciente -Ali joue à l’idiot devant son chef pour endormir sa vigilance- et subconsciente -certains éclairs de lucidité semblent surgir du plus profond de son être, le rappelant à des souvenirs et des sentiments enfouis, voire refoulés-, dont le roman semble globalement imprégné. Les différents aspects de cette fausse naïveté se révèlent être propices à l’observation critique, réalisée à mots couverts et néanmoins de manière parfaitement intelligible.
Remarquons dans un premier temps, la singularité du couple Ali/Mohammed, l’un et l’autre individuellement en prise avec leurs propres incohérences et, par ailleurs, contraints de se supporter mutuellement. Ainsi, Ali semble pouvoir jouir d’une certaine vivacité d’esprit et d’une sensibilité lui permettant de saisir le sens profond des choses qui l’entourent, sans que son statut ou ce qu’il représente ne puisse lui permettre d’exploiter cette richesse. De même, le chef pourrait mettre à profit son statut hiérarchique -en l’occurrence son droit de parole et d’autorité sur Ali- au service d’une réflexion et d’une perception censées sur la société marocaine, ce que son obéissance aveugle et son ignorance ne lui permettent pas d’accomplir. La confrontation de ces deux hommes, installés dans des rôles en totale contradiction avec leur « véritable » nature et situés aux antipodes l’un de l’autre, n’est pas, dès lors, sans créer quelques étincelles, permettant finalement à D. Chraïbi de livrer le « fond » de ses personnages et d’illustrer, par extension, quelques-uns des dysfonctionnements inhérents à la société marocaine dans son ensemble. Sortant de ses gonds au contact de son subalterne, le chef, totalement aliéné à sa fonction de représentant de l’ordre, offre ainsi une parabole du rôle et du fonctionnement du pouvoir marocain, selon D. Chraïbi. Or, le chef entretient un rapport pathologique au pouvoir, constitutif de l’expérience de la colonisation ; il se montre, par ailleurs, autoritaire, violent, extrêmement suspicieux, impitoyable ; il est totalement soumis à une certaine idée de la modernité, conçue dans l’oubli de la culture traditionnelle et sur le principe d’une occidentalisation globale de la société marocaine ; il ignore tout de la culture berbère et s’acharne violemment sur les Aït Yafelman ; il est enfin un intégral abruti totalement ridiculisé par Ali, jouant les bouffons chargés non pas de faire rire le « roi », mais de faire rire de lui, comme en atteste notamment la scène suivante. Confronté à la fureur de son chef, estomaqué par l’inflexibilité d’un témoin, Ali tente de rétablir le calme, jouant les bons subordonnés en surface, ridiculisant insidieusement son supérieur :
« - Ci rien qui di fretin, chif !
Le chef le
regarda avec stupeur, bouche ouverte. Son souffle montait et descendait avec un
bruit de forge.
- Di menu fretin di rien di tout, chif !
continua l’inspecteur très vite. Sardine,
sardine pourrite… Toi, li gros
poisson, li malabar, voyons ! Sacré d’Etat !
Et sans
plus attendre il se tourna vers le paysan. […] Sur le ton de l’engueulade au
souk, il se mit à aboyer :
- Ecoute,
toi Untel au crâne pelé et Dieu constamment à la bouche ! […] Mon chef que
voilà est un homme très important, d’une importance telle qu’il y a parfois des
zèbres qui attendent des trois mois, des six mois et davantage avant qu’il
daigne les recevoir et jeter un coup d’œil sur leurs dossiers. […]
Le
montagnard écoutait et regardait ce crieur public, essayant d’interpréter les
clins d’œil qu’il lui lançait, les rictus de sa bouche, cette espèce de
rigolade muette qui agitait sa face de tics et qui rétablissait ses paroles
dans le bon sens. »[522]
Privé du visage grimaçant de l’inspecteur, le lecteur peut néanmoins apprécier la bouffonnerie de l’inspecteur et le comique de la scène, à travers les déformations infligées parallèlement à la langue française.
Si la plupart des critiques relatives à l’organisation du pays se révèlent être essentiellement transmises par l’illustration des relations riches et complexes unissant Ali à son supérieur, d’autres émanent, en outre, de simples constats émis tant par les villageois que par les hommes de loi eux-mêmes ; des critiques permises, en fait, chez Ali et Mohammed, par la confrontation avec l’étranger -d’où une certaine parenté avec les Persans mis en scène par Montesquieu. Confronté aux villageois, rattachés de force aux institutions du pays -par le prélèvement de l’impôt notamment, effectué selon une manière de procéder adaptée au caractère moyenâgeux dont les villageois sont eux-mêmes taxés-, mais idéologiquement et psychologiquement indépendants, le chef Mohammed se voit brutalement soumis à la perte de ses repères. Incapable d’exercer son pouvoir, c’est-à-dire de susciter la peur chez les Aït Yafelman, il en vient alors à s’interroger sur la finalité de son intervention dans le village :
« Tout
le monde savait que la loi faisait peur, que c’était là sa fonction sine qua non. Se pouvait-il que le point
mort de l’enquête fût imputable à ces paysans non coopératifs et à leur absence
totale de civilisation ? Mais alors !… mais alors, s’ils n’avaient
aucune manière ni rognure de civilisation, c’étaient donc qu’ils étaient
imperméables à la loi et à la…peur ? C’était donc ça, le corps du
délit ? »[523]
Toutefois, l’éclair de lucidité dont le chef semble faire preuve ici demeure à l’état du simple questionnement (« Il traça un point d’interrogation au crayon rouge, bien net, qu’il remisa ensuite dans un recoin de son vaste cerveau »[524]), tout en nous livrant le véritable motif de l’enquête, à savoir la mise sous surveillance, le rappel à l’ordre d’une population marginale échappant au contrôle direct de l’Etat. La redéfinition des tenants et aboutissants de l’enquête conduit logiquement le chef à s’interroger sur lui-même et sur son rôle. Ses pensées livrent alors quelques-uns des aspects d’un système de police autoritaire, fondé sur la surveillance et la répression, se présentant comme un organe vital incontestable de l’Etat (« Qui oserait prétendre que la police n’était pas le seul corps constitué de l’Etat doué d’une santé de fer ? »[525]), valorisé techniquement, mais peu vivace d’un point de vue intellectuel (« En cette fin de XXeme siècle, où l’on pouvait aligner dix bonshommes et les transpercer tous de part en part avec une seule balle de Magnum 35, la technologie remplaçait souverainement les idées, tous les livres »[526]), à l’image du pays dans son ensemble. A travers le chef Mohammed, ses incohérences et ses extravagances, c’est en effet une vision globale du pays que D. Chraïbi semble proposer, comme le souligne cette remarque :
« Qu’il
était passionnant, mon Dieu ! -et poignant- de suivre la trajectoire du
destin d’un homme ! Surtout si cet homme-là était le chef en chair et en
os, et si son destin, individuel certes, mais aussi concentré qu’une boîte de
sauce tomate, avait correspondu point par point et décennie après décennie au
taux de croissance économique et culturelle de toute une nation. »[527]
Frustré par l’oppression coloniale, vécue comme une humiliation notamment infligée au père, vivant à la fois en concurrence et en ostracisme vis-à-vis d’autres secteurs de l’Etat comme le Ministère de l’Economie et des Finances, formé à la technologie de l’Occident, et en particulier à celle de « l’ancienne puissance tutélaire »[528], sensibilisé à des techniques de répression particulièrement violentes et faussement valorisé par l’octroi d’une parcelle d’autorité -de même que « les pays frères n’étaient rien, oh ! rien du tout, jusqu’au jour où le pétrole leur a donné un brevet d’existence »[529]-, le chef Mohammed semble représenter allégoriquement la partie gouvernante du pays, marquée par des dysfonctionnements inhérents tant à la colonisation qu’à une indépendance mal gérée.
S’apparentant globalement à une brute épaisse ridicule, le chef parvient néanmoins à se livrer, alors qu’il se laisse aller à la pensée, usé par la chaleur et l’enlisement de son enquête. Au-delà de la caricature et du grotesque du personnage, se dissimule une souffrance profonde que la fin du roman tend à mettre en relief. Une même souffrance semble également caractériser le personnage de l’inspecteur Ali qui, éloigné de la ville et de son chef, se livre à son tour à différentes réflexions suscitées par la confrontation avec les Aït Yafelman : nostalgie des pratiques traditionnelles, mise en cause des dérives de la « civilisation », remise en question personnelle.
Ainsi, bien que le grotesque imprègne largement le roman, la profondeur de la critique et l’intensité du propos n’en demeurent pas moins vivaces, offrant une œuvre extrêmement riche et complexe. Au-delà de la dérision, c’est toute la politique de modernisation par étatisation de la société marocaine qui est ici passée au crible, mettant en relief, avec humour, une critique que l’on retrouve par ailleurs exprimée de manière plus concrète dans différentes études, comme celle menée par Robert Escallier :
« L’exigence
de modernisation implique une unité de commandement consolidée, un effort
d’équipement en services techniques de tout premier plan. Plus l’intégration
des citadins au sein de la société civile se renforce (même si elle demeure
très insuffisante en de nombreux domaines), plus l’Etat doit pallier les
“abandons forcés” de la formation sociale traditionnelle. Ainsi, l’appartenance
à la tribu, c’est-à-dire au droit coutumier, à une société rurale
non-bureaucratique, fait place à l’adhésion à une société “étatisée”. Au
mouvement d’intégration correspond l’affirmation pressante des besoins que doit
satisfaire l’Etat bureaucratique. La multiplication de ses interventions exige
le renforcement de ses structures, crée une omniprésence à la fois recherchée
et discutée. »[530]
Abandon forcé de la formation sociale traditionnelle, étatisation de la société, modernisation du mode de vie urbain, rigueur suggérée de l’Etat dans cette entreprise et contestation supposée face au poids d’une telle politique : autant d’éléments mettant en relief la soumission aveugle, l’aliénation à une certaine conception de la modernité, les méthodes répressives du chef ainsi que les déchirements constitutifs de l’abandon de la culture traditionnelle, comme en témoigne l’instabilité d’Ali.
La perspective développée dans les autres volets de la série de l’inspecteur Ali ne semble pas, à l’inverse, susciter de lecture réellement approfondie, en ce qui concerne le discours critique véhiculé. Seul le premier roman de la série, Une Place au soleil, semble offrir davantage de relief à la critique sociale : il y est question des « légions de demandeurs d’emploi »[531], des louanges au Roi véhiculées par les journaux locaux, d’un suspect « à cheval entre les forces de l’ordre et la branche armée du Front islamique du salut »[532], du culte de la chefferie, du conflit israélo-palestinien et du rôle joué dans la « réconciliation » de la France et des Etats-Unis[533] ou encore de l’intervention « des pays développés » dans les affaires de « ceux qui étaient en voie de l’être »[534]. A l’exception de quelques critiques ponctuelles, les autres enquêtes de l’inspecteur Ali perdent ainsi de la gravité sensible dans Une Enquête au pays pour laisser place aux frasques et aux fantasmes de l’inspecteur Ali.
C’est sur un mode non moins amusé que J-P. Koffel oriente l’enquête menée par l’inspecteur Kamal dans L’Inspecteur Kamal fait chou blanc. L’aspect ludique du roman semble ainsi inspiré par l’enthousiasme de l’enquêteur mais également par le caractère loufoque attribué aux habitants de la « blanche mégapole »[535], et ce, en accord avec la singularité des tenants et aboutissants de l’affaire. C’est en effet pour venger les multiples « Cosette » du pays que le mystérieux justicier choisit de s’attaquer aux riches citadins, exploiteurs de jeunes villageoises, signant ses assassinats de l’allégorique « Comité Victor Hugo », conférant par là même à l’enquête une orientation singulière que l’inspecteur Kamal, fort de diplômes obtenus en études littéraires, identifie immédiatement : « contexte littéraire, démarche surréaliste »[536].
A l’extravagance des méthodes radicales employées par le meurtrier, auteur de dizaines de meurtres, correspond en ce sens le délire fantasmatique qui s’empare des témoins assaillis par la peur :
« Les
témoignages affluèrent, comme si chacun eût voulu apporter sa petite pierre
blanche. On l’avait vu partout. Parfois au même moment mais pas au même
endroit. Là, il portait la barbe, était brun ; la jellaba était jaune. […]
La barbe revenait comme une constante et l’on finit par la lui laisser. […] On
avait ordre d’arrêter les barbus, comme sous d’autres climats, les basanés, les
chevelus, les tatoués, les tondus, les hérissons et les hérissonnes. »[537]
Ce clin d’œil du narrateur, dérivant sur les « hérissons et les hérissonnes », trouve son pendant dans l’attitude globale de la population :
« Il
n’était pas rare qu’on vît un automobiliste zélé prendre en chasse un motard
barbu, ou un motard à jellaba, ou un jeune, quelque sans barbe et sans jellaba
qu’il fût, mais qui avait une tête pas catholique, ou un porteur de paquet
suspect… Ces courses poursuites n’allèrent pas sans de fâcheux accidents,
surtout quand les poursuiveurs étaient à leur tour poursuivis par des
poursuivants, flics ou paparazzi. »[538]
Soumis à la « démarche surréaliste » du criminel, la population sombre alors dans une psychose, appelant un retour aux « bonnes mœurs », mettant en relief, par là même les prétendus maux inhérents à la société marocaine.
Il s’agit pour J-P. Koffel d’exploiter le conservatisme du roman policier, en mettant en relief le délire hypocrite d’une société soumise à l’exacerbation d’une forme de « climat de moralisme »[539] :
« La
dissolution des mœurs, la perversion du sacré, la non-observance des
prescriptions divines, tout cela était confusément perçu comme facteurs de
malédiction. »[540]
C’est alors que s’observent de profondes mutations au sein des pratiques communautaires, impliquant, dans un premier temps, la désaffection, voire la fermeture de certains établissements jugés porteurs de « pervertissement », tels les cinémas, cabarets, boîtes de nuit et autres lieux de loisir. On assiste, à l’inverse, à un retour de pratiques dites plus convenables, tels les jeux de cartes, de société, les vidéos, la lecture, l’objectif des autorités consistant en un sens à réapprendre aux gens la vie communautaire, en valorisant notamment le dialogue (« Ainsi échangeaient le mari avec sa femme, le père avec ses enfants, le frère avec sa sœur, ce qui, dans beaucoup de cas, ne s’était jamais produit »[541]) et en favorisant encore un approfondissement culturel, notamment dans le milieu cinématographique (« Les gens ne se contentaient plus de n’importe quoi et la notion de plaisir se teintait d’intelligence »[542]).
Ces changements de mode de comportements sont autant d’engagements dans la voie d’un ultra-moralisme que l’auteur couronne magistralement avec l’évocation d’une dernière évolution sociale, et non la moindre, puisqu’il s’agit de la réhabilitation, dans les pratiques de lecture et d’écriture, de la forme policière :
« On
vit la famille d’un homme d’affaires en vue se passionner pour la littérature
policière et son épouse se mettre à écrire avec acharnement. […] Signalons au
passage que cette production littéraire, un vrai bouquet, n’était pas seulement
francophone, peu s’en fallait, et l’on vit promus au rang de langues
d’expression écrite des dialectes populaires dont quelques-uns s’étiolaient
dangereusement. »[543]
Scandalisé par l’exploitation de jeunes filles chez quelques riches citadins, J-P. Koffel choisit ainsi la forme policière dans une acceptation relativement classique -dénoncer le Mal et engager la société dans la voie d’un avenir meilleur-, tout en l’adaptant à sa propre sensibilité, dans la mesure où, dans ses romans, ce sont les criminels qui nous apparaissent comme les véritables partisans du Bien. Si la bourgeoisie marocaine est ici montrée du doigt, la police, quant à elle, se voit quelque peu discréditée et tournée en dérision par le trop parfait inspecteur Kamal ; ainsi, le coupable échappe finalement aux forces de l’ordre, ce que J-P. Koffel justifie en ces termes :
« Pourquoi
choisir que mes criminels échappent à la police et aux défenseurs de
l’ordre ? D’abord parce que mes héros sont sympathiques et que, dans tous
les cas, j’ai horreur de la police et des défenseurs de l’ordre. »[544]
Alimentés par quelques personnages/énergumènes, les romans proposés par J-P. Koffel et D. Chraïbi semblent répondre à différents fantasmes suscités par la forme policière et servir les propres élucubrations d’auteurs visiblement inspirés, voire désinhibés par le genre : le premier semble partager l’idéalisme et les fantasmes d’un « Robin-des-bois » ; le second, dans un tout autre registre, donne parfois l’impression de vouloir défier les limites de la liberté d’expression, en se permettant des passages résolument provocateurs car exagérément connotés sexuellement. Les romans dont il est ici question s’engagent, en ce sens, dans une perception de la réalité alambiquée et caricaturale.
Si la caricature et le fantasme participent ici de la critique sociale, en mettant en relief le propos de l’auteur, ils semblent fonctionner de toute autre manière dans d’autres romans de notre corpus, et notamment dans quelques-uns de ceux relevant de la sphère antillaise. Révélateurs -au sens photographique du terme- chez D. Chraïbi ou J-P. Koffel, la caricature et le fantasme semblent, à l’inverse, jouer le rôle de masques, notamment dans les romans des créolistes, le caractère caricatural des personnages renvoyant en particulier à la question identitaire, l’aspect théâtral des comportements soulignant encore la spécificité des rapports communautaires.
1.3-
La mangrove
antillaise
Nous avons pu constater précédemment que la singularité du cadre insulaire déterminait un contexte propice à une forme proprement antillaise du genre policier, notamment par une prise à contre-pied des clichés et des a priori suscités par une perspective fantasmée de l’espace tropical. Obscurcissant le cadre ou le soumettant à d’autres fantasmes se voulant issus d’une perspective locale, les auteurs antillais de notre corpus, et notamment les créolistes, s’orientent vers une représentation de la vie communautaire en accord avec le contexte façonné. Aux personnages hauts en couleur dépeints par les créolistes correspond ainsi une fresque des liens communautaires qui nous apparaît grouillante, exubérante, fortement caractérisée, voire « colorée ».
De la même manière, à la perspective angoissée et largement plus introspective des personnages mis en scène par M. Condé notamment, correspond une peinture moins édulcorée, plus sobre voire plus grave.
Ces différentes approches rendent compte d’une double perspective, l’une relevant d’une démarche, à certains égards, carnavalesque[545], l’autre se voulant ancrée de manière plus concrète et réaliste dans un questionnement centré sur l’essence de la société antillaise dans son ensemble.
1.3.1- Vie communautaire grouillante : entre théâtralisation et introspection
Confrontée au genre policier et soumise, de fait, au prisme de la suspicion, la population mise en scène dans les ouvrages relevant de l’espace antillais nous apparaît dans toute sa complexité, voire dans toute sa perversité, avec ses secrets et ses tabous, ses crimes et ses faiblesses.
Fidèles à la démarche du conteur, utilisant le rire et l’autodérision comme outils de résistance, les créolistes choisissent d’illustrer les « travers » communautaires dans leur absurdité, leur grotesque, dans ce qu’ils recèlent de risible, si bien qu’il s’agit non tant de dénoncer que de simplement montrer du doigt, dans une attitude se voulant parfois tendrement moqueuse.
Suggérant la curiosité exacerbée de la population insulaire et la prise en charge collective systématique du moindre événement, P. Chamoiseau se plaît ainsi à donner aux abords du lieu du « crime », des « allures de marché à l’heure du poisson rouge » :
« La
nouvelle avait descendu les rues avoisinantes et posé son signal au bout de la
Jetée. Les capitaines des pétrolettes, les pirates errants des voiliers de la
rade, les chauffeurs de taxi et les marchandes de bizarreries touristiques,
ramenèrent leur corps et leurs questions. Puis vinrent les jardiniers de la
Savane, les employés des banques proches, les vendeurs de jus glacé et de
sorbets aux trois parfums, quelques gens des communes en descente, des
Sainte-Luciens déguisés, des Dominicains à moitié invisibles, deux-trois rastas
matinaux, une femme folle couverte de farine blanche, un journaliste militant
(excité par ce qui ne pouvait qu’être un méfait colonialiste), et toute une
catégorie de ces irréductibles qui parviennent encore (Dieu sait
comment !) à dérouter les dispositifs d’assistance à l’exil. »[546]
Nous retrouvons une approche identique dans les romans de R. Confiant et E. Pépin qui s’attachent à illustrer le voyeurisme de la « meute des commères et des compères, friands des soubresauts qui agit[ent] les vies familiales »[547]. Il s’agit, pour ces auteurs, de souligner le caractère malsain de cette forme de promiscuité spatiale appliquée aux mentalités, en une mise à profit du temps libre des maquerelles qui, dans le roman de R. Confiant, « jacotent », « chignent », « brocantent des malparlances » ou encore « distillent des ragots sur autrui » [548], à la faveur d’un rituel reproduit quotidiennement sous l’ombre du quénettier de la Cour des Trente-Deux Couteaux. La pratique assidue du persiflage se trouve soutenue, dans le texte, par la mise en pratique d’une créativité langagière qui contribue dans le même temps à développer tout un aspect visuel, alimenté par l’effet de mise en scène suscité tant par les « complots » visant à exclure les non désirés de la communauté, que par une sorte de propension naturelle à la théâtralisation, dont semble pourvue la grande majorité des personnages présentés par les créolistes. L’aspect spectaculaire est notamment souligné par le narrateur de L’Homme-au-bâton :
« Ainsi
allait la vie comme un galop de cheval à trois pattes et toujours il manquait
la quatrième. Son absence cruelle, les malheurs qui en résultaient créaient le
spectacle. La meute ne perdait jamais un os. Elle s’acharnait et elle se
désagrégeait par petites bandes qui s’en allaient répandre le fait divers du
jour. »[549]
Nul ne parvient, en fait, à échapper au spectacle, y compris les personnages les plus secrets, comme par exemple l’Indienne Ferdine (Le Meurtre du Samedi) qui, exclue de la communauté, se réveille néanmoins un matin sous le regard réprobateur d’une « grappe de gens », après avoir « fretinfretaillé dans toutes les positions possibles et imaginables »[550], au terme d’un complot fomenté par les deux principales maquerelles du quartier.
Ce goût pour la mise en scène, attribué aux Antillais décrits, se révèle être également de mise dans la manière de procéder de l’écrivain. Là encore, le recours à un vocabulaire imagé, suggestif, souvent connoté sexuellement ou encore largement constitué de barbarismes et autres néologismes participe de l’aspect revendicatif, « bariolé », voyant et en même temps teinté d’oralité, propice à la représentation théâtrale. Le caractère largement caricatural de certaines scènes contribue, en outre, à inscrire le texte dans un rapport de complicité avec le lecteur, s’approchant à certains égards de la promiscuité s’établissant entre l’acteur de théâtre et son spectateur. Ainsi, le rituel du kalieur, incontournable technique de séduction de Bouaffesse -en même temps que passage propice à la démonstration, à la « leçon d’écriture » donnée par P. Chamoiseau-, est agrémenté par toute une série d’artifices visuels : déambulation du kalieur dans la salle de bal, avec « la Pierre Cardin cintrée, déboutonnée sur la toison de la poitrine, la Menue Martinique au bout de la chaîne en or », le « paquet de cigarettes américaines […] tenu du bout des doigts par la main à gourmette et à grosse chevalière »[551] ; ondulation des hanches en « un lafouka lascif »[552], « charroi de la Belle » en D.S. climatisée, « salsa du dominicain » et « sarclage du vieux nègre sautillant »[553] en prime. Autrement dit, si le kalieur -impliquant une entreprise de séduction- supplante ici le kokeur -réduit à l’acte sexuel-, si la théorie, l’esthétique et la poétique prennent le pas sur la simple crudité de l’acte, le résultat de l’entreprise menée par Bouaffesse n’en demeure pas moins inscrit dans la tradition machiste parfois reprochée aux créolistes. Parcourant la scène de bal, le narrateur décrit ainsi Bouaffesse comme « repérant les têtes intéressantes dans ce qu’il appelait“le bétail”»[554]. Si elle affirme explicitement le machisme du personnage, cette perspective ne semble pas vraiment en disculper l’auteur lui-même puisque finalement Bouaffesse arrive à ses fins, en suscitant de surcroît le regard amusé du lecteur ; c’est là un aspect que certains critiques interprètent comme une résultante de la prégnance du système colonialiste aux Antilles :
« Comme
dans une fête burlesque, le problème que pose une bonne partie des
représentations de la sexualité antillaise est que la description de l’ “autre”
(et de toute différence) -de sexe et d’orientation sexuelle- est amusante,
loufoque, pas sérieuse. La jouissance du rire, du lecteur, comporte
certainement une forme d’autodérision d’un machisme ou d’une phallocratie
exagérée. Toutefois, le lecteur de la littérature antillaise ne peut éviter des
représentations de la sexualité qui marquent bien l’héritage du système
colonialiste ravageur. »[555]
Pris en charge par les créolistes avec humour et autodérision, en une véritable fête burlesque, cet « héritage » s’avère être beaucoup plus lourd, en revanche, dans la perspective d’autres auteurs antillais. C’est ainsi que, tout en se référant aux mêmes « travers » communautaires que les créolistes, M. Condé notamment semble opter pour une orientation moins folklorique que véritablement tragique.
Après avoir évoqué le thème de la veillée dans le roman Traversée de la Mangrove, Colette Maximin, dans son ouvrage consacré aux littératures caribéennes, fait référence à « d’autres catégories du folklore local », en lesquelles elle reconnaît notamment « les tares collectives » que sont la jalousie et la méchanceté. Développant son propos sur la manière dont ces dernières trouvent expression dans la culture populaire et notamment dans le domaine de la croyance, elle ajoute, toujours à propos du roman de M. Condé :
« Les
tares collectives -jalousie et méchanceté- se reflètent dans le miroir
magico-religieux. Désirs d’assouvir, par le médiat d’une séancière, une haine
cristallisée autour d’un étranger perçu comme trop étrange. Rumeurs
malveillantes qui diabolisent une femme trop dure, parce que frustrée d’amour
en raison de sa couleur. Les croyances trahissent alors aliénation raciale et
fermeture sur soi. Soit comme le vecteur de charges négatives, soit en tant
qu’objet d’une perception dépréciative, la culture populaire donne l’écho du
mal-être. »[556]
Au-delà des conflits internes à chacun, le mal être dont il est ici question se manifeste essentiellement dans le rapport à l’autre, comme le souligne cette réflexion de Mira, personnage de Traversée de la Mangrove, à propos de Sancher-l’étranger :
« Il n’était pas né dans notre île à ragots, livrée aux cyclones et aux ravages de la méchanceté du cœur des Nègres. »[557]
A l’origine de la plupart des déchirements vécus individuellement et répercutés sur la communauté, cette méchanceté incite au repli sur soi, comme en témoigne la mise en évidence, par M. Condé, des secrets des uns et des autres dans Traversée de la Mangrove, ainsi que le mutisme de Dieudonné, incapable de communiquer son désespoir (La Belle créole). Chez les créolistes, à l’inverse, le malaise s’exprime de manière éclatante, au travers des spectaculaires états d’âme de personnages vivant de manière totalement extravertie leurs sentiments les plus profonds. Le recours secret, voire honteux, au quimbois[558], évoqué par C. Maximin, est ainsi abordé d’une manière hautement plus folklorique dans les romans des créolistes. La peur suscitée par l’expérience des mains mortuaires de Bouaffesse, « trempées dans un pourri de cercueil », discrédite en ce sens le bien-fondé de la pensée populaire, en donnant à voir les croyances et superstitions qui l’animent sous leur aspect le plus ridicule. Ainsi, Bouaffesse demeure finalement aux yeux du lecteur celui qui, avec ces mêmes mains mortuaires, ne cesse de se « gratter les fesses »[559] à la moindre contrariété.
Considérées au sein de Solibo Magnifique, la plupart des croyances populaires prennent finalement l’aspect de superstitions fondées sur des angoisses tant infantiles que grotesques. La question du quimbois est encore abordée avec la même futilité dans le roman de R. Confiant, Le Meurtre du Samedi-Gloria, qui, au gré d’une mise en scène touchant au burlesque, souligne le caractère risible à la fois du recours au quimbois et de la peur suscitée par ce genre de pratique. Epiant le quimboiseur Grand Z’Ongles, Hilarion -dont on nous précise qu’il « avait une sainte frousse de tout ce qui de près ou de loin touchait au quimbois »[560]- et Dorval -inversement sceptique à l’égard du ce genre de croyances- surprennent ainsi une scène des plus cocasses, mettant en présence le quimboiseur et son client, nus, l’un poursuivant l’autre avec un fouet, afin de remédier à une « blesse » ; une scène d’autant plus désopilante que le client s’avère être le Docteur Mauville, « membre éminent de la mulâtraille de Fort-de-France, homme politique redouté, chevalier de la Légion d’honneur, vénérable de la loge maçonnique “Liberté et Respect” »[561] et que la « blesse » se révèle être une « absence de bandaison »[562].
Une fois encore, c’est à travers le prisme de la question sexuelle que l’approche culturelle est abordée, réduisant le quimbois à un simple travers, à une déviance revendiquée comme proprement antillaise -comme le sexe, le rhum ou encore les combats de coqs.
Il est intéressant de constater que cette même question, quasiment inévitable dans la littérature antillaise, se voit abordée de manière sensiblement différente, dans des romans qui, comme celui de J. & J-C.Fourrier, Morts sur le morne, s’inscrivent néanmoins dans des registres a priori familiers de perspectives stéréotypées -rappelons la publication dans la collection « Tropicalia ».
C’est ainsi qu’à la mort accidentelle de son fils, Marie Nègre, personnage de Morts sur le morne, décide, afin de protéger ses autres enfants, de s’adjoindre le pouvoir d’un quimbois censé neutraliser le maléfice jeté sur elle et les siens, en privant chaque autre famille d’un de ses membres, sur le modèle d’un « jeu de sept familles ». Rejoignant les Nègre dans le deuil, les familles haïtienne, blanc-pays, mulâtre, libanaise, coulie et même métro finissent ainsi par subir la malédiction du quimbois, mettant fin, dans le même temps, à la souffrance de Marie Nègre. Au-delà de l’aspect purement romanesque, cette perspective souligne le rapport étroit s’établissant entre la souffrance née de l’injustice et le recours au quimbois.
Dans les romans créolistes, le quimbois, de même que les « bondieuseries », témoignent -alors qu’ils sont censés valoriser la culture créole- de l’immaturité, de l’incohérence, de l’hypocrisie ou encore du manque de discernement d’un peuple englué dans des croyances et des interdits, vecteurs du poids exercé par la collectivité sur chaque individu et témoins de la prégnance d’un système colonial fortement marqué religieusement.
Le roman de Guy Cabort-Masson, Qui a tué le béké de Trinité ?, en est une autre illustration et souligne notamment le rôle actif joué par l’Evêché sous le régime de Vichy marqué, à la Martinique, par le règne de l’Amiral Robert. On constate, en ce sens, qu’au fanatisme religieux meurtrier de Bernadette, personnage sombre et inquiétant de G. Cabort-Masson -elle assassine Michel de Sainte-Lucie, béké oeuvrant contre le régime de Vichy et la Légion-, répondent les « bondieuseuses » ridicules des créolistes, plus pitoyables que véritablement dangereuses, à l’instar de celle que pratique Myrtha, la bonne du curé dans Brin d’amour :
« [Myrtha]
était l’une des rares personnes à ne pas craindre le sorcier volant, car elle
s’était bardé le corps, y compris la culotte, de petits crucifix qui étaient
censés la protectionner contre les menées licencieuses du Vilain. »[563]
Nous constatons, de la même manière, la différence de tonalité séparant le roman de G. Cabort-Masson de ceux des créolistes. Ecrits à quelques années d’intervalle et s’attachant à décrire peu ou prou la Martinique des années 1950, ces romans s’inscrivent dans des univers radicalement différents, en particulier du fait de l’intérêt porté par G. Cabort-Masson au milieu béké généralement oublié des créolistes, mais également en raison de la divergence d’objectif affiché par les auteurs. De sensibilité proche de celle de l’écrivain et journaliste Tony Delsham, G. Cabort-Masson semble, en effet, orienter ses romans vers une perspective historique et réaliste ; or, nous avons déjà eu l’occasion de souligner, à l’inverse, le poids de la perspective fantasmée et du « rêver-pays » sur les œuvres des créolistes.
Résolument idéalisées -ou pour le moins mises au goût de leurs propre conception de l’idéal- et théâtralisées, les peintures proposées par les créolistes se voient véritablement placées sous le signe du masque, du déguisement, voire de l’accoutrement. Le thème du carnaval revient ainsi régulièrement, dans ces romans, comme un leitmotiv, tant de manière concrète -Solibo meurt dans la nuit du mardi gras au mercredi des cendres- que sous forme symbolique -à travers l’exacerbation des caractères et des passions notamment. C’est de cette double illustration que témoigne encore l’effet produit sur les touristes, dans Solibo Magnifique, par Congo :
«Congo
s’était bien diverti : touristes et spectateurs le croyaient déguisé.
On l’applaudissait sans raison, l’on riait sans même qu’il fasse le clown, et
l’on tenait à le photographier avec des enfants sur ses genoux, ou des femmes
qui lui donnaient la main. Il n’avait fui ses spectateurs que pour s’intégrer
parfois à quelque vidé sale, hurler, gesticuler sur environ cent mètres, puis
s’effondrer sous un tamarinier en quête de son souffle. »[564]
Clown, voire bête de foire malgré lui, Congo paraît ainsi encastré dans le décor carnavalesque sous le poids du regard étranger, se laissant enfermer dans des photographies sensibles au cliché et chères aux touristes, tout en offrant son corps aux déchaînements de la foule en une participation délirante au folklore local ; une manière pour Congo de « réhabiter » son folklore, sa culture populaire, en échappant à la perspective imposée par le regard du touriste.
A l’image de Congo, les personnages des créolistes semblent ainsi vouloir s’affirmer en substituant à leur « masque blanc » un déguisement plus local, s’exprimant le plus souvent dans une revendication caricaturale censée illustrer à la fois le ré-enracinement culturel et l’autodérision nécessaire à toute quête identitaire.
Or, tandis que les créolistes tentent, d’une certaine manière, de recouvrir, de repeindre le masque, d’autres écrivains antillais semblent opter pour des choix différents. Comme nous l’avons suggéré auparavant, M. Condé propose ainsi de s’aventurer sous le masque, dans les mystères de la face cachée. T. Delsham semble, quant à lui, choisir d’habiter le masque blanc, en créant un héros culturellement antillais de par le syncrétisme des multiples composantes formant son identité créole, mais inscrit, pour l’occasion, dans le schéma typiquement occidental du héros populaire de fiction aventurière. D’autres encore, comme G. Cabort-Masson, semblent pouvoir neutraliser, contourner, d’une certaine manière, le pouvoir déformant du masque, notamment en pourvoyant la narration d’une multiplicité de points de vue -procédé également exploité par M. Condé.
S’inspirant d’un même univers et prenant en compte des points de repère culturels communs (le poids de la collectivité insulaire sur l’individu, la complexité du rapport à l’autre, la coexistence problématique de multiples composantes culturelles ou encore la prégnance d’un passé colonial et esclavagiste lourd de séquelles), les auteurs antillais de notre corpus optent véritablement pour des stratégies[565] d’écriture diverses : folklore sur-créolisé, revendiqué avec fierté, pour les uns ; démarche se voulant moins colorée, plus naturaliste, pour les autres. La question sexuelle apparaît ici comme une souffrance profonde, là comme un objet de grivoiserie. Ainsi, la première expérience sexuelle de Dieudonné, personnage de La Belle créole, se fait au cours d’un viol collectif qui le traumatise ; il éprouve, par ailleurs, des sentiments passionnels déchirants, tant pour Lorraine que pour son amant. De même, la plupart des personnages de Traversée de la Mangrove, et notamment les femmes, vivent leur sexualité dans la frustration (la solitude de Léocadie), la soumission (Dinah s’est offerte corps et âme à son mari jusqu’à ne plus exister pour elle-même), la souffrance (Rosa subit les assauts de son mari, lui donnant des fils qu’il lui enlève, réduite à un rôle de mère porteuse), la mélancolie (Vilma rêve d’être son aïeule indienne pour suivre Sancher au bûcher funéraire) ou encore de manière perverse (Mira entretient une relation incestueuse avec son frère). Remarquons ici qu’abordée de manière plus légère par Tony Delsham, dans Panique aux Antilles, la question sexuelle, illustrée notamment par les qualités extraordinaires du héros en la matière, veut nous être présentée non tant dans l’optique du cliché à connotation raciste, relatif à l’activité sexuelle de l’Antillais, que dans la perspective d’une adaptation du personnage au cadre générique environnant[566]. A l’inverse, la démarche des créolistes finit par endiguer le cliché en l’ancrant de plus belle dans l’évocation d’une culture exagérément imprégnée par la question sexuelle. Or, bien qu’il s’agisse vraisemblablement de mettre en abyme les séquelles d’un système esclavagiste impliquant un rapport pervers au sexe (viols, choix d’esclaves pour la reproduction), la manière dont la question sexuelle est abordée dans les romans des créolistes relève manifestement davantage de fantasmes que de faits. Par ailleurs, la manière choisie par E. Pépin pour traiter de la question de l’homosexualité, se révèle être significative d’une perception relativement conservatrice du sexe -sans doute à l’image de la société antillaise dans son ensemble, mais peut-être avant tout de l’auteur lui-même. L’inspecteur Rigobert sombre ainsi dans la folie, après avoir été surpris par ses collègues dans un accoutrement de travesti. Le recours régulier à l’insulte « makoumè », très présente dans les romans des créolistes et désignant péjorativement une personne homosexuelle, atteste d’une même perspective, mêlant mépris, moquerie et grossièreté, à l’image de la tonalité globale du traitement de la question sexuelle.
Soumis une fois de plus au « grand rire » source de « la distanciation moqueuse »[567] chère à l’écriture de P. Chamoiseau et des créolistes en général, la culture antillaise nous apparaît, en ce sens, grouillante, à l’instar des fourmis folles sillonnant le cadavre de Solibo, s’agitant fiévreusement en une forme de chaos ordonné ; il s’agit-là, en un sens, du « monde difracté mais recomposé »[568]. Inscrits dans une dialectique se voulant anti-coloniale et en porte-à-faux vis-à-vis de peintures relevant autant de la négritude -par une quête identitaire erronée- que de la « blanchitude » -notamment par le regard exotique porté sur l’espace créole-, les Antillais décrits par les créolistes évoluent alors logiquement au sein d’un univers également connoté, voire orienté ; autrement dit, c’est bien la réalité qui se voit ici confrontée et adaptée à l’esthétique de la créolité.
1.3.2- Perceptions du réel antillais
Avant toute autre forme de détermination, c’est bien à travers la problématique « ethnique » que le contexte social antillais sous-tendant la plupart des romans de notre corpus, nous est présenté. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, la caractérisation de chaque individu par le recours à une classification dense et complexe, dont le critère essentiel réside en une combinaison alliant couleur de peau et origine ethnique, se révèle être centrale, notamment dans les romans des créolistes. Cette caractéristique est également sensible dans le roman de Michèle Robin-Clerc qui, par le biais de personnages visiblement sensibles à ce genre de distinctions, s’attache à rendre compte de l’existence d’une forme de parcellisation au sein de la société antillaise. C’est ainsi qu’à l’annonce du meurtre, la population s’empresse de déterminer la probable appartenance ethnique du meurtrier, arguant de théories et de mobiles plus ou moins fantaisistes :
« Le
mobile du Noir était la haine raciale mélangée à une sombre histoire de facture
impayée et d’un kouni a manman -grave
juron créole- jeté en public par Luynes au Noir ou l’inverse, on ne savait plus
très bien. Celui du Béké était une affaire de femme, celle de la victime, que
l’on avait vue avec un autre homme, ah oui, oui, oui, je vous assure. Les
raisons du zoreille étaient plus fumeuses. Il semblait qu’il ait accompli ce
geste uniquement parce qu’il était métropolitain. Les Blancs-France avaient
l’étrange pouvoir de mettre toujours d’accord les Noirs et les Békés contre
eux. »[569]
Cette forme de parcellisation, voire de ségrégation, est également illustrée par la fulgurante passion du commissaire Boucher -déjà marié à une femme dont on nous précise qu’elle est plus métissée que lui- pour Patricia, toute émue, quant à elle, « d’embrasser un Noir »[570].
Laissant entendre la prégnance d’un rapport nécessairement ambigu, voire malsain, s’établissant entre la minorité de Blancs et la majeure partie de la population, M. Robin-Clerc semble souligner la persistance d’une perception quasi ségrégationniste des rapports sociaux. C’est une même impression que laisse F. Chalumeau dans son roman Pourpre est la mer, et ce, d’autant plus qu’à l’instar de la Guadeloupéenne, il introduit son enquêteur fraîchement débarqué de sa Franche-Comté natale, dans le milieu de la bourgeoisie créole. Confronté au regard étranger, cette bourgeoisie nous apparaît alors véritablement engoncée dans des comportements et une idéologie qui nous sont présentés sous leur aspect le plus sombre : luxe ostentatoire, arrogance, racisme primaire (« Ah ! mon grand-père, c’était un vrai béké d’autrefois… Pour lui, les gens de couleur n’étaient pas de vrais êtres humains »[571]), ou encore névroses dues à une éducation exagérément conservatrice. F. Chalumeau dénonce, en ce sens, l’adultère généralisé au sein des milieux békés en le présentant comme la résultante d’années de jeunesse frustrantes, entre thés dansants, messes et « parties de plage chaperonnées »[572]. L’illustration de Blancs, aussi puissants que mauvais et totalement coupés du reste de la population, elle-même sensible à une certaine perception clivée du rapport au Blanc -la susceptibilité de Mozar, méfiant et agressif à l’égard de Laprée, en atteste-, semble inscrire l’univers dépeint par F. Chalumeau dans une perception figée et fortement imprégnée de relents coloniaux. L’auteur semble en effet suggérer l’existence, au sein de la société guadeloupéenne, d’un système relationnel passéiste, encore mis en relief par quelques vestiges de l’époque coloniale, persistant au sein du paysage -la présence d’usines à sucre désaffectées par exemple- comme au cœur des mentalités ; à cet égard, l’occupation de ces mêmes usines par les militants indépendantistes n’est sans doute pas anodine.
C’est dans une perspective tout aussi passéiste que Sancher, personnage de Traversée de la Mangrove, s’enlise dans l’obsession des crimes commis par ses ancêtres et s’enfonce parallèlement dans la boue de la mangrove, s’étouffant en quelque sorte dans une perception figée de la réalité post-coloniale antillaise. Or c’est bien en mourant que Sancher parvient à réveiller la vivacité, la vie grouillante de ce village implanté au cœur de la mangrove, à inspirer le désir d’entrer dans un autre temps.
A l’opposé, chez les créolistes, la société semble irrémédiablement figée entre deux temps, deux époques, grouillante de l’intérieur, mais figée en soi car incapable de véritablement prendre en compte la réalité, et plus précisément une réalité non relative au mode de fonctionnement et de pensée colonial.
Dans les romans de P. Chamoiseau, R. Confiant et E. Pépin notamment, le contexte social ne semble pas, en effet, perçu dans sa réalité parfois tragique, mais dans une sorte d’idéalisme utopique, rêveur. Ainsi, toutes les personnes réunies autour de la veillée de Solibo nous sont présentées à travers la profusion de leurs histoires, de leurs sentiments, de leurs cultures, sans pour autant véritablement exister dans cette réalité inquiétante touchant les Martiniquais, faite de chômage, de misère, de violence, de détresse. Il est évident, en effet, que les personnages mythiques qui nous sont présentés ne sont en fait que de pauvres gens. Si la rudesse de leur situation sociale nous est effectivement signalée -Doudou-Ménar n’a vendu que peu de chadecs ; idem pour Sidonise avec ses sorbets ; Congo vit dans une misérable case à deux pas du vacarme de l’aéroport ; quant à Solibo, il ne vend plus de charbon depuis longtemps-, elle nous apparaît néanmoins secondaire. Présentes à l’esprit des personnages tout au long de la journée, ces déconvenues devenues quotidiennes sont finalement occultées le temps de cette veillée, et ainsi, le temps du roman. De même que les témoins, confrontés à la brutalité des policiers, se réfugient dans leurs souvenirs heureux, l’auteur semble faire appel à l’oubli dans le fantasme et l’imaginaire, le rêve libérant en quelque sorte ses personnages du poids des contingences matérielles, fidèle en ce sens à la stratégie du conteur. Ceci explique le sentiment d’une certaine intemporalité baignant les oeuvres des créolistes : attachés à décrire la Martinique des années 1950-60, leurs romans semblent, en effet, figés dans le temps, entre deux époques, deux Martinique, comme en atteste notamment la reprise de la problématique opposant tradition et modernité. C’est ainsi que, d’un roman à l’autre, R. Confiant choisit de mettre en avant la quasi schizophrénie de son île :
« Deux
Martinique se côtoyaient là à l’évidence sans se rencontrer. L’une finissante,
vieillissante, nègre, indienne et blanche coloniale ; l’autre moderne et
blanche européenne. Implacablement blanche européenne. »[573]
Ou encore :
« On
avait beau dire-beau faire, il existait bien deux Martinique : l’une
francisée, citadine, logique, où il évoluait à l’aise comme Blaise ;
l’autre créole, rurale, superstitieuse, qui le déroutait. »[574]
Mettant en avant l’existence de deux Martinique, l’une coloniale, créole, rurale et superstitieuse, l’autre départementale, francisée, citadine et logique, R. Confiant semble vouloir dépasser le clivage Noir/Blanc, esclave/maître, pour s’orienter vers un autre type de confrontation, opposant cette fois-ci passé et présent, colonisation et départementalisation. Or, l’objectif visiblement poursuivi dans Le Meurtre du Samedi-gloria, et de manière encore plus évidente dans Brin d’amour, consiste en une mise en difficulté, voire en péril, de la modernité, de la Martinique francisée, face à la puissance du souffle du passé, de la Martinique coloniale. Cette approche est également perceptible dans Solibo Magnifique dans la mesure où si le monde traditionnel nous apparaît dans sa décrépitude, le monde moderne, incarné tant par le « primitif » Bouaffesse que par le rationaliste Pilon, s’impose au lecteur dans toute sa névrose, son mal être, son inefficacité, voire sa perversion. C’est ainsi que tout en construisant son intrigue autour de la disparition du monde traditionnel, P. Chamoiseau semble proposer de « réhabiter » ce monde par le biais du « marqueur de paroles », seul acteur, dans le roman, d’une forme de modernité salutaire. C’est donc d’un point de vue résolument optimiste que l’avènement de la modernité veut être abordée dans ce roman, en dépit du traitement tragique des acteurs du monde traditionnel et grâce à la perspective de la créativité littéraire, seule capable de créer le lien entre deux époques a priori incompatibles. Le traitement de la misère sociale à travers la question de la prostitution nous apparaît, en ce sens, des plus significatifs dans le roman de P. Chamoiseau. C’est en effet de manière poétique, voire enchanteresse, que le personnage de Conchita Juanez y Rodriguez, « de nationalité colombienne, sans profession, fichée comme se livrant à la prostitution, sans domicile fixe »[575], ainsi que le souligne le procès verbal, nous apparaît. « Superbe créature »[576], s’offrant aux « noctambules de Fort-de-France, nègres sans adresse, n’affleurant cette vie que la nuit, aux lieux des flambeaux du jeu-serbi, des bancs publics, des prostituées, plus furtifs que des rivières dans la grand-soif des Sud »[577], Conchita et les autres prostituées de la capitale prennent des allures majestueuses sous le regard rêveur de Solibo/Chamoiseau :
« Solibo
hantait les abris de la prostitution, sans refuser d’en être client quand un
argent le lui permettait. Le plus souvent, de prostituée en prostituée, il
présentait à ses compagnons d’autres manières de nous-mêmes : Ah, voici
Margareth de Sainte-Lucie, et voici Haïti, parle-nous d’Haïti Roselita,
manman ! c’est Clara de la Dominique, et voici Porto-Rico como esta
uste ? damned ! qui que je vois là si c’est pas Sacha de la
Barbade…la Caraïbe est là ! la Caraïbe est là !… Sans avoir connu ces
pays, brisant dans sa tête les os de l’isolement, Solibo Magnifique pouvait en
parler, et en parler et en parler… Les confidences de ces femmes, leurs façons
de goûter la nuit suffisaient au conteur pour décrire chaque terre, chaque
peuple, chaque douleur. »[578]
L’ approche est sensiblement identique dans Le Meurtre du Samedi-gloria de R. Confiant, avec la mise en scène de Philomène, « la péripatéticienne féerique, qui se moulait dans une robe fourreau bleue à paillettes et damnait l’âme des marins européens »[579] :
« Philomène
n’avait rien à voir avec ces rats d’égout, ces putaines mal dégrossies qui se
vendaient pour “cinquante francs debout-cent francs couché” le long de la route
des Religieuses ou au pont Démosthène. Philomène était une grande dame et, en
plus, elle était d’une belleté à faire pâlir Sophia Loren elle-même. »[580]
Ce portrait émerveillé est néanmoins nuancé par la suite :
« Son
seul problème, c’est qu’elle noyait un lointain chagrin d’amour dans la bière
“Lorraine” et que, lorsqu’elle était ivre, elle se livrait à des actes
dégradants comme de vomir dans les ruelles du quartier ou de s’affaler les
quatre fers en l’air contre les racines échassières du quénettier qui
ombrageait la Cour des Trente-Deux Couteaux. »[581]
Au-delà de la vision enchantée dominante, se distingue ainsi une face beaucoup plus sombre de la réalité miséreuse de toute une part de la population martiniquaise, livrée au chômage, à la prostitution, au manque d’argent et à la criminalité.
Dans le roman de M. Condé, La Belle créole, cette réalité s’impose véritablement au lecteur. Prenant à contre-pied toute une perception idéalisée de la société martiniquaise, M. Condé fait peser sur son roman une lourde atmosphère empreinte d’une aura apocalyptique, censée rendre compte de la prégnance des conflits sociaux gangrenant une société attaquée par ailleurs par d’autres fléaux, comme celui de la drogue par exemple.
Privé de sa mère par le cyclone « Hugo », ainsi que du soutien psychologique nécessaire pour faire face à une telle épreuve, pauvre et victime de crises lui donnant des allures de zombi, Dieudonné découvre ainsi les « vertus adoucissantes » des drogues dures[582] :
« Il
avait découvert les pouvoirs de la poudre magique. Il lui suffisait de s’en
emplir les narines et d’inhaler, inhaler pour que la terre retrouve sa rondeur,
sa couleur, sa saveur, ses odeurs. »[583]
Nécessaire à l’oubli, cette « poudre magique » prend une importance grandissante alors que le pays connaît une grave crise sociale. Lorsque Dieudonné sort de prison, en effet, la ville de Port-Mahaut paraît au bord de l’insurrection, à la suite d’une série de grèves des services publics : ordures jonchant les rues, coupures d’électricité, mise en place d’un couvre-feu, constitution de milices populaires, hausse de la criminalité, peur ambiante. La situation paraît d’autant plus préoccupante qu’elle souligne la mésentente de syndicats et de partis politiques prêts à sacrifier la Guadeloupe sur l’autel d’idéologies indépendantistes et de courses au pouvoir.
La peinture proposée par M. Condé paraît, en ce sens, particulièrement sombre, à l’opposé de l’a priori de la carte postale, ce qui semble interpeller le reste du monde :
« Boris,
à son habitude, avait harcelé des automobilistes faisant le plein d’essence
pour leur vendre son dernier recueil. […] Il s’agissait d’une équipe de
télévision italienne, venue de Bologne pour tourner un reportage sur le malaise
des Caraïbes. Pourquoi les Paradis se gâtent-ils ? Pourquoi deviennent-ils
des Enfers ? »[584]
Suggérant l’intérêt suscité, auprès des médias, par une investigation aussi porteuse que celle du Paradis devenu Enfer, alliant symbolique manichéiste, curiosité malsaine, dramatisation et « images choc » aptes à capter l’intérêt du public -autant d’éléments exploitables par le genre policier dans sa forme la plus vulgaire- M. Condé souligne, d’une part, cyniquement la superficialité avec laquelle la crise sociale antillaise est abordée, et semble suggérer, d’autre part, le désintérêt de l’Etat français en la matière puisque l’équipe de télévision en question est italienne. De même que les jurés passent à côté de la véritable histoire de Dieudonné, la profondeur de la crise antillaise semble totalement éludée, réduite à des constats superficiels et simplistes, occultée par la persistance d’un passé non révolu. Le traitement de l’Histoire se fait, en ce sens, déterminant dans les romans de Maryse Condé, où l’intertexte policier semble essentiellement fonctionner dans la perspective d’une enquête menée, non seulement au plus profond des consciences mais également dans les méandres d’un passé tourmenté.
Assumer une histoire marquée par la colonisation, la rejouer, la dédramatiser, l’adapter ou tout simplement la rechercher dans sa vérité : autant d’orientations permises par la reprise de la forme policière qui se fait, dans le même temps, le témoin, le vecteur de positionnements idéologiques divergents.
2- Enquête en amont
Si, comme le postule J. Dubois, l’avenir du récit policier est « toujours en reprise d’un passé »[585], la forme policière, appliquée aux littératures post-coloniales, ne semble pouvoir relever de perspectives véritablement anodines. L’hypothèse paraît d’autant plus plausible que le récit policier semble pouvoir se rapprocher, à certains égards, d’une certaine forme de discours historique, comme le souligne U. Eisenzweig :
« Tant le discours historique
que le récit policier, en effet, ont pour objectif la narration factuelle,
“véridique”, du passé. Ce qui entraîne une double similarité structurelle.
D’abord, comme l’Histoire, le roman policier trouve sa raison d’être dans les faits
mêmes qui sont l’objet de son projet narratif. A l’instar du texte historique
qui, par définition, ne peut se percevoir que comme le produit ultime des
évènements qu’il raconte, le récit de l’enquête (récit présent) n’existe que
comme la conséquence du crime (récit absent) qu’il se propose de reconstituer.
D’autre part, du fait même de la nature “vraie” du récit entrepris, chaque
occurrence narrative spécifique en contredit nécessairement une (ou plusieurs)
autre(s). »[586]
Terme de l’après-meurtre rassemblant différents éléments puisés dans l’avant-meurtre et essentiellement constitutifs du mobile qui est, quant à lui, le point de départ de l’élaboration du crime, l’aboutissement de l’enquête se fait nécessairement le point d’orgue d’une interprétation du passé, censée déterminer l’équilibre futur de la société en crise ; une interprétation donnant lieu à des orientations divergentes, témoins d’un positionnement vis-à-vis de l’Histoire, propre à chacun.
2.1-
L’Histoire
en creux
L’interrogation engagée par l’enquêteur menant sa réflexion dans les méandres du passé, se veut particulièrement résonante, appliquée aux littératures francophones post-coloniales. Le genre policier offre, en effet, l’occasion d’une mise au jour d’évènements qui, dans le cadre d’une Histoire aussi dense que celle des sociétés antillaises et maghrébines, peuvent encore présenter différentes zones d’ombre. Dans les romans de notre corpus, le propos historique se fait en ce sens prégnant, occupant une place centrale dans quelques œuvres en particulier, abordant l’enquête menée sur le passé comme matière à un évident réquisitoire.
2.1.1- Invocation factuelle du passé
Dans un ouvrage
consacré aux histoires parallèles de l’Algérie et du Maroc,
« En
Algérie et au Maroc, les après-indépendances ont été provisoirement refoulés.
C’est à l’orée du troisième millénaire que les exigences démocratiques ont fait
émerger ces périodes, synonymes de meurtrissures.
Cet
engouement pour le passé proche, s’observe par une profusion de récits de
batailles, de témoignages d’acteurs, de souvenirs en forme de mea culpa, …
Ce
grand déballage suscite surprises, malaises et interrogations. »[587]
Au-delà de la libération de la parole, cette forme de réhabilitation passe par toute une série d’évènements significatifs : inauguration d’une stèle à la mémoire du Gouvernement Provisoire Révolutionnaire Algérien, contribuant, selon B. Stora, au «“retour” d’une structure politique évincée par l’armée à l’indépendance » ; réhabilitation de figures dissidentes du nationalisme algérien (Messali Hadj notamment) ; hommage rendu à la population juive, à l’occasion d’une allocution à Constantine, en juillet 1999 ; ou encore limogeage du ministre de l’Intérieur marocain, Driss Basri, figure contestée et redoutée du pouvoir. Autant de gestes à la fois symboliques et déterminants, en lesquels B. Stora perçoit le signe d’un changement, amorcé en premier lieu par des bouleversements au sein de l’organisation des pouvoirs :
« En
1999-2001, tant en Algérie qu’au Maroc, le passé semble rattraper le présent.
Cette soudaine résurgence se comprend par les spasmes de l’actualité. Les
accessions au pouvoir, quasi-simultanées, de Bouteflika et de Mohamed VI, en
1999, ont bousculé des certitudes, libéré bien des paroles et ébranlé de
prétendues évidences. »[588]
Or, si la révélation du refoulé s’est effectuée, dans les journaux notamment, essentiellement à partir de 1999, comme le postule B. Stora, il convient de souligner la précocité des écrivains en la matière, aidés en cela par les opportunités éditoriales étrangères et déterminés par une quantité d’évènements ayant irrémédiablement marqué leur existence. C’est ainsi en tant que citoyens, témoins de cette Histoire non-dite, que les écrivains algériens s’engagent dans un processus de divulgation, placée sous le signe à la fois de l’intérêt collectif et de la nécessité individuelle. L’assassinat du Président Mohammed Boudiaf se révèle être, à cet égard, déterminant, comme en atteste ce témoignage de Boualem Sansal :
« J’ai cru en cet homme et sa mort a été pour
moi, comme pour l’immense majorité des Algériens, un choc terrible. En me
mettant à écrire, j’ai comme enfilé une tenue de combat pour m’insurger contre
ce système qui nous a menés si bas dans la vie et si loin dans le silence et la
lâcheté. »[589]
Cette prise de position nous permet de constater que chez les auteurs algériens engagés dans la forme policière, et particulièrement ceux de notre corpus, l’écriture se fait véritablement le vecteur d’un parti pris idéologique censé permettre à l’écrivain de prendre part au devenir du pays. L’écriture de l’Histoire peut ainsi se percevoir comme témoignage sur le passé et comme construction de l’avenir, autrement dit à la fois comme rétrospective et comme perspective. A cet égard, le regard porté par Jean-Pierre Koffel sur les dernières années du Protectorat marocain se révèle être significatif.
En choisissant pour cadre de l’intrigue les dernières années du Protectorat, J-P. Koffel prend, en premier lieu, le soin de préciser :
« Ce
roman, qui n’engage que la mémoire de son auteur, est avant tout une fiction qui
prend des libertés avec l’Histoire. »[590]
La fiction proposée se veut néanmoins non tant « réflexion sur l’Histoire » que simple « recherche sur une époque », comme le laisse entendre l’auteur dans un entretien qu’il nous a accordé, où il propose notamment un décodage des pseudonymes utilisés dans la fiction -on constate ainsi que la grande majorité des personnages sont inspirés de personnes ayant effectivement existé à cette époque- et où il témoigne encore de son intérêt pour l’historicité, présentée comme une des clés du genre policier :
« J’ai
effectivement voulu que ce livre soit une peinture de la société européenne de
la Marrakech des dernières années du Protectorat, où mes yeux de 20 ans étaient
sans complaisance. Un polar est d’abord un roman réaliste qui ne souffre pas
l’à-peu-près et requiert un souci maniaque de l’historicité. Tout doit être
crédible et une seule erreur peut décrédibiliser le tout (ainsi la formule “la
valise ou le cercueil” est née en Algérie en 1956 et c’est par erreur que je l’avais
imputée au Maroc de 1955 ; c’était la seule erreur que l’un de mes
premiers lecteurs, Nadir Yata, rédacteur en chef du quotidien communiste Al Bayane et ami très cher, tragiquement
disparu, avait relevée dans mon manuscrit). »[591]
C’est ainsi
que l’auteur prend le parti de mettre en scène des personnages significatifs
d’une époque, et plus précisément d’un engagement idéologique bien déterminé,
illustré, d’une part, par les mouvements de résistance réfractaires au
Protectorat et plus largement à l’entreprise coloniale, et, d’autre part, par
les actions « anti-terroristes » menées par des partisans convaincus
de la Résidence. Il est établi en effet que les dernières années du
Protectorat, et notamment l’année 1954, ont été marquées, au Maroc, par la multiplication
d’attentats de la « Résistance », auxquels ont riposté différentes
sections « anti-terroristes ». Dans un ouvrage récemment publié[592],
l’historien Pierre Vermeren fait ainsi référence à six mille attentats, ayant
été commis entre août 1953 et août 1955, par « une base en déshérence, qui
finit par susciter un “contre-terrorisme” européen », faisant état, dans
les villes, de sept cent soixante et un morts marocains et cent cinquante neuf
Européens. Ces attentats sont secondés, dans la fiction proposée par J-P.
Koffel, par l’action isolée menée par Virna Carlie. Or, il est intéressant de
constater qu’au-delà de la perspective romanesque développée par J-P. Koffel,
le personnage de Virna semble inspiré d’actions effectivement menées à
l’époque.
Il en est
ainsi du « tueur de Tadla » -évoqué notamment par
l’historien Charles-André Julien[593]-, auteur
de plusieurs meurtres d’Européens, avant de devenir la cible d’une gigantesque
chasse à l’homme infructueuse[594] et qui
pourrait avoir servi de modèle au personnage de Virna. L’action du « tueur
de Tadla », vraisemblablement apolitique, tout comme celle menée par Virna
Carlie, a néanmoins été attribuée par certains, dont Boniface, chef de la
région de Casablanca, au parti de l’Istiqlal, se donnant ainsi l’occasion de
nouvelles répressions.
C-A. Julien
évoque encore le cas du communiste Marcel Lamoureux, « petit colon élevé
dans le pays, qui vivait “vêtu à l’arabe” et parcourait la montagne “à dos
d’âne” »[595] arrêté le
6 décembre 1953 et accusé d’avoir incité les montagnards à incendier les
récoltes, à partir de 1946 ; figure emblématique que l’on perçoit
nettement à travers différents personnages du roman, dont Virna Carlie
elle-même. D’autres « effets de réel » se révèlent encore
perceptibles dans le roman, notamment à travers l’évocation d’actions abordées
de manière relativement précise dans le texte, par simples occurrences ou par
le biais de paragraphes, voire de sous-chapitres entiers, consacrés à
l’éclaircissement du contexte socio-politique de l’époque, comme par exemple la
sous-partie 7 du dixième chapitre :
« Le
terrorisme multipliait ses coups. Il y avait eu le tueur du Tadla, la bombe au
bar Chez elle, après celle du Marché Central. Les petites casernes,
dans le bled, les petits militaires dans le Rif,
dans le Sud, étaient attaqués par une insaisissable Armée de Libération. Des
gens étaient “descendus” dans la rue, à des arrêts d’autobus. […] On ne
réclamait qu’une seule chose : le retour de l’Exilé de Madagascar -et des
siens-, dont tout un peuple avait vu le visage dans la lune. »[596]
Il est encore question d’une grève de boutiquiers réprimée violemment, de soldats lynchés dans le Mechouar, d’émeutes sanglantes, de manifestations de femmes à Riad El Arouss, de l’incendie de quelques fermes de colons[597] ou encore d’attentats commis très précisément Boulevard de Suez, rue du Lieutenant Manevy, à Casablanca[598]. Ces éléments inspirés de l’Histoire ponctuent une intrigue fonctionnant selon une problématique elle-même représentative de l’Histoire du Protectorat, conférant au texte une certaine crédibilité, suscitant par là même un intérêt dépassant le strict cadre de la fiction.
Destinés à accompagner l’écriture de l’Histoire plutôt qu’à la supplanter véritablement, ces textes s’inscrivent finalement autant dans la perspective du témoignage, comme c’est le cas en ce qui concerne J-P. Koffel, que dans celle de l’enquête fonctionnant par spéculations, à partir de faits diversement récoltés, avec le parti pris que cela implique dans les deux cas.
Alliant témoignage et spéculation, B. Sansal prend ainsi le soin d’introduire un personnage d’historien au sein même de l’intrigue, reproduisant de ce fait les pans d’une époque qu’il n’a pu connaître qu’enfant et qu’il ne possède que par bribes. La fiction joue dès lors un rôle palliatif, permettant d’une certaine manière de transcender le temps ; une perspective dont témoigne également la démarche du Martiniquais Guy Cabort-Masson, qui choisit d’inscrire l’intrigue de son roman au XIXème siècle.
C’est ainsi dans le cadre d’un « roman historique », comme l’indique le paratexte, que G. Cabort-Masson tente de revenir, avec La Mangrove mulâtre, sur une affaire ayant défrayé la chronique en Martinique, en pleine période de débats abolitionnistes.
Faisant débarquer dans la rade de Saint-Pierre, le 18 juin 1842, le jeune Dampierre, avocat de vingt-huit ans, collaborateur de Bissette, lui-même proche de Victor Schoelcher -ces deux derniers deviendront progressivement rivaux-, G. Cabort-Masson choisit d’inscrire son texte au cœur d’une enquête fictive portant sur un fait divers bien réel quant à lui, ayant marqué les esprits de l’époque. Il s’agit, en effet, pour Dampierre d’enquêter sur les violences sauvages infligées à des esclaves, par un maître subitement emporté par la folie.
Au sein de la fiction, le maître en question se nomme Pierre Brafin, commerçant originaire de Bordeaux, prospérant dans le commerce pierrotin, avant de devenir propriétaire d’une terre en friches sous l’impulsion du béké Meaupoux. Tandis que l’exploitation sucrière se met progressivement en marche, sous l’œil bienveillant du béké, une série d’empoisonnements vient endeuiller la main d’œuvre esclave. Désemparé face à l’affaire et influencé par un commandeur -fils bâtard du béké bien décidé à récupérer son bien usurpé- le persuadant de la culpabilité de quelque esclave empoisonneur, Brafin décide de se comporter en maître, sombrant alors dans une folle répression meurtrière.
Ainsi que nous l’avons déjà souligné dans la première partie de notre étude[599], cette histoire sordide semble faire écho à une affaire s’étant effectivement déroulée à la Martinique, à cette époque. Dans un ouvrage récemment publié, l’historien Paul Butel évoque ainsi le cas de Pierre Dessalles, procureur général par intérim, chargé « d’enquêter sur le cas d’un géreur accusé de maltraiter ses esclaves »[600]. L’enquête n’aboutit finalement pas à la condamnation du béké, Dessalles jugeant les témoignages accusateurs peu fiables et constatant, par ailleurs, le « bon traitement » réservé à la majorité des esclaves de l’habitation. Or, c’est précisément après cette disculpation que G. Cabort-Masson choisit de faire intervenir le personnage de Dampierre, offrant par là-même à l’énigme une autre conclusion. Autrement dit, la fiction proposée par G. Cabort-Masson tend ici à « changer l’Histoire », à imaginer une autre conclusion à des évènements ayant réellement existé.
La seconde enquête menée par Dampierre permet, en outre, au jeune homme, « ignorant de tout sur le pays de [s]es ancêtres »[601], de découvrir et de décrire la société esclavagiste martiniquaise de l’époque, à travers différents éléments : clivages raciaux, enjeux économiques ou encore luttes pour le pouvoir, notamment entre Blancs créoles et Mulâtres. Il s’agit donc, pour G. Cabort-Masson, de porter un « regard romanesque » sur un fait divers représentatif d’une période charnière de l’Histoire antillaise, illustrant, d’une part, les dernières années de la période esclavagiste et, d’autre part, la montée en puissance d’une nouvelle force au sein de l’économie et de la société martiniquaises, celle des Mulâtres. C’est l’occasion pour G. Cabort-Masson de suggérer, en quelque sorte, que si l’esclavage a été aboli, le peuple noir, lui, ne va pas pour autant cesser d’être soumis au désormais double pouvoir des Blancs et des Mulâtres. Relativisant la portée de l’abolition de l’esclavage, Dampierre déclare en ce sens :
« L’abolition de l’esclavage était un faux problème puisqu’elle ne résoudrait en rien la situation des rares émigrés en Europe ni celle des mulâtres d’ici déjà assez riches pour faire honneur à tous les bordels de France. L’abolition n’était qu’un petit pont obligé vers l’abolition des races, la question de leur fusion. »[602]
Complétant, d’une certaine manière, une enquête inachevée -le béké a été disculpé mais finalement, le fond du problème mettant en évidence la difficile confrontation des différentes « forces en présence » sur le sol martiniquais, n’a pas été soulevé par le Procureur-, G. Cabort-Masson semble substituer au traitement strictement juridique de l’affaire, un point de vue prenant en compte les réalités sociales et raciales du pays.
Une nouvelle fois, il apparaît évident que le traitement de l’Histoire par ces écrivains s’inscrit dans une perspective dépassant le cadre du simple témoignage ou de l’enquête véritablement objective. L’écriture d’une Histoire souvent méconnue ou encore inédite constitue, en effet, un espace de choix pour des écrivains soucieux d’inscrire leur propos dans une perspective réaliste. Cette démarche paraît d’autant plus porteuse que le cadre romanesque leur permet, en outre, de modeler, voire d’orienter, le propos historique tout en conservant néanmoins la charge de crédibilité que ce dernier véhicule inévitablement.
2.1.2- Prise en charge romanesque de l’Histoire
Au-delà des faits et éléments datés ou vérifiables par l’Histoire, offrant aux intrigues mises en scène un cadre précis et conditionnant un discours généralement en prise avec une critique d’ordre socio-politique, les romans de notre corpus demeurent ancrés dans un univers défini clairement comme fictionnel, ne serait-ce qu’au travers du paratexte. Qu’il s’agisse de l’incorporation des personnages à un décor plus vrai que nature, encadré par des faits, des évènements auxquels le lecteur a sans doute déjà été sensibilisé -dans le cadre d’une approche proprement historique ou plus simplement médiatique- ou qu’il s’agisse encore, dans une perspective inverse, de l’implantation de ce même décor au cœur d’un univers proprement fictionnel, le rapport s’établissant entre réalité, Histoire et fiction se révèle être des plus intéressants. Confrontés à l’interprétation et à la mise en scène, les faits historiques, datés ou encore pressentis comme vérifiables, se voient en effet inévitablement propulsés dans un univers largement plus mouvant, instable, voire contestable. Ainsi, la démarche de J-P. Koffel, se veut ouvertement orientée : les faits décrits, et notamment ceux concernant les différents attentats commis de part et d’autre, relèvent certes du contexte réel de l’époque, mais la manière somme toute condescendante de traiter le personnage de Virna, auteur de nombreux meurtres de membres soupçonnés d’appartenir à l’organisation anti-terroriste[603] réprimant les actions menées par la « Résistance », ne fait aucun doute quant au parti pris de l’auteur.
Le traitement de l’Histoire par des non-historiens, en particulier dans le cadre de textes désignés comme romanesques, consiste ainsi à étayer un propos se voulant représentatif de la réalité et en prise directe avec une quête de vérité -le choix de la forme policière soutient logiquement cet objectif- tout en offrant une perspective quelque peu simplifiée de situations souvent obscures et complexes, et ce, par le recours à la mise en scène, à l’illustration concrète d’une histoire trouble incarnée par des personnages significatifs.
Comme nous l’avons souligné précédemment, la mort du Président Boudiaf a été déterminante dans la décision de B. Sansal de venir à l’écriture. Le choc et le sentiment d’injustice suscités par cet assassinat se retrouvent ainsi logiquement transmis à l’inspecteur Larbi :
« L’assassinat
du Président Boudiaf l’avait entraîné dans un autre abîme. En disparaissant, sa
femme avait emporté ce que trente années de vie commune avaient emmagasiné de tendresse.
La mort du Héros avait détruit le fragile espoir d’un peuple n’ayant jamais
vécu que l’humiliation, qui se voyait menacé du pire et qui, miraculeusement,
s’était mis à croire en ce vieil homme providentiel, inconnu de lui parce que
effacé de sa mémoire par trente années de brouillage organisé. »[604]
Anéanti, dans un premier temps par cet assassinat, Larbi se décide finalement à agir en menant son enquête, à l’instar de B. Sansal, décidé à combattre la « lâcheté » et le « silence » ; silence, né d’un « brouillage organisé » et illustré en particulier dans le roman par l’itinéraire de l’ami de Larbi, l’historien Hamidi, victime de ce que l’inspecteur nomme « les années de plomb » :
« L’inspecteur
l’avait connu lors des années de plomb. Ils n’étaient pas du même côté de la
barrière. L’un, étudiant en histoire, était fiché dans la rubrique des ennemis
du peuple. Sa fiche de police s’allongea au fil des vicissitudes de la scène
internationale. Par touches, la SM en avait fait un contre-révolutionnaire ;
dans le jargon abrupt du Parti, un fantoche à la solde de l’impérialisme, du
sionisme, du néo-colonialisme et de la réaction tant intérieure
qu’extérieure ; mais pas n’importe lequel puisqu’il eut droit à des pages
de mots pour cerner sa nature renégate. »[605]
Marginalisé, conspué, accablé de toutes parts, l’étudiant en Histoire est rapidement devenu l’ennemi public n°1, victime d’un acharnement relativement fantaisiste, comme l’indique la suite du portrait :
« On
lui prêta l’intention de renverser le régime. D’affreux limiers furent mis à
ses trousses. Bon, c’est vrai, ces brutes épaisses sombrèrent dans le
delirium à force de le pister de bar en tripot et de trinquer avec lui à la
santé des absents et perdirent totalement de vue leur mission de le détruire ;
mais c’était pure chance qu’il soit tombé sur des buteurs dépressifs. […] En
vérité, c’était un intello porté sur la parlote plus suggestive que subversive,
la polémique musclée et la bière dont il supportait mal les coups de barre et
qui, c’était plus une manière de snobinard inquiet qu’une réalité de civil mis
au pas, ne pouvait souffrir la vue d’un apparatchik. »[606]
Illustrant le caractère grotesque de la situation, B. Sansal relativise encore la portée de la démarche tant de l’historien que de ses opposants, en présentant notamment ses échanges avec Larbi comme « papotage » qui « cahin-caha, […] faisait marcher la bière et aidait le temps à tuer les consommateurs »[607]. Présentée ainsi comme simple discussion de comptoir -symbole, d’une certaine manière, de la liberté d’expression à son degré le plus élémentaire- la rencontre entre Larbi et Hamidi autour de l’enquête menée par le policier, n’en demeure pas moins riche d’éléments propices à une enquête profonde menée sur les aboutissants de la crise contemporaine algérienne, dont les tenants sont à rechercher dans les fondements mêmes de l’Indépendance. Amorçant la conversation sur des « on sait » ou des « on dit » -tels que « depuis le séisme d’octobre et le “je vous ai compris” du Raïs, la mafia a fait son apparition dans le pays » ; « pouvoir, corruption, ça fait la paire » ; ou encore « ce sont les chômeurs, les porteurs de cabas Tati, qui ont développé le marché noir, le trabendo »[608]- Larbi et Hamidi mènent progressivement le lecteur vers des réflexions plus denses, fonctionnant essentiellement sur un mode spéculatif. Tentant de trouver une explication logique et rationnelle au chaos ambiant, l’enquêteur Larbi imagine ainsi les Algériens brimés par l’autoritarisme du Front National de Libération, en commanditaires des actes de barbarie menés par les islamistes armés :
« A
l’indépendance, ils ont tout perdu, leurs biens, la vie pour beaucoup. Il ne
leur restait d’avenir que de s’aplatir devant le Parti et applaudir à ses
victoires. Crois-tu que ces hommes se sont effacés ? En guerriers, ils se
sont repliés quand la bataille fut perdue ; ils se sont mis en veilleuse
dans quelques tranchées ou trous d’obus et ont attendu le moment pour reprendre
le combat. »[609]
L’hypothèse est alors confrontée aux faits par l’intermédiaire d’Hamidi, à force de dates, de chiffres, de noms d’hommes et de partis, autour de l’histoire d’un individu en particulier, Mohammed Bellounis, dont l’itinéraire nous est retracé en trois temps, mêlant fiction et faits historiques :
1) A la suite d’un article, intitulé « Règlement de comptes à Rouiba » et publié par « un canard, connu pour ses travers langagiers mais d’abord pour ses accointances avec la défunte SM »[610], Larbi décide, en effet, de s’intéresser de plus près à cette « soupe de bobards glanés dans les cafés de la place, de brutalités tirées de l’imaginaire collectif et de potins exhumés du frigo de la maison »[611], retraçant l’histoire d’un certain Ahmed Ben Ahmed, personnage fictif -rappelant Ahmed Ben Bella, membre réel du F.L.N.- et parallèlement celle de Moh, l’une des deux victimes sur lesquelles Larbi enquête. Restitué partiellement dans le texte, l’article fait ainsi référence à la lutte, en 1955, du Général Bellounis -personnage historique- à la fois contre l’armée française et l’A.L.N., fort de l’appui de « sa horde d’épouvantails »[612], comptant de nombreux hommes dont Ben Ahmed et Moh. Obtenant la reddition de quelques douars, Bellounis et ses hommes sont finalement repris par les Français qui les poussent à occuper le maquis et à combattre le F.L.N., afin de passer aux yeux de la population pour les seuls libérateurs. L’entreprise se révèle peu fructueuse, amenant l’armée française à éliminer Bellounis, dont les troupes se répartissent entre F.L.N. et harkis, d’autres optant encore pour la fuite, les poches remplies d’argent. Parmi ces derniers, Si Moh, de retour au grand jour, après l’Indépendance et avec la libéralisation du pays, pour « faire fructifier le magot »[613], avec la complicité de l’administration.
Bien qu’étayée de détails et cohérente, cette version mêlant éléments de la fiction et de la réalité est clairement dénigrée par le jugement initial porté sur la valeur du journal. Elle témoigne néanmoins de l’audace du journaliste et par conséquent de B. Sansal lui-même, qui revient sur le sujet, cent vingt pages plus loin, par l’intermédiaire cette fois-ci de l’historien Hamidi qui y apporte quelques précisions.
2) Ainsi, précisant le portrait du célèbre Général, Hamidi rapporte, vraisemblablement en s’inspirant de la rumeur populaire, que c’est après avoir assassiné trois cents éléments de sa troupe que Bellounis a été « récupéré » par l’armée française, qui l’a « relancé contre le F.L.N. ». Désireux de négocier avec ses « maîtres », Bellounis aurait alors été éliminé par le colonel Trinquier.
Là, les indications s’écarte du cadre romanesque, d’où l’absence de référence aux personnages du roman et notamment à Moh. C’est alors que l’historien ajoute : « Voilà les faits »[614], proposant une nouvelle tranche de l’histoire de Bellounis.
3) Quittant la rumeur populaire pour revenir à des données plus concrètes et historiques, Hamidi revient ainsi sur la naissance du PPA[615], parti de Messali Hadj, dont le renoncement à la lutte sanglante donna naissance à une dissidence, inspirée par Nasser. Messali Hadj forma alors le MNA[616], auquel se joignit Bellounis, afin de contrecarrer l’avancée du FLN. Bellounis constitua alors un maquis, décidé à combattre les maquisards du FLN, dirigés par le colonel Amirouche. Les troupes de Bellounis furent décimées, mais lui-même parvint à s’échapper. Il reconstitua son armée, désireux de se venger avec l’appui des troupes françaises. Son ardeur à la vengeance aurait effrayé une partie de ses troupes qu’il fit taire en assassinant trois cents d’entre eux.
Trois versions, trois tranches d’Histoire, qui relèvent chacune d’une perspective singulière.
La première trace la trame globale de l’affaire, en mêlant références historiques et repères romanesques, puisque l’article s’interroge avant tout sur l’histoire d’une victime de ce qui est présenté comme un règlement de comptes.
La deuxième, inspirée de la rumeur populaire, s’attache à l’aspect quasiment légendaire du combattant Bellounis, victime de ses ambitions.
La dernière version, se voulant d’une certaine manière plus scientifique, souligne les enjeux de l’histoire de Bellounis, en un constat révélant les tenants de l’affaire : « Bellounis, parmi d’autres, a été le produit de la lutte entre le MNA et le FLN pour la direction de la révolution »[617].
La triple perspective ici proposée paraît simple dans sa perception globale, mais relativement complexe dans le cadre d’une quête de détails, et ce, pour une raison que l’historien s’empresse de mettre en avant :
« L’histoire
de la révolution n’est pas écrite, je te le signale si tu crois encore à la
parfaite rectitude du Père Noël. »
Avant de préciser :
« L’accès
aux archives de la révolution est réglementé et pas qu’un peu ! A côté,
Fort Knox est une galerie marchande. Cette bâtisse n’est pas comme les autres,
chaque pilier a trois ombres. Si le contenu en était révélé, le pays volerait
en éclats. »[618]
L’approche fictionnelle, fonctionnant sur le mode hypothétique consiste ainsi à pallier, d’une certaine façon, les carences d’une Histoire insaisissable, car non-écrite, se rapprochant en un sens de la démarche engagée au sein de la fiction policière par la prise en charge de la parole des éventuels témoins.
Dans la perspective de B. Sansal -comme dans celles de J-P. Koffel, G. Cabort-Masson, R. Mimouni, ou encore Y. Khadra- la connaissance du passé se révèle être déterminante dans la compréhension du présent et l’élaboration de l’avenir. Le recours à l’Histoire, quelle que soit la manière empruntée par ces auteurs, s’inscrit ainsi véritablement dans une démarche active, utile et pragmatique, fidèle en ce sens à la fonction conférée à l’enquête, dans le cadre de la fiction policière. Ayant déterminé les faits -par la définition d’un contexte historique- et établi leur lien avec les individus en cause -par la prise en charge romanesque- l’enquêteur peut alors livrer ses conclusions et procéder à une mise en accusation.
2.2-
Perspectives
critiques
La mise en accusation à laquelle peut procéder l’enquêteur dépend logiquement de la manière dont l’investigation a été menée, de la singularité de l’enquêteur lui-même, ainsi que du contexte entourant l’enquête, à quoi s’ajoutent, dans le cadre de la fiction romanesque, le parti pris de l’auteur ainsi que l’objectif recherché par l’écriture de son roman.
De manière générale, nous avons pu distinguer précédemment, au sein des romans de notre corpus, deux orientations opposées : l’une s’inscrivant dans une approche se voulant réaliste, l’autre participant d’un regard fantasmé. Cette double perspective joue un rôle déterminant eu égard à la manière dont la critique socio-politique intervient dans ces romans, donnant ainsi naissance à deux types d’approche critique : l’une procédant, en quelque sorte, à une mise en accusation argumentative dépassant le strict cadre de la fiction pour s’engager dans la voie de la dénonciation ; l’autre relevant d’une démarche plus subjective, visant à supplanter l’Histoire par la mémoire, le fait par l’anecdote, s’engageant finalement dans une approche relativement confuse et à certains égards peu percutante.
2.2.1- Dénonciation argumentative : crédibilité et preuves à
l’appui
Désireux de rendre à l’Histoire son droit à la parole et déterminé à lutter contre le silence et la lâcheté, Larbi ancre logiquement son enquête -et B. Sansal, son roman- au creux d’une réflexion profonde sur l’Histoire considérée à travers les faits, les interprétations, les témoignages et mettant notamment en relief les raisons et conséquences d’années de réflexions refoulées, confisquées, comme le remarque Pierre Lepape à propos du Serment des barbares :
« Simplement,
en décrivant les choses, les lieux, les hommes, les actions, l’auteur fait le
constat d’une réalité tronquée, déformée, transformée en absurdité par une
absence ou un fantôme : le passé. L’Algérie n’a pas de passé : celui-ci
a été transformé depuis quarante ans en légendes, en livre d’images pieuses, en
western où le preux cavalier blanc arabe combattait le vilain colonialiste
gaulois. Des saints et des héros, des méchants et des traîtres, une longue nuit
de servitude suivie d’une glorieuse et pure aurore de liberté, voilà l’histoire
telle qu’on la raconte à un jeune peuple qui, dans sa grande majorité, n’a rien
connu du tragique accouchement de l’Algérie et des tumultes de sa naissance.
Comment peut-on imaginer un avenir à partir d’une construction mensongère de
son propre passé, interroge Sansal. Comment peut-on espérer appréhender une
quelconque réalité lorsque son identité même a été faussée, truquée, mythifiée
et que chaque parole porte témoignage du mensonge originel ? »[619]
Alain Frachon revient encore sur cette inspiration puisée dans la manière dont l’Histoire algérienne est traitée et perçue :
« Dans
le mélange sansalien s’entrechoquent guerre d’indépendance et guerre actuelle,
personnages hauts en couleur et bureaucrates lugubres, vieux flics et jeunes
loups du pouvoir, une ambiance d’intrigues à ramifications complexes, de
drôlerie et de cruauté, d’incessantes allées et venues entre hier et
aujourd’hui. Car, chez Sansal, une partie du malheur algérien vient du passé
ou, plutôt, de la manière dont a été raconté le passé : gelé, pétrifié
dans une version officielle mensongère. »[620]
C’est ainsi que s’engage une redécouverte de l’Histoire algérienne qui, dans le cadre du roman de B. Sansal, s’inscrit en premier lieu dans une forme de reconsidération de la période coloniale. Larbi déclare en ce sens : « L’histoire a mille visages, chacun la voit comme il lui plaît »[621]. P. Lepape revient en ce sens sur l’inscription du roman de B. Sansal dans une perspective se voulant « anti-manichéenne » :
« Non,
les colons n’étaient pas tous des monstres assoiffés du sang et de la sueur des
Algériens, affamant une population autrefois fière et prospère. Non, l’histoire
de la guerre d’Algérie n’est pas celle de la lutte de tout un peuple contre
l’oppresseur et encore moins celle de purs chevaliers unis pour une cause
sacrée. Déjà se déroulait une impitoyable guerre des chefs, des intérêts, des
ambitions, avec ses alliances trompeuses, ses retournements, ses massacres
internes, ses rebellions locales et ses trahisons monnayées. Le reste suit
comme un mensonge qui ne peut plus s’avouer : le socialisme sans la
société, la démocratie populaire sous dictature militaire, l’armée transformée
en gang d’affairistes et l’islam intégriste se proposant de mettre le feu à la
maison pour en chasser les rats. »[622]
Il s’agit, en quelque sorte, pour B. Sansal, de ne plus considérer systématiquement le régime colonial comme facteur principal de la crise contemporaine ; aussi, accusation et disculpation vont véritablement de pair dans Le Serment des Barbares. En ce sens, si le vieil Abdallah est assassiné dans le roman, c’est en raison de son refus de profiter des legs du passé colonial : il renonce, en effet, à prendre part à un vaste trafic destiné à soutirer de l’argent à des Français ayant laissé leurs morts et leurs cimetières chrétiens en terre algérienne. Quant au meurtre de Si Moh, il s’inscrit au cœur d’un conflit d’intérêts, dont les prémices remontent significativement à la constitution des premiers mouvements de libération. Sans pour autant oublier les conséquences désastreuses et déstabilisantes d’années de colonisation, achevées de surcroît dans la violence la plus extrême, B. Sansal semble véritablement s’inscrire dans la perspective d’une responsabilisation des gouvernants algériens dans la crise accablant leur pays. L’enquête menée dans le passé de l’Indépendance se révèle être ainsi déterminante pour comprendre la situation actuelle, mais surtout pour contrecarrer tout discours utilisant la colonisation comme prétexte et unique explication à la crise[623], ainsi que le suggère cette réflexion finale :
« L’histoire
n’est pas l’histoire quand les criminels fabriquent son encre et se passent la
plume. Elle est la chronique de leurs alibis. Et ceux qui la lisent sans se
brûler le cœur sont de faux témoins. »[624]
Nous constatons néanmoins que la position de B. Sansal est mise à mal par certains critiques, dont Ghania Mouffok, journaliste à La Tribune, qui reproche notamment à l’auteur de plaider en faveur de la colonisation, de justifier une certaine idée de la colonisation, comparant son texte « à la littérature pied-noire et à sa nostalgie malsaine », pour terminer sur cette conclusion amère :
« Le
Serment des barbares fait la formidable démonstration qu’aujourd’hui, les
auteurs algériens ont un mal incroyable à construire une critique radicale de
trente ans d’indépendance sans passer par le prisme déformant de
l’autre. »[625]
Relevons encore la critique de Raïna Raïkoum qui qualifie le point de vue de Boualem Sansal sur son pays de « “regard francophone” très exotique sur l’Algérie et les Algériens », dans un article intitulé significativement « Sansal’s french cancans »[626].
Il nous semble, en réalité, que la démarche de B. Sansal se veut plus complexe, ni « anti- », ni « pro- » coloniale puisque tel n’est pas l’objet de son propos : il s’agit de juger non tant la colonisation que finalement la libération elle-même. Cet objectif est globalement celui des deux autres auteurs algériens de notre corpus, Yasmina Khadra et Rachid Mimouni.
Nous remarquons que les occurrences à la période coloniale sont moins présentes dans les romans de Y. Khadra qui s’intéresse davantage aux conséquences de la reprise désastreuse de l’après Indépendance, période qualifiée de « temps des biens vacants et du vide juridique »[627]. Ce sont donc autant les pères que les enfants de cette libération usurpée qui sont ici jugés, avec, au centre du propos, une mise en accusation fondamentale érigée de manière générale contre les profiteurs du système et de la crise. La plupart des coupables mis en scène dans les romans de Y. Khadra comptent, en ce sens, parmi les hommes les plus puissants du pays, parmi ceux ayant délibérément profité de la crise, et notamment celle survenue au moment des émeutes de 1988.
Interrogeant un suspect sur la prospérité de ses affaires et celles de ses associés, l’inspecteur Serdj, collaborateur de Llob, demande alors :
« Comment
ça a été, octobre 1988 ? »
L’homme répond :
« Mourad
m’a trouvé dans ma boutique. Il était excité. Il m’a dit “Tu me fais
confiance ?”. J’ai dit “Je demande à voir d’abord”. Il m’a dit “On va
foutre le bordel dans la ville”. J’ai dit “C’est déjà le bordel”. Il m’a dit
“Justement. Va y avoir du grabuge grande échelle. La rue va se rebiffer. Du
gâteau. Tu investis dans une boîte d’allumettes et tu rentres à la maison avec
vingt-cinq briques”. […] J’ai dit “Adjugé !”. Deux jours après, la rue
débordait de partout. On a mis le feu à des magasins et à des bus. On nous a
arrêtés et écroués. » [628]
Sans scrupules, prêts à tout pour s’enrichir, ces hommes vont finalement être utilisés de manière plus efficace par la mafia politico-financière, recyclés en hommes de main la plupart du temps par ce que Y. Khadra désigne comme :
« Un
ramassis d’anciens politiques qui n’ont pas pardonné d’avoir été évincés,
d’anciens patrons kleptomanes qui ont fini de purger leur peine et qui
reviennent sur scène se venger, des administrateurs destitués, des revanchards
qui veulent prouver je ne sais quoi… toute une confrérie de responsables
irresponsables dont les charniers d’aujourd’hui inspirent et titillent la
vocation des charognards… »[629]
Le commissaire Llob dénonce encore l’existence d’une connivence entre intégristes et mafia politico-financière :
« Un
grand nombre d’intégristes fréquentaient le salon des nababs, connaissaient
intimement les rouages des hautes sphères. Celui-là était garde du corps de tel
PDG, le voici émir d’une horde cannibalesque. Celui-ci était chauffeur d’un tel
néo-bey, le voici véhiculant des tracts subversifs à travers le pays. Au fil
des révélations, je suis tétanisé par ce sentiment qui vous prend à la gorge
lorsque vous vous apercevez que la lueur, au bout du tunnel, n’est que la
réverbération de l’enfer. »[630]
Cette dénonciation met également en évidence le caractère insaisissable de l’univers mafieux: si les hommes de main laissent des traces visibles, voire insoutenables, de leurs actions et s’ils demeurent identifiables, voire « emprisonnables », les commanditaires jouissent, quant à eux, d’une quasi impunité achetée. Un des proches de la mafia déclare en ce sens :
« Ces
gens-là sont les plus forts. Inexpugnables. Ils ont la rigueur de
l’Organisation du Crime, la solidarité de la Cosa Nostra, l’immunité des
parlementaires et l’impunité des dieux. »[631]
Témoignant du sentiment d’impunité justifié par l’institutionnalisation du bakchich, il ajoute :
« Ici,
ce n’est ni l’Italie, ni la France, ni les Etats-Unis. Ici, la justice se
prostitue aux plus offrants. Les valeurs fondamentales sont inhérentes aux
relevés bancaires. Si vous avez du fric, vous êtes chics. Tout à fait chics.
Absolument chics. Si vous n’avez pas le sou, même si vous êtes le Messie, tout
le monde s’en fout. »[632]
C’est donc bien le système algérien dans son ensemble, et plus précisément le système judiciaire, qui est ici mis en accusation par un commissaire de fiction policière blasé d’impuissance et par un écrivain-soldat soucieux de dénoncer ce qu’il considère comme étant une clé essentielle du problème : le crime organisé bénéficiant d’une plus que relative impunité. Ainsi, comme le souligne Fatma Zohra Zamoum :
« La
trilogie de Yasmina Khadra évoque d’une manière claire, au-delà du crime, les
conditions de vie d’un peuple assigné à résidence pour cause d’absence de
droits. Au fond, l’auteur présente en filigrane une crise de valeurs :
quel devenir pour un peuple qui n’a ni contrat
social ni justice ? En faisant la démonstration de l’absence de justice ou
de l’impossibilité de son application, il montre à quoi se réduisent les hommes :
à l’instinct de survie, et quand il n’y a plus que cela pour réguler une
société, il n’y a plus de bien collectif. »[633]
Remarquons que cette mise en accusation participait déjà du discours tenu, quelques années auparavant, par Rachid Mimouni dans Tombéza, notamment par la mise en scène d’un représentant de l’ordre profondément mauvais et corrompu en la personne du commissaire Batoul.
Palliant, d’une certaine manière, l’impuissance des uns ou la complicité des autres, le genre policier se fait alors véritablement la tribune d’une critique se voulant argumentative, concrète et, par là même, tout à fait incisive ; démarche permise par la possibilité offerte par le genre de mener une enquête aux retombées potentiellement interactives, c’est-à-dire mettant en prise présent et passé, et permettant la désignation des coupables.
Bien qu’insaisissable judiciairement, la mafia politico-financière illustrée par des personnages dotés de fonctions sociales précises et sans doute en prise avec une certaine réalité, se voit ainsi épinglée dans des romans bénéficiant d’une portée largement référentielle, comme en attestent les nombreux articles, concernant Y. Khadra et B. Sansal notamment, publiés en France dans des éditions non strictement littéraires, comme celles du Monde ou du Monde diplomatique. A cet égard, si les victimes ne se révèlent pas toutes représentatives du Bien, les accointances des « dirigeants » de la mafia politico-financière avec l’univers du Mal ne font aucun doute. Cette perspective se révèle plus complexe dans d’autres romans, où le malaise social s’avère être relativement diffus, confus et où la mise en accusation paraît, de ce fait, moins affirmative, plus spéculative, plus symbolique et finalement davantage ancrée dans l’univers romanesque.
Affirmant vouloir reconnaître la société créole dans toute sa diversité et assurant pouvoir concevoir l’Histoire comme « une tresse d’histoires »[634], les auteurs de la créolité empruntent ainsi la voie de l’historicité proposée par le cadre littéraire policier, d’une manière relativement singulière dans la mesure où l’enquête menée par les représentants de l’ordre n’a finalement que peu de prise sur l’Histoire en elle-même. Les enquêtes proposées semblent en fait totalement ignorer la perspective d’un questionnement mené sur le passé, en vue de la compréhension du temps présent. En revanche, le passé semble véritablement posséder la plupart des personnages mis en scène, qui nous apparaissent parfois, à cet égard, quelque peu « poussiéreux ».
2.2.2- Passivité et syndrome de l’« an tan lontan »
Nous avons souligné précédemment que les auteurs de la créolité inscrivaient régulièrement leurs intrigues au cœur des années 1950-1960 -période charnière de l’après départementalisation-, décrivant une société n’ayant dès lors que peu de prise avec la contemporanéité. La mise en scène de personnages censés représenter le monde martiniquais traditionnel, fait de conteurs, de djobeurs, de tambouyés ou encore de petites marchandes participe, en ce sens, d’une perspective que l’on serait tenter de qualifier de nostalgique, voire de passéiste. Dans Solibo Magnifique, il s’agit ainsi non tant de définir le monde traditionnel, d’un point de vue ethnographique, que d’esquisser finalement une sorte de complainte illustrant le caractère tragique de la perte d’un monde jadis si vivant[635]. Aussi, quand le roman de P. Chamoiseau s’ouvre, Solibo est déjà mort et tout ce qui nous parvient de lui émane de pleurs, de souvenirs, de regrets, voire de cris désespérés, en une peinture nostalgique de la grandeur de ce héros oublié de la modernité.
Remarquons que la nostalgie participe largement de l’état d’esprit de nombreux personnages mis en scène chez les créolistes. Il en est ainsi du père de Lysiane qui, dans le roman de R. Confiant, Brin d’amour, « rêvait encore de l’époque bénie où la canne à sucre enjambait les pentes les plus raides avec une énergie que nul ne semblait pouvoir accorer »[636], entraînant le lecteur vers un temps encore plus lointain que celui initialement proposé par l’auteur. On assiste, autrement dit, à un double retour en arrière : l’écrivain nous entraîne quarante ans en arrière à la découverte de personnages eux-mêmes tournés vers le passé. En outre, la nostalgie exprimée par le père de Lysiane semble souligner que la perception du passé et plus largement du temps, proposée par les personnages des créolistes, se fait tout à fait singulière, en ce qu’elle se révèle être à la fois inscrite dans une histoire concrète -celle de l’esclavage et des plantations- et représentée dans une perspective relativement abstraite -le temps relève parfois davantage du mythe que d’une époque précise ou d’une durée définie.
Il est intéressant, à cet égard, de nous pencher sur un passage de Solibo Magnifique des plus significatifs où il est notamment question de la manière dont le temps est perçu par les personnages.
Ayant pour conséquence de déstabiliser les enquêteurs -en une forme de résistance symbolique à l’oppresseur- les réponses données par les principaux suspects, à la question « Vous êtes restés combien de temps à écouter ce solo ? », rendent finalement compte d’une perception du temps particulièrement trouble et imprécise. Chamzibié, double romanesque de P. Chamoiseau, met ainsi en lumière le caractère insaisissable du temps, affirmant l’attentisme d’une population devenue en outre fataliste par la force des choses : « Qu’est-ce que hier, qu’est-ce que demain, quand on attend ? »[637]. Ti-Cal renchérit alors en niant l’existence d’un temps possible sans indépendance ni autonomie : « Sans Autonomie ou sans Indépendance, il n’y a que tempête ou temps mort… »[638]. Pipi, Didon, Sucette et Charlot dénigrent, quant à eux, la notion de temps, inutile en période de crise sociale et culturelle : « Le djob ne rythmait plus la vie, les brouettes ne grinçaient plus, alors qu’est-ce que le temps ? »[639]. C’est cette situation de crise que déplore encore Sidonise qui perçoit la modernité comme tueuse de temps, assimilé en l’occurrence au savoir-faire traditionnel : « Il fut un temps où sa sorbetière lui donnait le temps, le temps de parfumer le laitage au coco, le temps de tourner la manivelle dans la glace et le sel, mais là, à ce jour, le sorbet se faisait à l’ailleurs »[640]. Richard Coeurillon et Zaboca se réfugient encore dans la nostalgie de la canne, associant temps et travail ; une perspective similaire se retrouve dans les propos de Congo qui évoque le temps à travers les récoltes et regrette le « temps de manioc » supplanté par le temps des avions vrombissant aux abords de sa case. Quant à Conchita, Bête-Longue et Zozor Alcide-Victor, leur statut de marginaux coupés du monde les prive de toute conscience du temps.
Autrement dit, tous ces personnages nous sont présentés comme véritablement suspendus dans le temps, égarés entre passé et présent, entre tradition et modernité, leurs réponses n’étant que plaintes désabusées.
Cette situation n’est pas sans rappeler, à première vue pour le moins, celles des paysans de l’Atlas mis en scène par Driss Chraïbi, dans Une Enquête au pays. Coupés, tant géographiquement que culturellement du monde moderne citadin, les Aït Yafelman nous apparaissent, en effet, comme relevant d’un univers fortement ancré dans une certaine spécificité culturelle berbère, elle-même enracinée dans un temps ante-islamique prenant une résonance moins historique que véritablement symbolique. Raho, figure de l’ancêtre détenteur de la mémoire communautaire, est en ce sens présenté comme un personnage presque mythique, de par le caractère légendaire que lui confère le souvenir du commandant Filagare ainsi que du fait de l’aura mystérieuse baignant sa personnalité. Personnage emblématique fondu dans le paysage[641], doté d’une agilité déconcertante et accompagné d’un âne mystérieux que l’on serait tenter de croire magique, Raho se fait véritablement le porte-parole de la mémoire d’un autre temps, un temps lointain, marqué par le culte de la terre et le respect des êtres et des choses, un temps presque abstrait tant la poésie qui en émane se fait prégnante[642]. Or, bien que visiblement ancrés dans ce temps d’avant, avec la part de considération nostalgique que cela implique, les Aït Yafelman n’en demeurent pas moins conscients de l’existence d’un autre temps, moderne et « civilisé » ; ils le connaissent d’ailleurs parfaitement, en pâtissent parfois -l’intrusion dans leur village de représentants de l’Etat relativement hostiles le souligne- et se révèlent être néanmoins tout à fait capables d’en « profiter ». C’est ainsi qu’ils parviennent notamment à obtenir l’argent nécessaire à la réalisation d’un repas copieux de bienvenue, en envoyant un de leurs membres jouer au poker en ville. Donnant l’impression de vivre dans la nostalgie d’une Histoire révolue, les Aït Yafelman se présentent, en réalité, comme des résistants pragmatiques, non tant suspendus entre deux époques, deux cultures, deux religions que détenteurs d’une identité originelle véritablement inextinguible. Les Aït Yafelman paraissent ainsi cohabiter avec la modernité « en résistance », et non « en déshérence », comme c’est le cas notamment des personnages mis en scène dans les romans créolistes. C’est ainsi que le temps berbère auquel se réfère Raho nous apparaît de manière certes poétique mais pas véritablement nostalgique ou passéiste, et ce, du fait essentiel de la force de caractère propre aux Aït Yafelman.
Dans les romans créolistes, à l’inverse, la perspective de l’« an tan lontan » est vécue comme une béance emplie par les résonances d’un cri se répandant en échos incessants, censés s’inscrire dans le vide laissé par une conception partielle de l’Histoire. Les auteurs de l’Eloge de la créolité proposent, en ce sens, de mettre au jour la mémoire vraie, de révéler l’Histoire créole « naufragée dans l’Histoire coloniale »[643] et finalement d’opposer écrivains et historiens :
« Notre
histoire (ou nos histoires) n’est pas totalement accessible aux historiens.
Leur méthodologie ne leur donne accès qu’à la Chronique coloniale. Notre
Chronique est dessous les dates, dessous les faits répertoriés : nous sommes Paroles sous l’écriture. […]
Appliquée à nos histoires (à cette mémoire-sable voltigée dans le paysage, dans
la terre, dans des fragments de cerveaux de vieux-nègres, tout en richesse
émotionnelle, en sensations, en intuitions…) la vision intérieure et
l’acceptation de notre créolité nous permettront d’investir ces zones impénétrables du silence où le cri
s’est dilué. C’est en cela que notre littérature nous restituera à la
durée, à l’espace-temps continu, c’est en cela qu’elle s’émouvra de son passé
et qu’elle sera historique. »[644]
Le caractère insaisissable, imprécis du temps tel que perçu, notamment par les témoins de la mort de Solibo, résulterait donc d’une volonté de s’inscrire dans l’écriture d’une Histoire non-historienne, non-ethnographique, loin des faits strictement relatifs à la Chronique coloniale. En outre, selon la perspective développée dans l’Eloge de la créolité, il conviendrait de percevoir un réinvestissement de l’Histoire oubliée, là où nous serions tentée de reconnaître une certaine forme de passéisme et de culpabilisation. Ce serait, nous semble-t-il, oublier alors que le réinvestissement proposé émane de personnages dont nous avons vu précédemment qu’ils relevaient, pour une majeure partie, d’une certaine forme de folklore ; élément déterminant n’ayant pas échappé à certains critiques tels que Michel Giraud qui, dans un article particulièrement virulent à l’égard de la « politique » de la créolité, déclare notamment :
« La
littérature de la créolité, en particulier les romans de Chamoiseau et de
Confiant, s’attache plus à la célébration nostalgique de la particularité d’un
passé déjà révolu et à l’évocation conservatrice d’un folklore dans une large
mesure en déshérence qu’à la prospection d’un avenir commun particulièrement
incertain. »[645]
Bien que censée combler le vide d’un passé oublié -celui des individus noyés dans une sorte de chronique évènementielle- l’écriture de l’Histoire, telle que pratiquée par les créolistes, semble ainsi pâtir d’une certaine passivité, dérogeant en quelque sorte à la fonction que souhaiterait lui prêter la forme policière. Cette fonction est déterminante dans la mesure où, en ce qui concerne la plupart des romans de notre corpus, elle est censée clore l’enquête et légitimer l’investigation menée dans l’intimité des individus et parallèlement dans l’Histoire de leur pays, en une issue permettant l’élaboration d’une mise en accusation. Dans les romans des créolistes, cette démarche tend à la culpabilisation, et ce, notamment du fait du caractère pathétique et fataliste des personnages présentés. Or, cette forme de culpabilisation d’un peuple présenté, à certains égards, comme se complaisant dans le malheur, fait justement l’objet de la critique que M. Condé semble proposer dans Traversée de la Mangrove, en mettant en scène un personnage qui, si l’on ignore véritablement les raisons de sa mort, nous est présenté comme la victime d’une perception obsessionnelle du passé : Francis Sancher cause en effet son malheur, et peut-être même sa mort, en faisant des atrocités perpétrées par ses ancêtres colons une croix impossible à porter.
***
Clé de l’énigme pour la plupart des auteurs maghrébins de notre corpus, notamment conscients des séquelles engendrées par un accès brutal et non maîtrisé à l’Indépendance, le passé joue à l’inverse le rôle de cadavre encombrant, de fantôme envahissant accepté avec un certain fatalisme -se voulant dédramatisant-, dans la plupart des romans créolistes. Doublement impliquée par l’introduction de la forme policière et par l’inévitable densité de la charge historique surplombant les littératures nées d’espaces post-coloniaux, l’enquête menée en amont dans les romans de notre corpus se révèle être finalement significative de la démarche globale engagée par l’auteur. Elle se fait, en réalité, l’aboutissement de toute une mise en place quasi stratégique, à laquelle participent notamment le choix des enquêteurs -tour à tour clownesques, lucides, désabusés-, le recours à un intertexte spécifique -encadrant le propos, le soutenant ou lui octroyant davantage de relief par opposition- ou encore la mise en place d’un contexte singulier -s’exprimant tant au sein des couleurs utilisées pour la peinture brossée qu’aux objets dépeints eux-mêmes. A cet égard, les romans qui intéressent notre étude révèlent bien deux principales perspectives, l’une réaliste, l’autre fantasmée, illustrant parallèlement, deux versants majeurs du genre policier faisant intervenir une variante noire, témoin d’une société en crise, et une autre dite classique travaillant, d’une certaine manière, à l’illustration d’un monde parfait.
Ces deux orientations produisent nécessairement différentes impressions chez un lecteur pouvant être, tour à tour, saisi par la noirceur des tableaux brossés par les auteurs algériens, attentif aux reconstitutions proposées par G. Cabort-Masson ou J-P. Koffel, interpellé tant par les frasques que par la profondeur des romans de D. Chraïbi, séduit par le recul imposé par M. Condé, ou encore sensible à la poétique développée par les créolistes en même qu’agacé par la fixité du tableau proposé par ces derniers, en une représentation bariolée d’une Martinique que l’on finit par croire séquestrée par ses nouveaux chantres.
Quel que soit l’objectif recherché par l’auteur, quel que soit l’effet produit sur le lecteur, il est remarquable de constater l’extrême hospitalité d’un genre pouvant se décliner aisément de multiples façons. Car si le genre policier s’adapte au discours critique, à l’illustration d’une poétique ou simplement à la création d’une sphère ludique, il se révèle être parallèlement propice à l’expérimentation de toute une palette d’artifices, participant de l’élaboration d’une esthétique propre, agissant activement au cœur du texte. Libre de parole, pouvant se permettre les critiques les plus acérées, le genre policier propice à l’audace, la détermination et, dans un certain sens, à l’insoumission de certains auteurs de notre corpus notamment, se voit alors livré aux excès d’une parole libre se propageant dans les moindres recoins de ces histoires de crime, mimant leurs troubles, copiant leurs travers pour finalement offrir des textes aussi spécifiques, voire chaotiques, dans la forme, que les sujets dont ils traitent.
UNIVERSITE MICHEL
DE MONTAIGNE-BORDEAUX III
U.F.R. DES LETTRES
LE ROMAN POLICIER
A L’EPREUVE DES LITTERATURES
FRANCOPHONES
DES ANTILLES ET DU
MAGHREB :
ENJEUX CRITIQUES ET ESTHETIQUES
THESE
Pour l’obtention du Doctorat
ès Lettres
Discipline :
Littératures française, francophones et comparée
Présentée et soutenue
publiquement
par
Estelle MALESKI
Sous la direction de Madame
Martine JOB
Professeur des Littératures
francophones
Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III
JURY
Madame
Christiane Chaulet-Achour
Monsieur Jack Corzani
Madame Martine Job
Décembre 2003
- TOME II -
TROISIEME PARTIE
Jusqu’au bout du roman policier
« Il
faut habiter ce pays non pas avec des yeux tournés vers le passé, vers une
espèce d’image qui nous réconforte parce qu’elle est fidèle à une sorte de
mythe des Antilles qui a voulu nous faire croire que nous sommes un peuple
différent des autres et que nous avons une identité précise qui se définit
aisément. Il faut comprendre que le pays change, que les rapports entre
individus changent, qu’une Guadeloupe nouvelle se crée au fur et à mesure et
habiter ce pays c’est être à l’écoute de la modernité. »[646]
La question de la modernité s’avère être effectivement déterminante dans le cadre de l’étude de la transposition du genre policier aux espaces littéraires francophones du Maghreb et des Antilles.
Comme nous l’avons souligné précédemment, le genre policier, bien qu’apparu en prémices dès la fin du XIXème siècle, demeure inscrit dans la modernité, cette dernière étant notamment constitutive de la manière dont le genre policier parvient à s’adapter et à illustrer les soubresauts d’une évolution sociale soumise à de profonds bouleversements tout au long du XXème siècle ; l’importance croissante de l’environnement urbain participe de ces bouleversements. Témoin et réceptacle de l’évolution des pratiques socio-économiques, des mentalités ou encore des politiques, le cadre urbain transposé au texte confère au regard porté par le scripteur la valeur d’un témoignage précieux, donnant l’impression d’une certaine interactivité entre réalité et fiction. Adaptée aux univers post-coloniaux des Antilles et du Maghreb, cette interactivité prend une résonance toute singulière.
Se positionnant, d’une part, dans la lignée ou en porte-à-faux d’un intertexte correspondant à plus d’un siècle d’existence du genre policier et inscrivant, d’autre part, le genre au sein d’un contexte local fortement caractérisé, aussi bien par son aspect « extérieur » que dans sa spécificité socioculturelle, les romans de notre corpus s’engagent de manière plus ou moins marquée dans une appropriation du cadre générique. Cette prise de possession d’un genre jusque-là peu exploité dans les espaces littéraires maghrébins et antillais s’exprime dans les différentes transformations et adaptations que les auteurs de notre corpus font subir à la forme policière traditionnelle, profitant de l’adaptabilité d’un genre déjà décliné sous différentes variantes. A cet égard, la reprise de la forme policière et plus précisément la manière dont elle est adaptée, semble pouvoir participer de la mise en valeur d’une identité, d’une spécificité propres à ces espaces ; spécificité s’exprimant par le biais d’une double caractérisation concernant aussi bien la singularité du contexte référentiel que la manière de procéder des différents scripteurs. Nous constatons, en effet, que si le genre policier paraît adaptable et transposable à différents univers, son mode de fonctionnement même -se rapportant entre autres à l’organisation du schéma narratif, à la modalisation du système énonciatif ou encore à l’usage linguistique- semble lui aussi susceptible de subir les effets d’une telle acclimatation. Aussi, le recours à la modernité du genre policier traduit, au sein de la plupart des ouvrages qui nous concernent, aussi bien la volonté de procéder à une représentation précise et orientée de la société que celle de manifester l’avènement d’un renouvellement de la forme littéraire elle-même.
Si les orientations de fond et les objectifs poursuivis divergent, trois grands éléments essentiels du texte policier sont néanmoins repris et combinés par la plupart des auteurs de notre corpus : l’interrogation initiale qui sous-tend et conditionne l’ensemble du texte ; le suspense entretenu par la confrontation avec le mystérieux et l’incertain ; l’attente d’un dénouement final apportant un éclairage nouveau sur le texte dans son entier. Repris et adaptés par les auteurs de notre corpus, ces différents éléments subissent le plus souvent une mise à l’épreuve ardue ; nous verrons en effet que dans la perspective d’un renouvellement de la forme littéraire, le texte policier se voit -parfois irrémédiablement- bousculé, malmené car paradoxalement poussé à son comble.
I-
Le genre policier poussé à son comble
Entraînés par un contexte local caractéristique, voire atypique, et sans doute désireux de se démarquer d’un corpus policier déjà largement exploité, la plupart des auteurs antillais et maghrébins inspirés par la forme policière, empruntent globalement des voies qui, comparées à la variante classique du genre, semblent pouvoir relever du « non conventionnel ». Cet « anti-conformisme » se manifeste notamment par le choix d’une reprise appuyée, voire exagérée, de quelques principes clés du genre ; une démarche marginale vis-à-vis du cadre générique qui se révèle être néanmoins commune à différents romanciers dits « modernes », ainsi qu’à quelques tenants du Nouveau roman, comme le souligne Jacques Dubois :
« Le
récit d’enquête résiste mal à la tentation de pousser sa stratégie jusqu’au
paradoxe et de cultiver des formules narratives où l’ironie du retournement
confine au tragique. La parodie amère est comme la pente fatale du policier.
C’est ici que, toute trivialité mise à part, il se rencontre au mieux avec la
littérature de recherche et qu’entre les deux des échanges se nouent : dès
leurs débuts, M. Butor et A. Robbe-Grillet s’inspiraient du roman
policier ; quant au roman noir à la française (dit “polar”), il a pour
intertexte les fictions de L.F. Céline et de R. Queneau. »[647]
Cette tentation de la parodie se manifeste presque logiquement chez les auteurs de notre corpus, particulièrement sensibles à la notion ambivalente de « parodie amère ». La reprise dévoyée de la forme policière s’inscrit, en effet, chez ces auteurs, dans le cadre de la surenchère propice aussi bien à la perspective ludique qu’à une sorte d’enlisement, d’ensevelissement sous un discours de contenu et de tonalité tragiques.
1- Des données paroxystiques
Evitant le caractère insipide que pourrait revêtir toute fiction policière qui ne profiterait que du cadre « exotique » offert par la singularité des espaces visités, sans proposer de lecture plus profonde des sociétés décrites, la plupart des auteurs de notre corpus exploitent, de manière paroxystique, deux principes majeurs du genre policier que sont le manichéisme -garant de la morale- et le cartésianisme -garant de la raison. Ainsi, tandis que les écrivains tunisiens publiés aux Editions Alyssa surenchérissent sur le stéréotype culturel, et ce, de manière stérile -le lecteur est invité à considérer cette surenchère de manière non ironique mais simplement ludique, sans véritable mise en abyme- d’autres tentent d’appliquer cette surenchère de manière significative. Dans ces romans, la noirceur du crime et la densité de l’enquête se voient tant et si bien exploitées que le genre en perd finalement ses piliers, nous donnant à lire des romans si « noirs » que le manichéisme n’y résiste finalement pas, nous entraînant au cœur d’enquêtes si denses et si complexes que le cartésianisme finit par s’y perdre.
1.1-
Enlisement
dans la face « noire » du genre
Dans la préface de l’ouvrage d’Ernest Mandel, consacré à l’histoire sociale du roman policier, Jean Vilar définit le roman noir comme s’inscrivant dans « une littérature de temps de crise » faisant de ses lecteurs des « passagers de la nuit »[648]. Il ajoute :
« On
nous a beaucoup encrassés en présentant le récit noir comme une version moderne
de la tragédie grecque. Ce n’est pas une idée idiote, juste à côté de la
plaque, vaguement réac. […] Le roman noir plonge au contraire dans l’opaque
d’un tragique pas du tout épuré. Il progresse dans l’asphalt jungle où, à chaque instant, des parcours nouveaux doivent
être réinventés, où le danger guette, l’émerveillement aussi ; où la pire
des fautes est forcément la naïveté. »[649]
Dans le roman noir ainsi défini, comme dans bon nombre de romans de notre corpus, le refus de la naïveté semble aller de pair avec le rejet de toute perspective manichéenne, laissant entendre l’existence d’une forme d’équilibre établi entre puissances maléfiques et bénéfiques. Qu’ils s’inscrivent de manière plus ou moins latente dans la lignée de la variante noire du genre -par le paratexte, le contexte ou la nature de l’enquêteur- la plupart des romans qui nous intéressent offrent, de manière relativement homogène, au « mal », à l’échec, au « noir » dans ce qu’il recèle de plus primaire, une tribune de poids.
1.1.1- Victoire du cynisme et de l’amertume
Compte tenu de la noirceur du contexte social présenté dans les romans de Y. Khadra et de B. Sansal, de la multiplicité des crimes commis, de leur atrocité et de la barbarie primaire de leurs auteurs ou commanditaires, l’ensemble étant généré par la perspective saisissante d’une approche de type référentiel, il ne fait aucun doute que la littérature policière algérienne s’inscrit résolument dans la variante noire du genre. Ainsi, à propos de Y. Khadra, B. Bechter-Burtscher écrit :
« D’après leur structure et leur contenu, Le Dingue au bistouri, La Foire des enfoirés, Morituri et Double blanc sont incontestablement des romans noirs, et, maintes fois, les œuvres de Yasmina Khadra montrent que l’auteur connaît et maîtrise les règles de ce genre. Tandis qu’elle jongle avec ceux-là de façon créative au niveau du contenu et de la langue, la structure de ses romans suit sans innovations ou variations le modèle du roman noir. Dans tous ses romans, c’est donc un crime -l’assassinat ou la disparition d’une personne- qui se trouve au début des enquêtes du Commissaire Llob. Parallèlement aux recherches du commissaire et de ses collègues cernant de plus en plus les suspects, la série des crimes se poursuit, et Llob découvre toujours de nouvelles victimes jusqu’à ce qu’il arrive, à la fin du roman, à arrêter le(s) meurtrier(s). »[650]
Il s’agit donc pour Y. Khadra d’ancrer ses textes dans la lignée des Chandler ou Hammett, et ce, d’autant mieux que la manière dont Llob vient à bout des criminels ne tient pas de la simple et « sage » arrestation : dans les romans de Y. Khadra, en effet, les criminels épinglés dans la ligne de mire de l’enquêteur aigri n’échappent que rarement à l’application sévère d’une loi du Talion légitimée par un enquêteur devenu justicier tandis que, paradoxalement, les véritables criminels, piliers silencieux et invisibles de la mafia politico-financière, semblent demeurer insaisissables. Ainsi, bien qu’éprouvant une certaine sympathie et une inévitable compassion à l’égard de cet enquêteur malade d’impuissance, le lecteur n’en demeure pas moins confronté à la réalité d’actes de vengeance entachant nécessairement la « pureté » de l’enquêteur. En endossant le rôle du justicier, Llob verse à son tour, d’une certaine manière, dans le crime.
Enquêteur tout au long de l’affaire, Llob devient justicier in fine, comme pour pallier les déficiences d’un genre condamné à finir mal, dans l’ambiguïté et la victoire amère[651] ; une mutation expérimentée avant lui par d’autres, tels les « enquêteurs » mis en scène par R. Chandler ou encore W. Faulkner, comme le remarque notamment Catherine Pesso-Micquel :
« Les “chevaliers” de Faulkner et Chandler font fusionner la tradition européenne de la “quête” et la figure mythique du justicier solitaire américain, dont un autre avatar est le cow-boy des grandes plaines. Pour paraphraser Malraux, disons qu’ils constituent l’incongrue mais fertile intrusion de la Romance américaine dans l’univers cynique du roman noir. »[652]
Il s’agit en fait de l’intrusion d’une certaine logique chevaleresque qui exprime véritablement le désir de dépasser le fatalisme propre aux enquêteurs du roman noir et que l’on perçoit également nettement dans le brusque « réveil » de Larbi, soudain décidé à mettre sa vie en danger, à défier la mort, pour enfin s’accomplir en tant qu’enquêteur-justicier. Investi d’une mission dépassant le simple cadre de la fiction, Larbi outrepasse ainsi ses fonctions et transgresse les limites de son propre rôle pour s’engager dans une voie plus symbolique. Avec le roman de B. Sansal, le lecteur est alors confronté à un dépassement de la stricte fonction sociale du policier également sensible dans des textes qui, dès lors, sont perçus comme marginaux au sein d’un genre lié à des préoccupations plus concrètes et strictement limitées au cadre de la fiction. Jacques Dubois revient sur ces textes « à part » :
«
Certains textes policiers parmi les plus construits se distinguent par le
traitement désinvolte qu’ils font subir à la structure de base et par la crise
qu’ils ouvrent dans le genre dont ils se réclament. On dira que c’est pour eux
manière d’assouplir le caractère contraint de ce dernier et d’en accroître la
teneur romanesque. Une raison plus intrinsèque semble agir en l’occurrence. Le
détective qui déroge à son rôle, le récit qui dévie de sa ligne ne s’en
tiennent plus à leur programme initial -résolution de l’énigme et
identification du coupable- pour la raison qu’un projet second est venu
interférer avec le premier. S’est superposée à l’obligation de régler l’affaire
criminelle l’intention plus haute de mettre au jour et de réduire un
dysfonctionnement social d’ampleur variable. Rappelant les justiciers du premier
roman populaire, le détective se pose en réformateur ou même, pour mieux dire,
en utopiste. »[653]
Or, si transgression il y a dans les comportements de Llob ou de Larbi, ce n’est pas tant du fait d’un renoncement au projet initial, consistant à résoudre l’énigme et à identifier le coupable, qu’à une défaillance perturbant les modalités d’application de ce projet. C’est justement parce qu’ils veulent dénoncer les coupables à tout prix que Llob et Larbi sont obligés de déroger à leur rôle, qu’ils sont contraints de « faire cavalier seul » et de transgresser les règles de leur police, dans la mesure où c’est justement cette dernière qui est source de la transgression essentielle, celle de ne plus permettre l’exercice d’une justice équitable. Dans le cadre de la police algérienne et plus largement dans celui du système judiciaire, tel qu’il nous est présenté par Y. Khadra, B. Sansal et avant eux par R. Mimouni, de manière encore plus explicite, l’utopie ne consiste pas en un simple rêve d’idéal, mais s’exprime dans le rejet d’un système outrageusement perverti ; dans ces romans, l’utopiste est par conséquent actif avant tout.
Llob et Larbi pousseront ce rôle à son comble puisque tous deux meurent finalement assassinés, stoppés dans leur quête par la seule manière capable de neutraliser leur détermination : la mort. « Cow-boys » ayant perdu leur duel, Llob et Larbi meurent finalement en héros et, dans le contexte algérien, en martyrs. Rattrapée par le poids de la réalité algérienne, la « Romance américaine » est finalement absorbée par « l’univers cynique du roman noir », les personnages étant en quelque sorte rappelés, de la manière la plus sévère, à la logique de leur rôle initial.
Constante du roman noir, cette victoire du cynisme n’épargne pas pour autant certaines formes plus légères et ludiques du genre policier, telle que celle pratiquée notamment par D. Chraïbi avec les enquêtes de l’inspecteur Ali.
Volontairement parodiques et exagérément « drolatiques », les enquêtes de l’inspecteur Ali présentent, en effet, la caractéristique de s’achever dans une forme de « politiquement incorrect » revendiqué. Ainsi, la récompense obtenue par Ali pour l’enquête menée dans Une Place au soleil s’apparente davantage au détournement de fonds qu’à une simple rétribution salariale. C’est par ailleurs au terme d’obscures manigances qu’Ali parvient à conduire la coupable qu’il a démasquée à Trinity College, au Maroc, afin qu’elle y subisse la peine capitale. C’est enfin par la force et au moyen d’un stratagème odieux qu’il parvient à retenir le criminel mis en scène dans L’Inspecteur Ali et la C.I.A. dans une prison marocaine, où il sera retrouvé mort d’une balle dans la tête, sans que l’arme ne soit retrouvée, laissant ainsi penser davantage au meurtre qu’au suicide. Dans ce dernier cas, la manière dont Ali présente au prévenu son transfert dans une prison marocaine (« Mes hommes vont vous y conduire, politiquement et correctement »[654]) témoigne parfaitement du cynisme caractérisant l’attitude finale d’Ali.
« Plaisant » tout au long de l’enquête et du roman, Ali se révèle sous un nouveau jour in fine : autoritaire, impitoyable et cruel. Il s’agit pour D. Chraïbi de souligner le contraste évident s’établissant entre le caractère fictif de son personnage et la réalité beaucoup moins fantasque des conditions du maintien de l’ordre et de l’application de la justice au Maroc. Justicier incontrôlable au service d’une conception plus que discutable de la Justice, Ali entraîne finalement le lecteur dans les sombres recoins du genre policier. Il ne s’agit plus de mettre en scène des marginaux révoltés par l’injustice du système, comme dans les romans noirs de la première vague. La démarche de D. Chraïbi -plus développée encore dans Une Enquête au pays- mais également de P. Chamoiseau consiste à illustrer, d’une certaine manière, la victoire de ce système « injuste » sur toute forme de résistance. Ainsi, les défenseurs de l’ordre de la nouvelle génération se voient totalement aliénés à une conception autoritaire du respect de l’ordre, transformant le désir de justice en soif de répression.
Appliquant de manière excessive le principe du genre consistant à parvenir au rétablissement de l’ordre coûte que coûte, les enquêteurs trop « consciencieux », tels Bouaffesse et ses hommes, sombrent alors dans l’extrême, déterminant hypothétiquement le crime (« On avait tué ! Cette histoire d’égorgette en était la belle preuve »[655]), désignant arbitrairement les coupables (« Le brigadier-chef […] se devait de manier une intelligence en un tac de temps et trouver un coupable »[656]), tant et si bien que dans Solibo Magnifique, les enquêteurs lancés sur les traces d’un criminel inexistant, puisque Solibo n’a pas été assassiné, se voient étrangement confrontés aux limites de leur propre fonction romanesque. Dépêchés au cœur d’une affaire, et par extension d’une intrigue qui, en réalité, ne nécessitent pas leur présence, Bouaffesse et ses hommes pallient alors, d’une certaine manière, cette erreur de distribution en proposant leur propre adaptation d’un scénario défaillant, en fabriquant leur « cinémascope »[657], leur « cirque ». Ainsi, lorsque Bouaffesse tente d’atténuer l’ardeur des pompiers en déclarant « si vous faites le cirque Pinder moi je donne les tickets à l’entrée et je fais les quatre lions ! »[658], il ne croit pas si bien dire. Or, tandis que différents personnages du roman se réfèrent au cirque dans une perspective connotée positivement -il est souvent question de situations désopilantes ou d’attitudes clownesques[659]-, le cirque de Bouaffesse, quant à lui, n’a rien du divertissement, s’apparentant en réalité davantage aux jeux romains, mises à mort comprises.
C’est donc bien ici l’élément policier qui vient une nouvelle fois perturber l’atmosphère bon enfant à laquelle le comique de certaines scènes tendrait à nous faire croire. Tandis que les témoins de la mort de Solibo ont cru pouvoir « prendre la police pour des mickeys »[660], Bouaffesse se révèle être bien décidé à leur montrer de quel bois il se chauffe : n’est-il pas après tout « du bois de fesse », celui dont on fait les chefs ? C’est pourquoi pour venir à bout de cette enquête pour laquelle il a été sollicité, Bouaffesse ne lésine pas sur les moyens. Incapable de mener une enquête digne d’un grand détective, faute d’un manque de maîtrise de la méthodologie à appliquer en pareil cas (« Des bribes de ses cours par correspondance lui reviennent malement »[661]), et par là-même incapable d’honorer le schéma classique du genre policier, Bouaffesse opte rapidement pour l’action. L’agression supplante alors l’observation et les armes, la réflexion, tandis que l’intimidation et la violence primaire s’invitent aux interrogatoires. C’est riches de leur passion pour les westerns spaghetti que Bouaffesse et ses hommes se lancent alors dans la variante noire du genre, bavures à la clé, couvertes de surcroît par quelques faux-témoignages. Et c’est là vraisemblablement la transgression la plus évidente à l’égard du roman noir : Bouaffesse et ses hommes n’ont aucune fierté, aucune dignité ; ils n’assument pas leurs actes. Leur manière de mener l’enquête n’appelle, en outre, aucune morale finale. Seule l’amertume des victimes de la répression policière perdure :
« Quand,
devant moi, ils eurent agrafé leur procès-verbaux, leurs rapports, leurs photos
qui ne représentaient rien, qu’ils eurent noué leur gros dossier de merde pour
le descendre aux archives, signifiant ainsi qu’une enquête inutile venait de
s’achever, ils avaient découvert que cet homme était la vibration d’un monde
finissant, pleine de douleur, qui n’aura pour réceptacle que les vents et les
mémoires indifférentes, et dont tout cela n’avait bordé que la simple onde du
souffle ultime. »[662]
L’issue paraît d’autant plus sombre que l’emploi du futur (« aura ») semble mettre un point final à tout espoir de happy-end, même symbolique. C’est donc bel et bien sur un crime -suspect poussé au suicide et dossier classé abusivement- que le roman s’achève, prenant totalement à rebours la structure policière traditionnelle, d’autant mieux que la clé de l’énigme nous est révélée dès les premières pages, en deux temps ; d’une part, à travers la retranscription du procès verbal retraçant les principaux éléments de l’affaire, d’autre part, par l’introduction d’un bref résumé en préambule du premier chapitre :
« Au cours d’une soirée de carnaval à Fort-de-France, entre dimanche Gras et mercredi des Cendres, le conteur Solibo Magnifique mourut d’une égorgette de la parole, en s’écriant : Patat’sa !… Son auditoire n’y voyant qu’un appel au vocal crut devoir répondre : Patat’si !… »
Toute l’enquête menée par les policiers peut ainsi être perçue comme un supplément, comme une variation à la fois glauque et fourmillante, née de la fièvre créatrice d’un écrivain transformant une banale soirée de carnaval antillais en véritable bal des vampires, les témoins de la mort de Solibo se nourrissant eux-mêmes de la violence engendrée par l’intrusion, dans leur univers, de la répression policière :
« Le
major et la majorine se sont saisis, personne n’y peut plus rien. Bouaffesse
lui-même recule un petit brin. Il pressent d’imminentes dévastations et ne peut
s’empêcher de saliver comme à l’évocation d’un crabe farci. Nous-mêmes, notre
terreur de témoins se dissipe sous la venue d’une soif de voir (ô nous aimons
ces acmés de sangs, cette violence toujours florissante et disponible sans
pourquoi ni comment). »[663]
Ce goût immodéré pour la violence gratuite est à la fois revendiqué par la tournure emphatique de l’affirmation (« ô nous aimons ces acmés de sang ») et presque caché par la précaution d’une mise entre parenthèses ; il inscrit, en outre, les témoins de la mort de Solibo, représentants de tout un peuple -le pronom « nous » insinue la généralisation à l’ensemble des Antillais-, dans une forme de complaisance malsaine à l’égard de la violence. La société martiniquaise, telle que décrite par P. Chamoiseau, paraît, en ce sens, si pervertie que les victimes de la répression policière elles-mêmes jouissent de leurs propres souffrances, en une forme de sado-masochisme que l’auteur choisit d’éclairer à la lumière de la dérision. C’est ainsi qu’au terme du duel opposant Doudou-Ménar et Diab-Anba-Feuilles, la redoutable majorine est terrassée par un fulgurant coup de boutou, à l’origine d’un diagnostic peu rassurant de la part du « plus savant des pompiers » :
« Je
ne veux pas te forcer avec de grands mots, Brigadier, mais la dame est tombée
là sur un terrorisme crânien. C’est un grand mot de la médecine qui te paraît
comme ça compliqué, mais qui en fait veut simplement dire que la tête de la
dame est comme une tomate farcie… »[664]
Bien que poussant ses personnages à une violence permanente, P. Chamoiseau ne va finalement pas au bout de l’expression de cette violence, préférant bifurquer dans le grotesque et le « rire distanciateur ». Or, au-delà du ridicule illustré par l’ignorance d’un pompier se prenant au sérieux et doté judicieusement d’un vocabulaire prêtant au rire, c’est bien d’une femme mourante qu’il s’agit. Précisons ici que si le rire, illustré par le recours à une forme d’humour dit « noir », participe généralement du genre policier, notamment comme vecteur de la personnalité marginale de l’enquêteur, la perspective adoptée par P. Chamoiseau s’inscrit dans un registre sensiblement différent. La différence pouvant distinguer Solibo Magnifique des romans noirs « traditionnels » réside notamment, pour ce qui est du recours à l’humour, en ce qu’aucun personnage du roman de P. Chamoiseau ne semble véritablement capable de faire preuve de cynisme. La soif de violence des membres de la Compagnie, témoins du combat opposant major et majorine, est cynique, mais elle est vécue de manière passive, fataliste. Ce cynisme ne permet aucune distanciation ; il est stérile, subi. Il englobe les personnages sans que ces derniers ne puissent véritablement en disposer. Seul Bouaffesse parvient à en faire usage en falsifiant les dépositions faisant de la mort de Congo un simple accident, mais alors, contrairement aux romans noirs « traditionnels », le cynisme sert ici exclusivement le crime.
Plus que l’histoire d’une enquête, Solibo Magnifique semble donc proposer l’histoire d’un crime ou plus précisément celle d’une société criminelle où décidément rien ne va.
Notons en ce sens que dans les romans de notre corpus s’inspirant de la variante noire de la forme policière, ce n’est pas tant la vérité que l’espoir qui a finalement disparu. A cet égard, J-P. Koffel fait figure de marginal, d’idéaliste, de rêveur, en redonnant aux « gentils » le pouvoir de l’action et en inscrivant ses textes dans une perspective manichéenne. Rejetant cette approche quelque peu simpliste visant à distinguer les « bons » des « mauvais », d’autres auteurs, à l’inverse, proposent d’adapter le genre policier et plus précisément encore de le travailler. Subissant les effets de son acclimatation aux sphères sociale et littéraire des Antilles et du Maghreb, le genre policier s’engage alors dans une double perspective, l’une soumise à une approche de type référentiel, l’autre livrée à une perception fantasmée, toutes deux servant une seule logique : celle du désespoir.
1.1.2- Le « noir », entre logique et esthétique
Au-delà des affinités pouvant s’établir entre des textes d’aires différentes, il s’agit de souligner ici que, globalement, le recours à la forme policière s’inscrit, chez Y. Khadra et B. Sansal notamment, dans le cadre d’une écriture avant tout référentielle -bien que leurs textes participent également d’une poétique travaillée- tandis qu’elle sert, en ce qui concerne notamment les auteurs s’inscrivant dans le cadre du roman-enquête, une démarche ancrée dans une perspective s’attachant plus à la forme du texte qu’au fond de l’histoire narrée. Dans le premier cas, le recours à la variante noire participe d’une logique du désespoir, tandis que, dans le second, elle semble pouvoir s’inscrire davantage dans le cadre d’une esthétique du noir.
Les personnages mis en scène par P. Chamoiseau relèvent du désespoir, malgré le rire suscité par les portraits et attitudes grotesques présentés ; en réalité, c’est justement parce que leur malheur suscite le rire et la moquerie que leur situation est d’autant plus désespérée. Plongés dans une violence comportementale extrême et soumis à l’obligation d’exubérance clownesque que leur impose leur créateur, les personnages mis en scène par P. Chamoiseau semblent totalement étriqués dans leur rôle et au sein du contexte socio-historique qui leur est prêté. Or, le recours à la forme policière, pervertie en une victoire incontestable du crime in fine, contribue à renforcer leur « statut » de prisonniers, irrémédiablement ancrés à la fois dans leur créolité et dans une histoire de crimes « sans pourquoi ni comment ».
Il est intéressant, à cet égard, de remarquer, une nouvelle fois, la distance séparant P. Chamoiseau de T. Delsham. Dans Panique aux Antilles, en effet, le détective est véritablement un héros qui peut être, lui aussi, poussé dans les marges de la légalité, mais toujours pour une « bonne » raison, pour défendre des principes et une Justice « honorables ». Pierre Corneille est, en effet, conçu sur le modèle des détectives privés traditionnels, évoluant en marge des forces de police en lesquelles il ne croit guère. Homme d’action efficace et séducteur, il inspire la confiance et la sympathie du lecteur, bien que ce dernier puisse être irrité par le caractère quelque peu obsolète d’un héros aussi parfait. La démarche de T. Delsham, tout en paraissant anodine et inscrite dans une perspective purement éditoriale, relève en réalité d’un projet que l’auteur esquisse notamment dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Antilla, à propos de son dernier roman policier, intitulé Chauve qui peut à Schoelcher[665] :
« Je propose à notre imaginaire ce héros flamboyant, qui gagne toujours et fait rêver. Ce fameux mèt-piès refusé par certains d’entre nous, au prétexte que ce dernier ressemble trop à l’Autre dans son mécanisme de séduction. Tous les poètes du monde ont chanté les gagneurs issus de leur peuple, de leur passé ou de leurs…rêves. »[666]
Il ajoute :
« L’édition européenne, l’édition américaine, l’édition asiatique, alimentés par les auteurs de chez eux, ont magnifié le héros sans peur et sans reproche, invulnérable et noble, ouvrant la porte aux rêves, proposant des modèles, suggérant le dépassement de soi. Je pense que ce serait grave erreur de faire l’économie de ce héros flamboyant. Si l’édition française ou autre l’abandonne partiellement, et on ne peut abandonner que ce qui a existé, c’est plus par saturation du lectorat que par décision idéologique ou éthique. Le souci commercial de ces maisons est désormais le héros modeste et identifiable : celui qui souffre, qui prend des coups, qui pleure, qui est malmené par la destinée, qui est monsieur tout le monde, qui est émouvant dans sa faiblesse et qui est caricatural. C’est justement-là le drame de l’arrière, arrière petit-fils d’esclave. »[667]
Prenant pour cible les auteurs de la créolité en particulier, T. Delsham entend affirmer son indépendance vis-à-vis de ce mouvement en même temps que des maisons d’édition qui l’accueillent. Rejetant ce qu’il définit comme une certaine « philosophie compé-lapiniste[668] », T. Delsham crée un héros qui gagne, offrant une happy-end bien méritée à une certaine littérature enlisée dans la complainte et le désespoir :
« J’estime que l’on ne peut ainsi assommer un peuple par l’affirmation de son néant, que l’on ne peut ainsi lui marteler qu’il est une victime éternelle de l’esclavage, une victime éternelle du décervelage, une victime éternelle du colonialisme, “un jouet sombre au carnaval des autres”, “une peau noire sous un masque blanc”, que ses moindres choix politiques ou esthétiques, ne sont que résultantes d’une aliénation réussie, “d’un endormissement permanent”. »[669]
Dans Panique aux Antilles, les crimes se multiplient, plus sanglants les uns que les autres, servant le projet machiavélique d’un homme décidé à exploiter à outrance le potentiel touristique de l’île. Si le héros relève de l’idéal, si les ressorts du roman s’inscrivent dans une conception traditionnelle de la forme policière -d’action et non « de salon », avec meurtres, enquête périlleuse menée par un homme hors du commun, coupable démasqué et neutralisé- le propos reste ancré dans des préoccupations locales réelles. L’univers décrit est loin d’être parfait, mais le héros l’emporte néanmoins, suggérant que si le monde va mal, la situation n’est pas pour autant désespérée pour peu que l’on se décide à passer à l’action. Dans le roman de T. Delsham, le schéma est simple : les rôles sont redistribués, les policiers ne sont pas tous irréprochables et le système judiciaire présente de nombreux dysfonctionnements, mais la vision d’ensemble demeure manichéenne. A l’inverse, le propos tenu par P. Chamoiseau se veut beaucoup plus complexe, ne répondant finalement à aucun schéma type, affirmant son indépendance vis-à-vis d’un cadre littéraire codifié et maintes fois exploité et finalement se faisant remarquer. Or, cette perspective du détournement est loin d’être marginale : très tôt, les auteurs policiers se sont essayés au détournement, comme en atteste par exemple le roman d’Agatha Christie, intitulé Le Meurtre de Roger Ackroyd et faisant du narrateur le meurtrier. La démarche de P. Chamoiseau consiste à pousser cette « stratégie » du détournement à son comble, jusqu’à la négation-même du cadre générique puisque Solibo Magnifique n’est pas présenté comme un roman policier. Au héros lumineux, victorieux et rassurant proposé par T. Delsham, P. Chamoiseau oppose non pas un héros mais une multitude de personnages qui ont tous une part de responsabilité dans le malheur qui les touche. C’est ainsi que rapidement le « rire amer » fait place aux pleurs. Chaque chapitre de Solibo Magnifique contient ainsi, en sous-titre, une forme d’invitation aux larmes qui progressivement sombre dans l’accablement -souligné par une reprise de plus en plus élimée de la formule :
Chapitre 1 : (Pour qui pleurer ? Pour Solibo.)
Chapitre 2 : (Pour qui pleurer ? Mais pour Charlot.)
Chapitre 3 : (Qui pleurer ? Doudou-Ménar.)
Chapitre 4 : (Pleurer ? Congo.)
Il s’agit pour le narrateur de rendre hommage, d’une certaine manière, aux personnages victimes de la « déveine », en offrant à chacun une parole : le témoignage sollicité par le cadre policier devient alors le prétexte à une mise en pratique d’un des principes véhiculés par l’esthétique de la créolité et visant à permettre au « petit peuple » de s’exprimer.
Notons toutefois que cette volonté de distribuer la parole aux personnages n’est pas seulement le fait des créolistes et se manifeste également dans le roman de M. Condé, Traversée de la mangrove.
Dans la démarche de la Guadeloupéenne, il s’agit d’offrir la parole à ses personnages, selon des modes énonciatifs différents sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir[670]. Quel que soit le type de narration choisi, chaque personnage nous est livré dans toute sa vérité, les témoignages directs ou indirects prenant, à certains égards, les traits de véritables confessions, laissant apparaître le profond désarroi propre à chacun.
Réunis, à l’occasion de la disparition de Sancher, dans le cadre de la veillée mortuaire, les différents personnages se laissent ainsi aller à la mélancolie, aux regrets, aux constats d’échecs, entraînant le lecteur dans une suite de tableaux relativement sombres peuplés de confessions de « crimes » divers (mensonges, meurtre ?, adultère, inceste). Ces multiples témoignages constituent autant d’aveux en lesquels les « criminels » semblent pouvoir percevoir leur salut, chacun convenant de nouvelles orientations, de projets de départ, de perspectives de recommencement. C’est précisément cet espoir que la victime, Francis Sancher, ne parvient pas à s’offrir, incapable de se départir des remords suscités en lui par les crimes commis par ses ancêtres colons. Bien que l’origine de la mort de Sancher laisse subsister quelques doutes, on peut imaginer que l’une des raisons potentielles expliquant son décès réside en ce qu’il n’est pas parvenu à surmonter, oublier ou assumer le crime. Il est, en effet, possible qu’il soit mort de culpabilité, bafouant, d’une certaine manière, un des principes de base de tout criminel revendiqué comme tel, au sein du genre policier ; le seul crime de Sancher est finalement celui de la culpabilité, celui qui le pousse à se sentir responsable d’un crime qu’il n’a pas commis. Ici, le criminel et la victime ne font qu’un ; crime et châtiment fusionnent en un renversement de l’effet de causalité : c’est le sentiment de culpabilité qui avalise le crime ; c’est, d’une certaine manière, le châtiment qui fait exister le crime. A l’annonce de la découverte du cadavre, la question « Qui l’a tué ? », que tous se posent spontanément, en soulève ainsi une autre, qui pourrait se poser en ces termes : « Qui l’a puni ? ». Or, cette réaction est en rupture par rapport à la logique traditionnellement développée par le genre policier qui consiste à inscrire le crime dans la sphère de l’inattendu, de la surprise, de la rupture. Dans le cas du décès de Francis Sancher, aucun de ces trois éléments ne semble véritablement mis en avant puisque tous se doutaient que cet homme « finirait mal » ; lui-même attendait sa mort :
« Quand
Alix était venu le chercher, il s’était rappelé cette rencontre des jours
précédents, réalisant que cet homme bavard et ma foi assez enjoué l’attendait,
sa mort.»[671]
Perçue comme le fruit d’une malédiction pesant sur l’ensemble des hommes de sa famille, cette mort était en effet attendue par Sancher, presque par procuration, dès l’enfance. Ainsi, Sancher se souvient :
« Mon
père avait au visage une grande tache lie-de-vin au milieu de laquelle nageait
son petit œil froid comme celui d’un requin. J’ai l’impression qu’il était
toujours vêtu de noir tant tout son être évoquait pour moi la mort. En réalité,
il devait porter des costumes de toile blanche raide empesée par les soins de
nos innombrables servantes. Tous les soirs, ma mère nous faisait, mon frère et
moi, mettre à genoux au pied de son lit dans sa grande chambre carrelée de
rouge et les yeux fixés sur le Crucifix nous faisait prier pour lui. Nous
savions qu’une malédiction pesait sur la famille. »[672]
Tout le drame de Sancher est ici contenu en germe : la perception « négative » du père, comparé, en dépit de son statut de victime potentielle, à un redoutable prédateur ; le sentiment de culpabilité à l’égard de la situation de la famille dans le contexte local, l’évocation de la présence d’« innombrables servantes » laissant percevoir le malaise de l’enfant à l’égard de son statut de « fils de maître » ; le conditionnement morbide de l’enfant « poussé au noir » ; le sentiment de la faute comme mobile de la malédiction, impliquant le recours à la prière, dans une attitude de contrition ; l’implication de l’enfant dans le malheur à venir, la mère contraigant les enfants à prier pour leur père, en les associant, d’une certaine manière, inéluctablement à son destin tragique ; enfin la certitude de l’issue fatale puisque aucune échappatoire n’est envisageable. Malgré l’insouciance et les nombreuses incertitudes qui devraient être constitutives de leur jeune âge, ces enfants « savent » que la malédiction pèse.
Perçue comme une menace certaine, comme une malédiction prenant effet à une date ponctuelle (« des morts subites, brutales, inexpliquées, toujours au même âge, la cinquantaine »[673]), la mort de Sancher, des années après celle de son père et de ses aïeux, apparaît autant comme une punition injuste que comme la délivrance ultime survenant après des années de honte et d’angoisse. Sancher a vécu dans l’attente d’une mort maudite ; or cette mort est survenue comme prévu, en toute logique, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une série, mais en dépit du bon sens et de la raison, dans la mesure où la perspective de la malédiction demeure constitutive du domaine de la superstition.
Au caractère obscur de la mort, point de départ de la putréfaction de la chair et du chagrin des vivants, s’adjoint alors une forme de logique irrationnelle inquiétante. La question « Qui l’a tué ? » peut, en ce sens, être perçue comme un moyen de parer l’effroi suscité par la perspective d’une mort par malédiction ; c’est également cette raison qui pousse Bouaffesse à faire de Solibo, « noyé sans eau », la victime d’un complot criminel.
Le recours à l’hypothèse criminelle, et par extension au cadre de la fiction policière ou du roman d’enquête, semble ainsi participer d’une tentative de « balisage », de repérage, d’encadrement. Il s’agit de neutraliser la part d’incertitude provoquée par l’intrusion d’éléments irrationnels au cœur d’une intrigue, déjà déterminée par la mort, de rassurer peut-être le lecteur, mais surtout d’offrir aux personnages mis en scène une éventuelle issue de secours. Ainsi, Solibo Magnifique, Traversée de la Mangrove, L’Homme-au-bâton ou encore Brin d’amour illustrent, de manière explicite, la tension permanente s’établissant entre la perspective rationaliste du cadre policier et la dimension déstabilisante de la confrontation avec une mort mystérieuse. Autrement dit, ils expriment au premier plan le « conflit qui fonde le roman policier » qui est « celui d’une intelligence aux prises avec le mystère du monde »[674] ; conflit constitutif de la forme policière, comme l’indique notamment Ernest Mandel :
« Il
ne serait pas exagéré de soutenir que le vrai problème auquel s’intéresse le
roman policier classique n’est pas du tout le crime, et certainement pas la
violence ou le meurtre en soi. Ce serait plutôt la mort et le mystère, et avant
tout le mystère. Ce n’est pas fortuit. Le mystère est le seul facteur
irrationnel que la rationalité bourgeoise ne peut éliminer de son
univers : le mystère de ses propres origines, de ses propres lois de
fonctionnement et, plus que tout, le mystère ultime de sa destinée. »[675]
Au-delà du strict contexte romanesque faisant intervenir des personnages, au sein d’un espace-temps précis et autour d’une intrigue les mettant en relation, tout roman policier reposant sur le principe de l’énigme à résoudre, part en quête de ce que l’on pourrait définir comme le « crime suprême » dont les auteurs principaux se nomment « mystère », « incertitude » ou encore « ignorance ».
Sous-jacent dans la forme classique du genre, ainsi que le suggère E. Mandel, ce motif apparaît au premier plan dans quelques-uns des romans de notre corpus où l’enquête ne se fait pas tant recherche d’un coupable qu’observation des effets provoqués par l’intrusion d’une mort subite non naturelle ou supposée telle.
Dans le roman de type référentiel, pratiqué notamment par Y. Khadra ou B. Sansal, le crime ne constitue pas un simple prétexte nécessaire à la réalisation d’une enquête, dans la tradition du roman policier classique ; il fonctionne comme preuve, illustration, concrétisation des crimes perturbant la société algérienne et comme argument de la mise en accusation des acteurs principaux désignés comme responsables de la crise. A cet égard, l’observation des « effets du crime » est totalement soumise à la perspective de la dénonciation, la noirceur dans laquelle s’inscrit le contexte énonciatif répondant à la logique du crime. Dans ces romans, la mort se fixe sur le roman, concrétisée en amont par la présence d’un ou plusieurs cadavre(s), traquée en aval par un enquêteur révélant progressivement son mode opératoire ; elle y est vécue concrètement, répondant à un mobile, produisant des effets divers et perdurant dans la crainte suscitée par la liberté du coupable. Dans ces romans, la victime existe en tant que telle, mettant en relief l’atrocité du crime.
Dans d’autres romans -antillais notamment-, à l’inverse, les enjeux sous-jacents de l’enquête transparaissent au premier plan, interrogeant davantage le mystère que le crime en lui-même, abordant la mort de manière moins concrète qu’abstraite, voire métaphysique.
Les romans de type référentiel conçoivent la mort comme une fin en soi et comme le début d’une enquête cherchant avant tout à mettre un terme à la menace que constitue le criminel en liberté, au désordre, à un état de non-droit. Quelle que soit l’issue de l’enquête -échec de l’objectif, notamment dans les romans de Y. Khadra et B. Sansal où l’enquêteur disparaît ; « victoire » de l’enquêteur, comme dans le premier ouvrage de J-P. Koffel ou dans les « classiques » de l’inspecteur Ali-, le propos général du roman est fortement finalisé : « bonne » ou « mauvaise », valorisant une happy-end, comme dans la forme classique, ou proclamant le triomphe final de l’amertume, à l’instar de la variante noire, l’issue est là. A l’inverse, en percevant la mort de manière abstraite, comme une sorte d’ouverture à un univers parallèle, insaisissable et mystérieux, les romans tels que Traversée de la Mangrove, Solibo Magnifique ou Brin d’amour diffèrent sans cesse toute issue possible, rappelant la manière dont les esclaves africains percevaient la mort :
« A
l’origine, pour l’esclave, la mort était une grande libération. C’était le
moment qui lui permettait de retourner vers l’Afrique, de retrouver sa liberté
et une situation de bonheur. C’est pour cela que la mort s’accompagne d’une
veillée assez joyeuse où on boit du rhum, où on dit des contes. Le catholicisme
a aussi renforcé la notion selon laquelle la mort n’est pas une fin mais le
début d’une vie nouvelle. »[676]
Ainsi, que le roman s’achève dans une perspective appelant une ouverture « positive » (Traversée de la Mangrove), malheureuse (Solibo Magnifique) ou imprécise (Brin d’amour), la question de l’issue se pose : si ces romans s’achèvent avec le point final du texte -comme la vie disparaît avec le corps-, l’intrigue, elle, semble pouvoir errer continuellement entre différentes issues possibles, se désolidarisant, en quelque sorte, du roman-corps. Or, plus l’univers présenté apparaît à la fois dense, sombre et complexe, plus le nombre d’issues potentielles augmente. Le recours au noir, au mystère, à la mort participe donc davantage de l’économie narrative que de l’histoire narrée elle-même. Cette approche s’oppose à celle développée par les romans de type référentiel qui donnent la priorité à l’histoire et non à la manière dont elle est narrée. Soucieux d’intensifier les potentialités narratives de leurs intrigues, certains auteurs valorisent ainsi, à outrance, le caractère énigmatique de leurs histoires, tant et si bien que le rationalisme traditionnellement victorieux du genre se voit, ici, largement malmené.
1.2-
Mise en
défaut du rationalisme
Principe de base de l’enquête menée par argumentation-déduction, le rationalisme constitue la clé de voûte de toute fiction policière tendant à la résolution d’une énigme. Evoquant les affinités liant le genre policier à la psychanalyse, Alain-Michel Boyer définit le mode opératoire commun à ces deux disciplines dans le cadre de la confrontation avec le mystère :
« Confiance
absolue dans la raison, volonté de ne rien voir par-delà les faits objectifs et
de considérer que l’observation, même appliquée aux réalités les plus
surprenantes, reste la seule voie qui conduise à l’éclaircissement des
problèmes : telles qu’elles s’installent toutes deux, à la fin du XIXème
siècle, l’une dans les disciplines médicales, l’autre dans la littérature de
masse, psychanalyse et fiction policière partagent cet intérêt pour la levée de
toutes les énigmes, pour l’envers des choses, pour l’exploration de leur face
cachée, pour la mise en forme d’un processus de retournement. L’une et l’autre,
surtout, fondent leurs codes de déchiffrement sur des règles constantes, et
visent à garder l’imagination sous le régime d’une science. »[677]
L’imagination quadrillée par toute une série de principes relevant de la science, l’enquêteur -aussi bien Sherlock Holmes que les policiers mis en scène par C. Himes- peut alors déployer ses armes au service de la raison, présumée dès lors, en accord avec les règles du jeu instauré, seule garante du retour à l’ordre :
« Le
héros enquêteur, dont le travail ruine les explications “surnaturalistes”,
construit “méthodiquement” une explication naturelle des crimes, avec des
hypothèses et avec des faits : hypothèses qu’il induit des faits observés
et dont il déduit des faits observables ; faits qu’il observe pour inférer
puis pour vérifier ses hypothèses. Son enquête ainsi se dédouble : quête
logique (des hypothèses), quête empirique (des faits). »[678]
Or, si le mode de fonctionnement de l’enquête paraît ici relativement simple, car ordonné et encadré, il convient d’y adjoindre l’obligation d’instaurer un équilibre nécessaire entre faits et hypothèses, ainsi que de veiller à ce que les uns et les autres ne se confondent pas ; autant de conditions occultées, voire contredites, non sans dérision, dans quelques-uns des romans de notre corpus.
1.2.1- Intrusion d’éléments perturbateurs
La doctrine du rationalisme pose que tout ce qui existe ayant sa raison d’être, il n’est rien qui, en droit, ne soit intelligible. Dans le cadre des romans de notre corpus, et plus particulièrement de la sphère antillaise, ce principe est nécessairement grignoté par l’intrusion d’éléments irrationnels, présentés comme relevant de la culture locale. Le vaudou ou encore les quimbois jouent, en ce sens, un rôle déterminant et véritablement à double tranchant au cœur de la fiction policière.
De même que le paysage local, généralement déclencheur de perspectives fantasmatiques, paraît susceptible de se mettre au service d’un genre se devant de captiver son lecteur, le recours à des éléments permettant la jonction du folklore et du mystère constitue, dans ce cadre-là, un apport non négligeable. Le fait que de nombreux personnages aient recours au quimbois, comme protection ou comme outil de malveillance, présente ainsi l’intérêt de valoriser l’aspect distrayant, voire dépaysant du genre policier, tout en servant la charge mystérieuse nécessaire au maintien de la tension de lecture.
Apparaissant sporadiquement au fil du récit, le quimbois, et de manière générale tout élément relevant du surnaturel ou de l’irrationnel, fonctionne alors à la manière d’un stimulant chargé de pimenter quelque peu l’intrigue.
C’est ainsi que, dans le roman de Janine et Jean-Claude Fourrier, Morts sur le morne, la meurtrière valide ses crimes en les annonçant et en les signant par le dépôt d’objets maléfiques aux abords du lieu du crime. Elle utilise notamment une bouteille de champagne à moitié remplie d’une marinade contenant « des morceaux de coquille d’œuf et de miroir brisé, une aile de poulet encore garnie de ses plumes et une carte à jouer »[679] ; de quoi susciter la panique des habitants du village et éventuellement faire sourire un lecteur peu sensible à ce type de croyance. Ce genre de procédé « décoratif », offrant à la croyance un rôle quelque peu ornemental est pratiqué régulièrement par les créolistes -qui ne ratent pas ici l’occasion de singulariser d’autant mieux l’identité créole- mais s’avère être également repris par M. Condé, T. Delsham, F. Chalumeau ou encore G. Cabort-Masson[680].
Une majeure partie de leurs ouvrages étant proposés à un lectorat non strictement antillais, il ne fait aucun doute que les réactions suscitées par l’introduction du quimbois au cœur de ces textes, s’avèrent être susceptibles de servir toute une représentation exotique de la culture antillaise, et ce, d’autant que certains auteurs n’hésitent pas à forcer le trait, peu soucieux de mettre en péril la crédibilité du propos. L’attitude des personnages mis en scène dans Morts sur le morne nous apparaît, en ce sens, quelque peu abusive :
« Plombiray
avait perdu son âme. Dès la tombée de la nuit, ce hameau qui, à l’ordinaire,
grouillait de monde, était maintenant désert. […] On évitait la propriété
Desrivières. C’était devenu dans l’esprit des gens un lieu maudit. Une vieille,
“Man Louisette”, racontait même qu’elle avait entendu un soir, alors qu’elle
passait pas très loin sur le chemin, une femme qui riait bruyamment en
soulevant ses jupes. Elle ajoutait que la femme s’était avancée vers elle et
qu’elle avait, à la place de son pied gauche, un sabot de cheval. […] Un seul
lieu public, l’église, restait fréquenté. Chaque jour, elle s’emplissait de
fidèles silencieux, surtout des femmes qui, après leurs prières, couraient chez
Henrius le quimboiseur. En revanche personne ne plaçait un quelconque espoir
dans la police jugée incapable d’arrêter l’assassin, certainement un “gens
gagé”. »[681]
Il en est de même, de certaines réactions des habitants de Rivière au Sel (Traversée de la Mangrove), totalement soumis à la démesure d’une perception surnaturelle du monde :
« Ceux
qui étaient présents à la veillée de Sancher devaient se rappeler qu’à onze
heures sept minutes très exactement, la maison se mit à tanguer, rouler,
craquer de toutes ses articulations tandis qu’un grondement ébranlait l’air.
[…] Le surlendemain qui était un lundi, les gros titres de France-Antilles eurent beau s’égosiller par les rues des
villes :
TREMBLEMENT DE TERRE
EN GUADELOUPE
“Le séisme
a été particulièrement ressenti dans la Basse-Terre, dans la région de Petit
Bourg…”
les gens de
Rivière au Sel n’en crurent pas un mot et demeurèrent persuadés que c’était
Francis Sancher qui leur avait joué un mauvais tour avant de filer se perdre
dans l’éternité. »[682]
Palliant le vide médiatique du week-end, les habitants de Rivière au Sel créent ainsi leur propre version de l’événement ; le recours au domaine de la croyance superstitieuse vient alors combler le caractère inexpliqué de l’événement, non encore soumis à l’expérimentation scientifique. C’est dans une perspective identique que leur regard se porte encore sur une propriété dite hantée, et ce, non sans susciter à nouveau la perplexité du lecteur, induite par celle, manifeste, des propres témoins et victimes d’un étrange phénomène:
« Enfants
et adultes qui s’y aventurèrent prirent leurs jambes à leur cou, grelottant,
bredouillant, incapables d’expliquer clairement ce qu’ils avaient ressenti. Ils
avaient eu l’impression que l’œil malfaisant d’une bête invisible ou d’un
esprit s’était vrillé en eux. Qu’une force les avait poussés aux épaules et
envoyés valdinguer jusque sur le goudron de la route. Q’une voix avait hurlé en
silence des injures et des menaces à leurs oreilles. On commença à éviter
l’endroit. »[683]
Bien qu’exubérants voire insensés, à première vue, ces comportements semblent néanmoins pouvoir être légitimés par l’avènement de faits beaucoup plus concrets, venant accréditer la crainte suscitée par ce genre de croyances. C’est ainsi que Gauthier, rescapé du quimbois mis au point par Marie Nègre, dans Morts sur le morne, finit par trouver la mort à la suite d’une crise cardiaque, survenant au terme d’hallucinations éprouvantes en lesquelles il croit déceler le harcèlement de la mort ; une disparition qui coïncide mystérieusement, qui plus est, avec l’apaisement de la meurtrière, jusque-là soumise à de violentes crises de démence.
De même, les craintes exprimées par les habitants de Rivière au Sel à l’égard de la maison hantée sont tragiquement concrétisées par la mort de trois imprudents n’ayant pas perçu le danger qui menaçait :
« C’est
alors qu’ignorant sans doute toutes ces rumeurs et ces frayeurs qui
commençaient de s’amasser en nuages noirs, trois ouvriers agricoles haïtiens
qui avaient trouvé du travail à la Pépinière avaient défoncé la porte d’entrée
de la maison et étalé leur cabane sur le plancher de la salle à manger. Quand,
après trois jours, ils ne s’étaient toujours pas présentés au travail, Loulou
avait dépêché un contremaître pour leur sonner les cloches. Celui-ci les avait
trouvés raides morts dans leurs haillons, une langue noire leur pointant entre
les dents. »[684]
Malgré leurs origines haïtiennes -qui mieux qu’un Haïtien pourrait être sensible à ce genre de phénomène ?- ou peut-être du fait même de ces origines -leurs connaissances et leur sensibilité en la matière ont pu faire d’eux des proies idéales- ces trois hommes ont ainsi, malgré eux ou volontairement, servi et accrédité la croyance en lui offrant leur chair, en lui prêtant le caractère concret de leur corps.
C’est ainsi que cette approche a priori ornementale du quimbois et de tout élément relevant de l’irrationnel, que l’on perçoit dans la plupart des romans antillais de notre corpus, se fait, à certains égards, plus prégnante, encouragée en cela par le cadre générique au sein duquel elle s’inscrit. Le genre policier, alimenté dans sa forme classique par une approche ludique de la mort et du mystère, paraît en effet propice à une exploitation de tout élément pouvant susciter peur, incompréhension et mystère ; une exploitation nécessairement encadrée et contrôlée par un retour inéluctable de la raison au terme de l’enquête aboutissant à la levée de l’énigme. Or c’est précisément cette condition que bon nombre d’auteurs choisissent de remettre en cause, de manière plus ou moins évidente, si bien que le lecteur se trouve régulièrement confronté à une sorte d’équilibre maintenu tant bien que mal entre une multitude d’éléments relevant variablement de l’inquiétant et du délirant.
Participant de l’atmosphère glauque censée encadrer tout récit devant éclairer les circonstances d’une mort a priori inexpliquée, le suspense est généralement constitutif des propres états d’âme des personnages mis en scène.
Au sein du genre policier, les personnages se doivent d’être communicatifs et, en amont, de se sentir réceptifs au danger ; une double condition favorisée, dans La Belle créole, par la vulnérabilité du personnage principal livrant au lecteur ses états d’âmes, soumis de concert à ses propres angoisses et à une forme d’appréhension collective. C’est ainsi que la présence massive des chiens, dans les rues de la ville en crise, n’est pas sans susciter une profonde anxiété au cœur de la population, les chiens symbolisant les crimes coloniaux passés et alimentant toute une série de croyances superstitieuses :
« Comme
tous les gens du pays, Dieudonné détestait et redoutait les chiens. C’est une
vieille affaire. Au temps de la plantation, les chiens ont poursuivi le nègre
en fuite, traqué, fait saigner le marron pour le compte du Maître. En outre,
chacun sait que les Esprits adorent se tourner en chiens, prenant, pour jouer
leurs mauvais tours, la forme de l’ennemi séculaire. »[685]
Souvenir douloureux et mauvais présage, en même temps que menace réelle, la meute de chiens qui se retrouve ponctuellement sur le chemin de Dieudonné, dès sa sortie de prison, cristallise d’une certaine manière la peur de ce dernier à l’égard de son propre passé. L’apparition de la meute effraie Dieudonné et laisse peser une certaine menace sur l’intrigue elle-même, en ce que liée au domaine du surnaturel, la réaction de ces chiens ne peut relever que de l’incertain, de l’imprévisible. Désirant partager les « croyances » locales avec le lecteur -le caractère affirmatif des propos tenus sur l’incarnation canine des Esprits en est un exemple- le narrateur fait ainsi peser la menace sur le bon déroulement de l’intrigue en laissant douter le lecteur de la possibilité d’une issue rationnelle et rassurante à l’énigme et au danger. Il s’agit ainsi d’effrayer le lecteur ou pour le moins de le déstabiliser, non tant en le soumettant à une présentation exacerbée du crime qu’en le livrant à ses propres incertitudes, à l’invérifiable, l’impalpable. La question obsessionnelle posée, dans Solibo Magnifique, par Congo -« Ha lan-ô yé ? (Qu’est-ce que la mort ?) »[686]- à l’annonce de la mort de Solibo participe, de la même façon, d’une sorte de volonté d’entraîner le lecteur dans des considérations d’ordre métaphysique sans fin :
« Congo
profitait des silences pour glisser avec son accent de nègre originel : Ha
lan-ô yé ? ha lan-ô yé ?…, question à laquelle personne n’accordait
hak mais qui, certainement, servait de planche d’appel aux pensées
vertigineuses. »[687]
Procédant à la manière d’une incantation, cette phrase sert de point d’ancrage à toute une réflexion menée, dans le roman, non sur la mort en elle-même, mais sur la vie, de même que la véritable question posée par le roman n’est pas « Qui a tué Solibo ? », mais « Qui était-il vraiment ? » ou encore, par extension « Qui sont ceux qui restent après sa mort ? ». Nous constatons que, faisant appel aux « pensées vertigineuses », Solibo Magnifique ne tarde pas à plonger ses personnages dans l’hystérie, à sombrer dans un univers où le mystère se décline finalement davantage dans une perspective délirante que véritablement inquiétante.
C’est ainsi que, dans une perspective identique, certains auteurs, tel Raphaël Confiant dans Brin d’amour, transforme la charge mystérieuse nécessaire à tout roman d’énigme en véritable délire hallucinatoire, tant les évènements décrits et néanmoins attestés par différents témoignages, se révèlent particulièrement étranges, voire relevant de l’irrationnel.
Il est ainsi question, dans le roman de R. Confiant, d’une boule de feu malfaisante qui survolerait la ville, suscitant les interprétations les plus farfelues : le père Stegel imagine ainsi qu’il s’agit d’un mécréant s’enduisant le corps d’huile magnétique, avant de muer en une boule de feu[688] ; Myrtha, sa bonne, prétend avoir vu Lysiane s’entretenir avec la boule, imaginant qu’elle est, par conséquent, à l’origine du phénomène[689] ; de nombreux autres habitants pensent encore que cette boule est responsable des maux et comportements licencieux répandus dans le village[690]. Tandis que chacun y va de son explication, le lecteur se trouve rapidement pris entre deux hypothèses. La première est suscitée par l’évocation de l’accident survenu à Bogino, touché un jour par la foudre et en ayant perdu la raison : ce phénomène météorologique, d’explication rationnelle, aurait pu perturber d’éventuels témoins de l’accident, qui se seraient alors réfugiés dans le domaine de la croyance pour valoriser leur témoignage ou tout simplement pour expliquer le phénomène. La seconde fait état du témoignage de Lysiane, qui ne laisse aucun doute quant à l’existence de cette boule de feu et qui lui attribue fermement un pouvoir et une origine surnaturels :
« La
boule de feu, qui roule par-dessus les toits de tôle de Grand-Anse et folâtre
le long du poteau électrique qui fait face à ma fenêtre, ne m’a jamais
terrorisée. […] J’ai mille raisons de me laisser emmener sur son auréole de feu
et de disparaître à jamais, mais le temps n’est pas encore venu. »[691]
Le lecteur reste logiquement perplexe face à cette boule de feu, d’autant que Lysiane disparaît mystérieusement à la fin du roman et que les témoignages concernant le phénomène ne cessent de se multiplier en se nombreuses versions contradictoires :
« Il y
avait ceux qui avaient beau coquiller le grain de leurs yeux et ne distinguaient
pourtant pas une miette de lumière dans le faire-noir. Il y en avait d’autres
qui doutaient si fort, comme monsieur Cléomène, l’instituteur franc-maçon,
qu’ils ne levaient même pas la tête au moment où la boule de feu faisait sa
dévalée sur le pourtour du ciel. Mais, depuis qu’elle avait foudroyé Bogino et
qu’il en avait perdu la raison, ces raisonneurs furent contraints d’admettre
qu’elle existait bel et bien. »[692]
Or, les « raisonneurs » de la ville, et avec eux le lecteur, vont être soumis à bien d’autres mystères, tout aussi discutés selon les témoignages.
Lysiane évoque ainsi le naufrage d’un navire hispanique, à proximité des côtes de Grand-Anse, auquel les habitants auraient assisté. Déversant sur le rivage « des malles bourrées de vêtements somptueux, des caisses de bouteilles de vin fin, des débris de cordage »[693], le naufrage aurait également laissé un survivant. Toutefois, cette version est contredite à plusieurs égards. On nous apprend ainsi, dans un premier temps, que les Grand-Ansois nient le naufrage, ce que déplore Lysiane :
« Les
Grand-Ansois sont des autruches. Ils aiment à enfouir leurs peurs ou leurs
joies sous un amas de feinte débonnaireté. Ils fuient votre regard. Ils sont
experts en détournement de conversation. En dissimulation appliquée. »[694]
C’est, en outre, au gré d’un « sommeil rempli de rêve »[695] que Lysiane voit le rescapé ; rescapé, qui plus est, idéal avec des « yeux d’Indien ténébreux », une « bouche sensuelle de fils de l’Afrique-Guinée », des « cheveux et leurs boucles chatoyantes de Blanc manant », une « peau de goyave mûre, l’éclat moiré de [ses] bras de Chinois »[696]. Puis, progressivement, le naufrage semble attesté par les autres habitants, ne niant dès lors plus que l’existence du rescapé -c’est en tous les cas ce que suggère Lysiane :
« Personne
ne veut admettre que le naufrage du navire ne nous a pas seulement livré
victuailles et soierie. Qu’il y a bel et bien eu un rescapé. »[697]
La certitude de l’existence d’un rescapé, soutenue par Lysiane, est par ailleurs accréditée par l’identification de l’individu, nommé Osvaldo, ainsi que par l’intérêt que lui porte le détective Amédien lui-même :
« Amédien
avait toujours remis à plus tard l’idée d’aller interroger Osvaldo, le naufragé
du bateau hispanique qui, à en croire les habitants du bourg, vivait reclus
[…]. Nul ne l’avait plus revu depuis que Lysiane l’avait sauvé, ô miracle,
alors qu’il s’accrochait depuis plusieurs jours au récif de la Roche. »[698]
Or, tandis que l’existence du rescapé paraît enfin crédible -car insérée au déroulement de l’enquête menée par un rationaliste-, elle est une nouvelle fois contestée, dès la phrase suivante :
« Son
existence avait fini par être mise en doute par les plus jeunes et les anciens
avaient commencé à se demander s’ils avaient bien vu de leurs yeux vu ce jeune
homme ténébreux. D’aucuns pensaient maintenant qu’ils avaient pu être victimes
d’une de ces raconteries maléfiques que le cerveau maladif de Lysiane Augusta
enfantait régulièrement. »[699]
Le récit du naufrage lui-même par Lysiane, ne serait que le fruit de son imagination, voire de son génie d’« écriveuse » :
« D’autres
personnes, d’ordinaire peu enclines à croire et à diffuser les bruits les plus
invérifiables, soutenaient pourtant dur comme fer que le fameux naufrage qui
hantait la mémoire de Grand-Anse s’était produit au sortir de la guerre 14-18
et que, forcément, mamzelle Lysiane Augusta n’avait pu y assister ni
recueillir, à plus forte raison, un quelconque rescapé. A les entendre, la
jeune fille mélangeait ses propres songes aux raconteries des vieux-corps
oiseux et les enfilait telles de fausses perles pour en faire des entrelaçures
de paroles en chrysocale […]. »[700]
Doublement soumis à la fantaisie créatrice de l’écrivain Confiant-Lysiane, le lecteur se voit ironiquement « mené en bateau » et submergé par une totale incapacité à distinguer le vrai du faux, victime lui-même du délire hallucinatoire infligé aux personnages.
Nous constatons alors que tandis que, dans le roman de R. Confiant, l’atmosphère délirante imposée aux personnages n’est pas sans susciter le doute, voire la méfiance des protagonistes concernés, elle s’introduit, à l’inverse, de manière beaucoup plus fluide dans le roman d’Ernest Pépin qui plonge, sans aucune retenue, dans l’univers merveilleux du conte. Ainsi, dans L’Homme-au-bâton, l’inquiétant -il s’agit initialement de découvrir l’auteur de viols et de meurtres, en s’inspirant d’un fait divers ayant bouleversé la Guadeloupe dans les années 1960- est ici totalement emporté par le délirant avec l’arrestation d’un goyavier, résultat de la transformation d’un fossoyeur « maître de la métamorphose » :
« De
guerre lasse, les gendarmes pour bien montrer à tous qu’aucune sorcellerie de
nègres-bitations ne pouvait les effrayer passèrent les menottes au
goyavier. »[701]
Emprisonné, le goyavier se met paradoxalement à fleurir, embaumant les environs et contraignant le maire de la commune à ordonner la destruction de la prison ; c’est alors que l’arbre commence à dépérir, avant qu’un conteur haïtien ne trouve la solution « magique » :
« Au
cours d’une veillée-contes, un conteur haïtien expliqua que si l’arbre se
mourait c’est que personne ne se souciait de le nourrir.
Mais
comment nourrir un arbre magique ?
C’est très simple. Il faut lui raconter vos rêves… »[702]
Nous constatons que ce dénouement est, d’une certaine manière, permis par la neutralisation de l’enquêteur, confronté à ses propres angoisses existentielles -son homosexualité refoulée entre autres. Piégé par les orientations fantaisistes d’un écrivain décidé à faire triompher le mystère et l’irrationnel, l’enquêteur se fait finalement la victime de son créateur qui choisit de le mettre à mort sur son propre terrain, celui de la raison. Mis en retraite anticipée et conspué par la profession, le policier sombre finalement dans la folie.
Il s’agit, pour E. Pépin, de suggérer la nécessité de laisser subsister les croyances car, comme il l’indique en effet au terme du roman, c’est dans la croyance en l’irrationnel que se trouve le véritable courage :
« Cric !
Crac ! Il faut beaucoup de sang-froid pour croire à l’effroi -comme
poix-de-bois- semé par l’Homme-au-Bâton ! Alors crois-moi ou ne croix pas
pour moi c’est ton droit. Yé cric ! Yé crac ! »[703]
Conduisant le genre policier à se fourvoyer dans l’inexpliqué, E. Pépin ouvre le schéma narratif traditionnel du genre à d’autres perspectives. Choisissant d’évincer réalisme et cartésianisme de l’aboutissement de l’enquête, il oblige dans le même temps son enquêteur à déroger à sa fonction. Toute mise à mal du principe de raison dans le cadre de l’enquête implique nécessairement une reconsidération du rôle de l’enquêteur qui, dans certains romans, privé de la certitude d’une issue logique et rassurante à l’énigme, se voit fragilisé car tenté de succomber au vertige de l’inexplicable.
1.2.2- Tentation d’un abandon à l’inexplicable
Si, dans le roman Une Enquête au pays, la chaleur et l’insoumission « naturelle » des Aït Yafelman déstabilisent le chef Mohammed au point qu’il donne l’impression d’être une victime de la kouriyya, en se livrant à des transes incontrôlées (« Le chef se livrait à la démesure, indépendamment de sa volonté, frénétiquement, pour raison de force majeure et anarchique, faisant craquer les acquis de la civilisation, les interdits, les tabous, le devoir professionnel et même ce surmoi cher à Freud »[704]) la confrontation avec l’irrationnel se fait, à l’inverse, de manière plus contrôlée et volontaire chez d’autres enquêteurs.
C’est ainsi que l’inspecteur Laprée, mis en scène par F. Chalumeau, reconnaît avoir déjà été « initié » culturellement à l’univers de la croyance magique, en tant que métropolitain originaire d’un petit village où, enfant, il a pu entendre une multitude d’histoires de sorcières :
« Chez
nous, les vallées sont pleines de sorciers, rebouteux et autres faiseurs de
philtres. C’est la seconde industrie après Peugeot. »[705]
Fort de ce bagage culturel, il finit par se laisser convaincre de recourir à des méthodes d’enquête peu conventionnelles. C’est sans doute, en effet, cette familiarité pré-établie de l’enquêteur avec le monde de l’irrationnel qui permet à F. Chalumeau d’exploiter plus avant cet élément du folklore antillais, importé de la culture haïtienne, que constitue le vaudou, en lui offrant ponctuellement un rôle actif au sein de l’intrigue. L’inspecteur Laprée est ainsi invité à participer à une séance de vaudou par Odile, une femme séduisante sous le charme de laquelle il tombera par ailleurs, qui lui promet solennellement l’impossible, autrement dit la visualisation du crime :
« Si
les rites sont convenablement accomplis et si Ogou le veut bien, alors, ami, tu verras le meurtre ! »[706]
Partagé entre son instinct d’enquêteur prêt à tout pour découvrir l’énigme et l’obligation de raison imposée par sa fonction, Laprée hésite :
« A
deux ou trois reprises, il essaya de prendre ses distances : lui, un flic,
un esprit cartésien, on lui infligeait cette cérémonie baroque et on lui
promettait que la vérité se ferait jour à travers ces ténèbres ! Mais ses
velléités critiques s’engourdissaient vite. Sans pouvoir l’expliquer, il se
sentait à la bonne place, au bon endroit -au centre de lui-même. »[707]
Il cède finalement et la cérémonie se déroule sous l’impulsion de femmes traçant des motifs géométriques à l’aide de poudres colorées, sacrifiant un coq, buvant son sang, avant de conclure théâtralement en mettant Laprée à profit :
« La
“hounssi” Florémize s’avança à son tour, et montra à chacun les trois gros
clous qu’elle tenait dans ses mains. Les ayant enduits de sang, d’un geste
rapide elle les fit toucher à Laprée. Puis elle se dirigea vers le poteau et y
ficha les clous tout en hurlant les noms de Beudry, Wanda et Herra y
Santos… »[708]
Or, tandis que le nom de la victime et celui de deux des trois coupables -ce que le lecteur ne peut d’ores et déjà savoir, mais qui sera vérifié et attesté au terme de l’enquête rationnelle menée par Laprée- sont prononcés, Laprée est subitement pris d’un vertige qui le transporte sur les lieux de son enfance, quelques minutes après l’accident ayant causé la mort de son père :
« Laprée
n’assista pas à l’accident, mais une tache grise soudain apparut, prit les
contours du tracteur renversé. Le lourd moyeu de la roue broyait la poitrine du
père. De la bouche renversée s’échappaient du sang et du vin mêlés. Le grand
frère sortit d’un buisson, chaussait d’étranges sandales en lanières de pneus.
D’une main cette fois ferme, il resserra les vis des freins. Il s’éloigna
enfin, prenant garde à poser ses pas dans les rainures du tracteur. »[709]
C’est ainsi que le lecteur comprend, et que Laprée réalise, que le père de ce dernier est mort assassiné. La vision retranscrite expose, en effet, comme le terme d’une enquête policière pourrait le proposer, tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’énigme : les circonstances de la mort (tracteur renversé), l’arme du crime (le lourd moyeu de la roue), l’« état » du cadavre, l’identité du meurtrier (le grand frère), l’acte criminel en lui-même (le frère resserre les vis) et la manière dont il a tenté de brouiller les pistes (en ne laissant aucune trace de pas).
C’est donc bien ici une séance de vaudou qui s’octroie le rôle traditionnellement dévolu à l’enquêteur, la méthode surnaturelle supplantant efficacement la logique déductive traditionnelle. Or, cette double révélation ne tarde pas à être nuancée plus loin et elle l’est, en réalité, au sein même du récit de la vision qui nous est proposé. En précisant que la main criminelle est « cette fois ferme », le narrateur suggère, en effet, qu’elle ne l’a pas toujours été et l’on comprend qu’il se réfère ici sans doute au moment où le frère a dû desserrer les vis des freins. Ce détail indique que le narrateur a assisté à la scène qui a précédé le crime, et ce, sans qu’il se révèle être pour autant omniscient puisque les sandales du criminel lui paraissent « étranges », suggérant que le récit est en fait simultané à l’action. Cette vision de Laprée correspondrait donc non à une restitution de la scène, mais à un retour en arrière lui permettant de vivre la scène en direct. Or, voilà qu’à la suite de cette version transcendant largement les limites de la raison en suggérant un déplacement de Laprée dans le temps, l’enquêteur en suggère une deuxième, cette fois-ci tout à fait rationnelle :
« Tu
soupçonnes Franck d’avoir tué Beudry, à cause du filet. Pour en avoir le cœur
net, tu as organisé ta cérémonie vaudou, n’est-ce pas ? Tu m’as fait
avaler cette mixture, et j’ai vu ce
que je me cachais de toutes mes forces. »
Après le vertige suscité par la vision et une tasse de café, Laprée peut se rassurer, et avec lui le lecteur, en apportant quelques clés à la scène étrange qui vient de se dérouler. Il expose ainsi les motivations d’Odile, l’instigatrice de la séance, en soulignant que son objectif principal résidait en la disculpation de son amant : la séance de vaudou avait donc pour fonction de la rassurer. Or, s’il ne fait aucun doute que la foi d’Odile en ce genre de procédés s’avère être totale, le scepticisme de Laprée en la matière semble, à l’inverse, plus que probable. En jouant sur le double sens de la phrase « Tu m’as fait avalé cette mixture » -mixture/potion, mixture/version-, Laprée suggère en outre que les prétendues révélations auraient pu être décidées préalablement par Odile et ses comparses. En insistant par ailleurs sur le verbe « voir » -insistance traduite par l’italique pouvant souligner une insistance vocale du locuteur sur ce mot- il semble insinuer que l’usage de ce verbe n’est peut-être pas à prendre au sens premier et que cette vision n’est en fait que la révélation à la conscience d’un savoir refoulé. L’expérience vécue par Laprée relèverait ainsi davantage de la psychanalyse que de la magie. Cette confrontation avec le surnaturel paraît par là-même relativisée, en signe de résistance de la méthode rationaliste soumise à l’épreuve de l’inexpliqué ; une résistance qui paraît également affichée par d’autres enquêteurs revendiquant une logique implacable, comme par exemple le détective mis en scène dans Brin d’amour :
« Le
détective Amédien commençait à trouver le temps long. L’instant de
l’émerveillement évanoui, Grand-Anse avait fini par l’ennuyer. Car il l’avait
bel et bien émerveillé, ce bourg à la laideur massive adossé à une mer
perpétuellement déchaînée. Le privé se donna dix jours, pas un de plus, pour
résoudre ce que cet amateur de superlatifs ronflants de Romule Casoar
qualifiait d’énigme et qui, pour lui, n’était qu’un simple casse-tête. On
n’était quand même pas plus malin ici qu’en ville ! »[710]
L’orgueil mis à mal, Amédien préfère minimiser l’affaire en renonçant à lui octroyer le sacro-saint statut d’énigme, faire-valoir de tout enquêteur digne de ce nom. Appliquant sa logique déductive au statut même de l’affaire qui lui est confiée, il conclut que si lui, « le plus brillant détective privé du pays »[711], ne parvient pas à résoudre cette prétendue énigme, c’est tout simplement qu’elle n’en est pas une. Poussé dans les derniers retranchements de sa fierté, Amédien va jusqu’à avancer un argument de poids, en l’affirmation d’une impossible supériorité de la campagne sur la ville, en matière de réflexion.
Digne représentant d’un mode de pensée ne pouvant échouer, Amédien est néanmoins contraint de reconnaître l’inefficacité de son enquête, menée en terrain hostile à toute forme de raisonnement :
« Il
avait soudainement hâte d’en finir avec cette enquête qui semblait vouloir
piétiner à loisir et regrettait les rivages plus hospitaliers, « plus
cartésiens », pensa-t-il, de l’En-Ville. »[712]
Nostalgique de l’En-ville, et avec elle d’un terrain propice à l’exercice de la logique, le détective privé ne tarde pas à sombrer dans le découragement :
« Amédien
fit véritablement l’expérience de ce qu’en créole on appelle « être un
chien à bord d’un canot ». Aucun des repères qui étaient les siens à
Fort-de-France ne se retrouvait ici. […] Le détective ne put s’empêcher de
lâcher, sous le regard ironique de l’hôtelière : « Patate ça !
Merde ! Merde !
Il remonta
lentement jusqu’à sa chambre, résolu à brusquer les choses. Sinon, ce serait
lui qui en perdrait la raison, et à court terme.»[713]
Ce découragement commun aux enquêteurs traditionnels, souvent en prise au doute à la simple pensée de l’éventualité d’un échec n’est pas, chez Amédien, soudainement renversé par l’éclair de génie habituellement de mise en pareil cas. Réquisitionné pour résoudre l’énigme engendrée par la découverte de deux cadavres, Amédien est en effet traîtreusement soumis aux mystères et fausses pistes distillés par l’étrange Lysiane -et derrière elle par l’écrivain Confiant-, au manque de collaboration des Grand-Ansois hostiles à cet enquêteur ne relevant pas de la police officielle et globalement à l’ensemble de ces « évènements tant secrets qu’extraordinaires qui eussent pu constituer, pour peu qu’une âme dévouée eût accepté de les consigner, une bibliothèque entière »[714]. C’est ainsi « l’esprit accablé de perplexité »[715] que le détective privé envisage son retour à Fort-de-France, et ce, non sans que les habitants de Grand-Anse ne se décident à lui jouer un dernier tour.
Venu assister à la veillée du corps de Nestorin Bachour, Amédien devient en effet l’objet d’un canular permettant, dans l’esprit de la veillée traditionnelle, une forme de dédramatisation de la mort par le rire, tout en impliquant, dans le même temps, une certaine prise de distance à l’égard de la gravité conférée à l’enquête -et ce, notamment en regard de son acceptation classique, les enquêtes des « grands » détectives étant généralement empreintes de solennité. C’est ainsi qu’avant même de s’en rendre compte, Amédien « se trouv[e] pris entre les fils d’araignée du diseur »[716] dépêché pour l’occasion. Reprenant le principe de la devinette, le conteur Dachine propose, en effet, de faire d’Amédien l’objet de l’énigme à découvrir :
« Mes
dents marchent jour et nuit, ma tête cherche jour et nuit, et pourtant je ne trouve
rien, qui suis-je ? »[717]
Poussant plus loin la plaisanterie, Dachine poursuit en s’adressant au cadavre de Nestorin :
« Qui
c’est qui bat tout le temps de la mâchoire ? reprit le conteur, qui
calcule aller-pour-virer dans sa caboche et qui est pourtant incapable de
trouver ce qu’il cherche ? Qui ?
-Amé… Amédien !” fit une voix étouffée qui s’éleva du cercueil. »[718]
Soudain confronté à l’impossible -annoncé préalablement par une plaisanterie de Dachine invitant Nestorin à ne plus « faire le mort »- Amédien est saisi par la révélation de ce qui pourrait constituer la seule explication plausible du casse-tête dont il n’émerge pas : Nestorin n’est pas mort et toute l’affaire n’est en fait qu’une vaste plaisanterie.
Cependant, cette hypothèse de secours vacille à son tour :
« La
lucidité du détective vacilla une fraction de seconde, avant qu’il ne prît
conscience que l’éboueur était ventriloque. Les veilleurs se gaussèrent de son
ahurissement et Myrtha, la bonne du presbytère, moulée dans une robe indécente,
lui tendit un verre de tafia. »[719]
Réalisant son incapacité à résoudre l’affaire et n’ayant dès lors plus de raison de se conformer à son rôle de parfait détective voué au célibat, Amédien décide de consommer son échec en demandant, avec succès, la main d’Amélie, jeune mulâtresse convoitée.
De même que le personnage du Préfet, mis en scène dans le roman d’Ernest Pépin, initialement persuadé que l’affaire n’est autre qu’un « conte à dormir debout ! Tout juste bon pour effrayer les enfants »[720], se voit finalement contraint de prêter foi au mystère, en découvrant le cadavre de sa maîtresse vraisemblablement victime de celui dont il niait l’existence, les rationalistes invités à visiter l’univers antillais, à la lumière des créolistes, demeurent de vains résistants. Cet état de fait semble d’ores et déjà admis par les moins brillants mais néanmoins les plus pragmatiques, voire résignés, d’entre eux, tels l’inspecteur Dorval mis en scène dans Le Meurtre du Samedi-Gloria:
« Ici,
il savait que rien de ce qu’il avait patiemment appris dans son commissariat
parisien ne lui serait d’une quelconque utilité. Les interrogatoires,
l’assemblage des indices ou des preuves, les filatures et tout ça n’avaient
guère de signification dans un pays où les meurtres étaient non seulement rares
mais n’obéissaient à aucune logique européenne. »[721]
Retrouvant son pays natal, Dorval oublie ainsi les « leçons » apprises Outre-mer pour réinvestir, d’une certaine façon, une forme de savoir maternel, fait de croyances et de démesure, le rappelant à sa créolité première. De la même manière, dans Solibo Magnifique, Bouaffesse et Pilon se résolvent finalement à admettre la version de l’égorgette de la parole, après éclairage d’un quimboiseur.
Dans ces romans, l’enquête est, en ce sens, mise au service non de la raison mais bien du mystère. Plus l’enquête avance, plus le mystère s’épaissit, en accord avec ce qui nous est présenté comme une autre manière de penser, un mode de fonctionnement différent, non cartésien, dont la particularité consiste à entraîner le lecteur dans les circonvolutions d’une « logique du pourquoi du pourquoi ».
Les romans policiers ou romans-enquêtes antillais de notre corpus tendent ainsi à faire de l’acceptation du mystère la clé même de l’énigme. Or, si cette surenchère de l’énigme se manifeste de manière exubérante dans les romans que nous venons d’évoquer -donnant à voir une forme singulière de « gothique bariolé »-, elle est abordée dans une perspective plus mesurée dans Traversée de la Mangrove, où Maryse Condé utilise notamment le thème de l’étranger -celui dont on ne sait rien, qui s’avère être, de ce fait, détenteur de secrets-, afin d’illustrer ce goût pour l’incertain, le caché, l’inconnu, visiblement propre aux Antillais, tels qu’ils nous sont présentés.
Dès son arrivée à Rivière-au-Sel, Francis Sancher cultive ainsi, de lui-même, un certain mystère autour de sa personne : il agit sans prévenir, sans parler, sans révéler ses intentions c’est-à-dire en créant la surprise par chacun de ses actes, voire en choquant. Il s’installe, en ce sens, dans la propriété dite « maudite », choisissant de vivre dans un lieu que tous ont rejeté, affirmant par là même sa marginalité et laissant supposer qu’il est peut-être déjà maudit lui-même. De plus, en se faisant livrer par voies de camions publicitaires, c’est-à-dire en brisant la tranquillité du morne et en y faisant intervenir des éléments extérieurs, des appareils électroménagers et deux dobermans, il signale qu’il bénéficie d’une certaine aisance financière et qu’il se range du côté de la modernité : deux nouveaux motifs de marginalisation dans ce morne retiré. Il suggère surtout qu’il cherche à se protéger de quelque chose, qu’il a peur ou qu’il a fait quelque chose qui pourrait susciter une vengeance, ce qui ne manque pas d’éveiller la curiosité des habitants de Rivière au Sel qui s’empressent d’imaginer toutes sortes d’histoires sur son compte.
Cette situation est par ailleurs accentuée par le fait que le nouveau venu choisit, comme premier « confident », Moïse le facteur, à qui il dévoile sa véritable identité par commodité. Francis Sancher révèle ainsi qu’il se nomme Francisco Alvarez Sanchez et lève par là même une part de son mystère en affichant ses origines latino-américaines, et ce, tout en épaississant, par ailleurs, l’énigme dévoilée en soulevant une nouvelle interrogation : pourquoi cacher son véritable nom ? D’autre part, en choisissant Moïse comme unique dépositaire de son secret, Sancher s’inscrit dans un curieux paradoxe qui réside en ce que Moïse, facteur, est par là même celui qui est chargé de répandre les nouvelles. Le mystérieux nouveau venu de Rivière au Sel confie donc, par la force des choses -pour recevoir son courrier, c’est-à-dire, d’une certaine manière, pour exister en tant qu’individu dans ce morne, aux yeux de l’extérieur- sa véritable identité, en toute discrétion, à une personne qui est à la fois celle qui partage chaque jour une part de l’intimité de chacun et celle qui peut facilement la violer en la racontant à d’autres. De fait, Moïse ne tarde pas à révéler ce qu’il sait sur Sancher, d’autant mieux qu’il s’avère être convaincu de l’intérêt de creuser l’histoire de cet homme qui lui a, en outre, explicitement recommandé de ne pas chercher à en savoir davantage (« Pose pas de questions ! La vérité pourrait t’écorcher les oreilles »[722]).
Encouragé par le mystère autant que par l’interdit, Moïse contribue à faire de Sancher le nouvel objet de convoitise d’une communauté manifestement alimentée, vivifiée, par le désir de savoir. C’est alors que chacun y va de son hypothèse, prétendant être en mesure de révéler les secrets du nouveau venu :
« Les
histoires les plus folles se mirent à circuler. En réalité, Francis Sancher
aurait tué un homme dans son pays et aurait empoché son magot. Ce serait un trafiquant
de drogue dure […]. Un trafiquant d’armes […]. Ce qui était sûr, c’est que les
revenus de Francis Sancher étaient d’origine louche. »[723]
Nous constatons ici que quelle que soit la théorie envisagée, ce que cache Sancher, son secret, ne peut être qu’honteux. Sancher se comporte différemment des autres et porte un nom d’emprunt tout en se permettant de se faire remarquer au sein du village : d’étranger, il devient étrange et, dans le cadre de l’espace communautaire, suspect, voire criminel, notamment dans la mesure où il vient perturber l’ordre du village. Il semble donc que l’on retrouve ici cette particularité propre à la modernité qui veut que, pour le bien et l’équilibre de la vie communautaire, rien ne demeure caché, que tout relève du domaine public, que le droit au privé, à l’intime s’estompe afin que l’individu s’intègre à la communauté, ne pensant plus en terme d’individualité mais de collectivité.
En outre, l’exemple de la marginalisation de Sancher, du fait de la préservation d’éléments relevant du privé, du secret, ne se manifeste pas de manière isolée et trouve une résonance dans l’évocation d’une autre figure d’étranger : celle de « Désinor, l’Haïtien », dont la marginalisation transparaît d’ores et déjà dans cette désignation signant son statut d’étranger. C’est, en effet, en fuyant un contrôle de papiers effectué par la police que Désinor est arrivé à Rivière au Sel, son statut d’étranger se couplant alors avec celui de criminel et se manifestant, au sein du cadre communautaire, par un désir d’isolement, « s’étant mis en tête de se tirer de la déveine tout seul »[724]. Or, ce choix de ne pas se fondre dans la collectivité, de ne pas offrir son histoire et ses projets à la communauté, fait de lui un exclu aux yeux des autres Haïtiens, eux-mêmes relégués en « colonie », qui répandent alors diverses rumeurs sur son compte, inventant son histoire cachée à défaut de la connaître :
« Il
serait un tonton-macoute lâché par les siens, une âme damnée de Jean-Claude que
ce dernier aurait abandonnée avant d’aller mener la vie douce en France avec
les millions volés, un boko poursuivi par des loas -des esprits- en
colère. »[725]
Ayant choisi de conserver une vie privée, de vivre individuellement, Désinor suscite des interprétations qui, toutes, tendent à faire de lui un sorcier doublé d’un proscrit. M. Condé exploite ici la dimension capitale prise par la notion de secret au cœur d’une société comme celle d’Haïti, marquée par le vaudou, où ce qui est caché et vécu individuellement est pressenti comme lié à la sorcellerie.
Dans le cadre communautaire antillais, tel que celui proposé par M. Condé, la préservation de secrets ou le simple fait de ne pas vouloir tout révéler de soi implique nécessairement une exclusion de la communauté. Nous constatons néanmoins que le mystère, en suscitant la curiosité et en donnant naissance à diverses rumeurs, à différentes tentatives de révéler publiquement l’inconnu, réintroduit, d’une certaine manière, l’individu mystérieux qui d’exclu devient subitement objet de toutes les conversations et préoccupations. Réinventé, d’une certaine manière, par les différents témoignages qui lui sont consacrés -comme toute victime de roman policier peut-être réinventée au fil de l’enquête-, Sancher nous est ainsi décrit unanimement comme un être secret, comme en attestent divers indices laissés à cette intention, au fil du texte, par les différents narrateurs. Or, cette unanimité n’est pas nécessairement synonyme de fiabilité, les indices laissés pouvant tout simplement rendre peut-être moins compte de la réalité que d’une certaine orientation de la pensée collective. Le lecteur peut, en effet, constater que si Sancher lui est apparu mystérieux au premier abord, de par les témoignages livrés, il ne se veut pas aussi secret que le prétendent les habitants de Rivière au Sel, devenant en fait, à certains égards, simple objet de leurs fantasmes.
Certains détails tendent ainsi à suggérer que cet homme n’est pas si mystérieux. Lorsque Moïse évoque, par exemple, l’existence d’une malle mystérieuse que posséderait Sancher, « d’où il tirait tout. L’argent pour la viande, le pain ou les boîtes de Pal pour les chiens. Les ramettes de papier jaune »[726], il suscite la curiosité de ses interlocuteurs. Cette curieuse malle semble pouvoir receler mille choses et nous fait déjà miroiter la révélation prochaine de divers secrets concernant son origine et la raison pour laquelle elle est fermée à clé et reléguée dans un coin retiré de la maison. Or, cette perspective ne tarde pas à être renversée dans la mesure où, contre toute attente, le mystérieux Sancher, possesseur du coffre secret « gardait la clé à la portée du premier venu dans un bougeoir à la tête de son lit »[727]. Ce simple exemple permet au lecteur d’envisager une double orientation dans la perception de cet être mystérieux : il s’agit, en fait, de considérer Sancher comme un individu qui a des secrets et comme celui à qui l’on attribue des secrets, les véritables secrets en sécrétant de faux.
Sancher et Désinor ne semblent finalement mystérieux que dans leur refus ou leur incapacité à s’intégrer à la communauté. Le mystère prend ici la forme de l’inconnu, l’inconnu prenant à son tour celle non de l’inexplicable, mais tout simplement de l’inexpliqué, du secret. L’énigme ne se joue plus ici au niveau de la raison mais dans le cadre du savoir. Certes, les déductions suscitées, dans le cadre communautaire, par la confrontation avec le secret se permettent de glisser dans l’irrationnel, mais la manière dont l’énigme se pose et tente de se résoudre relève, en réalité, d’un fonctionnement tout à fait cohérent et rationnel. En cachant publiquement des choses, Sancher a posé une énigme ; avant de pouvoir la résoudre, ceux à qui l’énigme a été posée ont imaginé différentes hypothèses, parmi les plus incroyables ; invités à l’introspection au cours de la veillée du cadavre, et parallèlement à la réflexion et, d’une certaine manière, à l’argumentation par le recours au témoignage, chacun tire finalement ses propres conclusions.
Dans Traversée de la Mangrove, l’irrationnel intervient, sans pour autant entraîner le roman dans un univers délirant, comme c’est le cas dans les romans des créolistes[728] . L’exemple proposé par le roman de la Guadeloupéenne paraît, en fait, indiquer que la mise en valeur de l’énigme n’est pas forcément permise par le glissement dans l’univers de l’irrationnel, de la croyance, de la superstition : la société elle-même, le simple rapport s’établissant entre les hommes, suffit à produire le mystère, l’effroi, le vertige nécessaires à tout récit d’énigme. Relevant du secret, de l’inexpliqué ou plus simplement encore du non-dit, le mystère est alors transposé au domaine de la parole, ce que certains textes mettent à profit au niveau de la constitution même du récit.
1.2.3-
De
l’inexpliqué à l’« énigme des mots »
Contrairement à la perspective développée par la plupart des auteurs antillais, les romans policiers maghrébins ne jouent pas sur l’aspect métaphysique du mystère.
Dans l’ouvrage critique intitulé Le Récit impossible, Uri Eisenzweig souligne, à propos du récit d’énigme, en s’appuyant notamment sur les travaux de Robert Champigny[729], que « l’énigme qui est censée caractériser le genre relève d’une logique non pas déductive, mais bien narrative »[730] ; autrement dit, et toujours d’après R. Champigny, dans un récit de détection, l’énigme fonctionne comme secret narratif et non comme énigme conceptuelle ; elle est physique et non transcendantale.
Dans les romans policiers de Y. Khadra, il s’agit effectivement de révéler ce qui n’a pas encore été décrit -la scène du crime, permettant l’identification du coupable, la détermination de son mode opératoire, voire de son mobile-, de restituer, par exemple, la vision du crime que le jeune témoin du meurtre de Ben Ouda, dans Double blanc, s’est épargné en se réfugiant dans un placard, puis en se suicidant. Doublement refoulé, le récit du crime n’a plus, dès lors, qu’à espérer la perspicacité de l’enquêteur lancé aussitôt à sa recherche. C’est ainsi en relevant les indices, sondant les pistes, interrogeant les témoins, défiant les suspects, que l’enquêteur peut prétendre procéder aux recoupements, déductions, inductions, accusations nécessaires à la mise en perspective de sa quête de la scène absente. Dans ces romans le mystère relève, pour partie, de ce qui est caché, et ce, selon différents schémas.
Ainsi, dans Le Dingue au bistouri, le meurtrier prend contact avec Llob avant même de commettre son premier crime pour lui proposer, dans le cadre du récit d’énigme, l’impossible : « Je t’invite à suivre en direct la mise à mort d’un être humain »[731]. En réalité, le principe de la scène absente sera néanmoins respecté dans la mesure où Llob « vit » les crimes successifs de manière décalée, en différé : le meurtrier communique avec lui avant et après les crimes et non pendant. La révélation du caché consiste alors, pour l’enquêteur, à déterminer l’identité du coupable, son mobile, ainsi qu’à dépister d’autres éventuelles victimes.
Dans La Foire des enfoirés, l’exploitation du mystère relève encore d’une autre approche dans la mesure où, au-delà de l’enquête menée sur le crime, le rôle de l’enquêteur lui-même soulève différentes interrogations. En relevant les indices laissés sur les différents lieux de son investigation, Llob en arrive notamment à soupçonner le bien-fondé de sa propre fonction au sein de l’affaire : il se sent, en effet, manipulé et découvre qu’il est suivi par des agents du Bureau de la surveillance et des Investigations, autrement dit par le contre-espionnage algérien. Une autre enquête vient ainsi se greffer sur la première, suggérant finalement que les tenants et aboutissants de l’énigme s’engagent bien au-delà de la découverte du meurtrier. De fait, Llob finit par comprendre que les crimes sur lesquels il enquête ne sont que la face visible d’une véritable affaire d’Etat.
Dans Morituri, Y. Khadra densifie de la même manière la portée de l’énigme, en conférant au crime un mobile idéologique d’ordre national -puisqu’il s’agit pour les adeptes extrémistes d’Abou Kalypse d’éliminer les intellectuels du pays-, mais également en s’y prenant à deux reprises pour finalement résoudre le mystère : celui que Llob a neutralisé comme étant le principal responsable des « commandos » n’est, en fait, que l’ennemi du véritable instigateur du mouvement qui s’est servi de Llob pour se débarrasser de son indésirable concurrent.
Exploitant les différentes possibilités de mise en abyme de l’énigme de fiction, Y. Khadra s’oriente encore, avec Double Blanc, dans une nouvelle direction, puisque ce roman lui permet de mettre en relief la perspective du texte absent, et plus exactement du texte indéchiffrable, illustration du chaos s’emparant de la scène du crime, indispensable à la mise en problème de la mort de la victime. L’enquête menée par Llob repose ici sur deux moteurs principaux : d’une part, le déchiffrement d’un signe tracé par une victime, au moyen de son sang -HIV, qui, sans rapport avec le virus du sida, si ce n’est de manière allégorique, désigne un projet, nommé « Quatrième Hypothèse », prévoyant un programme de sabotage, de chantage, de corruption, destiné à servir les intérêts de puissants industriels- ; d’autre part, la découverte du texte dénonciateur de la machination, à l’origine du meurtre de Ben Ouda.
Privé de véritable enquête, le dernier roman du volet, L’Automne des chimères, n’en demeure pas moins également porteur d’une charge énigmatique puisque au-delà du suspense -qui consiste, d’une certaine manière, en une mise en action du mystère- entretenu par la tension constante maintenue sur la vie de Llob, sans cesse menacé de mort, le roman s’achève précisément sur un flagrant délit de substitution de texte : sans que l’on sache comment ni par qui ni dans quelles circonstances le crime a été commis, Llob est découvert mort par Lino, son adjoint, dépositaire de ce fait d’une nouvelle énigme à résoudre.
Cette mise en abyme de l’énigme suscitée par la confrontation avec la scène absente -et, par glissement dans le cadre romanesque, avec le texte absent- est encore approfondie par la coïncidence, chez Llob, des fonctions de policier et d’écrivain. A cet égard, le cambriolage dont le commissaire est victime et au cours duquel son dernier manuscrit est subtilisé annonce, d’une certaine manière, la fin prochaine de l’enquêteur, la substitution du texte signant symboliquement l’impossibilité d’un dénouement favorable à l’enquêteur. L’énigme dépasse ainsi le cadre narratif pour envahir la raison d’être même du texte. Tout au long de ses enquêtes, Llob apparaît aigri et désespéré en grande partie du fait d’un sentiment d’impuissance grandissant, au fil des années, et le conduisant à agir parfois de manière excessive. Du point de vue de l’écrivain, cette impuissance se manifeste par le biais d’une assignation au silence : Llob doit ainsi faire face à la censure imposée par ses supérieurs, à l’instar de son créateur lui-même, Mohamed Moulessehoul, contraint à l’usage d’un pseudonyme afin de contourner le contrôle exercé sur ses textes par les hautes instances de l’Armée.
Il convient, dès lors, de préciser que ce qui est caché, dans le cadre de ces romans présentant la particularité de se référer explicitement à l’Algérie contemporaine, ne peut uniquement relever du simple secret narratif. Si, à un premier niveau, le mystère est suscité par l’ignorance des circonstances du crime -c’est cette ignorance qui fonde l’énigme appelant la mise en œuvre d’une enquête intervenant dans une perspective explicative- il soulève, par glissement, une démarche qui se fait non plus seulement explicative, mais interprétative, et ce, tant au niveau du crime que du dénouement de l’intrigue. Permettant la mise en texte du récit policier, le mystère semble pouvoir coïncider ainsi avec une forme d’indicibilité induite par la portée extra-fictionnelle des tenants et aboutissants du crime. Le mystère s’inscrit alors non plus dans le non su, mais bien dans le tu ; un glissement que semble suggérer également, à sa manière, Boualem Sansal, notamment au cours d’un passage du Serment des barbares consacré à l’évocation allégorique d’une activité présentée comme répandue en Algérie, celle des mots croisés :
« Apprenons
ceci : après le foot, les mots croisés sont le hobby chéri de l’Algérien
lettré. C’est une façon de vivre
acquise lors des années chape de plomb et botte militaire. C’était une époque.
En décryptant du matin au soir, on avait l’impression de faire intelligence
avec les grandes puissances et de marquer des points, c’était bon. Les chefs
d’alors ne pigeaient que dalle à cet exercice biscornu mais très vite, ils
virent tout le mal qu’ils pouvaient en tirer, la chose étant abrutissante pour
ses adeptes. Le quadrillage sans issue de la grille n’était pas si étranger
dans la soudaineté de leur intérêt. Sous couvert de promotion de la culture
moderne, ils oeuvrèrent à sa propagation. Il y eût excès et l’élite (pon-pon-pooon,
ponpon !) sombra dans l’énigme des mots. On le sous-estime car beaucoup
gagnent à se taire mais le phénomène est à l’origine de la perte de sensibilité
dans les bureaux et, par là, du dérèglement de l’économie administrée dans son
ensemble. C’est ainsi que l’économie souterraine, tenus par d’obscurs
illettrés, a fini de manger son pain noir et s’attaque à présent au commerce
extérieur et à la banque centrale. On ne sait comment, ces caïmans savent tout
de l’histoire du cheval de Troie et de l’art d’imiter le cri du hibou. »[732]
Nous remarquons, en premier lieu, que ce passage fonctionne, tant sémantiquement que structurellement, de manière duelle, voire ombrée : un propos apparent en cache un second, qui se révèle être son reflet, fonctionnant à un deuxième niveau de sens.
Au premier plan, le narrateur explique l’origine du goût des Algériens lettrés pour les mots croisés, de manière quelque peu fantaisiste, en prétendant néanmoins au caractère tout à fait sérieux de l’explication. Tout en s’inscrivant dans le cadre d’une démonstration argumentative, la tonalité affichée du texte respire, de ce fait, l’insouciance ainsi qu’une certaine nonchalance, exprimées notamment par l’usage d’un lexique familier (« le hobby chéri », « ne pigeaient que dalle », « manger son pain noir »), par une sorte de dérision dans le ton -sensible, entre autres, à travers l’appellation fantaisiste regroupant les intellectuels du pays sous la bannière de « l’Algérien lettré », s’opposant à celle des « années chape de plomb et botte militaire », comme s’il était ici question d’une mode ou d’un slogan-, ou tout simplement par le décalage produit par l’élévation de la pratique des mots croisés au rang de véritable tare nationale.
Or, au creux de cette approche fantaisiste, le lecteur se voit néanmoins confronté au référent algérien, illustré notamment par l’évocation des « années chape de plomb et botte militaire » -qui, au-delà de l’aspect purement énonciatif, évoquent une période noire de l’Histoire algérienne-, du « dérèglement de l’économie administrée » ou encore de la prospérité de « l’économie souterraine » en passe de se généraliser. La nonchalance emportant la tonalité apparente du texte finit, par ailleurs, par tomber dans l’excès, comme en attestent les pointes de nostalgie émanant de l’évocation des années de dictature militaire (« C’était une époque », « c’était bon »), ou encore la note de cynisme perceptible à travers l’accompagnement musical (« pon-pon-pooon, ponpon ! ») désignant l’élite, de manière onomatopéique ; autant d’éléments éraillant la légèreté apparente de l’explication, pour laisser finalement percer un propos de fond de tonalité plus grave. C’est, en effet, pour pallier l’obligation de silence imposée par la dictature militaire que les intellectuels se sont réfugiés dans une pratique ludique cérébrale et solitaire, se donnant l’impression de pouvoir encore exercer leur pouvoir de réflexion et leur droit à la parole (« on avait l’impression de faire intelligence avec les grandes puissances et de marquer des points »), par le recours à une activité combinant pensée et maniement des mots, ainsi que par le choix d’une confrontation rassurante à l’énigme appelant, par principe, une solution applicable.
La représentation proposée ici par B. Sansal est évidemment allégorique et entraîne le lecteur vers une nouvelle strate du propos, le texte fonctionnant en fait par surimpressions.
En filigrane, il n’est donc plus question d’illustrer le goût de « l’intellectuel algérien » pour les mots croisés, comme refuge offert à l’intelligence brimée par la dictature militaire, mais bien d’affirmer la démission de l’élite intellectuelle dans les affaires du pays, au moment de l’Indépendance et de rendre compte de la manière dont elle s’est leurrée, dont elle s’est auto-abrutie, dont elle s’est livrée aux chefs de l’époque. Ce « message » sous-jacent s’accompagne intratextuellement de différents procédés rendant compte du travail d’écriture effectué au sein de ce texte, moins anodin qu’il n’y paraît.
Le début du passage (de « Apprenons ceci » à « c’était bon ») est constitué de phrases courtes, relativement simples à comprendre et relevant d’une tonalité globalement paisible. Ces remarques de lecture vont cependant à l’encontre de la manière dont les « chefs » perçoivent la réalité de ce qui vient d’être décrit : « les chefs d’alors ne pigeaient que dalle à cet exercice biscornu ». A l’inverse, la suite du texte (de « Le quadrillage » à « l’énigme des mots ») rendant compte de la stratégie mise en oeuvre par les chefs, censée répondre à un plan, une logique, est évoquée de manière suggestive, allusive et dans une perspective presque totalement métaphorique, rendant plus difficile la compréhension du propos. Cet obscurcissement du propos s’accentue par la suite, rompant finalement l’équilibre supposé par la structure en chiasme initialement proposée : avec la stratégie offensive -maléfique, qui plus est- menée par les chefs, l’obscur prend finalement le pas sur le texte. Ainsi, la dernière partie du paragraphe se fait de plus en plus confuse, le texte ombré cédant finalement place à l’ombre du texte, la démarche explicative brouillant paradoxalement le sens du propos tenu et appelant une approche interprétative. Le lecteur, soumis à un discours métaphorique, se voit ainsi littéralement confronté à l’énigme du texte. L’illusion de participation que semble lui proposer le genre policier classique, en lui permettant d’exercer quelques-unes de ses facultés intellectuelles -attention, réflexion, logique- dans le cadre de la recherche d’un coupable, prend ici une toute autre tournure. Dans le roman de Boualem Sansal, en effet, où l’acte d’écriture prend une résonance dépassant largement la fonction que peut lui réserver le discours de type référentiel, le lecteur est véritablement mis à contribution, moins en ce qui concerne l’enquête menée autour des deux meurtres perpétrés que dans la perspective de découvrir finalement ce que l’auteur cherche précisément à dire, et ce, d’autant que son statut de haut fonctionnaire de l’Etat laisse supposer le caractère « renseigné » du propos. Ce n’est pas tant l’intrigue en elle-même qui provoque ici l’excitation du lecteur que la qualité de l’auteur qui laisse entendre qu’il a quelque chose à dire et que, s’il prend le risque d’écrire sous son véritable nom et en affichant la nature de sa fonction, c’est sans doute que ce quelque chose en vaut la peine -la collection « Blanche » de Gallimard lui prêtant foi par ailleurs[733].
Dans le cas du Serment des barbares, l’attention ne se porte pas en priorité sur le dénouement de l’intrigue, mais bien sur les révélations concrètes susceptibles d’émailler le récit de l’enquête. En fait, le lecteur cherche l’auteur derrière le texte ; or, ce dernier choisit de jouer parfaitement le jeu de cache-cache engagé en opacifiant son texte par un travail d’écriture approfondi. Le texte se fait alors à la fois réceptacle et reflet de l’énigme, le lecteur étant dès lors invité à se faire lui-même enquêteur, déchiffreur du texte. A cet égard, Uri Eisenzweig remarque la coïncidence s’établissant entre l’enquête et le texte même :
« Si
le roman policier classique se présente comme un jeu, il ne peut faire que son
univers imaginaire ne soit finalement autre chose qu’un texte. Corrélativement,
le Grand Détective n’est pas un lecteur comme les autres. “Lisant” à la surface
du monde, il est celui des personnages qui comprend que son univers, y compris
et avant tout la scène du crime, est textuel. Ce qu’il perçoit à travers les
divers indices, les multiples signes qui le constituent, ce n’est pas tant des
significations que l’acte sémiotique lui-même. Elucider l’énigme, pour lui,
c’est avant tout comprendre qu’elle est à lire. Le sang ne fait sens que s’il
est perçu comme encre. »[734]
L’« énigme des mots » à laquelle se réfère B. Sansal et dont il fait le tombeau de l’élite intellectuelle, paraît ainsi ré-exploitée, dans Le Serment des Barbares, où elle n’est plus subie comme une fatalité réduisant au silence, mais où elle propose, à l’inverse, un espace d’ouverture au texte : finalement, plus l’énigme se répand, plus elle offre à lire.
C’est ainsi que B. Sansal offre à son roman quelques variations, comme notamment cette « Histoire de mariage »[735], intervenant sur deux pages au sein d’un chapitre titré, se démarquant visuellement par sa brièveté ainsi que par le choix d’une police différente du reste du roman.
Ce micro-récit intervient après un chapitre d’une trentaine de pages consacré à la marche du 22 mars 1993, à laquelle de nombreuses femmes participèrent entre autres, s’élevant contre le terrorisme et la multiplication des assassinats perpétrés en particulier au sein des milieux intellectuels. Le récit de cette marche présente la particularité de s’inscrire dans une double perspective : il s’agit, d’une part de rendre compte de la peur, de la terreur suscitées par l’éventualité de la mise en place d’un mouvement de répression à l’initiative des terroristes et, d’autre part, d’imprégner le récit de l’écho de la multiplicité de réactions engendrées par un tel mouvement de révolte-résistance et, à plus grande échelle, de la médiatisation excessive déployée autour de l’événement. En reportage au cœur de la foule, le narrateur récolte ainsi la parole de bouche en bouche, livrant les opinions les plus alarmistes, les interrogations angoissées, les incompréhensions, les prédictions catastrophistes. Les questions-réponses se multiplient, la tension est à son comble[736], les langues se délient en une recherche effrénée des responsables ; une frénésie qui envahit le cœur même de la marche pour finalement convier Alger à « l’exorcisme »[737]. De fait, la population ne tarde pas à se trouver face à ses démons, lorsque la rumeur d’une contremarche islamiste se répand au cœur du mouvement[738] : la foule se croit encerclée, « frissonne d’horreur », se retrouve « abasourdie par l’énormité soudaine de la situation »[739]. Or tandis que les manifestants perçoivent déjà le pire, à force de souvenirs des révoltes sanglantes de 1988, s’imaginant en « troupeau fasciné conduit à l’abattoir »[740], totalement hypnotisés, en transe, face à la perspective de la mort prochaine, le récit prend une nouvelle orientation en faisant apparaître Larbi -élément repère du lecteur-, accompagné de forces spéciales censées prévenir toute attaque islamiste -sorte de garantie pour la foule. Après un premier mouvement de crainte, le calme revient alors avec l’annonce d’un repli des islamistes, laissant aux différents protagonistes une impression « d’irréel » :
« Une
fois de plus, la réalité et l’illusion s’étaient fondues sous nos yeux sans que
nous y comprenions goutte. Tout est devenu latent. Il faudrait beaucoup de mot
pour en parler. Quand l’enjeu est la vie et la mort si proche, quand le début
et la fin se mêlent en tout point, l’air qu’on respire a le goût du vide. Il
vaut mieux se taire et disparaître dans ses rêves.
Ce
jour restera dans les mémoires, avec ses mystères qu’il faut déchiffrer. Dieu
que la mort est parlante et le bégaiement de la vie tuant ! »[741]
Ainsi que nous le laisse entendre ce dernier soupir, la sensation d’irréel qui se dégage de cette journée semble, en fait, relever tout simplement de l’absence remarquée de la mort, pourtant largement annoncée comme partie prenante de la manifestation. Pour une fois, la mort n’a pas frappé, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Cette perspective éclaire amplement la variation que nous évoquions précédemment et que l’auteur nous propose dès la page suivante.
Le passage consacré à cette variation décrit les préparatifs du mariage de la fille d’un grossiste, en insistant sur l’exubérance des festivités, sur les jeux d’« alliances » favorisés par ce genre d’événement, sur la rigueur du protocole socio-religieux, ainsi que, dans le cadre de la crise algérienne, sur le discours bien huilé des personnalités invitées pour l’occasion et qui « y vont de leur discours pour dire combien tranquille est la vie quand se taisent les menteurs et les étrangers dont le souci commun, évident et cynique, est de faire accroire que l’Algérie est à feu et à sang »[742]. C’est alors que le narrateur intervient :
« Cela
aurait pu durer jusqu’à l’aube si une khatiba du GIA n’était pas passée par là,
attirée en fait par les lumières, la musique, l’odeur de méchoui. »[743]
Le protocole nuptial laisse alors place aux atrocités habituelles que le narrateur décrit, tout en prétendant les épargner au lecteur, et ce, jusqu’à la chute finale : malgré le réalisme de la description, cette scène d’horreur a tout l’air d’être purement imaginaire, puisque le narrateur poursuit en décrivant les prétendues victimes en pleine santé, le lendemain du soi-disant massacre. Le narrateur conclut alors :
« Merci,
cher Ali, de ton témoignage qui n’en est pas vraiment un. Il ne faut pas
toujours croire ce que l’on voit de son balcon ; la nuit, tous les chats
sont gris. »[744]
Cette « Histoire de mariage » qui se présente un peu sous la forme d’un conte -de par son caractère à la fois grandiose et irréel- ou d’une fable -l’adage final offrant à l’histoire une morale à retenir en guise de leçon- semble proposer une parabole de ce qui nous est présenté, à la fin du chapitre précédent, comme un fondu entre réalité et illusion, et ce, à différents niveaux. Ainsi, la mise en garde explicite, livrée au terme de l’histoire et censée susciter une relativisation des « témoignages » apportés sur la crise algérienne, semble inviter le lecteur à la méfiance : de même que tout enquêteur confronté à l’inconnu -non su ou tu-, le lecteur se doit d’être prudent. Or, cette mise en garde se fait d’autant plus résonante qu’elle émane d’un narrateur non identifié, comme semble l’indiquer et/ou le justifier le changement de police caractérisant le passage.
Une fois encore, B. Sansal sème le doute, ne cesse de confronter son lecteur à « l’énigme des mots », l’invite à prêter attention à toutes les voix, tous les témoignages, toutes les perspectives, tout en l’obligeant à demeurer vigilant, voire actif. Pour tenter de percer l’énigme de ce texte, le lecteur doit enquêter lui-même, tester la véracité des données référentielles avancées ou encore décortiquer le mode de fonctionnement du système énonciatif ; autant d’exigences imposées par le roman de B. Sansal qui, contrairement à la forme classique du roman policier, ne peut se limiter à une lecture unique. La véritable énigme proposée par le texte dépasse, encore une fois, largement le strict récit de l’enquête menée par Larbi ; par le travail d’écriture engagé par B. Sansal, elle en vient même à dépasser l’énigme relative au contenu référentiel, pour engager une réflexion sur le savoir, la vérité et leur mode de transmission dans le roman.
Nous remarquons globalement que les romans policiers ou d’inspiration policière, de notre corpus, sont largement orientés vers une mise à l’épreuve de quelques principes fondateurs du genre, tels le manichéisme ou le rationalisme. Dans ces romans, en effet, le « principe de la surenchère »[745] fait véritablement recette, tant dans le cadre du discours critique que dans une perspective purement esthétique, si bien que le lecteur est régulièrement invité à s’interroger sur la crédibilité, la véracité, voire le bien-fondé du contenu de sa lecture aussi bien que sur la manière dont l’auteur expérimente le cadre romanesque.
Habitué à l’accord de feintise traditionnellement passé avec l’auteur, le lecteur doit ici faire face à une forme de lecture aventurière, éprouvante à la fois par l’attention sollicitée et par l’agacement suscité parfois, et ce, d’autant que le principe de la surenchère appliqué au sein du genre policier, présentant la particularité de reposer sur l’avènement de la parole -témoignages, aveux, mensonges, bluff, révélation finale-, se fait particulièrement dévastateur.
2- Contamination du système énonciatif
En proposant de pousser à son comble le genre policier, la plupart des auteurs de notre corpus parviennent, en quelque sorte, à s’approprier une forme littéraire déjà mondialement connue et largement pratiquée. Qu’il s’agisse, pour les auteurs, de s’orienter vers un procédé d’adaptation -à un intertexte et à un contexte locaux précis-, de transposition, voire de travestissement, l’élasticité du genre policier est ici fortement mise à contribution. Ceci n’est pas, a priori, pour déplaire « au lecteur de roman policier »[746] avide de surprise, de suspense ou encore d’excitation, à la lecture d’une forme littéraire dont il est néanmoins censé préalablement connaître l’issue, si ce n’est dans les termes précis du moins dans la pratique d’ensemble. Toute démarche originale trouve ainsi généralement un accueil chaleureux de la part du lecteur, à condition que les règles du jeu soient peu ou prou respectées.
Si le genre policier peut ainsi tolérer une certaine surenchère du crime, un profil d’enquêteur presque légitimement en rupture vis-à-vis de la perfection des figures traditionnelles de gentleman, il n’en demeure pas moins exempt, en principe, de toute forme de dérapage incontrôlé et notamment au sein du système énonciatif même. C’est ainsi, par exemple, que dans le roman d’Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd, le criminel s’avère être, certes, le narrateur lui-même -ayant de ce fait péché, vis-à-vis de son lecteur, par omission- mais il n’échappe pas pour autant à la lucidité d’Hercule Poirot qui rétablit la vérité au terme d’un couple de chapitres intitulés respectivement « La vérité », « …et rien que la vérité ». Dans ce roman, le détective pousse son pouvoir jusqu’au sein même de l’acte narratif, puisqu’il parvient à prendre le dessus sur la Voix directrice du roman. Afin de préserver l’objectif narratif du roman, c’est-à-dire parvenir à la résolution finale de l’énigme, le personnage se voit ainsi contraint de mettre en péril l’équilibre énonciatif du récit, puisque le personnage destitue son narrateur. Nous remarquons que c’est cette même prise de pouvoir du personnage sur l’instance narratrice à laquelle s’est notamment essayé Djamel Dib dans L’Archipel du Stalag[747], en offrant à ses personnages la possibilité de contester, ouvertement et activement, les choix opérés par leur créateur-narrateur. Cette pratique est encore exploitée dans bon nombre de romans de notre corpus, fermement décidés à offrir un véritable espace de parole à leurs personnages.
2.1-
Mise en place d’un récit polyphonique
A partir du moment où l’énigme est posée, le roman policier, quelle que soit sa forme finale, s’engage dans un processus destiné à faire suinter le crime. L’enquêteur est alors sollicité pour transcender le silence que la mise à mort de la victime a provoqué, pour partir à la recherche d’un criminel, voué également au silence ou plutôt à l’effort de non révélation, et ce, depuis l’instant même où il a décidé de mettre en action son projet machiavélique. Placée sous le signe d’une parole inédite, in-ouïe, confisquée ou dissimulée, l’enquête n’a dès lors d’autre but que de faire parler, qu’il s’agisse du cadavre -par le recours à l’autopsie, par l’exemple-, des lieux mêmes du crime -par une analyse scientifique des indices éventuellement laissés-, des témoins/suspects -sondés au gré des interrogatoires- ou même des simples faits -par recoupement, déduction. Ainsi que le souligne Alain-Michel Boyer, l’enquêteur se fait alors « traducteur », voire « interprète » :
« Si
le paradigme de lecture, dans le roman policier, est ouvertement herméneutique,
c’est parce que le détective est non seulement un traducteur qui parvient à
rendre accessible ce qui ne l’est pas immédiatement, mais aussi un interprète
qui découvre les rapports secrets qui unissent le sens manifeste et le sens
dissimulé. Certes, le détective, comme le psychanalyste, ne peut découvrir que
ce qu’il cherche, mais, en bâtissant une architecture du sens, chacune de ses
interventions réduit la multivocité ou la surdétermination des signes pour
transférer ceux-ci à l’intérieur d’une grille de lecture spécifique où il ne
leur reconnaît qu’une seule valeur. D’un mot, le roman policier n’est pas un
rébus : il propose la mise en scène
d’un style ou d’une diversité de styles herméneutiques. Herméneutique, il est
vrai, simulée, en écho à une
simulation d’enquête : le détective imite et affecte une interprétation,
il en offre le spectacle et le faux-semblant. Mais cette herméneutique feinte
comporte une singulière caractéristique : dans le monde de Conan Doyle, de
Van Dine ou de Rex Stout, interpréter
équivaut à raconter : l’acte cognitif se fond dans un acte narratif. »[748]
Dans le cas de la plupart des romans qui nous intéressent où, comme nous l’avons précédemment démontré, l’enquêteur n’est pas vraiment compétent, s’avère être soit déficient, soit muselé, et où le cadre de l’intrigue ne se veut pas tout à fait conventionnel, se laissant envahir par des éléments perturbateurs propices tantôt au délire fantasmatique, tantôt à la désolation désespérée, la maîtrise de l’acte narratif paraît tout à fait problématique.
De même que le conteur Solibo se voit étranglé de l’intérieur par « un flot de verbe »[749] retenu trop longtemps, le roman de la parole refoulée pratiqué au sein du genre policier, ne tarde pas à subir, sur le plan énonciatif, les effets de la mise à mal précédemment évoquée de sa structure fondamentale, de ses principales règles.
2.1.1- La parole en flots
L’enquête policière de fiction se fixe pour objectif la découverte de la scène absente, et, d’un point de vue énonciatif, la révélation du texte absent. Le rôle de l’enquêteur consiste alors à reconstituer la scène absente, par induction-déduction, à partir des faits et témoignages récoltés et, corrélativement, à agencer les éléments constitutifs du récit en train de s’organiser. En déterminant, par exemple, l’ordre de passage des témoins/suspects dans la salle d’interrogatoire, en extrayant des lieux du crime les indices supposés déterminants, en faisant procéder à telle analyse en laboratoire, et non à telle autre, ou encore en désignant rapidement le ou les suspects qui méritent plus particulièrement son attention, l’enquêteur se pose en véritable chef d’orchestre, tant au sein de l’enquête que du récit lui-même -dans la mesure où ce dernier semble le suivre à la trace. La responsabilité de la « bonne tenue » de l’enquête et du récit repose donc bien, en apparence, sur l’enquêteur ; ce qui n’est évidemment pas sans devenir problématique au sein de quelques-uns des romans qui nous intéressent, tels Solibo Magnifique.
Ainsi, tout en paraissant comprendre la nécessité d’isoler les principaux témoins de la mort du conteur, de circonscrire les personnages potentiellement détenteurs de la clé de l’énigme au cadre de l’enquête, et par là même du roman, en prenant soin de laisser les badauds inutiles de l’autre côté des barrières de sécurité, Bouaffesse et ses hommes se révèlent être incapables de prendre en charge l’organisation du récit, encore embryonnaire, du « crime ». C’est ainsi que, dans l’attente de l’arrivée de l’« enquêteur à tête bien remplie » et face au chagrin suscité par la mort de leur ami, les membres de la Compagnie s’empressent de se livrer hors cadre et de profiter de l’éloignement ou de l’absence des policiers pour laisser échapper leur parole en dehors de toute maîtrise ou orientation policières.
Profitant de la dispersion des enquêteurs mis en scène, les « oubliés de la Chronique coloniale » obtiennent ainsi, grâce à la médiation du « marqueur de paroles », la possibilité à la fois de parler et d’être écoutés au sein d’un espace de choix, le roman, qui leur offre la liberté de parole, tout en permettant l’ancrage de cette dernière dans l’écrit. Solibo Magnifique prend, de ce fait, l’apparence d’un « livre d’or » dédié au conteur, réunissant souvenirs, témoignages, hommages, à la fois empreints de joie et de tristesse. Toutefois, dans la perspective du cadre policier, induit par l’arrivée sur les lieux du souvenir du « car de la Loi »[750], le livre d’or se couple en quelque sorte avec le registre de main courante, et finalement avec le rapport de police : le roman s’ouvre, en ce sens, sur la retranscription du procès verbal détaillant les circonstances de la découverte du cadavre. Le cadre judiciaire participe ainsi, comme le souligne notamment Dominique Chancé, de la fragmentation du texte censée illustrer la disparition du conteur, détenteur de la parole, unique et continue :
« La
déposition policière est, par excellence, le genre qui fragmente le récit,
chacun devant s’y soumettre à son tour. Les paroles des personnages ne se
réunissent plus, elles se morcellent, comme l’histoire de Solibo. En effet,
c’est autour de ce grand absent que rayonnent ces paroles diverses. “La parole”
unique d’un sujet qui disait “je” se décompose en “dits”, au pluriel :
pastiches, citations, évocations indirectes, dans lesquels se perd l’unicité du
discours premier, originel. C’est alors la “personne de l’absence”, le “il”, qui
se réfère à Solibo, dans la fragmentation, le démembrement de témoignages
multiples. Le texte fait, en quelque sorte, son deuil, de l’énonciation unique
du conteur. »[751]
L’entreprise de fragmentation de la parole, et à travers elle du « nous », inscrit Solibo Magnifique dans la perspective déployée par le genre policier et décrite en ces termes par Alain-Michel Boyer :
« Dans le roman policier, le secret habite des anecdotes. L’enquête, en segmentant le réel pour l’élucider, le détaille en fragments détachables : autant de signatures et d’artefacts, de situations descriptibles et déchiffrables qu’elle enchaîne dans la conduite d’une énonciation. » [752]
Or, l’énonciation proposée par le roman de P. Chamoiseau semble elle-même s’inscrire dans une forme de segmentation, en ce qu’elle relève d’un émetteur aux « identités » multiples : narrateur non identifié, s’exprimant à la première personne et se présentant comme une figure du conteur (« cette récolte du destin que je vais vous conter »[753]) ; narrateur absent, s’effaçant devant les différents témoignages offerts au défunt ; narrateur/témoin identifié sous la figure du marqueur de paroles et, de fait, narrateur/personnage tantôt figure du « il », tantôt figure du « je », à la fois Chamoiseau, Chamzibié, Ti-Cham ou encore Oiseau de Cham, simultanément marqueur de paroles et « sans profession »[754]. Il s’agit, pour P. Chamoiseau, d’impliquer directement le mode de fonctionnement énonciatif du roman au cœur de l’hybridité revendiquée comme partie constituante et indéniable de la créolité, ce que souligne D. Chancé :
« Le
“marqueur de paroles” achève dans Solibo
Magnifique et Texaco la synthèse
d’un double mouvement de décomposition et de recomposition du “nous”.
L’instance énonciative, divisée et complexe, qu’il représente prend la suite de
l’énonciation unique du conteur, réalisant symboliquement le dépassement d’une
situation littéraire et sociale caduque. Après le deuil et la veillée du
conteur, il semble que le “marqueur de paroles” puisse prendre le relais,
assumant une contradiction interne qui le fait le médiateur somme toute idéal
d’une communauté elle-même complexe, à la fois extrêmement diverse et clivée
mais également une et reconnaissable dans sa créolité. Relieur d’histoires et
“marqueur de paroles”, celui qui rencontre la collectivité est cette fois à
même d’en recueillir la parole et de “collecter” un corps de textes
démembrés. »[755]
Réunis sous l’égide d’une énonciation elle-même hybride, les témoignages offerts par les membres de la Compagnie, de manière dispersée, comme s’il s’agissait finalement des cendres de la dépouille, se voient en ce sens légitimés au cœur du récit de l’enquête, non dans le cadre d’un fonctionnement purement digressif, mais comme vibrations, comme autant de résonances drainées par le processus du souvenir. C’est donc en les réunissant dans une même vibration que P. Chamoiseau semble présenter ces personnages si différents, si créoles.
Il nous semble, toutefois, nécessaire de nuancer cette approche qui, si elle rend compte de la poétique développée par l’auteur, semble trahir dans le même temps les limites d’une telle démarche.
D’un point de vue énonciatif, P. Chamoiseau illustre parfaitement ce qu’il désigne comme le « monde difracté mais recomposé », mais le « nous » qu’il prétend représenter ne correspond qu’à une perception fantasmée de la société créole. Aussi, la réunification de la communauté, à laquelle prétend procéder le « marqueur de paroles », ne se réalise qu’au sein du texte, dans la mesure où les personnages mis en scène relèvent davantage de la représentation subjective de l’auteur que d’une véritable approche de type référentiel. En d’autres termes, il convient de souligner que la « fragmentation » de la société martiniquaise dépasse le seul cadre énonciatif : si P. Chamoiseau rend compte de la diversité des voix, et par là même des identités créoles, la réunification à laquelle il semble vouloir procéder demeure virtuelle et limitée à l’espace textuel. A cet égard, le « marqueur de paroles » est moins un « relieur », un « médiateur », qu’un inventeur d’histoires ; il n’est qu’un gage d’authenticité apparent couvrant la mise en pratique d’une esthétique, d’une création et, plus largement encore, de l’appropriation d’un discours idéologique. Il nous paraît en ce sens erroné de percevoir le « marqueur de paroles » comme un être à part entière ; il n’est qu’un personnage fictif au service d’une poétique, contrairement à ce que laisse parfois entendre P. Chamoiseau lui-même, aidé en cela par une critique susceptible de se laisser séduire par le discours convaincu, argumenté et esthétiquement attrayant que véhiculent globalement les créolistes.
Or, donnant parfois l’impression d’entretenir volontairement une certaine ambiguïté autour de la figure du « marqueur de paroles », P. Chamoiseau nuance lui-même la portée de sa démarche, en reconnaissant l’incapacité de l’écrit à demeurer totalement fidèle à l’oral. Delphine Perret suggère, en ce sens, « l’auto-ironie » dont semble faire preuve P. Chamoiseau :
« “L’Oiseau
qui écrit tout le temps” [Chamoiseau] apparaît d’ailleurs un peu ridicule aux
yeux des gens. “Cesse d’écrire kritia kritia”, lui dira Solibo, “et
comprend : se raidir, briser le rythme, c’est appeler sa mort. […]
Ti-Zibié, ton stylo te fera mourir couillon […]” (71-72)[756].
Il y a ainsi une manifestation de lucidité ironique sur ce qui se perd
irrémédiablement avec la disparition du conteur traditionnel. Si la tentative
du narrateur se fonde sur l’oralité et reconnaît humblement sa dette envers
celle-ci, elle doit aussi avouer qu’elle ne peut qu’être différente : “je
pars [dit Solibo], mais toi tu restes. Je parlais mais toi tu écris en
annonçant que je viens de la parole. Tu me donnes la main par-dessus la
distance. C’est bien, mais tu touches la distance…”. »[757]
Selon D. Perret cette forme d’« auto-ironie » semble signer la volonté de l’auteur de mettre en scène son propre solibo[758] :
« Le
Maître de la parole n’était rien, un homme tombé, et c’est en n’étant rien,
seul dans la montagne, qu’il a appris à écouter la vibration de la nature et
d’autrui. Par son auto-ironie, Chamoiseau agit de même, il se défait de son
importance. Peut-être est-ce ce qui lui permet d’offrir un discours
véritablement pluriel, comme s’il était à l’écoute de vibrations
multiples. »[759]
La mise en scène du « marqueur de paroles » imparfait et tombé, semble ainsi permettre à P. Chamoiseau de combler l’absence du chef d’orchestre traditionnellement représenté, dans le cadre du roman policier, par l’enquêteur ; il s’agit en quelque sorte d’offrir aux personnages un interlocuteur/porte-parole qui leur ressemble, afin de leur rester fidèle. Or, l’intervention de ce personnage, passeur entre le monde de l’oral et celui de l’écrit, permet certes de transmettre une parole unifiée, faite de vibrations à la fois multiples et harmonieuses, mais, du fait même de sa présence, laisse peser sur cette parole une certaine artificialité. Comme dans le roman policier, le « marqueur de paroles » ne retranscrit pas, telles quelles, les paroles des personnages ; il les agence ou plutôt donne l’illusion de les agencer, n’étant que la couverture visible de l’écrivain. C’est ainsi que le « marqueur de paroles » rappelle finalement, presque malgré lui, que la polyphonie qu’il veut laisser entendre n’est en fait que le dédoublement, voire le travestissement d’une seule voix : celle du scripteur.
Cette volonté de faire entendre toutes les voix paraît également s’exprimer dans le roman de M. Condé, Traversée de la Mangrove, mais sous une forme sensiblement différente : ici, ni « marqueur de paroles », ni rapporteur ou porte-parole désigné sur l’ensemble du roman, mais une succession de témoignages recueillis nominalement.
Le cœur du roman, intitulé « La nuit » est ainsi composé de vingt « chapitres » qui, les uns par rapport aux autres, présentent la particularité de fonctionner selon des modes énonciatifs différents. Ainsi, les chapitres consacrés aux femmes, mais aussi à Joby, le plus jeune fils de Loulou, ainsi qu’à Xantippe, l’homme-esprit, le « messager », parabole de l’Antillais originel, laissent place à une narration homodiégétique, avec utilisation du passé composé ; le narrateur y parle, sous le mode du discours, de sa vie, de manière rétrospective tout en évoquant ses sentiments présents, laissant paraître une forme d’illusion de simultanéité entre les évènements et leur récit. D’autre part, les chapitres consacrés aux hommes font intervenir une narration à la troisième personne, avec emploi du passé simple, s’inscrivant dans le « mode du raconter » selon l’expression d’Yves Reuter[760], les paroles des personnages étant médiatisées par le discours d’un narrateur hétérodiégétique et transposées tantôt au style indirect, tantôt au style indirect libre.
Quel que soit le mode choisi, ces chapitres se placent sous le signe du témoignage. C’est ainsi que chacun d’entre eux s’ouvre sur une parole en style direct, insérée au corps du texte ou retranscrite entre guillemets, selon que l’énonciation procède, par la suite, du discours ou de la narration. En réalité, seul Sonny, l’enfant « attardé » de Dodose Pélagie, réduit la plupart du temps au silence ou à des borborygmes, ne livre aucune parole, « exprima[nt] par une chanson la peine qui débordait de son cœur »[761]. Ne s’exprimant pas directement au sein du texte, et étant incapable de communiquer avec le reste de la communauté -Sancher excepté- Sonny s’avère être paradoxalement le seul à manifester oralement ses sentiments, autour de la dépouille de son ami disparu. Les autres habitants de Rivière au Sel, présents à la veillée, demeurent en effet relativement silencieux autour du cercueil, se montrant, à l’inverse, particulièrement loquaces au sein du texte. Quelle que soit la situation d’énonciation dans laquelle chacun se trouve, le rapport que tous les personnages entretiennent avec la parole paraît fondamental, voire obsessionnel. Il n’est qu’à relever les nombreuses occurrences inscrivant la parole dans un fonctionnement de type comportemental, comme c’est le cas pour Moïse, premier « témoin » :
« Quand
il était avec Francis, Moïse n’ouvrait pas la bouche. »
« Tout ce qu’il aurait pu raconter, et même inventer, aurait semblé fade et sans sel, comparé aux fantaisies épicées que Francis, moulin à paroles, servait jour après jour. »
« A
l’école, la maîtresse l’oubliait, mi-Chinois mi-Nègre, perdu dans son sommeil
tant et si bien que les rares fois où elle lui adressait la parole, il restait
sans voix […]. »
« Francis
Sancher n’avait pas ouvert la bouche. Le lendemain, pas découragé, Moïse avait
poussé plus loin l’interrogatoire. »
« Un
soir, n’en pouvant plus de peine, Moïse profita d’une embellie et courut chez
Francis, des mots et des mots d’explication à la bouche […]. »[762]
Chez Moïse, la parole fait acte et semble le déterminer davantage que toute autre caractéristique physique ou psychologique. Sa fonction de facteur, en outre, fait de lui un messager chargé de transmettre les nouvelles : il joue, en ce sens, le rôle de serviteur, de vecteur de la parole, au sein de la communauté. C’est ce même rôle que M. Condé semble lui offrir au sein du roman : de même que Moïse a été le premier à entrer en contact avec Francis Sancher, son témoignage ouvre, au sein du texte, la voie/voix aux autres habitants de Rivière au Sel. C’est ainsi qu’au fil des récits, souvenirs et confessions directs ou rapportés, le lecteur se fait en quelque sorte le dépositaire d’une multitude d’histoires, si bien que de lecteur, il se sent progressivement devenir auditeur. Au-delà du « bavardage coupé de rires des hommes et [du] bourdonnement des prières des femmes »[763], en marge de « ces blagues grossières, ces contes cent fois entendus, ce ron-ron de prières hypocrites »[764] qui peuplent la veillée, autrement dit au-delà de la parole factice et d’artifice, le lecteur est assailli par un flot de paroles ininterrompu, mêlant colportages, rumeurs, souvenirs, interrogations et autres paroles véhiculant les états d’âme des uns et des autres.
Ainsi, les colportages et rumeurs sont véritablement prégnants au travers de la reprise ponctuelle, et fonctionnant de manière anaphorique, de la proposition « les gens disent que », introduisant un discours de type indirect. Les souvenirs sont, quant à eux, perçus dans une perspective moins nostalgique qu’explicative et se présentent comme autant de « versions des faits ». Les interrogations sont pour leur part exprimées au style direct, y compris dans les récits faisant intervenir un narrateur hétérodiégétique. Enfin, les plaintes, les regrets, les rancœurs, les paroles haineuses, les accusations, les aveux, mais aussi les souhaits, les annonces, les projets, se multiplient, se succèdent et s’entremêlent. Se chevauchant inévitablement dans l’esprit du lecteur, confronté à des morceaux d’histoires censés constituer le sens global du roman qu’il découvre, les témoignages, livrés directement ou non par les habitants de Rivière au Sel, ne s’affrontent pas néanmoins réellement, chaque personnage se voyant attribuer son propre espace de parole.
Ainsi, comme dans la fiction policière, le moment consacré à l’audition des témoins réalisée sous contrôle, dans une atmosphère de suspicion et globalement sous tension, s’avère être, presque paradoxalement, un moment de libération : tout ce que l’on sait doit ici être dit. Or, tandis qu’au sein de la fiction policière traditionnelle, les éventuels détenteurs de secrets, voire suspects, donnent l’illusion de tout dire, alors que leur témoignage s’avère être en réalité limité à la préservation de leur propre intérêt, les habitants de Rivière au Sel sont censés pouvoir se livrer en toute liberté, parler sans retenue, puisque leur témoignage ne s’adresse en principe qu’au lecteur et demeure inaudible au reste de la communauté. En un sens, les flots de paroles que laissent échapper les habitants de Rivière au Sel doivent paradoxalement leur libération à la garantie du maintien du silence.
Cette tension constante et paradoxale maintenue entre silence et parole est favorisée par l’insinuation d’un intertexte policier et se manifeste logiquement au sein d’autres romans de notre corpus, tel celui de Rachid Mimouni, Tombéza.
Cloitré sur un lit d’hopitâl, aphasique, le visage baigné d’urine après la vengeance d’un de ses ennemis, Tombéza fait son entrée dans le roman en étant réduit à l’état de rebut, incapable de quoi que ce soit si ce n’est de penser. C’est ainsi qu’entre sanglots et rire libérateur, il laisse finalement remonter en lui l’histoire de son accident, celle de sa vie par glissement, donnant à voir un tableau de l’Algérie contemporaine, par extension. Il se livre ainsi sans retenue et sans anxiété, en dépit de la menace que laisse peser sur lui le commissaire Batoul et malgré l’insistance de Rahim à lui poser une multitude de questions ou simplement à lui parler « comme s’il avait tout oublié des explications fournies par le médecin, comme s’il ignorait [son] incapacité à articuler le moindre mot »[765]. Être abject et solitaire, réduit physiquement au silence et à l’immobilisme, Tombéza est, de fait, débarrassé de ses handicaps, de sa démarche claudicante, du rictus déformant son visage et globalement de tous ces éléments lui ayant valu son surnom, mais également privé de ses mesquineries, attaques et mauvais comportements habituels. N’ayant dès lors plus d’autre choix que celui de procéder à l’inventaire de sa vie, Tombéza se raconte et raconte finalement son pays, de digression en digression, prêtant sa voix, et plus exactement son corps impotent, à d’autres voix porteuses d’histoires, de témoignages, de justifications ou encore d’incompréhensions. Réduit au silence, le corps de Tombéza se fait alors, par contraste, le point de départ d’un récit polyphonique pris en charge par une multitude de voix de passage se succédant dans l’esprit de Tombéza, s’enchâssant dans le récit, avec une grande liberté poussant parfois à la confusion.
2.1.2- Orientation et parti pris de l’énonciation
L’équilibre du roman policier traditionnel dépend essentiellement de la manière dont le scripteur parvient à maintenir le cœur de l’énigme secret, tout en livrant un récit rendant compte des avancées de l’enquête, mettant parallèlement en évidence la performance du détective. Autrement dit, la « réussite » du récit policier dépend essentiellement de la qualité du système énonciatif mis en place par le scripteur.
A cet égard, le choix du narrateur s’avère être déterminant, dans la mesure où ce dernier crée le lien entre le scripteur, détenteur de la totalité du récit et de la clé de l’énigme, et le lecteur qui doit avoir l’illusion que le récit fini n’existe pas encore, qu’il est en train de se construire sous ses yeux. Cette impression est d’autant plus prégnante qu’en suivant la progression de l’enquête, le lecteur est installé au cœur d’un récit qui lui apparaît balisé, avec un début -le crime- et une fin -la résolution de l’énigme.
Une première remarque s’impose en ce qui concerne le choix du narrateur. Dans le cadre du roman policier conçu dans une perspective ludique, proposant la mise en texte d’une énigme dont la résolution implique un procédé strictement intellectuel, la fonction du narrateur se limite à un procédé d’écriture : il intervient pour incarner, en quelque sorte, la progression du récit. Si l’enquête proposée transcende, à l’inverse, le strict cadre ludique, comme c’est le cas par exemple des romans de type référentiel, prenant notamment pour cadre l’Algérie contemporaine dans une perspective critique, le narrateur ne fonctionne dès lors plus simplement comme simple vecteur du récit, mais comme porte-parole assumant un discours critique.
Dans les romans de Y. Khadra, la narration est ainsi assumée par le commissaire Llob lui-même et soumise, de fait, aux différentes facettes du personnage, parmi lesquelles nous distinguons celles du policier, de l’idéaliste déçu et de l’écrivain.
Llob, « le policier », offre notamment à l’énonciation un certain dynamisme, une tension perpétuelle, alimentée entre autres par la peur, l’enthousiasme ou encore la détermination et propice au maintien d’une des conditions majeures du récit d’énigme, le suspense. Ce dynamisme se manifeste notamment, au sein du récit, à travers l’évocation des sensations physiques de Llob[766] :
« Sa
main décrit un arc. Il se recroqueville ; la télécommande lui échappe et
s’abat sur le carrelage. Une couche de verglas me cimente le dos. J’entends
Lino chanceler de panique. Son souffle débridé me creuse la nuque. Je réalise
enfin ce que signifie “être fait comme un rat”. »[767]
« J’ai
brusquement envie de tout laisser tomber. Le cinglé qui halète et agonise au
bout du fil, m’inspire des sentiments déroutants. Je ne sais plus ce qui
m’arrive. Mon ventre se froisse, mon cœur se rétrécit, et un goût nauséeux a
envahi ma gorge. »[768]
« […]
il balance le téléphone sur Lino en hurlant et se redresse. Mon Dieu ! Sa
tête a manqué de toucher le lustre. Son énorme ombre recouvre toute la pièce.
Le plancher se met à trembler sous son poids. Je le vois happer Lino et le
catapulter à travers un vaste canapé. Je tire… Deux fois… Sans m’en rendre
compte. Comme dans un rêve fétide. Le Dingue s’arc-boute, pareil à une chimère
foudroyée par les dieux, pirouette sur lui-même dans un rugissement inhumain et
s’abat. »[769]
Sur le modèle des détectives de « Série noire », le policier mis en scène par Y. Khadra fait, en outre, preuve d’un certain humour pouvant paraître à la fois gouailleur et cynique, imprégnant largement la tonalité du récit, Llob prenant triplement appui sur son coéquipier pour se moquer, sur lui-même en pratiquant une forme d’autodérision et sur le lecteur invité à partager son regard moqueur :
« Lino
est ahuri. Il a l’air d’une vache qui voit passer un roumi. »[770]
« -Vous êtes diablement sexy.
-Apparences,
ma chère. En réalité, je suis un peu comme le melon. Je prends du ventre au
détriment du pédoncule. »[771]
« Il
égrène une brochette, la trempe dans la mayonnaise, puis dans la harissa,
ensuite dans la moutarde -remarquez la fluidité et la judiciosité de la
progression- et se met à grignoter dedans en gémissant d’aise. »[772]
Llob, « l’idéaliste déçu », teinte quant à lui la narration de son spleen, se permettant des variations à la fois désabusées et saillantes, laissant percer toute l’amertume et le désarroi non pas du policier mais bien de l’homme :
« J’ai
beau me répéter qu’au moins je suis honnête, que ma conscience est peinarde,
qu’il n’y a pas de sang sur mes économies ; rien à faire : aussi
intègre, aussi sain que je sois, à côté de ces gens-là, je ne mérite pas plus
d’égards qu’un paillasson. »[773]
« J’ai
beau me répéter que les braves se doivent de ne pas se laisser abattre, que le
sort d’une nation dépend de leur entêtement à tenir la dragée haute aux hydres
omnipotentes ; j’ai beau rêver d’un jour où la justice triomphera enfin du
trafic d’influence et des passe-droits ; j’ai beau croire que, dans le
ciel serti de milliards d’étoiles, il y en a une pour moi, plus belle que
toutes les galaxies réunies, l’assurance qu’arborent les Dahmane Faïd finit
immanquablement par me dévitaliser. »[774]
Enfin, Llob, « l’écrivain », permet à la voix narrative de jouir d’une certaine poésie, encouragée en cela notamment par l’imprégnation d’un intertexte foisonnant :
« Il
pleut sur la ville comme pleure, dans son cœur, un amant renié. De gros nuages
sombrent se coagulent dans le ciel. Dans la brume naissante, Alger ressemble à
sa Casbah. »[775]
« J’ai
brusquement du chagrin pour ce cinglé qui me fait penser au personnage de
Mohammed Moulessehoul, ce personnage qui disait à son reflet dans le
miroir : “J’ai grandi dans le mépris des autres, à l’ombre de mon
ressentiment, hanté par mon insignifiance infime, portant mon mal en patience
comme une concubine son avorton, sachant qu’un jour maudit j’accoucherai d’un
monstre que je nommerai Vengeance et qui éclaboussera le monde d’horreur et de
sang”. »[776]
« Nous
étions pauvres mais, tels des nénuphars que les eaux croupissantes de l’étang
n’altèrent pas, nous flottions à la surface des déboires avec une rare sobriété
et nous guettions la moindre lumière pour nous en inspirer. »[777]
Relevons encore un passage significatif, paraissant témoigner de la superposition et d’une certaine manière de la coïncidence des trois modes énonciatifs :
« Saigné
aux quatre veines, l’horizon accouche à la césarienne d’un jour qui finalement
n’aura pas mérité sa peine. Je m’extirpe de mon plumard, complètement
dévitalisé par un sommeil à l’affût du moindre friselis. Les temps sont
durs : un malheur est si vite arrivé. »[778]
Dans les romans de Y. Khadra, l’instance narrative peut ainsi bénéficier de la triple caractérisation du personnage énonciateur et entraîner le lecteur au cœur d’un texte l’accaparant de tous côtés : le lecteur peut se sentir, en effet, à la fois pris au cœur de l’intrigue policière, saisi par la réflexion menée sur l’Algérie contemporaine et éventuellement séduit par la qualité littéraire du récit. Triplement arrimé à l’angle de vue de Llob, le lecteur paraît ainsi invité à « coller » véritablement à la narration, saisi et en confiance[779].
Précisons toutefois que l’expérience du narrateur intradiégétique-homodiégétique n’implique pas nécessairement l’adhésion ou la sympathie du lecteur, ainsi que le suggère notamment R. Mimouni qui, tout en faisant de Tombéza l’énonciateur phare du récit, suscite d’emblée, chez le lecteur, un mouvement de recul à l’égard de ce narrateur abandonné dans un rebut envahi d’odeurs pestilentielles, livré aux cafards et à la malveillance du concierge borgne de l’hôpital, venu lui uriner sur le visage. Cette prise de distance vis-à-vis de Tombéza ne cesse par ailleurs de croître au fil du roman, au fur et à mesure des souvenirs égrenés esquissant les contours de ce personnage à la fois rejeté du reste de la communauté et résolu à l’abjection. La distanciation suscitée par la personnalité du narrateur s’exprime, en outre, au cœur même du système énonciatif prêtant d’autres voix à la personne du « je », ainsi que nous l’avons suggéré précédemment.
Dans une perspective inverse, nous remarquons que le roman de B. Sansal s’oriente vers un système énonciatif évitant soigneusement le strict recours à la première personne. Dans Le Serment des barbares, l’inspecteur Larbi n’est pas le narrateur officiel du roman ; il n’en demeure pas moins omniprésent au cœur de la narration, favorisé en cela par le recours à différents procédés discursifs laissant entendre ponctuellement sa voix au cœur de l’énonciation, qu’il s’agisse de l’introduction du discours rapporté direct (« Larbi appréciait ses manières, mais pour s’en moquer. “Peut-être fais-je flic de série ?” se dit-il en s’efforçant d’oublier l’image gélatineuse qu’en donnent les feuilletons égyptiens […]. »[780]), du discours indirect libre (« Le policier était excédé par ce verbiage de syndicalistes à vie. Sont capables de nous noyer comme des pierres, ces jean-foutre-là. »[781]) ou qu’il s’agisse encore d’une forme de discours mené par le narrateur sur la « vie intérieure » du personnage, ou psycho-récit (« Lui-même se sentait un intrus ; c’était la première fois qu’il visitait un cimetière chrétien, il s’attendait à tout. Pour un musulman piégé à la naissance, c’est duraille. Etrange sensation. La mort lui parut soudain impie. »[782]).
Dans ce roman, le « moi pensant » du personnage se substitue à son « moi parlant », en une illustration de la solitude de l’enquêteur veuf, inutile et en fin de vie. Soulignons néanmoins que la voix de Larbi se fait également entendre de manière directe, notamment grâce à l’intervention ponctuelle de son ami historien, Hamidi. Or, les paroles qu’ils échangent en de longs dialogues s’avèrent être capitales, dans la mesure où, réunies, elles semblent donner le ton à l’ensemble du roman. C’est en effet au cœur de ces échanges que paraît s’établir la véritable enquête du roman : fort du désir de savoir, de l’expérience, des connaissances et de la perspicacité à la fois de l’enquêteur et de l’historien, le scripteur du roman livre ainsi un récit se faisant la conjonction de toutes les voix, de toutes les hypothèses, de tous les témoignages. Dans le cadre de la fiction policière, le récit proposé se présente à la fois comme « un système à interpréter » et comme un « système interprétatif »[783], s’inscrivant au cœur d’une logique herméneutique proposant de « saisir le réel au moyen d’une énonciation, aspirer à retrouver une intelligibilité première, ce qu’il y a d’originaire dans l’acte et dans le dire, vaincre l’éloignement qui sépare le témoignage de son commentateur »[784]. En réunissant au sein de l’énonciation, le témoignage et le commentaire, le scripteur crée, d’une certaine manière, la véritable enquête, destinée non pas à l’enquêteur de fiction, mais bien au lecteur.
En ce sens, Alain-Michel Boyer remarque que la solution apportée par la révélation finale de l’enquêteur suscite généralement une certaine déception chez le lecteur, « surpris de lire une explication parfois embarrassée ou insipide »[785]. Il développe :
« En
fait, la clé, dans le roman-problème, apparaît comme dérisoire, en partie parce
qu’elle ne procède d’aucune cause ou fin extérieure, mais surtout parce que le
chapitre final, image en réduction, inversée, des investigations, a pour rôle
de désigner, par rétroaction, le récit de l’enquête -ante-récit- comme le vrai récit, dans la mesure où le roman
policier éprouve, en permanence, le besoin de représenter les fonctionnements qui l’instaurent, de réfléchir sa
propre genèse, ou, si l’on préfère, de produire, en lui-même, un dispositif qui
exhibe ses principes narratifs. Visible et lisible activité d’élaboration,
contrainte générique qui assigne à l’enquête un rôle scripturaire, selon trois
degrés : raconter l’histoire de l’engendrement du roman, donner un
équivalent concret de l’activité narratrice, montrer le procès de la création
littéraire. »[786]
Aidé des connaissances et réflexions de l’historien, Larbi parvient ainsi à découvrir la vérité et plus précisément les raisons et circonstances des meurtres :
« Lui, Larbi, connaît l’histoire de ces hommes et cette connaissance l’a mené à ce trafic. Le cercle est fermé. »[787]
Larbi étant parvenu à la connaissance de l’histoire, le cercle se referme ; une perspective sensiblement différente dans le cadre du roman policier traditionnel où le cercle ne peut véritablement se refermer qu’avec la révélation publique, effective ou promise, de la clé de l’énigme, le doigt de l’enquêteur pointant fermement le coupable. Or, la question du partage du savoir de l’enquêteur se voit ici explicitement mise en perspective :
« Mine de rien, il avait remué pas mal de boue. Maintenant il sait ; les preuves viendront plus tard. “Les autres savent-ils qu’il sait ?” est la vraie question. »[788]
Le lecteur sait que Larbi sait, il sait ce que l’enquêteur sait et le coupable lui-même en a été informé indirectement, par le biais d’un intermédiaire -contrairement aux usages du genre- au gré d’« un bluff dérisoire » qui s’avère être en fait « une provocation dangereuse »[789], qui causera finalement la mort de l’enquêteur. C’est ainsi que la tension du roman est ici portée non sur l’objet de la révélation, mais bien sur ce qu’il advient de cette révélation, sur la manière dont elle est exprimée et transmise. La réflexion du docteur Hamidi, qui vient clore le roman, révèle en ce sens la véritable clé de l’énigme :
« Son
ami policier avait raison. L’histoire n’est pas l’histoire quand les criminels
fabriquent son encre et se passent la plume. Elle est la chronique de leurs
alibis. Et ceux qui la lisent sans se brûler le cœur sont de faux
témoins. »[790]
Le véritable enjeu du roman policier se voit mis en évidence ici par la manière dont le roman s'achève, en une mise en perspective du dire et de l’écrire. En effet, il convient de souligner que tout ce qui fait le roman policier, ce n’est ni le crime, ni le mystère, ni le suspense, ni le génie ou le courage de l’enquêteur, mais la manière dont ces « ingrédients » sont transmis, exposés ou suggérés au lecteur. Cette mise en perspective de l’agencement du système énonciatif nous renvoie alors à la bipolarité du roman policier, à la fois « texte en fonction », livré au lecteur soumis au développement d’une intrigue et « texte en fonctionnement », répondant en quelque sorte au mode opératoire mis en place par le scripteur. Une des particularités du roman policier consiste à faire coexister et coïncider ces deux perspectives, au su d’un lecteur qui, pour découvrir la réponse à la question posée par l’intrigue « Qui l’a tué ? », n’a dès lors de cesse de sonder le texte en fonctionnement, à la recherche des indices laissés à son intention ou, à l’inverse, masqués par le scripteur. La lecture de romans policiers implique donc bien la participation active du récepteur du récit qui se manifeste non tant au sein de l’intrigue qu’au niveau du texte lui-même. L’absence de l’enquêteur ou son arrivée différée tendent à souligner cette perspective.
Ainsi que le souligne André Peyronie, le personnage de l’enquêteur n’est en rien le « découvreur » de l’énigme, sinon un simple transmetteur d’informations détenues et livrées arbitrairement par le scripteur :
« Dans
le roman policier à énigme, on passe de l’énigme à la solution par le moyen
d’une enquête.
La
première remarque qu’il nous faut faire est que nous ne participons pas du tout
à une véritable enquête, mais que nous assistons, en réalité, au simulacre
littéraire d’une telle enquête. Le détective ne découvre évidemment rien que
l’auteur ne sache déjà et qu’il n’ait prévu de faire apparaître à tel ou tel
moment. Il est, dans le roman, pour faire semblant de découvrir les
renseignements qu’il faut progressivement communiquer au lecteur. Autrement
dit, l’enquête du détective est le nom que prend dans le roman la distribution
de l’information. »[791]
L’enquêteur assure donc la transmission de l’information et, avant cela, il justifie par sa présence la mise en texte de l’énigme ; si la victime « incarne » la mort, l’enquêteur, lui, matérialise d’une certaine manière l’énigme. Or, nous constatons, notamment à travers les romans de M. Condé, que l’absence de l’enquêteur ne perturbe en rien ni la mise en texte de l’énigme, ni même la transmission des informations censées permettre au lecteur de progresser dans sa compréhension des tenants et aboutissants du problème posé.
Dans Traversée de la Mangrove, le caractère énigmatique de la mort de Sancher est ainsi rapidement établi à la fois par la certitude des habitants persuadés qu’il s’agit-là d’un crime et par l’incertitude du médecin légiste, qui reste des heures enfermé en salle d’autopsie sans pouvoir affirmer qu’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle ou criminelle. C’est finalement un autre médecin légiste, venu de la Pointe, qui tranche l’affaire en concluant à une rupture d’anévrisme. Or, le mal est déjà fait : le doute installé perdure, d’autant plus que le deuxième médecin légiste s’avère être un « étranger » qui ne connaît rien aux affaires de Rivière au Sel et que, par conséquent, sa parole ne compte guère. En outre, le verdict de la mort naturelle est finalement bienvenu, puisqu’il infirme toute possibilité d’intervention policière, laissant aux habitants de Rivière au Sel la responsabilité de l’enquête, autrement dit la responsabilité du récit. C’est ainsi en quête de réponses qu’ils se réunissent autour de la dépouille, jouant auprès du lecteur à la fois le rôle de témoins et de transmetteurs des informations nécessaires d’une part, à l’appréhension du contexte au sein duquel l’énigme est venue se loger et, d’autre part, à la découverte de l’identité de la victime, pouvant éclairer les circonstances de sa mort. Le récit s’organise ainsi malgré l’absence de l’enquêteur, M. Condé mettant en place un système énonciatif qui parvient à se passer d’un quelconque intermédiaire/interprète/régisseur de la parole et qui joue même de cette absence de focalisation centralisée du récit pour permettre au lecteur d’appréhender la seule véritable enquête qui soit dans le roman, celle engagée sur les paroles, les mots, la mise en texte.
Prenant soin d’éviter, là encore, l’intervention d’un enquêteur/organisateur du récit, M. Condé fait s’ouvrir l’intrigue de La Belle Créole sur le terme d’un procès prononçant l’acquittement de Dieudonné. Bien que l’enquête officielle soit ici achevée, tout est fait pour que le procès signe non la fin mais bien le début de l’affaire et par là même du récit, d’une part, parce que le lecteur est nécessairement amené à se demander ce que Dieudonné a fait pour passer en jugement et, d’autre part, dans la mesure où dès la lecture du verdict, il comprend que le procès qui s’achève n’est pas parvenu à faire toute la lumière sur le drame qui vient d’être vécu, comme en atteste le malaise ressenti par Dieudonné :
« Il
ne se reconnaissait pas dans l’image que l’avocat s’était évertué à donner de
lui, pitoyable victime. Pas plus d’ailleurs dans celle que peignait l’avocat
général : brute grossière et dangereuse. »[792]
Dès sa sortie du tribunal, Dieudonné guide ainsi le lecteur sur les traces de sa véritable histoire, revenant sur les lieux du crime, laissant filtrer des pensées, des souvenirs, des émotions qui tiennent le lecteur en haleine, jusqu’à la révélation des circonstances du « crime », une vingtaine de pages avant la fin du roman. De plus, privé de la perspective d’une arrestation ou d’un jugement, déjà survenus, le lecteur est maintenu sous tension, ne pouvant anticiper ni projeter le terme du roman.
Quelles que soient les dispositions permises par l’organisation du système énonciatif, une constante demeure en l’intérêt de maintenir l’attention du lecteur ; constante évidemment commune à toute production destinée à un public, mais qui présente l’intérêt, dans le cadre du roman policier, d’être affichée, revendiquée, reconnaissable voire palpable en cette donnée déterminante que représente le suspense. Elément indispensable, notamment au sein de la fiction policière, le suspense renvoie à la dimension spectaculaire et à l’effet de mise en scène nécessairement véhiculés par le genre.
2.2- Le récit mis en scène
Si la voix directrice du récit propre au roman policier classique prétend simplement rapporter des faits, rendre compte du déroulement de l’enquête ou encore permettre au lecteur de détenir les informations suffisantes à la résolution de l’énigme, il convient de garder à l’esprit le fait que le véritable objectif du récit policier consiste en une vaste manipulation de la lecture. Afin que le récit « réussisse », il est nécesaire que le lecteur soit maintenu sous tension en ayant l’impression qu’il est sur le point de tout découvrir, alors qu’en fait il est soigneusement maintenu à l’écart de la solution tout au long de l’enquête.
Dans le cadre de cette mise en attente du lecteur, le parti pris enveloppant la voix directrice et orientant la tonalité du récit s’adjoint alors différents effets de mise en scène censés orienter la lecture et la conditionner de manière plus ou moins visible et explicite.
2.2.1- Contextualisation du récit : modalisation du
système énonciatif
Dans le roman policier traditionnel, le lecteur, tout en sachant d’avance à quel type de schéma il va être confronté, est invité à occulter, d’une certaine manière, le « plan de route » du récit préalablement déterminé par le scripteur, aidé en cela par la diversion proposée par la mise en évidence d’un second « plan de route », celui de l’enquête, initié cette fois-ci, tambours battant, par le détective. Autrement dit, il s’agit, dans le cadre de la fiction policière, d’attirer l’attention du lecteur sur le déroulement de l’enquête afin de lui faire oublier la manière dont le récit s’organise.
En surface, le lecteur est donc invité à s’intéresser à l’histoire faisant l’objet du récit. Point de départ de cette histoire, l’énigme justifie la réalisation d’une enquête qui, de fait, coïncide avec le déroulement du récit, dont l’intérêt se voit a priori assujetti à la « qualité » de l’enquête menée. Un récit qui aspirerait à maintenir le lecteur en éveil serait donc avant tout constitutif de la richesse des ingrédients nourrissant l’enquête. Or, ainsi que le souligne François Rivière :
« Tous les moyens sont bons
pour dissuader le lecteur de s’abandonner au ronronnement de la succession
romanesque des éléments du récit […]. Le travail de falsification n’est jamais
chez les auteurs les mieux doués, synonyme de “brouillage”. Il ne s’agit pas de
plaquer sur un récit anodin une structure compliquée, mais de pervertir avec
soin une histoire simple, implacable, dont le déroulement seul est truqué et imposé
comme tel au second niveau de lecture. »[793]
L’éclairage apporté par F. Rivière nous conduit ainsi à revoir l’hypothèse précédemment formulée : ce ne sont, en effet, pas tant les ingrédients de l’enquête qui déterminent l’intérêt du récit, que les modalités énonciatives de ce dernier qui permettent d’offrir du relief à l’enquête. Concrètement, il s’agit ici de nous intéresser aux « modes » du récit proposé par la fiction policière, autrement dit à la question de la « régulation de l’information narrative »[794], constitutive de deux données essentielles : la « distance » et la « perspective ». Reprenons le développement proposé par G. Genette :
« On
peut raconter plus ou moins ce que
l’on raconte, et le raconter selon tel ou
tel point de vue ; et c’est précisément cette capacité, et les
modalités de son exercice, que vise notre catégorie du mode narratif : la “représentation”, ou plus exactement
l’information narrative a ses degrés ; le récit peut fournir au lecteur
plus ou moins de détails, et de façon plus ou moins directe, et sembler ainsi
[…] se tenir à plus ou moins grande distance
de ce qu’il raconte ; il peut aussi choisir de régler l’information qu’il
livre, non plus par cette sorte de filtrage uniforme, mais selon les capacités
de connaissance de telle ou telle partie prenante de l’histoire (personnage ou
groupe de personnages), dont il adoptera ou feindra d’adopter ce que l’on nomme
couramment la “vision ”ou le “point de vue”, semblant alors prendre à
l’égard de l’histoire […] telle ou telle perspective. » [795]
La question de la « distance » et de la « perspective » est, en fait, déterminante dans le cadre de la fiction policière où la dynamique du récit relève essentiellement du positionnement et de l’orientation adoptés par l’instance narrative. C’est ainsi que le suspense, par exemple, naît moins de la teneur des évènements mis en scène que de la manière dont ils sont perçus et présentés au lecteur. Une scène empreinte de suspense -et par conséquent garante de l’éveil et de l’intérêt du lecteur- dépendra donc de la manière dont elle sera racontée et plus précisément de la nature du rapport que l’énonciateur entretiendra d’une part, avec l’objet ou la situation décrits et, d’autre part, avec le récepteur du récit : si l’énonciateur n’a pas « vécu » la scène, de quel point de vue se place-t-il ? A-t-il une perception omnisciente ou partielle des éléments du récit ? Exprime-t-il une quelconque implication dans l’histoire racontée ? S’il se pose en narrateur intradiégétique, propose-t-il de la scène décrite un récit simultané ou différé ? Dans quelles conditions a-t-il vécu ou participé à cette scène ? Quelles sont ces conditions au moment où il livre le récit ? Enfin, quel que soit le positionnement de l’énonciateur, à qui s’adresse-t-il et quel rôle ou quel effet produit la scène décrite au sein du texte dans son ensemble ?
Pour résumer, le suspense relève de la perception du lecteur -ce que Eleazar Lipsky nomme le « pressentiment », défini comme « la réaction du lecteur envers l’histoire » et plus précisément comme « sa capacité à prévoir un événement, à anticiper »[796]- et de la manière dont le narrateur parvient à le positionner vis-à-vis de la scène décrite.
Afin d’illustrer notre propos, revenons sur une scène décrite dans le roman de Fortuné Chalumeau, Pourpre est la mer.
Au cours d’une filature, l’inspecteur Laprée et son adjoint Mozar sont entraînés en pleine nuit, par le suspect qu’ils surveillent, jusque sur l’îlet de Cahouanne. Ayant perdu la trace de l’individu, ils se séparent et le narrateur prend alors le parti de suivre Laprée dans sa progression incertaine. Seul et sans allié, dans le noir et en terrain inconnu, Laprée réalise le danger de sa situation et, contre toute attente, c’est toute l’orientation du récit qui bascule alors. En effet, la confiance accordée presque d’emblée à Laprée par le lecteur, du fait de son assurance ainsi que du pressentiment -conditionné par le cadre générique- que rien de grave ne peut lui arriver, s’évanouit subitement devant la réaction surprenante de l’enquêteur :
« Il retint son souffle et prêta l’oreille : il lui semblait entendre de sourds appels monter de la mer. C’était une plainte ou un gémissement comme ceux que produit le vent qui s’engouffre dans une cheminée. Non loin, de menus craquements le firent sursauter. Il écouta, le cœur en écharpe, mais ceux-ci décrurent et disparurent.
C’est
alors qu’il se prit à avoir peur. Une peur laide, pas la peur bien excusable de
l’homme d’action ou du soldat qui évalue l’ampleur du danger. Une peur d’enfant
à l’abandon qui renifle et cherche à faire couler ses larmes. Il s’apitoyait
sur lui. Pauvre Laprée, qui avait épousé la police pour expier, au service du
Bien, le crime de sa mère et de son frère. Pauvre Laprée qui venait de se
fâcher avec son seul ami antillais. Pauvre Laprée exposé au danger, seul et
sans amour… »[797]
De même que Laprée se voit soudainement confronté à la peur, le lecteur réalise brusquement que ce dernier n’est pas le héros courageux et aventurier auquel il avait cru avoir affaire. Quelque peu déstabilisé par la « véritable nature » du héros, le lecteur se laisse plus aisément gagner par l’angoisse, et le suspense opère alors, porté par la mise en doute de l’invulnérabilité du héros. Or, tandis que le récit s’enfonce de plus en plus dans l’incertain et que le sort de Laprée semble scellé à et par ses propres appréhensions, la tonalité du récit est à nouveau inversée, Laprée reprenant finalement ses esprits pour se remettre en action :
« [ Pauvre Laprée exposé au danger, seul et sans amour…] Au bout d’un moment, il fut dégoûté de se dégoûter. Il pensa à Odile : il rêva qu’elle était innocente et qu’elle l’aimerait. Il retrouva un peu de courage. Les phosphorescences marines éclairèrent mieux la scène, un grillon lança sa stridence familière, et tout à coup l’île devint son alliée. Il se sentit nu, non plus comme un cadavre qu’on va laver, mais nu comme on l’était au paradis. »[798]
Libéré de ses peurs d’enfant, supplantées par de plus légitimes craintes d’aventurier, Laprée reprend son rôle d’homme d’action que rien n’arrête, le nouvel éclairage de la scène l’invitant à endosser un rôle mieux adapté à sa fonction aussi bien qu’au cadre générique de l’intrigue. De nouveau au service de l’enquête, Laprée part en quête d’indices sonores, visuels, à l’affût du moindre signe susceptible de l’éclairer. C’est alors que « l’idée saillit brusquement » : sur les lieux du meurtre, soumis à la « mise en scène de [s]on ennemi »[799], Laprée réalise qu’un autre meurtre se prépare. Tandis qu’il craint alors pour la vie de son coéquipier, il est violemment assommé ; de quoi maintenir la tension du récit, puisqu’ainsi neutralisé, l’enquêteur, après avoir suggéré l’existence d’une menace sérieuse pesant sur son coéquipier, le prive de tout secours possible. De fait, après avoir sombré « dans une nuit plus obscure que celle qu’il venait de quitter »[800], Laprée revient à lui. La tension qui régnait la veille sur l’îlet Cahouanne s’est certes atténuée, mais le suspense créé autour du récit de la scène se voit, quant à lui, maintenu. Le lecteur ignore, en effet, ce qu’il est advenu des deux enquêteurs ; c’est l’occasion, pour le scripteur d’user de l’ascendant établi dès lors sur le lecteur. Légitimé, en quelque sorte, par l’état comateux de Laprée (« Ses yeux se réveillèrent longtemps avant sa conscience »[801]), le narrateur procède alors par « visions » :
« Il
aperçut, loin sur la blancheur de la mer, trois fleurs oranges qui dérivaient
vers lui. Elles l’intéressaient prodigieusement. Les anges bienveillants de la
mort venaient le chercher, et il se sentait content. Un long moment, un courant
oblique sembla éloigner ces créatures de la côte. Elles sortirent même de son
champ de vision, et c’était pire que mourir. »[802]
Tandis que Laprée délire et que le lecteur s’imagine que le héros est peut-être en train de mourir, un nouvel éclairage vient baigner la scène :
« Le
soleil naissant lui blessa la nuque de ses feux. Et il montra les fleurs
oranges pour ce qu’elles étaient : trois femmes qui nageaient dans des
gilets de sauvetage. »[803]
Alors que les visions se précisent, Laprée retrouve ses esprits et, par la même occasion, le cours de l’action reprend ; les bras s’activent autour de l’enquêteur qui finit par comprendre :
« Il reconnut près de l’eau l’endroit où ils avaient découvert le cadavre de Beudry. Et il vit clair comme le jour, maintenant éclatant, ce qu’il craignait : un troisième plongeur à genoux se penchait sur Mozar. Un filet emprisonnait celui-ci jusqu’aux cuisses, et l’eau profonde clapotait autour de lui. »[804]
Notons cependant que si Laprée voit désormais clair, le lecteur, quant à lui, demeure encore quelque peu dans l’incertitude, le narrateur choisissant de procéder de manière elliptique. Le lecteur aura, plus tard, la confirmation que Mozar a été tué, mais le narrateur, en se contentant de suggérer cette mort, ne lui livre aucune certitude et le laisse en proie à un « pressentiment » pesant. Soumis à la perception subjective de l’enquêteur, le mode du récit se fait par là même fluctuant, et si Laprée a l’impression de n’être qu’un acteur du scénario mis au point par le criminel, le lecteur, quant à lui, ne peut que subir la mise en scène orchestrée par le détenteur du récit du crime, dont l’enquêteur se fait le complice.
En outre, de même que Laprée comprend rapidement qu’il fait partie d’un scénario, le lecteur se trouve dès l’ouverture confronté à toute une série de « ressorts » coutumiers de la forme policière, participant de l’effet de mise en scène traditionnellement développé par le genre. Alors qu’il est invité à une réception chez la future victime, Laprée aperçoit ainsi une substance étrange au fond de son verre, imaginant qu’on a peut-être glissé un sédatif dans sa boisson ; il est, par ailleurs, témoin d’une conversation compromettante, annonçant un crime prochain ; il est surpris, encore, par un coup de feu, quelques minutes après que son hôte ait déclaré, en plaisantant, avoir de nombreux ennemis susceptibles de vouloir le tuer. Ces différents indices fonctionnent comme autant de ressorts bien tendus, mais finalement provisoirement abandonnés -puisque le meurtre sera commis ailleurs et sans Laprée- qui ne servent en rien la progression de l’intrigue, mais qui déterminent un contexte énonciatif bien ciblé.
En effet, la fiction policière s’installe ici d’emblée au cœur d’un système, d’un modèle aux rouages bien huilés, et elle le fait explicitement, ironiquement et avec provocation. Il s’agit d’attirer l’attention du lecteur et de l’inviter à ne pas tirer de conclusions hâtives au moindre signal du récit : la poudre blanche dans le verre n’est sans doute qu’un éclat de pierre[805] ; la conversation compromettante surprise n’est peut-être que le fruit de l’imagination d’un enquêteur rêvant de jouer les héros[806] ; enfin, le coup de feu s’avère être vraisemblablement accidentel. La méfiance du lecteur aiguisée à l’égard de la subjectivité du récit, le narrateur peut alors plus légitimement conserver la perspective offerte en focalisation interne, intégrant sans retenue ni distance, les différents témoignages recueillis par Laprée. Confronté à la subjectivité du récit, le lecteur se fait le récepteur des pensées « vraies » des personnages, en même temps que le spectateur de leur représentation sincère ou falsifiée, au sein du récit de l’enquête que Laprée tente de reconstituer. C’est ainsi que le lecteur se retrouve pris, d’une certaine façon, au cœur d’un double récit : celui de l’enquête menée sur le crime, focalisé sur la perception de l’enquêteur -ce que Laprée voit, pense, déduit- et celui livré en contrepoint par le scripteur offrant une perspective kaléidoscopique, portée par la multiplicité des points de vue proposés. Aux yeux du lecteur, l’information narrative prend, en ce sens, la forme d’un jeu de miroirs, déclinant un même objet selon des distances et des perspectives différentes.
Avec son roman intitulé Qui a tué le béké de Trinité ?, G. Cabort-Masson met également en évidence cette forme de construction kaléidoscopique permise par le cadre de la fiction policière.
Bien que le titre de l’ouvrage oriente la lecture vers le cadre policier, le crime annoncé n’intervient que tardivement dans le récit -à la page 148-, retardant dans le même temps l’intervention de la « tête pensante » censée répondre à l’interrogation posée par le titre. Dans l’attente du point de départ du récit policier à proprement parlé, le lecteur assiste ainsi à l’exposition des éléments constitutifs de l’énigme policière à venir ; une exposition qui s’étend finalement progressivement en une anticipation, pour le lecteur, du crime pressenti voire espéré par les différents protagonistes. Tout en nous livrant différents renseignements « pratiques » sur les personnages -identité, histoire personnelle, rôle au sein de l’habitation-, le récit retrace quelques épisodes marquants de la vie de chacun, éclairant en quelque sorte leur profil psychologique, pour finalement nous livrer leurs impressions sur ce que presque tous considèrent comme la dernière journée du « béké de Trinité ». La retranscription de ces impressions illustre tout particulièrement la perspective kaléidoscopique précédemment évoquée.
En livrant sa propre perception de ce qui fut la dernière journée du « béké », chaque personnage offre, en effet, différentes perspectives d’une même scène, d’un même événement. Il en est ainsi, notamment, de « l’incident » qui se produit alors que Michel (propriétaire de l’habitation et future victime) et Amédée (amoureux de Judith, la maîtresse forcée de Michel), rejoignent un îlet où tout le monde les attend pour un pique-nique, à bord d’un canot qui chavire subitement.
La première « description » de la scène nous parvient de Bernadette. Tandis qu’elle rêve de voir mourir Michel (« Qu’il meure ! Cet homme entre elle et sa Marie Josèphe »[807]), Bernadette se livre à un délire fantasmatique où elle s’imagine être une pieuvre, envoyant ses « gigantesques tentacules balsamiques »[808] happer le canot où se trouvent les deux hommes, pour l’entraîner dans les profondeurs de la mer. Alors que Bernadette se retrouve « éblouie »[809] par cette vision de bonheur, la réalité vient étrangement rejoindre le fantasme :
«
Malgré elle, sa bouche dicta la condamnation en hurlant : ils ont
coulé ! Immédiatement, elle fut convaincue ; elle revoit la
scène : Amédée s’est dressé. Qu’avait-il vu ?
Déséquilibrée, la barque chavira quille en l’air. Rien ne bouge, personne. Puis la barque est retournée, les têtes émergent, les deux hommes se hissent dans le canot.
Quand
elle les sentit tous agglutinés autour d’elle, alors vers Marie Josèphe et
Judith, elle laissa tomber : “Amédée a voulu noyer Michel”. La victime
expiatoire était désignée. Elle n’était que l’instrument. »[810]
Le récit fantasmé laisse place, semble-t-il, au récit mimétique décrivant la scène telle qu’elle se produit sous les yeux de Bernadette et non plus seulement dans son esprit. Le pragmatisme de Bernadette prend alors le dessus sur ses désirs : son rêve a trouvé écho dans la réalité ; elle le concrétise aussitôt par la parole, avant d’en faire un élément déterminant pour la suite de son plan d’action. Si ses intentions s’avèrent être relativement claires -Amédée ferait un bouc-émissaire idéal-, sa perception de l’évènement demeure quant à elle encore quelque peu confuse, ainsi que le confirme la suite du récit :
« Peu
à peu Bernadette se soumit au mouvement perpétuel de la mer. La vague se tasse,
monte, tire en elle, contractée, la puissance de l’océan. […] Ainsi va le
pouvoir, et ma vie songea Bernadette, à moitié assoupie.
Le
soleil brûlant l’obligea à sortir de sa transe. »[811]
Focalisé sur un personnage en demi-sommeil et même en transe, le récit qui vient d’être fait prend alors une nouvelle tournure aux yeux du lecteur, et ce, d’autant mieux que l’incident n’est plus évoqué dans les paragraphes suivants et que les autres personnages se comportent comme si de rien n’était. Bernadette aurait-elle rêvé d’un bout à l’autre de la scène ? Le lecteur demeure dans l’incertitude jusqu’à ce que l’incident soit à nouveau évoqué par un autre personnage, Judith :
« Il y a à peine une heure, elle achevait de mettre les herbages dans la soupe quand madame Bernadette a crié, ils ont coulé ! On s’est tous rassemblé sur un coin de la plage au risque de faire basculer l’îlet. Au large, dans le bleu profond, loin de la barre des brisants on voyait le canot retourné, écale en l’air, rien à côté, personne. »[812]
Elle ajoute, comme si elle répondait à une question l’invitant à confirmer la vision/version de Bernadette -question que pourrait se poser le lecteur :
« Non, madame Bernadette ne pouvait rien voir d’ici, c’est son cœur qui a vu l’accident et c’est pour ça que je la crois. Mon cœur me dit qu’Amédée est maintenant capable.»[813]
Comme sollicitée par un enquêteur invisible, Judith donne sa version de l’histoire, en mettant l’accent non sur l’incident en lui-même auquel elle n’a pas assisté, mais sur ce qu’elle a vu une fois le canot renversé. Tandis que la vision de Bernadette se voit plus largement focalisée sur le moment qui a précédé l’incident, la version de Judith se porte sur la validité du témoignage de Bernadette et plus précisément sur l’accusation portée contre Amédée ; une accusation accréditée par Judith qui, si elle n’a rien vu, demeure néanmoins persuadée de la culpabilité d’Amédée, guidée en cela, comme Bernadette a pu l’être, par ses désirs les plus ardents. C’est alors qu’une nouvelle version intervient, quelques pages plus loin, focalisée cette fois-ci par le point de vue de Marie-Josèphe, l’épouse de Michel :
« Elle
entendit alors hurler Bernadette. Ils ont coulé ! Toutes les bestioles de
l’îlet se groupèrent autour de la Tante. Il n’y avait rien à voir sinon un
canot renversé. Puis Michel et Amédée grimpèrent dans le canot.
Elle
reçut un coup dans les côtes, le coude de Bernadette.
-Tu
as vu ? Amédée, j’en suis persuadée, a fait exprès.
Elle
foudroya Judith du regard comme si Judith en était responsable.
Péniblement,
les hommes arrivèrent, leur canot halé par Fernand. Michel […] se pencha vers
sa femme :
-
Si Amédée n’était pas là, le veuvage t’irait bien ma p’tite Jo.
Là,
Jo haussa l’épaule. Le moment de plaisanter… Evidemment que le veuvage m’irait
bien et le plus tôt serait le mieux… »[814]
Globalement, la version avancée par Marie-Josèphe est identique aux deux autres, mais là encore, l’attention glisse davantage vers l’après-incident, chaque nouveau témoignage permettant au lecteur d’avancer un peu plus dans le déroulement de la scène. L’intervention directe de Michel permet, en outre, de dédramatiser la portée de l’incident qui de « tentative de meurtre » redevient simple « accident ». Une nouvelle réponse potentielle à l’interrogation posée par le titre apparaît, par ailleurs.
Ces trois versions d’un même événement, ces trois récits modalisés selon des perspectives différentes, convergent vers une même perception d’ensemble, mais racontent finalement tous des histoires différentes. La première histoire est celle d’une femme haineuse et névrosée, ayant en tête le projet de tuer ; la deuxième concerne une femme amoureuse vivant dans l’espoir d’être libérée, par son « chevalier », du droit de cuissage exercé par son « employeur » ; la dernière est celle d’une femme un peu terne, espérant qu’une main bienfaitrice se charge de faire disparaître son époux encombrant.
La véritable histoire ou plus exactement le récit de la vérité, intervient finalement une trentaine de pages plus loin, sous l’impulsion du commissaire Lesveque, obtenant en quelque sorte les aveux d’Amédée concernant cette tentative de meurtre avortée. S’en tenant au récit des faits, Amédée retrace le déroulement des évènements : il a pris le canot avec Michel, s’est dressé brusquement pour faire chavirer l’embarcation volontairement, dans le but de noyer son employeur, le sachant mauvais nageur ; lié affectivement à Michel, il s’est finalement résolu à le repêcher.
Avant d’obtenir la vérité, le lecteur a donc été confronté à différentes versions, portées par différentes « visions », assujetties à la subjectivité de chacun, elle-même constitutive du rôle attribué à chaque personnage au sein de la fiction. Nous observons donc que la modalisation énonciative participe de la lisibilité du texte, les personnages imprimant leur spécificité, voire leur « identité », au cœur même du récit. Dans le cadre du récit policier, où la régulation de l’information se voit entièrement régie par la volonté d’en dire le moins, tout en donnant l’impression d’en dire le plus, cette lisibilité ne manque pas de se faire visibilité. Dans l’attente de révélations et d’actions, le lecteur de roman policier est en fin de compte littéralement pris en charge par le récit multipliant les effets de mise en scène, lui donnant à voir plus que l’invitant à lire.
2.2.2- Dimension spectaculaire et « visibilité »
du récit
Dans le cadre d’un récit tendu vers la recherche d’une réponse attendue par un lecteur dont la curiosité a été éveillée dès l’ouverture, la modalisation de la narration paraît déterminante en ce qu’elle paraît susceptible d’influencer le lecteur ; en effet, confronté à un récit où le soupçon est de rigueur, le lecteur peut néanmoins demeurer influençable car entièrement soumis au désir de savoir.
Dans le roman de F. Chalumeau, la régulation de l’information narrative, concentrée sur la perception de l’enquêteur, mime en quelque sorte les soubresauts, les incertitudes, les fulgurances de l’enquête, arrimant le lecteur à un système énonciatif procédant en focalisation interne. Or, Laprée présente la particularité de donner parfois l’impression d’une certaine indépendance à l’égard du projet scriptural. Tout en jouant son rôle d’acteur de fiction policière à la perfection -il s’offre même une happy-end des plus banales, dans les bras d’une suspecte innocentée- Laprée semble, en effet, parfois déchirer la toile de la fiction, invitant le lecteur à repérer la présence du scripteur en amont du récit.
Il ne cesse, en ce sens, de rappeler ironiquement l’existence d’un scénario réglant ses moindres faits et gestes ; son enquête vient, en ce sens, perturber un tournage de cinéma, Laprée expliquant à l’acteur vedette furieux :
« Ne vous en faîtes pas, mon vieux. C’est dans le scénario. »[815]
Tandis que « l’assistance agglutinée » hésite « entre fiction et réalité », l’acteur intrigué s’enquiert alors du nom du metteur en scène :
« Jean-Pierre
Hasard, répondit l’autre en se détachant. »[816]
Notons que cette réplique fait écho à la citation de Jack London, apposée en épigraphe du roman :
« Le monde, un chaos de violence effrénée régi depuis toujours par la seule loi du hasard, dispensateur aveugle des chances et des malchances. »
Si le hasard peut être désigné comme étant à l’origine du déroulement des évènements de la vie, dans le récit, il n’est autre que le produit d’une mise en scène entièrement régie par le scripteur. Or, une des particularités de la fiction policière consiste en ce que l’organisation du récit trouve sa représentation au sein même de l’intrigue : dans le roman policier, la mise en scène régissant le récit se dissimule sous une autre mise en scène, élaborée cette fois-ci par l’enquêteur. Dans un article intitulé « Portrait de l’artiste en policier », Alain-Michel Boyer relève les différentes connections pouvant s’établir entre le travail de l’écrivain et le rôle joué par l’enquêteur au sein de l’intrigue, attribuant à ce dernier un rôle de scripteur :
« L’enquêteur,
en combinant les éléments du “matériel”, le transforme. Dans son patient
travail d’agencement, il s’astreint, le plus souvent, à des hypothèses, des
suppositions, d’incessants remaniements qui ajoutent des énoncés sans annuler
ceux qui précèdent : autant de simulacres de récritures. Autant d’essais
successifs de “rédactions” qu’il ne biffe pas toujours. »[817]
Rapprochant les hésitations, les bifurcations ou encore les erreurs de l’enquêteur à la recherche de la vérité, des ratures de l’écrivain, il ajoute :
« Le
policier ne cesse de corriger, de vérifier les détails, d’ajouter des
développements, de choisir une voie plutôt qu’une autre, de reprendre, comme un
auteur, le schéma narratif qu’il dessine, de l’accroître de quelques
personnages -soudain frappés de suspicion-, de l’amputer d’un autre, et chaque
apport nouveau, chaque modification s’apparente à une variation sur le même
thème, jusqu’à ce qu’il ait trouvé l’ “expression” adéquate. »[818]
Comme nous l’avons souligné précédemment, de même que le scripteur ne se contente pas d’écrire, mais de mettre en scène son écriture -les modalisations du récit participant notamment de l’éclairage de la scène, orientant la perception du lecteur/spectateur-, l’enquêteur se livre à son tour au jeu de la représentation. Prêt à tout pour découvrir la vérité, il se fait acteur, notamment lorsqu’il mène les interrogatoires, modulant son jeu en fonction des personnalités auxquelles il est confronté, forçant la voix, bluffant ou se montrant charmant, pour impressionner, déstabiliser ou encore mettre en confiance. Se considérant seul maître à bord face à tous ces suspects potentiels, il se fait encore metteur en scène, déterminant fermement les orientations de l’enquête. Il assume enfin superbement ces deux fonctions de concert, au moment du dénouement et de la reconstitution finale, dont la théâtralité est notamment soulignée par Marie-Hélène Huet :
« L’enquête
ne consiste pas exclusivement à reconstruire patiemment ce crime auquel il n’a
pas été donné au lecteur d’assister. Elle conduit, de façon tout aussi
méthodique, à remplacer la scène secrète du crime par sa re-présentation publique ; représentation qui peut prendre la
forme d’un discours, d’une mise en scène plus ou moins dramatique, mais qui
garde toujours quelque chose de théâtral en ce que, cette fois-ci, le meurtre
n’est pas commis, mais récité ou joué. Triomphe paradoxal de l’illusion au
terme d’une investigation rigoureuse, cette conclusion restaure l’acte même
dont le roman avait été privé, met le lecteur et les personnages innocents en
position de spectateurs disculpés, et désigne le meurtrier comme l’acteur
principal du drame. »[819]
Dans le cadre de récits exploitant largement le principe de la surenchère vis-à-vis de la forme policière traditionnelle, comme c’est le cas de la plupart des romans de notre corpus, ce jeu de la représentation prend une résonance toute singulière, en étant notamment susceptible de se fondre dans la caricature. A travers le personnage de l’enquêteur, nous remarquons, en effet, que la plupart des romans qui nous intéressent ne se livrent pas à une production de fiction policière, mais bien à une reproduction de la forme. A cet égard, certains enquêteurs mis en scène conçoivent leur fonction et composent en quelque sorte leur propre rôle, en prenant pour modèle quelques références connues de la fiction policière romanesque, cinématographique ou télévisuelle. Au niveau du roman, cette perspective relève de l’intertextualité et, au sein de l’intrigue, elle confère aux personnages d’enquêteurs un statut quelque peu ambigu. Il s’agit souvent, pour les personnages eux-mêmes, de souligner par contraste leur vraisemblance vis-à-vis des modèles de fiction ; or, paradoxalement, bon nombre d’entre eux semblent s’être orientés vers le métier de policier, en ayant eu à l’esprit une représentation de leur fonction inspirée des modèles de fiction. En outre, si quelques-uns sont rattrapés par la « réalité » -l’adjoint du commissaire Llob, Lino, confronté à la situation algérienne, ne tarde pas à comprendre que le rôle qu’il s’était imaginé jouer en devenant policier, sous l’influence des séries télévisées américaines, n’a pas lieu d’être- d’autres, au contraire, tendent à se perdre, avec la complicité du scripteur, dans le jeu de la représentation, l’enquête devenant le théâtre de leurs débordements spectaculaires.
Bouaffesse et ses hommes ou encore l’inspecteur Ali -notamment dans la trilogie consacrée à ses enquêtes en solo-, s’engagent à offrir au lecteur un spectacle garanti ; spectacle dont participe, par exemple, outre ses écarts comportementaux habituels, la quasi érotomanie dont semble « souffrir » l’inspecteur Ali. Si la dimension spectaculaire développée par D. Chraïbi se combine avec un certain goût pour la provocation, elle est abordée dans une perspective plus proprement théâtrale, dans le roman de P. Chamoiseau : quand Ali se donne en spectacle, les enquêteurs mis en scène par P. Chamoiseau font le spectacle, et plus précisément « font le cirque », un peu malgré eux.
Confiée à la perspicacité de policiers névrosés et primaires, l’enquête mise en scène dans Solibo Magnifique s’adapte, en quelque sorte, à l’atmosphère délirante créée autour de la dépouille du conteur, proposant des rebondissements non pas simplement stupéfiants, mais bel et bien spectaculaires. Il en est ainsi du branle-bas de combat déclenché autour des fourmis-manioc de Guadeloupe, venues sillonner le corps de la victime (« Bondié ! la fourmi-manioc ne se trouve qu’en Guadeloupe !… »[820]) ou encore du « cirque » joué autour de la levée du cadavre :
« Veut
pas partir, chef, chevrotaient-ils, l’est plus lourd que l’usine de Robert, si
on le soulève on perd nos graines…
D’un
bref coup de sifflet, Bouaffesse fit venir en renfort Jambette,
Diab-Anba-Feuilles et Bobé. Mais Solibo pesa une tonne et demie. Il appela les
deux gardiens de la barrière. Mais Solibo pesa deux tonnes. Il rameuta un des
cars : les policiers s’entassèrent au-dessus du cadavre, se battant pour
une prise. Mais Solibo pesa cinq tonnes. »[821]
Défiés, en quelque sorte, et invités à participer à la dernière représentation du conteur -comme les écoutants du conte sont sollicités par le conteur pour lui donner la réplique-, les policiers entrent alors dans le jeu :
« Diab-Anba-Feuilles
qui se disait né coiffé de son placenta (donc inaccessible aux diableries)
donna les directives : Les pieds d’abord, tirez en zigzags, bon, récitez
le Notre Père et tirez vers la gauche, bon, heu, qui n’a pas été baptisé ?
ceux qui n’ont pas été baptisés reculent à treize mètres et croisent leurs
doigts. Un, deux, trois : saint Michel !… Bon, hum, on va imaginer
que c’est une igname. Prêt ? allez… Bon, qui a de l’eau bénite ?…
L’arrivée de l’inspecteur principal interrompit leur ahan, et, estébékoué,
s’associant aux efforts vains jusqu’à l’épuisement, Evariste Pilon redécouvrit
(in situ) un des mystères de par ici. »[822]
Ces nombreux rebondissements confèrent aux lieux du crime des airs de théâtre de Guignol et semblent rythmés par « une des expressions favorites [de Bouaffesse], celle qui, rebelle à toute traduction, associe vertigineusement les sommets et les abîmes philosophiques : Andjèt sa, pito ! »[823], pouvant faire écho, dans le cadre de la fiction policière, à la toute aussi énigmatique réplique « Bon sang mais c’est bien sûr ! ». Notons cependant que tandis que cette dernière réplique, tout en ne signifiant rien littéralement, signale clairement au lecteur que le détective a trouvé la clé de l’énigme et qu’il ne saurait tarder à faire ses révélations, l’expression de Bouaffesse, « rebelle à toute traduction » indique, à l’inverse le désarroi du policier et le chaos dans lequel l’enquête semble irrémédiablement plongée. Il s’agit-là, en outre, d’associer la confusion ambiante à une problématique d’ordre linguistique, ce qui n’a rien d’anodin dans la mesure où la question linguistique participe, dans la représentation proposée par P. Chamoiseau, de l’incompréhension et des conflits générés au sein de la société antillaise et sévissant notamment entre francophones et créolophones. Elle constitue, de ce fait, un terrain de choix propice aux affrontements, quiproquos et autres situations favorisant l’effet visuel de certaines scènes.
S’enlisant dans la confusion, le roman de P. Chamoiseau utilise en effet la question linguistique comme source de conflits et par là même comme ressort de l’intrigue.
Ainsi, Congo ne comprend pas le français, ce qui irrite les enquêteurs et le met, par conséquent, en danger ; Bête-Longue ne comprend guère mieux les questions qui lui sont posées ; Bouaffesse ne maîtrise pas vraiment la pratique de la « langue de l’officialité » ; Pilon a, quant à lui, besoin d’un traducteur pour interroger les suspects. L’usage de la langue devient donc problématique ici, alors qu’elle représente un vecteur essentiel de l’enquête menée traditionnellement dans le roman policier, où l’enquêteur peut être perçu comme le « maître des langages auxquels il impose son langage »[824].
Dans le roman policier, le détective adapte son langage en fonction de ses interlocuteurs : son objectif consiste à obtenir des résultats, autrement dit à établir une bonne communication. Parallèlement, l’énonciation tente, quant à elle, de séduire le lecteur et d’établir une certaine connivence avec lui. Cette connivence passe, dans la variante noire du genre notamment, par une « mise en argot du texte », afin d’approcher le lecteur au plus près, comme le suggère notamment Claude Gaugain :
« Le
roman policier voudrait recréer l’illusion du reportage en direct grâce à un
recours à la langue parlée qui jusque-là n’appartenait guère au domaine du
livre. C’est le but de cette mise en argot du texte. L’argot, généralement très
compréhensible, n’est pas le langage hermétique du milieu, son rôle semble
plutôt de nier la substance du livre et d’ébaucher une sorte de roman parlé.
Parole feinte qui travaille à se faire oublier comme écriture et littérature.
Cette généralisation du langage parlé ne tend d’ailleurs pas à toucher un
public populaire -La Série Noire, des enquêtes l’ont montré est surtout lue par
des intellectuels. Elle tend surtout à établir un contact “direct” avec le
lecteur, à lui faire oublier qu’il lit un roman à cause de la connivence que le
langage parlé établit. Le roman devient donc plus réaliste parce que par
l’utilisation du langage parlé, il échappe à tous les préjugés sur la chose
écrite. Le roman, empreint de relents littéraires, pouvait n’être qu’un roman
né de l’imagination. Le roman policier présenté comme roman parlé ne pourra
être qu’un roman du vécu. »[825]
« Nier la substance du livre », « ébaucher une sorte de roman parlé » : n’est-ce pas là justement un des objectifs majeurs visés par les auteurs de la créolité, avec notamment, chez P. Chamoiseau, la mise en scène du « marqueur de paroles », passeur entre l’oral et l’écrit ?
Il nous semble intéressant de nous référer ici à une définition du « marqueur de paroles », proposée par Xavier Garnier, dans l’ouvrage intitulé Littérature francophone :
« Un
marqueur de paroles n’est ni un auteur, ni un narrateur mais un médium qui veut
“serrer les mots pour qu’ils collent à la langue”. Exit le narrateur qui met en
récit des actions, le marqueur de paroles tente de ramener les mots à la chair
du réel. Le récit cède le pas au tableau vivant. Le roman capture le réel brut,
sans le configurer. »[826]
Un objectif similaire est également repéré dans la démarche littéraire de Raphaël Confiant :
« C’est
ce même refus de configurer le réel qui caractérise la démarche de Raphaël
Confiant. La société créole dont Confiant veut rendre compte est exubérance,
débordement, dérèglement. Le roman créole ne sera ni construit ni structuré. Il
sera conçu comme un amalgame d’anecdotes hétéroclites, impliquant une
multiplicité de personnages hauts en couleur, qui sont le point d’ancrage de la
création romanesque de Confiant. […] Les personnages de Confiant n’existent que
dans la mesure où la parole publique leur a donné une visibilité : c’est
la rumeur publique qui fait à la fois exister les personnages et les anecdotes
qui les concernent. Le liant qui permet à ce foisonnement de récits de prendre
corps est l’intense mise en circulation de la parole par la rumeur populaire.
D’où le penchant de Confiant pour la caricature, l’effet de grotesque. Le réel
antillais est gonflé par la parole créole qui est toujours une parole publique,
plurielle, circulante. »[827]
Si le propos développé par X. Garnier nous semble globalement vérifiable, certaines de ses remarques mériteraient néanmoins d’être nuancées. La volonté des créolistes est vraisemblablement de donner l’impression que le « roman capture le réel », que la parole circule librement, qu’elle mène l’intrigue en même temps que le récit. Par ailleurs, le récit proposé par les créolistes est certes entièrement soumis à la prolifération de la parole, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il « cède le pas au tableau vivant ». L’exubérance, le débordement et le dérèglement participent non tant du réel antillais que de la représentation qui en est faite ; une représentation relevant à certains égards du folklore, si bien que le réel antillais nous apparaît non pas vivant, mais bien figé au sein d’une représentation orientée, fortement caractérisée, voire caricaturale. Autrement dit, si la peinture proposée offre une grande diversité de couleurs ainsi qu’une perspective en relief, l’objet de la représentation -le réel antillais- n’en demeure pas moins « configuré », c’est-à-dire, en l’occurrence, créolisé. Précisons, en ce sens, que le « réel brut » ne peut être capturé ou tout simplement perçu qu’à travers une représentation, permise par le recours à une énonciation. Or, l’énonciation proposée par les récits des créolistes se veut désorganisée et débordante -pour ce qui est du système narratif-, bruissante, créative, sensitive et, à certains égards, hypnotique -en ce qui concerne la langue en elle-même. Aussi déstabilisante et chaotique qu’elle puisse paraître, elle répond néanmoins à un projet, à un système, à une modalisation et par conséquent à une configuration. En ce qui concerne les écrits de la créolité, nous pourrions même parler de sur-configuration tant la réception du lecteur paraît conditionnée au sein même du texte, notamment par le recours systématique aux néologismes ou encore aux barbarismes, qui offrent, d’une certaine manière, une visibilité textuelle à la créolité. De même, la parole populaire, avant de pouvoir faire exister les personnages, est rendue visible au sein du texte. Le recours au discours métaleptique, visant à interpeller le lecteur directement («Mais d’abord, ô amis, avant l’atrocité, accordez une faveur : n’imaginez Solibo Magnifique qu’à la verticale »[828]) participe de cette « mise en visibilité » de la parole au sein de l’énonciation.
Plus loin, Xavier Garnier ajoute :
« Le
projet ambitieux des romanciers de la créolité passe d’abord par un travail sur
le style qui tend à retrouver le bruissement de la langue créole. Le danger que
nos auteurs jusqu’ici parviennent à éviter avec talent est celui du procédé
stylistique. Tant que les romanciers de la créolité verront dans le style un
processus et non un procédé, ils prolongeront une quête musicale qui remonte
loin dans le roman caribéen et dont l’enjeu est de capter les harmoniques d’un
monde pluriel. »[829]
Si les auteurs de la créolité tentent, dans l’absolu, de « capter les harmoniques d’un monde pluriel », au sein du texte cette tentative se manifeste concrètement, voire lourdement, les « harmoniques » étant plaqués en quelque sorte sur les mots ; il en est ainsi, par exemple, de la systématisation de la suffixation en « -ure ».
Les auteurs de la créolité ne captent pas seulement les harmoniques d’un monde pluriel, ils les signalent et en impriment la langue si bien que, dans ces romans, le visible finit par prendre le pas sur le lisible. L’observation du processus de la créolisation se fait tellement pesant sur le texte, sur l’organisation du système énonciatif ou encore sur la représentation du réel antillais, qu’il semble finalement relever du procédé, et ce, d’autant mieux que le mode opératoire choisi par le scripteur créoliste -la typologie des personnages, le contexte, le système énonciatif- se répercute d’un roman à l’autre ; l’écriture de P. Chamoiseau ou de R. Confiant est reconnaissable en quelques lignes, familière d’une certaine façon et néanmoins étrangère, aussi bien à un lecteur francophone que créolophone. Séduisant ou déplaisant, cette langue de l’écrit interpelle le lecteur, signifie au-delà même du récit, transpire sa créolité ; elle ne sert pas l’intrigue, elle l’accompagne, la dépasse, la surplombe et, d’une certaine manière, elle lui fait de l’ombre, dépassant les limites imposées originellement par le genre policier, si l’on en croit P. Boileau et T. Narcejac :
« L’histoire policière ne vaut plus que par la richesse de l’invention. C’est l’invention, et non plus “l’écriture” qui fait le style. Qu’elle vienne à faiblir et la platitude menace. Qu’elle reste vigoureuse et l’écrivain, même maladroit […] continue de nous captiver. Le style du roman policier est un style de pensée. Il tient moins à la forme qu’au fond. »[830]
Précisons que cette remarque de Boileau-Narcejac nous paraît d’autant plus contestable que le genre policier a rapidement fait preuve d’une certaine « perméabilité langagière »[831], créant des effets de lecture qui, au sein de notre corpus, se manifestent diversement.
Ainsi, Beate Bechter-Burtscher souligne la proximité établie avec le lecteur dans les romans de Yasmina Khadra, par « la langue dont Llob se sert, langue pleine d’humour, souvent ironique et aussi argotique, ne cachant rien »[832], tandis que Christiane Chaulet-Achour met en avant les difficultés pouvant survenir à la lecture du roman de Boualem Sansal, engendrées par un véritable « travail d’écriture » reposant sur « une recherche lexicale, un jeu sur des registres de langue divers, un usage de la doxa tournée en dérision, des trouvailles au carrefour de ce qui se dit quotidiennement en Algérie et des inventions de l’écrivain, qui impriment un cachet original à ce texte et font écran à ce qui est raconté de l’Histoire récente et actuelle »[833].
Qu’elle fasse écran à la perception des tenants et aboutissants de l’intrigue ou qu’elle en facilite et oriente l’accès, la langue -et par glissement l’écriture- « perméable », pratiquée dans le cadre du genre policier participe de l’entreprise de révélation/rétention de l’information pratiquée au sein de l’intrigue. Une telle entreprise est consubstantielle de la forme policière censée, d’une part, aiguiser l’intérêt d’un lecteur à l’affût du moindre indice susceptible d’éclairer sa quête de « vérité », tout en étant, d’autre part, orchestrée par un scripteur veillant à ne pas trop en dire. Alors que le genre policier donne l’impression de reposer sur un rapport de confiance s’établissant entre le scripteur et le lecteur, sa « réussite » dépend, en réalité, de la capacité du premier à leurrer le second ou encore de la manière dont le « texte en fonction » parvient à éclipser le « texte en fonctionnement ». Or, paradoxe du genre, ce simulacre n’a pas manqué d’être exploité par certains auteurs ayant choisi de pervertir la forme classique du roman policier, pour confronter le lecteur à sa propre crédulité, à travers des schémas tous plus surprenant les uns que les autres : le coupable est le narrateur ou encore l’enquêteur lui-même ; le crime n’en est pas un ; ou encore la solution finale s’avère être erronée voire occultée. Affichant les coutures, les ficelles du genre, quelques-uns de ces romans, tels Le Meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha Christie, ou Les Gommes d’Alain Robbe-Grillet, ont dès lors permis la naissance d’une nouvelle forme de roman policier et, par extension, d’une nouvelle forme de lecture, entraînant lecteur et scripteur au cœur d’un échange, voire d’un affrontement livré en terrain instable et placé sous le sceau de la méfiance, du soupçon.
II-
« L’ère du soupçon »
Nous reprenons ici, à dessein, le titre d’un essai de Nathalie Sarraute qui constitue l’une des premières manifestations théoriques de l’école du Nouveau Roman. Il nous paraît, en effet, intéressant d’éclairer la suite de notre étude à la lumière de quelques perspectives développées par les Nouveaux Romanciers.
Apparu au cours des années 1950, autour de quelques figures marquantes, tels Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute ou encore Claude Simon, le « courant » littéraire nommé « Nouveau Roman »[834] propose globalement une nouvelle manière de penser la littérature, de concevoir aussi bien l’écriture que la lecture. Selon Dominique Rabaté, « il s’agit de rompre avec le roman traditionnel, d’affirmer que la littérature doit, comme la peinture avant elle, éliminer ce qui ne lui appartient pas en propre »[835]. Les notions de personnage, d’histoire, d’engagement, de distinction entre forme et contenu ont été revisitées par les Nouveaux Romanciers appelant une mise en perspective de l’écriture. Dominique Rabaté précise :
« L’écriture
se met en scène dans les mises en abyme (retrouvant un geste gidien), dans la
monstration des procédés qui accentuent la spécularité narrative. Le rôle du
signifiant, des jeux sur les mots pour des enchaînements qui ne cherchent plus
à se dissimuler derrière le vraisemblable est ainsi revendiqué, à titres
divers. »[836]
Il s’agit d’une mise en scène de l’écriture dont semblent pouvoir se réclamer la plupart des auteurs de notre corpus. Il en est ainsi lorsque Larbi se demande s’il ne fait pas « flic de série », que l’inspecteur Laprée met en avant l’existence d’un scénario régissant le déroulement de son enquête, que Lino s’inspire des personnages de fiction policière pour « construire » son propre rôle, que P. Chamoiseau apparaît dans son roman sous les traits du « marqueur de paroles », que M. Condé, R. Confiant ou encore Y. Khadra mettent en scène des figures d’écrivain, qu’E. Pépin précise au lecteur, au terme du roman, qu’il n’est pas obligé de croire à l’histoire de l’homme-au-bâton ou encore lorsque T. Delsham et D. Chraïbi usent et abusent, sans aucune réticence, des ressorts les plus visibles et stéréotypés du genre. Il s’agit ici vraisemblablement de signifier au lecteur l’existence d’un envers du décor, de l’inviter à suivre, au-delà de l’intrigue développée au sein du récit, les procédés de mise en écriture de ce dernier ; il s’agit encore, conformément aux objectifs avancés par les Nouveaux Romanciers, de ne plus percevoir seulement « l’écriture de l’aventure », mais bien « l’aventure de l’écriture »[837].
Dans les romans de notre corpus, en effet, pratiquant le genre policier à l’excès -lorsque le crime et le mystère n’envahissent pas démesurément le récit, le manichéisme et le rationalisme l’emportent, de manière trop évidente pour que le lecteur y croie-, cette mise en avant des procédés d’écriture se fond dans une véritable mise à nu du roman. Débordée par l’intensité du réel référentiel, aussi bien que par la créativité exacerbée des différents scripteurs encouragés par la perméabilité langagière, stylistique et même formelle du cadre générique, l’intrigue censée capter la tension du récit en même temps que l’attention du lecteur, se voit en ce sens globalement évincée, dans ces romans, au profit d’un travail d’écriture témoignant de la présence textuelle d’un scripteur se refusant au devoir de discrétion traditionnellement imposé par le genre policier. Dans la plupart de ces romans, en effet, le scripteur se fait généralement remarquer, soit en amont d’un système énonciatif complexe, voire confus (polyphonie, perspective kaléidoscopique), soit au travers d’un parti pris revendiqué incitant l’adhésion du lecteur.
Complexifiant le système énonciatif, sur-modalisant le récit, travaillant la langue, jouant de la crédulité du lecteur, trompant ses attentes en se servant notamment de sa tendance à « typifier »[838], anticiper et parfois même à survoler le texte, les auteurs de notre corpus, sur le modèle des Nouveaux Romanciers, pénètrent le roman par une de ses voies les plus perméables, afin de ruiner tout espoir d’une lecture linéaire, confortable et d’une certaine manière « pré-mâchée ». Ainsi convié à faire coïncider lecture et enquête, le lecteur se trouve rapidement confronté à la certitude que ce que dit le roman se cache nécessairement sous ce qu’il raconte. Sur les traces du détective, il ne tarde pas, en effet, à comprendre la nécessité de vaincre l’illusion, de percer les secrets d’un récit tout entier constitué de faux-semblants. L’enquête policière de fiction laisse alors place à une mise en accusation du récit, donnant dès lors naissance au texte suspect.
1- Le texte suspect
Pour que le mystère perdure autour du crime et que le suspense gagne la lecture, la narration policière doit nécessairement être guidée par un énonciateur ne pouvant être qu’ignorant ou bien dissimulateur. Le but du récit consiste alors à faire taire cette voix qui ne sait pas ou qui dissimule, afin de la remplacer par celle du détective qui, au terme de l’enquête, détruira l’énigme par les mots. Dans l’attente du récit de la « vérité », la narration déficiente, que Uri Eisenzweig nomme également la « vacance narrative fondatrice »[839], suit les soubresauts d’une enquête soumise à une multitude de voix annexes, porteuses d’hypothèses nécessairement erronées ou partielles, de témoignages subjectifs, de mensonges et de révélations plus ou moins fiables. U. Eisenzweig évoque, en ce sens, la formation de métarécits venant se greffer et constituer le récit de l’enquête :
« Le
texte policier classique consiste ainsi en une structure d’enchâssement
narrative où le récit de l’enquête “contient”, pour ainsi dire, ceux des divers
personnages qui y apparaissent. Mais aussi, ces actes narratifs partiels, ces
métarécits seront essentiellement suspects, leur caractère douteux (ni évident
ni nécessairement faux) étant ce qui fonde et compense à la fois l’impuissance
du narrateur du récit tout entier. Or, nul événement ne devant, en principe, se
produire une fois la scène du crime décrite, le texte de détection n’est censé,
au fond, que présenter de tels métarécits. C’est-à-dire qu’il constitue un
ensemble narratif fondé quasi exclusivement sur le doute et la
suspicion. »[840]
Créant une sorte de flottement énonciatif, ces métarécits participent de la constitution globale du texte et entraînent le récit dans une oscillation permanente entre le dit et le non dit, le su et le tu, la vérité et le secret. De même que l’enquêteur traque la vérité en-deçà des paroles des témoins/suspects, le lecteur se voit confronté aux secrets du récit, étriqué entre le dit et le non-dit.
1.1-
Confessions
paradoxales
Engagé dans un processus d’élucidation, l’enquêteur de fiction policière se pose, de fait, en farouche ennemi de toute forme de secrets, qu’il s’agisse de banales cachotteries, de crimes passés, payés ou étouffés, d’affaires glauques dissimulées honteusement ou encore du secret suprême levant le mystère du crime pour lequel le fin limier a été réquisitionné. La perspective de la levée intégrale du secret s’associe, dès lors, logiquement à une mise en examen symbolique de tout individu lié de près ou de loin à la victime, autrement dit de tous les personnages mis en scène, chacun d’entre eux ayant, a priori, un rôle précis à jouer au sein de l’intrigue, les privant de toute présence anodine. Avant de pouvoir permettre la reconstitution du puzzle que constitue l’énigme, l’enquêteur doit ainsi pouvoir en rassembler les pièces visibles, mais surtout invisibles. Ainsi, comme le souligne Jacques Dubois :
« Détection
et déduction sont les temps forts d’un procès d’identification aussi efficace
que systématique. Dans ce procès, le crime est surtout prétexte à une rupture
du pacte de discrétion, de la règle de censure qui protège les vies privées. A
partir de quoi, chaque existence va être proprement suspectée, c’est-à-dire
tenue pour détentrice de quelque secret qu’il est bon de mettre au jour. »[841]
Ces « révélations de résistance » mettent en attente le lecteur et maintiennent une tension constante entre la parole et le silence, entre la vérité et le mensonge, entre la révélation et le secret.
1.1.1- Quand dire c’est taire[842]
La lecture d’un roman policier se combine automatiquement avec le désir non tant de comprendre -c’est là le rôle de l’enquêteur- mais bien de savoir. Ce savoir s’avère être nécessairement problématique au sein d’un récit dont la longévité demeure constitutive de la préservation du cœur de l’énigme. Le rôle des témoins se fait alors capital, comme nous l’avons suggéré précédemment, chacun offrant à l’enquêteur et par extension au texte, son propre récit, sa version des faits, ses informations comme autant de biais permettant de différer, tout en l’étayant, la révélation finale. Ce subterfuge, mis en place par le scripteur, place le récit au cœur d’une tension constante entre le dit et le non dit, ce que certains auteurs de notre corpus, désireux notamment de laisser paraître au premier plan les coutures du texte en une mise en abyme du récit, ne manquent pas d’exploiter.
C’est le cas, par exemple, de Maryse Condé qui, avec Traversée de la Mangrove, propose un récit récusant, dès les premières pages, toute parenté avec la forme policière, tout en nouant l’intrigue autour du caractère énigmatique de la victime. La manière de procéder de M. Condé semble indiquer ici que la nature de la mort importe finalement peu : ce n’est pas le crime qui fait le récit d’enquête, mais bien le maintien de la tension entre le su et le non su. Or, cette tension accapare véritablement le récit, si bien qu’à mesure qu’ils parlent, qu’ils se livrent, qu’ils nous renseignent, qu’ils ergotent sur la mort de Sancher, les habitants de Rivière au Sel se fondent un peu plus dans le silence, le récit qu’ils livrent au lecteur n’étant que la transcription de leurs pensées secrètes. C’est, en effet, en huis clos que le lecteur reçoit ces témoignages qui, s’ils libèrent les personnages de leurs pensées les plus pesantes, n’en constituent pas moins un frein à tout espoir de communication au sein de la communauté ; en outre, au terme de ces témoignages/confessions, bon nombre d’entre eux décident de quitter Rivière au Sel. Paradoxales par principe -ce qui est dit au lecteur est tu au sein de la communauté-, ces révélations sont de la même manière maintenues dans une constante tension entre le dit et le non dit.
Ainsi, au fur et à mesure que les personnages se livrent, les mobiles et désirs de meurtre se multiplient, tout en s’invalidant d’eux-mêmes. Par exemple, Aristide et Loulou s’exclament respectivement :
« Ce
n’est pas ainsi qu’il aurait dû mourir. C’est son sang, son sang qui aurait dû
couler au-dehors et venger ma sœur. »[843]
« Non,
non, non ! Ce n’est pas ainsi qu’il aurait dû mourir. Trop propre, trop
douce, cette mort ! C’est la cervelle à l’air, éparpillée jusqu’aux
lianes-trompette, le sang baignant les lichens et les mousses qu’on aurait dû
le trouver. Puisque ce sans-graine d’Aristide ne pouvait rien, c’est moi qui
aurais dû agir. Et je n’ai rien fait non plus. »[844]
Faisant état des intentions de meurtre des deux hommes, ces déclarations les disculpent, dans le même temps, de toute implication dans la mort de Sancher, le regret de ne pas avoir tué venant supplanter le désir de meurtre. Nous remarquons, en outre, que déplorant la douceur de cette mort apparemment naturelle, ces deux témoignages ne cessent paradoxalement de réactiver la thèse du meurtre, manifestement légitimée par la haine suscitée par la victime. Les regrets exprimés par Carmélien se font en ce sens plus ambigus:
« Aujourd’hui,
Francis Sancher était mort. Une main secrète avait accompli la vengeance à
laquelle sa lâcheté ne se décidait pas. Il n’aurait donc plus à soutenir son
regard ou à l’aveugler. La route était libre. »[845]
L’état d’esprit de Carmélien alimente encore le mystère de cette mort soudaine. Ainsi, la satisfaction éprouvée par le jeune homme face à la mort de Sancher répond explicitement à la question « A qui profite le crime ? », traditionnellement révélatrice du nom du meurtrier. Par ailleurs, l’évocation de l’existence d’une « main secrète » vient rappeler qu’un meurtrier se cache peut-être derrière cette mort suspecte. C’est ainsi que, comme le souligne Dominique Rabaté à propos de l’écriture du secret :
« A
mesure que tout se dit, tout reste à dire. Le secret révélé n’en finit pas de
secréter toujours plus de secret ! »[846]
Chaque nouvelle information apportée par le mystérieux Sancher sur son identité, son histoire ou encore ses projets, suscite paradoxalement toujours plus de questions :
« Je
m’appelle Francisco Alvarez-Sanchez. Si tu reçois des lettres à ce nom-là, ce
sont les miennes. Autrement, pour tout le monde ici, je suis Francis Sancher.
Compris ?
[…]
-Francisco
Alvarez-Sanchez ? Dans quel pays as-tu été chercher ce
nom-là ? »
« Que
faisait Francis ?
Il installa
une table de bois blanc sur sa galerie, posa dessus une machine à écrire et
s’assit derrière elle. Quand les gens, surpris et démangés par la curiosité,
arrêtèrent la camionnette de Moïse pour lui demander ce qu’il faisait là, ils
s’entendirent répondre que c’était écrivain. Ecrivain ? Qu’est-ce qu’un
écrivain ? » [847]
Il ne s’agit pas simplement, pour les habitants de Rivière au Sel, de savoir, mais de comprendre le sens profond de ce qui vient d’être révélé, en assignant l’objet du secret à leur propre système référentiel, la révélation devant nécessairement trouver sa place au sein du milieu l’ayant accueilli. Or, cette adaptation de l’objet du secret au contexte de la révélation pervertit l’essence et la véracité de l’information délivrée. Ainsi, les origines latino-américaines révélées par la consonance du véritable nom de Sancher, trouvent un sens dans le système référentiel de Lucien Evariste qui s’empresse de l’imaginer sous les traits d’un barbudo, ayant combattu dans la Sierra Maestra, aux côtés de Fidel Castro[848] ; ce sens greffé sur le secret révélé s’avère être erroné, Sancher ayant involontairement brouillé davantage les pistes en révélant sa véritable identité. De la même manière, la révélation de l’activité scripturale de Sancher fait l’objet d’une confrontation avec l’univers référentiel des villageois ; or, dans le morne retiré de Rivière au Sel, au milieu des années 1950, « la seule personne à qui on donnait ce titre [« écrivain »] était Lucien Evariste et c’était en grande partie par moquerie »[849]. Confrontés à une activité n’ayant aucun référent concret au sein de leur communauté, les villageois concluent à l’exclusion de cet intrus, de ce « fainéant, assis à l’ombre de sa galerie, fixant la crête des montagnes des heures durant pendant que les autres suent leur sueur sous le chaud soleil du Bon Dieu »[850]. Cependant, tout en imaginant que Sancher passe son temps à ne rien faire, les villageois constatent néanmoins qu’il ne manque de rien ; le secret révélé éveille alors immanquablement les soupçons et prend, en ce sens, rapidement les traits du mensonge :
« C’est
cela un écrivain ? Allons donc !
Les
histoires les plus folles se mirent à circuler. En réalité, Francis Sancher
aurait tué un homme dans son pays et aurait empoché son magot. Ce serait un
trafiquant de drogue dure, un de ceux que la police, postée à Marie-Galante,
recherchait en vain. Un trafiquant d’armes ravitaillant les guérillas de
l’Amérique latine. Personne n’apportant la moindre preuve à ces accusations,
les esprits s’enfiévraient. »[851]
Préférant inventer l’histoire de Sancher, plutôt que d’essayer de concevoir une réalité n’ayant aucun référent dans le quotidien de la communauté, les villageois transforment le secret révélé en une multitude de nouveaux secrets potentiels acceptables, car impliquant une interprétation concrète. Incapable, d’une certaine manière, de faire exister ses secrets au sein de la communauté, Sancher semble ainsi réduit à demeurer définitivement l’« étranger » qui, en dépit de ses tentatives, ne parviendra jamais à communiquer avec les autres. Ainsi, comme le souligne Man Sonson, Sancher ne cesse de parler, tout en demeurant incapable de véritablement communiquer :
« Les
gens qui disent que c’était un moulin à paroles ne se trompent pas. Il était
toujours en train de raconter quelque chose. Mais moi, je ne faisais pas
attention. »[852]
Confronté à des individus incapables de l’écouter -si Man Sonson ne lui prête guère attention, Joby va jusqu’à prendre la fuite pour échapper aux anecdotes que lui raconte Sancher[853]- le « moulin à paroles » devient moulin à vent, brassant l’air de ses paroles, pour finalement mourir seul et incompris. Cette incommunicabilité le suit, par ailleurs, jusque dans son activité d’écriture, puisqu’en intitulant son roman « Traversée de la Mangrove », Sancher se condamne d’emblée à l’impasse de la page blanche :
« Je
ne finirai jamais ce livre puisque, avant d’en avoir tracé la première ligne et
de savoir ce que je vais y mettre de sang, de rires, de larmes, de peur,
d’espoir, enfin de tout ce qui fait qu’un livre est un livre et non pas une
dissertation de raseur, la tête à demi fêlée, j’en ai trouvé le titre :
“Traversée de la Mangrove”.
J’ai haussé
les épaules.
-On ne traverse
pas la mangrove. On s’empale sur les racines des palétuviers. On s’enterre et
on étouffe dans la boue saumâtre.
-C’est ça,
c’est justement ça. »[854]
En nommant son roman, Sancher le fait exister, mais le titre qu’il lui donne le condamne paradoxalement au silence, voire à l’inexistence. Sancher a, d’une certaine façon, enfermé son dire dans la mangrove in-traversable, dans ce village de Rivière au Sel où il ne sera pas parvenu à se livrer, étouffé par ses propres angoisses, muselé par l’incapacité des autres à l’écouter.
Il nous paraît intéressant, une nouvelle fois, de confronter cette approche de l’incommunicabilité développée par M. Condé de celle proposée par Rachid Mimouni dans Tombéza.
Incapable de livrer son témoignage aux policiers venus l’entendre, Tombéza laisse son histoire s’écrire, au gré de ses souvenirs ; une histoire qui raconte son enfance malheureuse, soumise à la cruauté du monde, sa rencontre avec Malika qui meurt tragiquement, son ascension sociale odieuse et honteuse ; une histoire qui raconte encore l’Algérie dans ce qu’elle possède de plus sombre, de plus abject. Le récit multiplie les voix et les perspectives, en un flot de paroles ininterrompu qui finit par nous livrer, par le biais de l’enquête menée par Rahim, les circonstances et motifs de la tentative de meurtre ayant réduit Tombéza au silence. Cependant, au-delà de ces histoires multiples, en marge de l’intrigue reconstituant l’histoire de Tombéza, un silence pesant demeure néanmoins en ce vide saisissant engendré par l’absence d’espoir et de toute perspective d’avenir. L’ensemble du récit procède, en ce sens, de manière analeptique : la plupart des voix qui se font entendre relèvent du passé et celles qui s’avèrent être inscrites dans le présent semblent incapables d’offrir un quelconque espoir, qu’il s’agisse de celle de Batoul, meurtrier de Tombéza, celle des infirmières indifférentes à la souffrance ou encore celle de Rahim, policier honnête et consciencieux. C’est ainsi que, comprenant qu’il va mourir, Tombéza semble lui-même se réjouir de sa prochaine disparition :
« Dans
l’état où je suis, c’est encore ce qui peut m’arriver de mieux. J’ai vécu sans
vergogne, et je crèverai sans drame, sinon sans remords. »[855]
Apparemment vide de conscience morale, totalement détaché de son propre sort, Tombéza semble toucher ici au paroxysme de son inhumanité, de son abjection. Or, c’est précisément à partir de cet instant que le récit bascule et que Tombéza finit par tomber dans la profondeur de son existence. En effet, alors qu’il est sur le point de mourir, Tombéza vient à comparer son sort à celui de Bismillah, un vieil aveugle pratiquant l’Islam avec ferveur, qui, renonçant à blasphémer alors que Tombéza l’y encourageait, a fait une chute mortelle dans un précipice. Profitant de l’incertitude du lecteur, ignorant les raisons de cette chute -bien qu’il se doute de la responsabilité de Tombéza dans le drame-, Tombéza se livre alors à une sorte de parabole illustrant la vacuité de son existence :
« Comme
Bismillah, qui a trébuché dans le précipice que ses yeux morts ne pouvaient
déceler, qui a peut-être délibérément fait ce pas dont on le menaçait, qui a
peu-être été bousculé, mais qui est parti avec la certitude que ce n’était
qu’un court et mauvais moment à passer, un peu comme la rougeole ou la
circoncision. Au fond, je crois qu’il serait juste que chacun en ait pour ses
croyances, la béatitude ou la géhenne, ou le néant, que Bismillah retrouve la
lumière, les fleuves de miel et les houris, et Brahim toute la bière qu’il
voudra. Au fond, je crois que l’aveugle a été plus clairvoyant que moi et que
si c’était à refaire… je crois que somme toute, ce n’était pas une
solution. »[856]
Quelles que soient les raisons de cette chute mortelle, Bismillah est parti avec des certitudes, en respectant jusqu’au terme de sa vie ses convictions et engagements : la profondeur du précipice n’était rien comparée à la profondeur de sa foi. Confronté à la mort, Tombéza, lui, ne sait rien, ignore ce qui l’attend : le lecteur n’a, dès lors, qu’à imaginer le sort qui lui est réservé, qu’à choisir l’issue du roman, entre béatitude, géhenne et néant.
Tombéza n’a cessé de se raconter tout au long du récit, a peuplé le récit de ses histoires, lui a prêté une multitude de voix ; ce faisant, il a laissé le lecteur le juger. S’étant laisser observer tout au long du roman, il a offert une image, il a livré une histoire, à travers lesquelles le lecteur a tenté de l’approcher au plus près ; mais c’est finalement au moment de mourir, face à lui-même, que Tombéza se livre véritablement dans sa profondeur. C’est cette profondeur qui s’exprime dans les points de suspension cristallisant le regard que le personnage porte finalement sur lui-même ; c’est dans ce silence que, pour la première fois, pointe l’idée d’un recommencement, d’un espoir paradoxalement permis par la mort. Cet espoir et ce recommencement s’avèrent être illusoires pour le personnage en train de mourir, mais néanmoins porteurs de sens en ce qui concerne le récit, pouvant être repris, à la lumière de cette esquisse de repentir. Réifié en quelque sorte dès l’ouverture du roman, traité comme un rebut, voire comme un urinoir, Tombéza semble néanmoins retrouver un peu de son humanité en ces quelques mots, ces demi-mots de fin laissant entrevoir et même espérer ses regrets.
Pour survivre, ne pas se laisser vaincre et, d’une certaine manière, pour défier le crime d’abandon et de maltraitance infligé par sa famille, Tombéza a fait le choix du cynisme, de la vengeance et de la cruauté. Sancher, le personnage de M. Condé, autre exclu, s’est à l’inverse réfugié dans la honte, la culpabilité et la peur, ne parvenant pas à assumer les crimes commis par ses ancêtres colons.
Tombéza et Sancher ont donc échoué, mais si le récit de leur vie baigne dans l’amertume, c’est dans le regret que s’éclaire finalement leur existence et le récit dans son ensemble. Ainsi, après avoir traduit les regrets de Sancher (« Si la pluie est tombée comme ça, c’est qu’il la regrette, la vie, toute amère qu’elle est et sans jamais rien pour la sucrer »[857]), les habitants de Rivière au Sel perçoivent soudain l’étranger sous un nouveau jour :
« Qui
était-il en réalité cet homme qui avait choisi de mourir parmi eux ?
N’était-il pas un envoyé, le messager de quelque force surnaturelle ? Ne
l’avait-il pas répété encore et encore : “Je reviendrai chaque saison avec
un oiseau vert et bavard sur le poing” ? Alors, personne ne prêtait
attention à ses paroles qui se perdaient dans le tumulte du rhum. Peut-être
faudrait-il désormais guetter les lucarnes mouillées du ciel pour le voir
réapparaître souverain et recueillir enfin le miel de sa sagesse ? Comme
certains se rapprochaient de la fenêtre pour guetter la couleur du devant-jour,
ils virent se dessiner un arc-en-ciel et cela leur parut un signe que le défunt
n’était en vérité pas ordinaire.»[858]
Après une nuit de réflexion, de témoignages, d’introspection, les villageois réalisent avoir tu injustement les paroles de Sancher. Il semble néanmoins que ce soient bien ces paroles tues, ces messages de l’« envoyé » qui parviennent à s’exprimer au travers des nouvelles résolutions, des envies de liberté s’étant imposées toute la nuit à l’esprit de ces « prisonniers » de la mangrove. C’est ainsi que, s’inspirant en quelque sorte des espoirs des villageois, le récit s’achève à son tour sur une réouverture symbolique, encouragée par la résonance de toutes ces voix tues tout au long de la nuit :
« Secouant
sa fatigue et voyant devant elle la route droite, belle et nue de sa vie, Dinah
rouvrit le livre des psaumes et tous répondirent à sa voix. »[859]
En s’achevant sur la perspective d’une réouverture, voire d’une relecture, le récit que propose M. Condé semble retrouver ici les traces de sa vague parenté avec la forme policière.
« Cristallis[ant] sur la fin du texte tout le potentiel de révélation accumulé par le roman »[860], le récit policier s’achève, en effet, traditionnellement sur une forme de relecture de l’énigme à la lumière des différents déductions agencées par le détective. Le déroulement de l’enquête se présente, en ce sens, sous la forme d’un récit éclaté et si le déroulement de l’intrigue est nécessairement circonscrit à une lecture unique -dès lors que le lecteur sait, l’intérêt de l’intrigue se dissout-, l’appréhension du récit engendre un double niveau de lecture : lorsque l’énigme est révélée, la lecture du texte en fonction s’achève pour donner naissance, au minimum, à une deuxième lecture potentielle, pouvant laisser apparaître le mode de fonctionnement du récit par surimpression. Or, la plupart du temps, la mise en scène éclatante des conclusions de l’enquêteur tend à évincer cette deuxième lecture, en attribuant le « génie » du récit non au scripteur, qui a su maintenir une tension constante entre le dit et le non-dit et se jouer du lecteur sans que celui-ci ne s’en aperçoive, tout au long du récit, mais à l’enquêteur, proclamé découvreur de l’énigme sous les yeux d’un lecteur subjugué. Aussi, dans la perspective d’une mise en abyme du récit, la mise en scène d’enquêteurs incompétents ou d’énigmes jugées insolubles est tout à fait profitable. Relevant du non-sens, au niveau de l’intrigue policière, elle offre, au niveau scriptural, la perspective d’une véritable plongée dans les dessous du récit, à la recherche du texte invisible et inaudible, à la rencontre du scripteur.
1.1.2- Quand taire c’est dire
« Se
taire ce n’est pas être muet, c’est refuser de parler, donc parler
encore. »[861]
La tension du récit policier repose sur le maintien d’un non-dit, présent par son absence tout au long du récit -il est l’objectif du récit- et matérialisé, au sein du texte, par un dire en construction qui, afin de préserver le suspense, ne cesse d’afficher son incapacité à atteindre ce non-dit, tout en poursuivant son cheminement. Autrement dit, le récit policier naît avec l’absence d’un dit -le récit du crime- et se développe dans le dire de ce non-dit -le récit de l’enquête. Or, plus le non-dit tend vers l’indicible, c’est-à-dire plus l’énigme paraît insondable, et plus le dire s’intensifie, l’enquêteur multipliant les efforts afin de relever le défi auquel il est publiquement confronté. Notons que cette tension entre le non-dit et le dire s’apparente, à certains égards, au procédé mis en place par le système de la prétérition, dont Philippe Hamon propose notamment l’approche suivante :
« Elle
se présente souvent comme la lexicalisation d’un manque, d’un défaut de compétence du descripteur, d’un défaut de
son vouloir/savoir/pouvoir décrire, bénéficiant à la fois de l’innocence de
l’incompétence du dire et de l’efficacité du dit. Elle est alors signal d’une
distance, d’une tension, ou d’une contradiction entre une intention déclarée et
un faire réalisé, entre un refus ou une impuissance à dénommer et un luxe de
nominations subséquentes […]. »[862]
Prenant appui sur différents extraits (Racine, Zola, Balzac), P. Hamon évoque encore les différentes marques textuelles de la prétérition :
« Signaux
d’une tension et d’un jeu entre le descriptif et le narratif, signification
d’un “manque” là où un “luxe” textuel va se déployer, les marques de la négation-dénégation
prétéritive, marques cumulables, peuvent passer, on le voit, aussi bien par des
préfixes (in-descriptible, in-estimable, in-nommable, in-dicible), par des
suffixes renvoyant à une impossibilité (-able ; -ible), par les temps et
modes de l’hypothèse (subjonctif, conditionnel), par des particules négatives
(sans), par le lexique du manque […], et par les verbes modaux (vouloir,
pouvoir, savoir, devoir) eux-mêmes. »[863]
Ces procédés participent du discours de l’enquêteur, à la fois personnage/descripteur intradiégétique, porteur du manque à découvrir, et personnage/narrateur homodiégétique catalyseur et organisateur du « luxe textuel » se déployant au sein de l’enquête. Comme nous l’avons souligné précédemment, ce « luxe textuel » se manifeste, dans les romans de notre corpus, de manière extravagante, étayé par le caractère polyphonique et sur-modalisé du système énonciatif mis en place ; il est encore surenchéri par une densification du « manque » s’exprimant, dans le cadre du récit policier, sous des formes variées. Au sein de la fiction policière, en effet, le manque s’exprime avant tout dans le taire et si le taire s’avère être, en amont, le fait du scripteur, il se révèle être imputable, aux yeux du lecteur, à un ou plusieurs personnages. Ainsi, le manque initial se fait constitutif du caractère apparemment insondable de l’énigme déterminant les circonstances d’un crime et s’avère être, de fait, le fruit des efforts du criminel s’étant appliqué à taire toute trace d’explication logique, confisquant par là-même le récit du crime. Le maintien de ce manque -matérialisé par l’enquête en cours et contribuant à produire du suspense- est, quant à lui, imputable aussi bien au criminel, adversaire direct de l’enquêteur, qu’aux nombreux autres personnages ayant intérêt à tenir l’énigme et ses affluents secrets. Autrement dit, au sein de la fiction policière, le manque manifeste une intention de taire intrinsèque de l’intrigue -en apparence pour le moins- et afin que le tu demeure, le taire multiplie les stratégies.
L’étude menée précédemment sur les modalisations du récit, et plus précisément sur la question de la focalisation, témoigne d’une première manifestation du taire sous la forme d’une subjectivisation du récit, permettant une orientation, voire un détournement de l’information censée guider l’enquêteur dans ses recherches.
L’orientation du récit ainsi permise use généralement, par ailleurs, de différents procédés permettant une forme de parcellisation de l’information qui se manifeste diversement au sein du texte, notamment par le biais de l’ellipse et, plus précisément, de « l’ellipse hypothétique »[864] en laquelle Yves Reuter reconnaît, entre autres, le motif de l’alibi.
La fonction de l’alibi est multiple au sein de la fiction policière et cristallise, d’une certaine manière, les diverses orientations de l’enquête. Ainsi, l’alibi accentue le manque produit par le récit absent du crime, en contribuant à réduire le nombre des suspects et donc des solutions potentielles, mais il permet à l’enquêteur, dans une perspective inverse, d’éliminer le superflu et de se rapprocher par là même du coupable. L’alibi, et plus précisément les vérifications qu’il nécessite, constitue, en ce sens, au-delà du relevé des indices sur les lieux du crime, un des éléments essentiels permettant à l’enquêteur d’exercer ses facultés. Il s’agit en effet pour ce dernier, de partir en quête de preuves, de témoignages concordants, mais surtout d’éclairer les différentes versions apportées par les témoins à la lumière du soupçon. A cet égard, tout témoin fait rapidement figure de suspect potentiel, la fiction policière n’offrant qu’une mince latitude aux innocents irréprochables. Les différents secrets, plus ou moins « utiles » à la résolution de l’enquête, occupent alors l’enquêteur qui ne se prive pas de faire valoir, de manière ostentatoire la plupart du temps, sa réputation de fin limier. Or, tout en faisant démonstration de son talent, en déterrant les différents secrets collatéraux du crime principal, l’enquêteur se voit finalement détourné de son objectif premier, si bien que la vérification des alibis -et bien souvent, par là-même, la résolution de l’énigme- subit des retards qui s’avèrent être nuisibles à l’enquête, mais indispensables à la construction du récit.
Les alibis présentés généralement dans les débuts de l’enquête fonctionnent, en ce sens, comme autant de ressorts tendus, potentiellement porteurs du mensonge révélateur de l’identité du coupable. Chaque alibi implique ainsi la superposition de plusieurs versions, de différents récits censés corroborer une même information : il s’agit-là, pour l’enquêteur, de parer le caractère elliptique, subjectif voire orienté de toute version, de combler les « blancs » du récit, de laisser transparaître ses failles. Il en est ainsi de l’enquête menée par l’inspecteur Laprée, dans le roman de Fortuné Chalumeau.
Interrogeant la veuve de la victime sur son emploi du temps la nuit du crime, autrement dit sur son alibi, Laprée reçoit la version suivante :
« J’étais
au casino de l’hôtel Prins van Orange, à Saint-Martin. Pourtant, le baccarat et
la roulette m’ennuient : je gagne toujours. Mais c’était l’anniversaire de
Jean-Paul Clermont, l’acteur de cinéma. Vous connaissez, bien sûr ? Tous
ses invités m’ont remarquée : j’ai fait un scandale au maître d’hôtel
parce que mon champagne ne pétillait pas assez. Jean-Paul adore mes scènes. Mon
accent le fait rire aux larmes. Il m’exhibe comme un animal curieux :
“C’est ma Béké martiniquaise, dit-il. On l’a dirait échappée d’Autant en emporte le vent ! Elle a
d’impayables numéros de Pompadour en colère… ”
Ses
bracelets d’or et ses bagues exécutaient un ballet d’étincelles en accompagnant
ses explications. »[865]
Manifestement à son aise face à Laprée, Wanda semble bénéficier d’un alibi apparemment fiable et aisément vérifiable. Dînant dans un lieu public très fréquenté, Wanda prétend, en outre, avoir été remarquée par bon nombre de clients du restaurant, invités de marque d’un célèbre acteur de cinéma ; autant de garanties, auxquelles s’ajoutent la distance séparant la veuve des lieux du crime -elle était à Saint-Martin ; le meurtre a été commis sur un îlet de Guadeloupe- ainsi que l’« effet de réel » dont participent les nombreux détails étayant la version proposée. Ainsi, la présence de Wanda à l’hôtel est justifiée par les festivités organisées à l’occasion d’un anniversaire dont l’invité d’honneur est célèbre ; le scandale provoqué par Wanda confère, en outre, à la soirée une tournure anecdotique contribuant à marquer la présence de la future veuve sur les lieux.
Or, en dépit de l’apparente fiabilité de l’alibi, l’enquête de Laprée finit par dévoiler l’imposture, grâce au témoignage de l’employé du restaurant, victime du scandale :
« La
femme qui vous a fait un scandale ce soir-là était-elle vraiment madame
Beudry ?
-
Non. C’était une femme de son âge, habillée comme elle, une Française. Elle
s’est comportée exactement comme madame Wanda. La chose m’a frappé. Je n’en ai
parlé à personne car je n’étais pas au courant de ce meurtre. Mais son accent
créole sonnait faux. Croyez-moi, j’ai passé mon enfance en Guadeloupe. Les
invités ont pu s’y tromper, il y avait beaucoup de gens ivres alors… »[866]
Non seulement Wanda a menti, ce qui fait d’elle une suspecte, mais elle s’est fabriqué un alibi ; un subterfuge prouvant sa culpabilité et apparaissant après coup, en filigrane, dans les non-dits de la version livrée à Laprée.
Ainsi Wanda laisse entendre que sa présence à Saint-Martin est liée à la fête organisée pour Jean-Paul Clermont ; or, rien n’indique qu’elle y était invitée et la manière dont elle se distingue des autres convives -« ses invités »- semble même souligner que sa présence n’avait pas été requise par l’acteur. En outre, au moment du scandale, elle précise avoir été remarquée par tous les invités, et non par Jean-Paul Clermont lui-même qui, nous le comprenons après coup, ne pouvait remarquer cette femme à l’accent sonnant faux, alors que ce qui démarque Wanda à ses yeux, c’est précisément son accent. En évoquant, par la suite, l’intérêt de l’acteur pour les « scènes » qu’elle a coutume de jouer, Wanda laisse imaginer le plaisir de Jean-Paul à la voir jouer celle-ci, sans pour autant faire explicitement de lui un spectateur au même titre que ses invités : l’ego démesuré de l’actrice qu’elle rêve de devenir semble la pousser à faire de la jeune femme ayant joué son rôle l’espace d’une soirée, une simple et pâle doublure, incapable de capter, comme elle, l’attention d’un si grand acteur. Tout en veillant à maintenir la fiabilité de son alibi, Wanda prend néanmoins le soin de présenter sa version de telle sorte que son ego n’en souffre pas trop.
Le secret du subterfuge s’avère être, d’une certaine manière, préservé par le caractère elliptique et orienté du récit de Wanda, et perdure d’une part, dans les détours de l’enquête retardant la vérification des faits avancés par la veuve et d’autre part, grâce au silence du serveur ignorant l’importance de son témoignage : à l’ellipse pratiquée dans le récit de Wanda, s’adjoint alors la paralipse caractérisant le silence du serveur, permettant au scripteur d’entretenir la rétention d’information nécessaire à la « réussite » du récit d’enquête.
Avec la paralipse, en effet, « le récit ne saute pas, comme dans l’ellipse, par-dessus un moment, il passe à côté d’une donnée »[867]. Il nous paraît ici intéressant de nous arrêter un instant sur ce procédé, notamment à la lumière d’un des romans d’Agatha Christie ayant exploité superbement le principe de la paralipse.
Dans Le Meurtre de Roger Ackroyd, en effet, le texte absent déterminant le moment du crime, trouve sa représentation dans la paralipse que constitue l’omission, dans le récit du narrateur -le Dr Sheppard- des dix minutes au cours desquelles le meurtre a été commis :
« Ackroyd
était fort entêté ; plus on le poussait à accomplir un acte plus il s’y
refusait. Tous mes arguments demeurèrent inutiles. La lettre lui avait été
apportée à neuf heures moins vingt. Il était juste neuf heures moins dix
lorsque je le quittai, sans qu’il eût achevé de la lire.
La
main sur la poignée de la porte, j’hésitai et regardai en arrière, me demandant
si je n’avais rien oublié. Je ne vis rien, je sortis en hochant la tête et je
fermai la porte derrière moi. »[868]
Bien que soupçonneux à l’égard des éléments distillés par le récit, le lecteur de roman policier accorde généralement sa confiance au narrateur : vraisemblablement parcellaire, faillible ou encore influençable et partial, notamment lorsqu’il s’agit d’un des personnages mêlés à l’intrigue, le narrateur s’avère être néanmoins absent, en principe, de la liste des suspects répertoriés aussi bien par l’enquêteur que par le lecteur. C’est ainsi que le récit du Dr Sheppard fonctionne, en première lecture, comme une simple relation de faits : Ackroyd a voulu lire la lettre ; Sheppard le quitte alors qu’il poursuit sa lecture, en prenant soin de ne rien oublier sur son passage, comme il arrive à tout un chacun de procéder au sortir d’une pièce. Or, éclairé à la lumière des accusations de Poirot, affirmant la culpabilité du Dr Sheppard, le lecteur est conduit à revoir sa première lecture, aidé en cela par le narrateur démasqué lui-même :
« Je
suis assez satisfait de moi comme écrivain.
La
phrase suivante n’est-elle pas parfaite ? “La lettre lui avait été
apportée à neuf heures moins vingt. Il était juste neuf heures moins dix
lorsque je le quittai sans qu’il eût achevé de la lire. La main sur la poignée
de la porte, j’hésitai et regardai en arrière, me demandant si je n’avais rien
oublié.”
Tout
était exact. Mais supposons que j’aie mis une ligne de points après la première
phrase ! Quelqu’un se serait-il jamais demandé ce qui s’était passé
pendant ces dix minutes ? »[869]
Ainsi, les dix minutes de prétendue lecture d’Ackroyd représentent le temps qu’il a fallu à Sheppard pour commettre le crime. Autrement dit, le laps de temps s’inscrivant, en première lecture, dans une perspective elliptique relève en fait plus précisément de la paralipse, le narrateur, fiable détenteur du récit, prenant après coup les traits d’un froid calculateur, manipulateur, menteur par omission. Dans ce roman, l’ère du soupçon gagne ainsi la narration, c’est-à-dire finalement la légitimité même du récit : c’est parce qu’il a réussi à tromper le lecteur, au seul moyen de son dire, que le Dr Sheppard s’estime satisfait de son accomplissement en tant qu’écrivain. Toute l’entreprise de Poirot aura donc consisté à révéler le tu masqué par le dire du narrateur criminel ou encore à lever l’ellipse, à restituer les informations retenues par la paralipse.
La paralipse -il en est de même pour l’ellipse- se manifeste, au sein du texte, comme un dicible indicible : le manque produit par la paralipse brille par son absence et traduit finalement un non-dit qui, pour être reconnu comme tel, doit se trahir, reproduisant, matérialisant d’une certaine manière, au sein du texte, le caractère paradoxal du secret. En effet, ainsi que le souligne Vincent Descombes :
«
Dès lors que je parle, il y a des choses que je ne peux pas dire. […] La
définition du secret est contradictoire ; elle en fait un dicible
indicible. »[870]
L’indicible n’existe au sein du secret que dans la mesure où il peut être dit : pour exister, le secret doit trouver un dépositaire, le taire se réalisant alors dans un dit. Or, ce dit s’inscrit lui-même dans un dire, puisque taire revient à dire que l’on ne dit pas. L’existence du secret implique donc la trahison d’un tu dans le taire.
Le roman de Maryse Condé, Traversée de la Mangrove, nous en offre notamment un exemple explicite.
Mira et Aristide entretiennent une liaison incestueuse secrète. Le secret qu’ils croient partager à deux existe, en fait, au cœur d’un second secret détenu par Loulou, leur père. Or ce second secret n’existe comme tel qu’au moment où le tu devient taire[871], c’est-à-dire au moment où Loulou laisse entrevoir qu’il sait mais qu’il se tait. Accusé par Loulou de lui avoir enlevé sa fille Mira, Sancher rétorque alors :
« - Je n’étais pas le premier, si tu veux tout savoir, et tu as mal gardé ta fille. Un autre s’était largement frayé le passage. »[872]
Cette déclaration choquante déclenche un geste-réflexe de Loulou, avouant malgré lui ce « dicible indicible » dont il s’avère être porteur :
« Involontairement, Loulou s’était tourné vers Aristide qui, sous le poids de ce regard, avait vacillé. »[873]
Laissant Aristide comprendre qu’il sait, Loulou fait exister son secret en lui offrant un dépositaire et le préserve, dans le même temps, en gardant le silence ; ainsi, Sancher ne remarque rien du dialogue sourd s’établissant entre père et fils (« Sans se douter de rien, Francis Sancher continuait moqueusement »[874]). En décrivant le geste involontaire de Loulou, qui échappe à Sancher, le narrateur permet ainsi au lecteur de se faire à son tour dépositaire du secret, d’accéder à une vérité cachée, reproduisant en ce sens le schéma de la forme policière. Dans le cadre de la fiction policière, en effet, le secret est nécessairement lié au crime, sa révélation coïncidant, de fait, avec l’accès à la vérité ou plutôt, devrions-nous dire, à une vérité. Il convient, en effet, de préciser que la vérité que prétend atteindre la fiction policière in fine cristallise, d’une certaine manière, l’intention du scripteur ; elle intervient pour mettre un terme au récit, autrement dit pour venir à bout des hésitations, spéculations, errements de l’enquêteur, en avalisant une version parmi tant d’autres. Dans le roman policier, la vérité coïncide dès lors avec le choix d’un schéma narratif, avec une intention scripturale potentiellement porteuse d’un contenu extra-fictionnel. Dans la mesure où le récit policier s’avère être fortement tendu vers un aboutissement appelant et couronnant cette vérité, il convient d’en définir plus précisément les contours.
1.2-
« La
vérité et rien que la vérité »
Quelle est la portée de la vérité que l’enquêteur livre fièrement et spectaculairement au terme de son cheminement ? Quel rôle joue-t-elle au sein de l’intrigue et, par extension, au sein du récit ? Que révèle-telle ? Que cache-t-elle ? Quels sont ses véritables tenants et aboutissants ?
Dans le cadre du récit policier fonctionnant sur la base meurtre/enquête/résolution, de telles questions ne se posent pas vraiment, tant il est vrai que le lecteur demeure soumis à un paradigme de lecture l’invitant à considérer la révélation finale de l’enquêteur comme une fin en soi. Les multiples interrogations envahissant le récit et l’esprit du lecteur, tout au long de l’enquête, s’évanouissent, en effet, avec la révélation de la vérité qui s’avère être, de surcroît, si bien argumentée que le lecteur ne songe que très rarement à la remettre en cause. Tout en donnant l’illusion de développer une multiplicité d’issues possibles, le récit policier s’inscrit, en réalité, au cœur d’une stratégie posant comme unique et indéfectible la résolution de l’énigme proposée par l’enquêteur.
Le caractère directif de l’orientation du récit policier prend, à cet égard, une résonance singulière en ce qui concerne quelques œuvres de notre corpus, en soulevant notamment la question du parti pris imputable à la plupart des auteurs inscrivant l’intrigue dans un contexte référentiel bien déterminé. Dans ces romans, la révélation de la vérité coïncide souvent avec une mise en accusation non d’un individu en particulier, mais bien d’un système. Il s’agit de dénoncer une action criminelle en veillant à ce que cette dénonciation dépasse le simple cadre fictionnel : le scripteur prend position et tente, de manière plus ou moins évidente, de rallier le lecteur à sa cause. Au caractère idéologiquement, voire politiquement orienté de cette démarche, s’oppose une perspective proposant au lecteur une multiplicité de vérités, d’issues, de solutions possibles, pervertissant ainsi allègrement la traditionnelle directivité du genre.
Quelle que soit la direction empruntée, la plupart des textes de notre corpus prolongent le questionnement engagé par l’intrigue policière, au-delà du terme du roman, offrant finalement une forme de récit ouvert.
1.2.1- Conditionnement du lectorat
Ainsi que l’indique Jean-Paul Sartre, dans l’essai intitulé Qu’est-ce que la littérature ?, « la lecture est création dirigée »[875] : d’une part, la subjectivité du lecteur donne corps à l’objet littéraire -J-P. Sartre explique, par exemple, que dans le roman de F. Dostoïevski, Crime et châtiment, « l’attente de Raskolnikoff, c’est mon attente, que je lui prête »[876]- tandis que, d’autre part, l’exercice de cette subjectivité est sollicité et orienté par les mots qui « sont là comme des pièges pour susciter nos sentiments et les réfléchir vers nous »[877].
La lecture de fiction policière illustre concrètement cette double application. En effet, sous-tendu par la perspective de la résolution d’une énigme, le récit policier se constitue au gré d’une série d’effets d’attente venant solliciter l’imagination du lecteur. Soumis au doute -se demandant ce qui lui est caché- et à l’incertitude -se demandant ce qui va arriver-, le lecteur, défié de surcroît par l’enquêteur, s’engage alors dans un processus d’anticipation, de création « proleptique ». Dans le cadre de la fiction policière, l’objectif du scripteur consiste à toujours décevoir cette anticipation du lecteur, à susciter tout en infirmant ses différentes tentatives de création, à conserver sans relâchement une longueur d’avance sur lui, la notion de « création dirigée » prenant ici tout son sens. Daniel Couegnas souligne en ce sens le caractère directif, voire démagogique, de la paralittérature dont participe le genre policier :
« L’abus
du cliché, la mise en place manichéenne des valeurs et la structuration
monolithique des personnages contribuent à rendre antithétiques paralittérature
et dialogisme. Il est bien rare que, dans les œuvres qui nous occupent, le
lecteur soit amené à hésiter quant au jugement à porter sur une action
narrative ou un personnage. »[878]
Tout en sollicitant l’imagination créative du lecteur, le scripteur intervient donc, au creux du récit, de manière sous-jacente et, autant que faire se peut, en toute discrétion, en tant que metteur en scène chargé de « diriger » la participation du lecteur, d’orienter sa perception. Le recours aux différents procédés relevant de la modalisation du récit participe notamment de la direction, du conditionnement de la lecture, pouvant être soumise, par ailleurs, à d’autres éléments susceptibles d’influencer son orientation. La prise en compte de l’hypertexte peut jouer, à cet égard, un rôle déterminant, tout particulièrement en ce qui concerne les ouvrages dont le propos dépasse le strict cadre de la fiction. Nous remarquons, en effet, que le caractère directif de la fiction policière permet, notamment dans le cadre des romans de type référentiel, l’expression d’un parti pris engageant le propos de l’auteur au sein d’un discours idéologique se perpétuant au-delà de la fiction.
Beate Bechter-Burtscher souligne que tandis que les premiers volets des enquêtes du commissaire Llob, publiés en Algérie, laissent primer l’humour et le sarcasme des enquêteurs sur la noirceur du contexte social décrit, les romans publiés en France sous le pseudonyme de Yasmina Khadra semblent, à l’inverse, privilégier le contexte référentiel qui finit par prendre le pas sur la fiction. Elle précise :
« C’est
que les évènements contemporains pèsent lourdement sur les personnages ;
leurs remarques humoristiques et sarcastiques ont cédé la place à une critique
accusatrice ; les enquêtes du Commissaire Llob et de ses coéquipiers se
transforment en rencontres avec les responsables du conflit algérien. »[879]
Combinée avec la sympathie inspirée par le commissaire Llob[880], ainsi qu’avec la « soif d’information venant d’Europe »[881] à l’égard de l’actualité socio-politique algérienne notamment, cette « critique accusatrice » semble dépasser sans peine le strict cadre fictionnel, le commissaire Llob se faisant, d’une certaine manière, le porte-parole engagé de Mohammed Moulessehoul, officier de l’Armée algérienne. Ce dernier remercie, en ce sens, le commissaire Llob d’avoir été « un personnage extrêmement attachant et … coopératif »[882], autrement dit, d’avoir su rallier un public attentif -si ce n’est bienveillant voire séduit-, avant de se faire le vecteur idéal du discours critique engagé par l’auteur. Les « rencontres avec les responsables du conflit algérien », évoquées précédemment par B. Bechter-Burtscher, participent en ce sens d’une véritable mise en accusation dressée à l’encontre de la « mafia politico-financière » agissant en amont et des Groupes Islamiques Armés intervenant en aval[883].
Cette version, que le lecteur fut tenté d’avaliser alors que l’identité de l’auteur demeurait cachée, a pu perdre par la suite de son crédit avec l’arrivée sur le devant de la scène de Mohammed Moulessehoul, au moment où l’Armée algérienne était justement mise en cause et même accusée d’avoir joué un rôle dans différents massacres perpétrés contre la population civile. Le discours offensif jusqu’alors tenu par Yasmina Khadra, tant par le biais de ses romans que dans les nombreuses déclarations recueillies par la presse, s’est vu progressivement supplanté par un discours défensif, l’auteur ayant été tenu de s’expliquer sur son appartenance à l’Armée algérienne.
Répondant à la sollicitation de Jean-Luc Douin, l’interrogeant sur les accusations portées à l’encontre de l’Armée algérienne, dans le massacre de Bentalha, Yasmina Khadra s’exprime en ce sens, dans un premier temps, de manière relativement prudente sur le sujet :
« Toutes
les armées du monde se cassent les dents face au terrorisme ! L’armée
algérienne est formée pour la guerre classique contre d’autres armées, pas pour
affronter une guérilla dont les règles lui échappent, une guerre sournoise,
jusqu’au-boutiste, qui opte pour le spectaculaire au détriment de la logique,
se surpasse dans l’absurde. Les terroristes s’attaquent à tout, aux arbres, aux
chiens, aux vaches, aux bergers. L’armée algérienne est d’une vaillance extrême
contre ces gens-là ! Mais elle est incapable de mettre à genoux
l’intégrisme. »[884]
De plus en plus sollicité sur cette question épineuse, Yasmina Khadra multiplie dès lors les explications, les justifications qui, avec la pression médiatique, se font de plus en plus virulentes. Il obtient ainsi ce qui apparaît comme un « droit de réponse », dans le quotidien Le Monde, où il s’exclame notamment :
« Je
déclare solennellement que, durant huit années de guerre, je n’ai jamais été
témoin, ni de près ni de loin, ni soupçonné le moindre massacre de civils
susceptible d’être perpétré par l’armée. Par contre, je déclare que l’ensemble
des massacres dont j’ai été témoin et sur lesquels j’ai enquêté portent une
seule et même signature : les GIA. »
« L’armée algérienne n’est pas un ramassis de barbares et d’assassins. C’est une institution populaire qui essaye de sauver son pays et son âme avec le peu de moyens appropriés dont elle dispose que compensent sa détermination et sa vaillance, et rien d’autre. »
« Je reviens des maquis, des villages blessés, des villes traumatisées ; je reviens d’un cauchemar qui m’aura définitivement atteint dans ma chair et dans mon esprit ; je reviens de ces nuits où des familles entières sont exterminées en un tournemain, où l’enfer du ciel tremble devant celui des hommes, où les repères s’effacent comme des étincelles dans l’obscurité, tant l’horreur est totale et la douleur absolue. Et que suis-je en train d’entendre ? Que le soldat miraculé que je suis est un tueur d’enfants ! » [885]
Yasmina Khadra réitère, par ailleurs, ce type de propos dans la presse algérienne :
« J’AIME
L’ANP. Elle ne m’a pas ménagé, mais les hommes qui ont jalonné mes déconvenues
l’ont emporté sur le reste. C’est une institution qui a fait son devoir malgré
les conditions morales et psychologiques désastreuses. Sans elle, l’Algérie
serait un gigantesque champ de ruine. Les braves de ce pays s’en souviendront.
En tant que soldat, j’y ai donné le meilleur de moi-même en m’acquittant
honorablement de mes tâches. »[886]
Malgré ces déclarations poignantes, qui ne sont pas sans rappeler, par leur tonalité, les éclats d’indignation du commissaire Llob, Yasmina Khadra subit le revirement de la critique qui l’avait jusqu’alors encensé[887], ainsi que le constate, de manière ironique et amère, Mohamed Benchicou :
« Comment
séduire Paris sans dénoncer l’Armée, sans dire du mal de sa patrie, sans placer
quelque formule sympathique à l’endroit des islamistes ? Pour avoir boudé
le monde des paillettes, refuser le bâton de David Copperfield et s’être entêté
dans le verbe de Hugo plutôt que dans la littérature indigène, Khadra s’est
exposé au châtiment qui attend les serfs rebelles. En pleine admiration devant La Sale Guerre et Habib Souaïdia, la
télévision française l’ignore, Le Monde
tergiverse, Libération
l’accuse : agent de la Sécurité militaire. »[888]
Délibérément partial et globalement excessif, le point de vue de M. Benchicou présente néanmoins l’intérêt de mettre en évidence la question des attentes du lectorat français -et plus précisément ici de la critique parisienne- à l’égard de la littérature algérienne.
Si la critique française n’est sans doute pas aussi sectaire et réductrice que M. Benchicou le laisse entendre, la question de la partialité caractérisant la réception actuelle de la littérature algérienne paraît néanmoins pertinente. Il convient, dès lors, de souligner que le parti pris adopté par la critique à l’égard des textes publiés sur l’Algérie coïncide avec le fait que la littérature algérienne contemporaine se fait souvent la tribune de scripteurs, pas nécessairement « écrivains de profession », mais porteurs d’un discours qu’ils matérialisent et font entendre, par le recours à la forme romanesque. Aussi, la lecture de la production romanesque algérienne s’inscrivant dans une démarche référentielle, n’est pas sans susciter une prise de position du récepteur, potentiellement informé, par ailleurs, par d’autres transmetteurs (journalistes, historiens, écrivains, sociologues, politologues, etc.). A cet égard, l’effet d’attente produit sur le lecteur coïncide, d’une certaine manière, avec une quête de savoir suscitant une implication non plus d’ordre créatif mais relevant davantage d’une approche argumentative et cognitive. Confronté à un discours en prise avec la réalité, le lecteur perçoit le récit comme porteur d’informations pouvant être contestées ou avalisées hors fiction. Le mode de communication choisi par le scripteur paraît, en ce sens, déterminant.
Dans le cas des romans de Yasmina Khadra, le recours à un mode narratif homodiégétique, soumettant le lecteur au discours d’un enquêteur inspirant une certaine sympathie, contribue à avaliser le discours idéologique véhiculé par le récit. Llob inspire confiance, son approche de la réalité algérienne est précise, son discours poignant, et le lecteur est par conséquent tenté de se laisser convaincre ; c’est, au demeurant, ce qui était susceptible de se produire alors que l’anonymat de l’auteur était préservé. Il est probable, en effet, qu’en découvrant l’appartenance de Yasmina Khadra à l’Armée algérienne, le lecteur et la critique aient pu se sentir quelque peu floués par la rétention de cette information, susceptible de remettre en cause la légitimité du scripteur.
A la lumière de cette révélation et des soupçons pesant sur l’implication de l’Armée algérienne dans différents massacres ayant touché la population civile, le discours critique de Llob peut, dès lors, prendre un tout autre relief ; c’est, potentiellement, un autre texte qui s’offre au lecteur, Mohammed Moulessehoul apparaissant sous le masque du commissaire Llob. Cette deuxième lecture, suscitée finalement en dépit de l’auteur, souligne la mobilité, la palpitation du texte livré à l’interprétation et plus précisément au parti pris. Le texte échappe à son créateur dans la lecture, en même temps qu’il s’y réalise. Entre le créateur et le lecteur, le texte se livre à une multiplicité de possibles, que la directivité du genre policier s’efforce de réduire illusoirement, comme le suggère notamment Marc Escola :
« Le
genre obéit à une rhétorique singulière qui suppose l’ouverture d’un éventail
de possibles textuels que le chapitre final vient brutalement refermer ;
cette résolution des possibles dans un texte ultime ne se fait pas sans
restes : il est tout simplement impossible de subsumer en un unique texte
(le récit du meurtre), l’ensemble des éléments dont le roman a eu besoin pour
produire, avec le défilé des suspects, une multiplicité de fausses
pistes. » [889]
Empruntant le genre policier par des voies détournées, la plupart des romans de notre corpus ne manquent pas, à l’instar des Nouveaux Romanciers, d’exploiter ces restes, ces possibles textuels qui, de coutures invisibles de la fiction policière traditionnelle se voient propulsés, non sans conséquences, sur le devant de la scène romanesque.
1.2.2- Les « possibles textuels »
A partir d’une étude consacrée à l’ouvrage de Pierre Bayard, intitulé Qui a tué Roger Ackroyd ?[890] et proposant une relecture critique du célèbre roman d’Agatha Christie, Marc Escola met en évidence différentes raisons de contester la manière dont Hercule Poirot clôt son enquête sur l’affirmation de la culpabilité du Dr Sheppard. Il précise :
« La
solution d’Hercule Poirot a sans doute le mérite de réordonner dans une unique
chaîne de causalité les faits saillants révélés par l’enquête ; elle
n’établit pas pour autant l’impossibilité de toutes les variantes : de là
l’impression d’inachèvement que suscite l’enquête, la pression que ces
variantes exercent sur ce même dénouement : le système de ces variantes
vient tisser une manière de texte fantôme qui hante encore les dernières pages
du roman et qui, tout autant que l’ultime aveu d’une paralipse par le
narrateur, conditionne une singulière relecture du récit, voire une
contre-enquête à la manière de P. Bayard. »[891]
Négligeant de démontrer l’invalidité des autres variantes, autrement dit des autres versions possibles du récit du crime, Hercule Poirot impose ses conclusions au terme du roman, avec la complicité du scripteur ajoutant un dernier chapitre, intitulé « Apologie », reproduisant les aveux du narrateur. C’est donc dans la perspective d’une lecture critique et contestataire -ce qui paraît relativement original en ce qui concerne les romans d’Agatha Christie rencontrant vraisemblablement peu de lecteurs imaginant mettre en doute les brillantes déductions d’Hercule Poirot- que Pierre Bayard, et à sa suite Marc Escola, s’engagent dans une nouvelle enquête, l’un et l’autre affirmant finalement la légitimité de deux autres versions possibles du récit du crime.
Tout en argumentant leur propre version du crime, P. Bayard et M. Escola prennent le soin de mettre en doute les conclusions d’Hercule Poirot, en partant notamment du principe que les éléments sur lesquels le détective belge fonde son raisonnement ne sont pas nécessairement fiables. Rien n’indique, en effet, que le crédit qu’il accorde à certains témoins est justifié, ni que sa célèbre clairvoyance n’a pas été fourvoyée par quelque prodigieux menteur.
Dans les romans d’Agatha Christie, ainsi qu’au sein de tout récit faisant intervenir un enquêteur passant pour brillant et infaillible, aucun mensonge ni méfait quelconque n’est censé échapper au fin limier. Tout se passe, en effet, comme si l’enquêteur jouissait d’une clairvoyance sans borne, lui permettant non tant de déceler, mais bien de désigner la vérité. Cette assurance et cette autorité affichées par l’enquêteur hypnotisent, d’une certaine manière, le lecteur qui demeure généralement ébloui par celui qu’il considère comme un être hors du commun et qui a tendance à oublier que ce dernier n’est autre que la couverture du scripteur. Remarquons, en effet, que l’enquêteur n’est infaillible que dans la mesure où le scripteur en a décidé ainsi, avec l’assentiment du lecteur qui doit accepter cette donnée comme partie prenante du pacte de lecture[892] déterminé par le genre policier. Contestant l’exclusivité de la version avancée par Poirot, M. Escola s’attaque en ce sens, à la cohérence même de l’organisation du récit mené par le scripteur, en soulignant, par exemple, que dans la mesure où le Dr Sheppard s’est suicidé après avoir été démasqué par Poirot, il ne peut être l’auteur du récit rétrospectif que nous lisons, comme cela nous est avancé. Porteur de différentes incohérences de ce type, le récit proposé paraît donc contestable, déstabilisant par là même la démarche de l’enquêteur. C’est donc en mettant au jour les failles lézardant l’organisation du récit, que P. Bayard ou encore M. Escola s’octroient le droit de contester Poirot et de réhabiliter, en quelque sorte, d’autres possibles textuels. Or, il s’agit-là d’un procédé prisé par quelques-uns des auteurs de notre corpus qui renoncent à clore le récit sur l’affirmation d’une vérité, qui refusent d’imposer une solution à l’énigme posée, préférant ouvrir le récit sur une multiplicité de possibles.
Considérant que chaque suspect se révèle être porteur d’un texte possible, certains auteurs tels Maryse Condé ou encore Raphaël Confiant -avec Brin d’amour uniquement- évincent la perspective d’une vérité unique au profit d’une démultiplication du récit, soumis non plus à la ligne directrice de l’enquêteur, mais au foisonnement des témoignages, sentiments et mensonges des suspects potentiels. Or, le personnage du suspect « n’en finit pas de se dire », ainsi que le souligne Jacques Dubois :
« Le
suspect-témoin est ce personnage que l’on n’en finit pas de soumettre à un
interrogatoire, qui n’en finit pas de se dire et qui autorise l’invasion du
texte par d’abondants dialogues. Stimulé par l’enquêteur, son discours
effervescent charrie le flux du réel et de l’imaginaire, du précis et de
l’approximatif, du vrai et du faux. Il est ce fatras dont seules méritent
d’être dégagées quelques données précieuses, quelques pierres vouées à bâtir
l’édifice de la solution. »[893]
En l’absence d’enquêteur capable d’extraire ces « quelques pierres vouées à bâtir l’édifice de la solution », c’est donc au lecteur de tenter de reconstituer patiemment les différentes pièces du puzzle, de distinguer le vrai du faux, de bâtir sa propre version du récit du crime ou plus largement du texte absent. Il s’agit, d’une certaine manière, de donner l’illusion d’établir une liaison directe entre les personnages et le lecteur. Les deux romans de M. Condé, Traversée de la Mangrove et La Belle créole, se présentent en ce sens comme des « roman[s] d’atmosphère policière sans policiers », selon la formule adoptée par André Malraux à propos du roman de William Faulkner, Sanctuaire :
« Faulkner
sait fort bien que les détectives n’existent pas ; que la police ne relève
ni de la psychologie ni de la perspicacité, mais bien de la délation ; et
que ce n’est point Moustachu ni Tapinois, modestes penseurs du quai des
Orfèvres, qui font prendre le meurtrier en fuite, mais la police des garnis,
car il suffit de lire les mémoires des chefs de police pour voir que
l’illumination psychologique n’est pas le fort de ces personnes, et qu’une
“bonne police” est une police qui a su mieux qu’une autre organiser ses
indicateurs. […] Sanctuaire est donc un roman d’atmosphère policière sans
policiers, de gang aux gangsters crasseux, parfois lâches, sans
puissance. »[894]
C’est donc, dans Sanctuaire comme dans Traversée de la Mangrove notamment, la parole de ces « indicateurs » qui intéresse véritablement le récit. Nara Araujo évoque, en ce sens, les « affinités électives » s’établissant entre les textes de M. Condé et « la narration faulknerienne où l’énoncé/vérité est relativisé, à partir du sujet de l’énonciation »[895].
Cette relativisation de l’« énoncé/vérité » prend effectivement tout son sens à la lumière de ce que nous serions tentée de qualifier d’« incidents » ou de « revers » de lecture, effritant progressivement la confiance établie initialement entre scripteur et récepteur dans le cadre du pacte de lecture.
Livré à la subjectivité de l’énonciation, le lecteur de Traversée de la Mangrove ne cesse, en effet, de subir des revers de lecture engendrés par la confrontation des différentes voix oeuvrant à la construction du récit. Grâce au témoignage de Moïse, nous découvrons, par exemple, que Sancher possède une malle remplie de billets de banque :
« Une
fois la malle ouverte, Moïse eut un saisissement. De l’argent ! Des
billets de banque ! Plus qu’il n’en avait jamais vu depuis qu’il avait
déserté le ventre de Shawn. Pas seulement des français, bonasses et familiers,
mais des billets étrangers, des américains, verts, étroits, tous semblables et
par là même trompeurs, perfides. Combien y en avait-il ? »[896]
Or, tandis que la précision de la description des billets, associée au discours indirect libre, contribuent à attirer l’attention du lecteur sur cette découverte extraordinaire, un autre personnage -Carmélien- vient contester, dans le dernier quart du roman, la véracité du témoignage de Moïse concernant ces billets :
« Il
se rapprocha et, de l’angle où il prit place, il eut vue sur la moitié
inférieure du cercueil. Pas du beau bois ! Toutefois, ils n’allaient pas
dépenser de l’argent pour un salaud ! La malle était vide, à part quelques
papiers sans intérêt, vieilles lettres, mince brochure qu’ils avaient reléguée
dans le fond d’un placard. Où Moïse avait-il vu des liasses et des liasses de
dollars ? Sans doute, ce soir-là, le bougre était-il saoul. »[897]
Confronté à ces deux versions contradictoires, opposant le témoignage d’un homme et le constat d’un autre, le lecteur multiplie les hypothèses : Moïse a-t-il affabulé, cherché à attirer l’attention ou a-t-il réellement vu ces billets ? Carmélien, rongé par la haine, ne prétend-il pas que la malle était vide pour justifier hypocritement le peu d’efforts consentis à l’égard du choix du cercueil ? Il est encore possible que tous deux disent vrai ; dans ce cas, qu’est-il advenu de l’argent ? Quelqu’un l’a-t-il volé et, si oui, ce vol a-t-il un rapport avec la disparition de Sancher ? Le témoignage de Carmélien, survenant après celui de Moïse et constituant la dernière version apportée sur le sujet, devrait-il avoir plus de poids aux yeux du lecteur ?
Le lecteur serait effectivement tenté d’accorder davantage de crédit au témoignage de Carmélien, d’autant que Moïse est à maintes reprises décrit comme instable psychologiquement et buveur, mais ce choix demeurerait purement subjectif : aucun élément du récit n’affirme ni n’infirme aucune des hypothèses proposées. Dans Traversée de la Mangrove, le lecteur semble libre de son interprétation, invité à prendre part à la création. Aucune vérité ne lui est délivrée dans la mesure où le récit est entièrement régi par la voix ou le regard de personnages non-omniscients. L’énonciation se fait, en ce sens, le reflet des passions, des hallucinations, des errements, des erreurs d’appréciation du sujet, renvoyant finalement le lecteur à sa propre condition, le livrant à l’incertitude. L’objectif de M. Condé tend, à cet égard, à se rapprocher de celui des Nouveaux Romanciers qui, à l’image d’Alain Robbe-Grillet, reprochent notamment au roman balzacien de viser à « imposer l’image d’un univers stable, cohérent, continu, univoque, entièrement déchiffrable »[898], de présenter le monde comme intelligible et par là même racontable. Pour les Nouveaux Romanciers, il s’agira, au contraire, de s’accorder à la complexité du monde, à ses incertitudes, à ses incohérences, de privilégier une « écriture de l’approximation, de la suspension, de l’entre-deux »[899].
Cette perspective apparaît comme un leitmotiv dans les romans de M. Condé notamment, où le lecteur est confronté à des revers de lecture, mettant en cause ce qu’il sait et bouleversant également ce qu’il perçoit : les contradictions ne sont pas seulement internes au récit, elles ne concernent pas uniquement les données informatives qu’il livre, mais elles gagnent le processus de lecture lui-même. Un passage puisé dans La Belle créole nous paraît, à cet égard, significatif.
Après avoir refusé son aide à Dieudonné, Boris, envahi par le remord, part à la recherche de son ami. Tandis qu’il est victime d’une panne de voiture, Boris aperçoit des dizaines de flambeaux affluant vers une maison où se tient vraisemblablement une veillée. Intrigué par l’identité du défunt, il se mêle aux villageois, « écoutant avidement leurs réflexions » :
« - Si
c’est pas malheureux, disait un vieux-corps […] en le prenant à témoin.
Personne ne veut la mort du pécheur. Il avait été acquitté. Maintenant, une
nouvelle vie l’attendait !
- Qui
ça ? Qui ça ? De qui parles-tu ?
Mécontent
de ces questions, le vieux corps ne répondit pas. »[900]
Ne parvenant pas à obtenir de réponse, Boris finit par se frayer un chemin jusqu’à la chambre à coucher où repose le défunt, tandis que le lecteur, guidé par les indices livrés par le « vieux-corps », anticipe déjà la mort de Dieudonné :
« Sur
le lit qui occupait l’essentiel de l’espace, un jeune homme, presque un enfant,
reposait. Il portait une combinaison très moderne […]. Ce fut ce vêtement peu
commun qui attira l’attention de Boris. Il bouscula les gens de droite et de
gauche, arriva à proximité de la couche mortuaire : Dieudonné.
Une flèche
de douleur, si violente, lui transperça la poitrine qu’il reprit conscience, le
nez sur le volant de sa Toyota, trempé, transi, car les vitres étaient baissées
et la pluie qui tombait l’avait inondé. Un rêve. C’était un rêve dont les
images s’accrochaient, tenaces et terrifiantes à son esprit ! »[901]
Il est probable que, guidé par le point de vue de Boris, le lecteur ait cru à la mort de Dieudonné ; or, une lecture attentive, voire suspicieuse, aurait pu lui laisser entrevoir le caractère fantasmatique du récit livré par Boris. Voici, en effet, la manière dont ce dernier décrit la maison, alors qu’il voit arriver les multiples flambeaux :
« Des
dizaines de bougies brûlant à même la terre formaient un tapis de feu. En son
mitan, une maison se posait qui semblait descendre du ciel, tournoyant sur
elle-même comme une toupie. Peu à peu, sa forme émergeait de l’ombre. Elle
flottait, se balançait comme un vaisseau sidéral, puis se posait, rayonnant
dans la noirceur tel un diamant dans un écrin de velours noir. »[902]
Attentif aux faits, maintenu dans l’attente par un récit empreint de suspense, ne cessant de procéder par retardements, le lecteur peut[903] finalement occulter les différents indices textuels que lui transmet le caractère métaphorique de la description, pour finalement n’y revenir qu’après coup. La manière dont le récit se construit autour de l’histoire de Dieudonné, par flash-back lacunaires suscitant le besoin de savoir du lecteur -ce même besoin qui s’exprime à la lecture d’un roman policier-, contribue, en effet, à valoriser le signifié au détriment du signifiant. Les différents « incidents » venant déstabiliser le pacte de lecture, participent en ce sens de la contestation de ce besoin de savoir et de ses effets réducteurs sur la lecture. Dans Traversée de la Mangrove ou encore La Belle créole, le roman ne se limite pas à ce que le lecteur sait ou à ce qu’il a appris ; il se réalise au contraire dans tous les non-dits, les non-sus, les zones d’ombre, dans tous les possibles textuels qui subsistent au terme de la lecture.
Cette perspective s’avère être encore plus explicitement revendiquée dans le roman de Raphaël Confiant, Brin d’amour, qui s’achève sans que le lecteur ne sache avec certitude qui est l’auteur des deux meurtres ayant bouleversé le village de Grand-Anse.
Tout au long de l’enquête, en effet, les hypothèses et les versions du récit du crime se multiplient, toutes plus ou moins cohérentes les unes que les autres : les deux victimes, l’un séducteur effréné, l’autre extorqueur de fonds, ont certainement subi la vengeance d’un de leurs nombreux ennemis. Le détective Amédien se révélant incapable d’imposer sa version, le récit se répand en une multiplicité de possibles : Lysiane reconnaît les meurtres en accusant les victimes de l’avoir violée, mais le détective ne la croit pas ; Wadi Bachour, le père d’une des victimes, aurait assassiné son fils et l’extorqueur de fonds pour hériter d’une forte somme et préserver ses intérêts ; le béké Chénier de Surville pourrait également avoir tué pour une sombre affaire de combats de coqs ; il est même question de la culpabilité du père Stegel, qui aurait vengé sa fille cachée, victime des malversations des deux disparus. Tandis que l’incertitude demeure, que le lecteur se perd dans les possibles textuels, la « liseuse-écriveuse » Lysiane annonce finalement « le terme de cette comédie grivoise »[904]. Présentant le détective privé et le journaliste réquisitionnés pour résoudre l’affaire comme « des hommes passés à côté de leur cri »[905], elle proclame que seule l’écriture détient la vérité et qu’en tant qu’« écriveuse », elle renonce à livrer cette vérité :
« Qu’on
le sache ! nul n’éventrera jamais le secret de la mort brutale du
bâtard-Syrien, ni celui de la noyade du pasteur adventiste. Ni celui de la
fuite définitive du rentier Siméon Désiré.
Le mot se
terminera en moi dans le délabrement interlope des plus hautes seigneuries du
ciel. »[906]
Aussi, les derniers espoirs du lecteur, désireux de savoir « qui a tué ? », s’évanouissent définitivement, peu après cette déclaration : alors que le père de Lysiane, le conteur Tertullien Augusta, entame un conte prétendant retracer « la vérité nue »[907], Bogino vient interrompre ses paroles avec un chant qui finit par captiver l’assemblée, recouvrant la voix du conteur. Ainsi que l’avait annoncé Lysiane, le secret de ces deux meurtres demeure inéluctablement prisonnier des mots, à la fois étouffé dans la gorge du conteur et scellé dans les silences de l’écrit. Or, cette prise directe de pouvoir de l’« écriveuse » sur le récit porte un coup fatal à la notion même de « pacte de lecture », sacrifié dès lors à l’affirmation de plus en plus marquée du scripteur omniprésent et omnipotent.
Dans les romans s’inspirant de la forme policière, sans en respecter ni les règles ni la finalité, le scripteur tend à faire remarquer sa présence, à prendre de plus en plus de place au sein même du récit, laissant entrevoir les ficelles, les rouages du texte en construction. C’est ainsi qu’au fur et à mesure que le scripteur tend à exister, à se rendre visible au sein du texte, l’unité du roman se désagrège progressivement, entraîné -à première vue pour le moins- dans un véritable processus d’autodestruction.
2- Processus de démembrement du roman
Ainsi que nous l’avons précédemment souligné, la fiction policière multiplie les contradictions et elle apparaît notamment paradoxale par principe, en ce qu’elle implique la mise en place d’un pacte de lecture faisant de l’illusion sa pierre angulaire, tout en demeurant astreint à l’obligation de crédibilité nécessaire à l’adhésion du lecteur : bien que conscient du caractère ludique du contrat de lecture proposé par le genre policier, le lecteur doit croire au crime, à l’enquête, aux rebondissements, aux révélations et il ne peut logiquement mettre en doute le raisonnement de l’enquêteur. Invité à mener sa propre enquête, à exercer son propre raisonnement, le lecteur de fiction policière doit avoir l’illusion d’être confronté à une énigme qu’il a le pouvoir de résoudre. Or, dans le schéma policier classique, le lecteur n’a jamais le dernier mot et même s’il soupçonne à juste titre le coupable dénoncé in fine, l’enquêteur prend toujours le dessus en exposant théâtralement ses conclusions, ce que le lecteur, privé de public, ne peut se permettre. En outre, tandis que le lecteur se lance à la poursuite de l’enquêteur -et non du criminel, puisqu’il s’agit avant tout, pour le lecteur, de relever le défi de l’enquête et non de combattre le crime- et s’engage sur le terrain de la raison en quête de la clé de l’énigme, le scripteur, quant à lui, opère en amont du récit, au niveau non de la logique, mais bien de l’esthétique, voire de la rhétorique[908].
Réunis autour de l’intrigue, scripteur et lecteur ne se rencontrent donc jamais directement au sein du récit, le premier dissimulant sa présence sous celle de l’enquêteur, sa stratégie narrative sous les directives de l’enquête et maquillant sa voix sous la mise en place d’un mode énonciatif polyphonique, grâce à la perspective du témoignage suspect. Or, laissant croire à son absence, le scripteur apparaît néanmoins, tout au long du récit, notamment à travers l’« arbitraire évènementiel »[909] conduisant à la solution de l’énigme et se cristallisant en une forme d’« arbitraire énonciatif », véhiculé par la version finale imposée par l’enquêteur. La « réussite » de la fiction policière dépend, en ce sens, du maintien d’une tension contradictoire reposant sur l’équilibre déterminant la présence/absence du scripteur au sein du récit : plus le scripteur agit sur le récit -en veillant, par exemple, à la vraisemblance, des enchaînements, à la mise en valeur de la perspicacité de l’enquêteur ou encore au maintien du suspense, par différents effets d’attente travaillés- moins il s’y laisse percevoir, laissant au lecteur l’impression de suivre un récit en construction, voire en auto-construction.
2.1- Présence/absence du scripteur
Le premier signe de cette forme de présence/absence caractéristique du scripteur de fiction policière, réside en un paradoxe pouvant s’établir entre le cadre paratextuel propre au genre et le texte lui-même. Ainsi, défiant la perspicacité du lecteur ou encore suscitant sa curiosité par une série de questions intrigantes généralement posées en quatrième de couverture, le paratexte encadrant généralement la fiction policière participe d’une mise en abyme du texte qui, dès l’ouverture du récit, veille à l’inverse à effacer toute trace apparente de jeu, tout élément extérieur à l’intrigue. De même, l’introduction d’un intertexte faisant écho à quelques grandes figures (détectives ou auteurs) du genre -nous avons vu précédemment[910] que la plupart des auteurs de notre corpus ne manquaient pas de se référer ironiquement à leurs prédécesseurs les plus célèbres- fonctionne de manière ambivalente au sein du récit : tout en entraînant le récit au sein d’une réflexion métatextuelle, le recours à cette intertexte permet très souvent à l’auteur de se désolidariser de ces modèles du genre, afin d’offrir davantage de crédit au déroulement de l’intrigue ou encore de renforcer l’illusion référentielle déterminant le contrat de lecture. Il semble donc que tout en servant la cohérence du récit, paratexte et intertexte trahissent l’invisibilité du scripteur, éventuellement tenté, par ailleurs, de succomber à la perspective d’une visibilité plus marquée ; la mise en scène de personnages d’écrivains semble notamment participer de cette tentation.
2.1.1- L’écrivain en scène
Dès les débuts du genre policier, la figure de l’écrivain ou plus précisément du scripteur, a eu un rôle à jouer au cœur même du récit, se confondant la plupart du temps avec celle du narrateur chargé du récit de l’enquête : il en est ainsi du Dr Watson, assurant la chronique des enquêtes de Sherlock Holmes, héros de Conan Doyle, ou encore du Capitaine Hastings, compagnon d’Hercule Poirot, dans quelques romans d’Agatha Christie. Il s’agit avant tout, pour ces scripteurs, de se poser en faire-valoir du fin limier en racontant par le détail, mais également en commentant non sans une certaine emphase, le déroulement des investigations de ce dernier. A cet égard, la mise en valeur du brio de l’enquêteur dépend, en partie, de l’admiration de son observateur/scripteur ; admiration constitutive, d’une certaine manière, du manque de perspicacité de ce « chroniqueur », simple transcripteur du génie d’un autre. Ainsi, selon Uri Eisenzweig :
« Watson
et ses pairs ne savent pas ce dont ils parlent. Mais cette déficience n’est pas
accidentelle. Bien au contraire, elle est nécessaire au fonctionnement et à la
crédibilité du récit policier, puisque le mystère qui fonde celui-ci exige, non
pas que l’on se taise, mais bien que l’on parle tout en ne disant précisément
pas ce qui est à savoir. Autrement dit, l’aveuglement de Watson le critique
conditionne l’efficacité de Watson le chroniqueur. En d’autres termes
encore : ce n’est qu’en parlant de Holmes sans le comprendre qu’on peut le
créer. »[911]
Le personnage de l’écrivain enrichit donc la fiction policière de sa capacité à raconter ce que lui-même ne peut pas dire, révéler, comprendre ; il cristallise, en un sens, cette tension, que nous évoquions plus haut, entre le dit et le non-dit constitutifs du récit d’énigme. C’est précisément cette tension que manifestent les différentes figures d’écrivain reproduites dans quelques-uns des romans de notre corpus, tels Solibo Magnifique, Brin d’amour, Traversée de la Mangrove, La Belle Créole ou encore les romans mettant en scène les enquêtes du commissaire/écrivain Brahim Llob.
Le personnage du « marqueur de paroles », créé et mis en scène par P. Chamoiseau, constitue la figure la plus ressemblante du scripteur watsonien, en ce qu’il se propose de simplement retranscrire, témoigner, raconter cette fameuse soirée de carnaval où l’un des derniers conteurs de Fort-de-France trouva la mort. Or, de même que la fonction de Watson ne consiste pas, en réalité, à retranscrire les enquêtes de Sherlock Holmes, mais bien à jouer le rôle de faire-valoir d’un personnage que Conan Doyle s’efforce de faire passer pour exceptionnel, le « marqueur de paroles » est loin d’être le simple transmetteur, transcripteur d’une histoire ; comme Watson, il en est l’interprète, incarnant par là même la stratégie narrative du scripteur. Le « marqueur de paroles », personnage du roman, capte ainsi l’attention du lecteur en lui donnant l’illusion de suivre un récit se construisant de l’intérieur, s’« auto-gérant » d’une certaine manière. Signant la présence intratextuelle d’un scripteur, il tend à éclipser, par ailleurs, le véritable créateur du récit, ni « marqueur de paroles », ni « oiseau de Cham », ni « Chamzibié », mais Patrick Chamoiseau, auteur du roman Solibo Magnifique.
Cette fausse indépendance accordée au « marqueur de paroles » semble également participer de la figure de l’écrivain, telle que la développe Raphaël Confiant, dans Brin d’amour.
Lysiane, l’« écriveuse » mise en scène par R. Confiant, caractérise une parole à la fois orale et écrite, fonctionnant de manière énigmatique. Les « Cahiers » qu’elle tient sont ainsi recouverts d’une « fine écriture quasi illisible »[912], de « lignes énigmatiques »[913], suscitant chez ses proches à la fois curiosité, peur, colère, moquerie ou encore admiration. Les Grand-Ansois ne comprennent pas le langage de l’« écriveuse » et tandis qu’ils accusent la jeune femme de « déparler », cette dernière prétend détenir, grâce à l’écriture, le seul vrai langage qui soit :
« Je
dois donc lutter avec chaque mot avant de le tracer sur la feuille, comme pour
le purger de ses miasmes. Comme pour le purifier. Sinon je me trahis à chaque
pas et me joue de moi-même. Je plains donc ceux qui n’écrivent jamais, car ils
passeront à côté de leur vie, munis pour tout sésame d’un faux langage, comme
on dit de la fausse monnaie. […] Il n’y a guère ici-là que la coulée d’amour et
son chapelet de phrases apparemment biscornues pour s’approcher un tant soit
peu d’un langage qui soit notre vérité vraie. »[914]
Contrairement au scripteur watsonien, la figure de l’écrivain tend, chez R. Confiant, à jouxter la perfection : Lysiane sait, voit, sent, comprend tout ; elle plane au-dessus du reste du monde, à la manière de cette boule de feu survolant la ville. De plus, les rares personnes à avoir pu approcher cette perfection -notamment Siméon Désiré, maître de la coulée d’amour ou Milo Deschamps, ayant reconnu en Lysiane une poétesse- ont mystérieusement disparu de Grand-Anse et c’est finalement Lysiane elle-même qui se voit contrainte de « déshabiter le monde » emportant avec elle ces secrets inaccessibles au commun des mortels. A l’inverse du schéma prisé par Conan Doyle, l’enquêteur mis en scène par R. Confiant se révèle être, en effet, indigne du talent scriptural de Lysiane. L’énigme demeure donc scellée par le génie de l’écrivain, le non-dit illustrant finalement un dit incompris, ce qui n’est pas sans laisser parfois le lecteur perplexe, confronté à cette irrémédiable -semble-t-il- inaccessibilité de l’écrivain. En effet, soumettant autoritairement le lecteur aux directives de l’« écriveuse » Lysiane, R. Confiant semble stériliser, d’une certaine manière, le pouvoir créatif de la lecture, en monopolisant la conduite de la parole : la présence du scripteur vient ici annihiler toute initiative créatrice extérieure à celle de l’auteur.
A l’omniprésence pesante de Lysiane/Confiant sur le récit s’oppose, en ce sens, l’absence affichée de l’écrivain Sancher, mis en scène par Maryse Condé, dans Traversée de la Mangrove.
Ecrivain inaccompli enfermé dans l’impasse d’un titre castrateur, personnage absent découvert mort dès l’ouverture du récit, Sancher ne va néanmoins cesser, tout au long du roman, d’alimenter la parole s’étendant du ronronnement des prières de circonstance aux confessions intimes des uns et des autres. Source d’interrogations, de quiproquos, de mésentente ou encore de trahison, la présence de l’écrivain Sancher à Rivière au Sel cristallise, en un sens, l’incommunicabilité caractérisant les liens communautaires régissant le village. C’est néanmoins autour de la dépouille de la victime, dans l’expression intime du rapport de chacun à l’étranger décédé, que les villageois parviennent finalement à raconter Sancher et à se dire entre eux, dans le silence de leurs consciences réunies.
Ayant transmis à chacun une part de son histoire, de ses angoisses, de ses colères ou encore de son amour, l’écrivain Sancher a, d’une certaine manière, dispersé au sein de la communauté les différents ingrédients de son roman impossible, à savoir cette part « de sang, de rires, de larmes, de peur, d’espoir, enfin tout ce qui fait qu’un livre est un livre et non pas une dissertation de raseur, la tête à demi fêlée »[915]. C’est en effet une foule de sentiments, de sensations impalpables qui s’expriment tout au long du récit, au fil des confessions directes ou indirectes des villageois, soumettant le lecteur à une subjectivité multiple et insaisissable, la figure de l’écrivain se faisant simple catalyseur d’un récit véritablement pris en charge par ses propres composants.
Cette perspective, tendant à limiter le rôle de l’écrivain dans la construction même du récit, paraît également suggérée dans le roman intitulé La Belle créole.
Sans être directement représentée au sein du roman, la figure de l’écrivain s’avère être néanmoins investie, dans le roman de M. Condé, par le personnage de l’avocat qui, confronté au silence de son client accusé de meurtre, se voit contraint d’inventer le récit du meurtre :
« Il
s’était mis à l’œuvre tout seul, construisant le réel à partir de son
imaginaire, comme un romancier, édifiant ou rejetant patiemment diverses
versions du drame. »[916]
Influencé par « l’histoire singulière du pays »[917] autant que par l’engagement de son père, fervent défenseur de la « cause noire » et auteur d’un pamphlet intitulé « Nous ne serons plus les lupanars de l’Occident », l’avocat chargé de défendre Dieudonné, homme de couleur accusé du meurtre de Lorraine, sa maîtresse blanche, construit alors sa version des faits à partir d’une argumentation jugée « césairienne, voire fanonienne »[918] : oppressé, maltraité par la femme blanche autoritaire, l’amant de couleur, brimé, s’est brutalement révolté afin de renverser sa triste condition d’homme soumis. Après avoir emporté l’adhésion du jury et permis la libération de Dieudonné, l’avocat est alors soudain envahi par le doute, persuadé d’avoir mal déchiffré le silence de son client :
« A
présent, ce mélodrame qui avait si bien emporté l’adhésion d’un jury crédule,
lui semblait sans imagination. Ses acteurs s’étaient bornés à reprendre les
vieux rôles du répertoire, à endosser les costumes archi-usés par la tradition.
Il s’était trompé : un drame moderne, entièrement moderne se cachait
derrière ce paravent aux motifs éculés. »[919]
L’avocat, double de l’écrivain -et plus précisément d’un « romancier »- réalise avoir séduit le jury et plus largement le public, avec une version passéiste, édulcorée et surtout complètement fausse. Dieudonné, privé de vérité, devenu « un bwa-bwa de carnaval, habillé d’oripeaux, travesti des fantasmes de ses compatriotes »[920], est alors envahi par ses souvenirs, détenteurs du véritable récit du crime. Livré à sa propre conscience, Dieudonné laisse ainsi percer la véritable histoire du crime, celle d’un homme fou amoureux d’une femme en qui il croyait retrouver la figure de sa mère décédée et qu’il tua accidentellement, en état de légitime défense. Une fois encore, l’« histoire vraie » s’écrit en marge de la figure du scripteur, en réaction contre elle ; le scripteur se fait, à nouveau, le catalyseur du récit, sans pour autant prendre en charge sa construction.
Qu’il s’agisse, comme s’y emploie M. Condé, d’émarger la figure du scripteur ou, à l’inverse, sur le modèle de P. Chamoiseau ou de R. Confiant, de lui offrir explicitement une représentation et un rôle centraux au sein de l’organisation et de la constitution du récit, l’impression laissée par cette mise en scène de l’écrivain tend à suggérer le caractère autonome du récit, se construisant de l’intérieur. Ainsi, comme le souligne Jean-Claude Vareille :
« Dans
cette obstination que met le roman policier à nous présenter en son sein des
écrivains et des écrivants, à démultiplier par d’infinies reproductions
spéculaires les problèmes de son propre engendrement, réside bien la preuve
qu’il est le roman d’un roman et une des images des problèmes auxquels se
heurte tout scripteur à la recherche de son texte. Proclamant à chacune de ses
pages qu’il est une œuvre artistique, inscrivant sa littérarité dans son
organisation formelle, il accumule les images de sa production et de sa
propension à la réflexivité. »[921]
Avant de nous pencher plus précisément sur les tenants et aboutissants de la quête du scripteur à la recherche de son texte, intéressons-nous un instant à la réflexivité du texte, à la manière dont il s’auto-alimente, à ce qui constitue ses « moteurs » internes, en abordant notamment la question de l’indice.
2.1.2- Le motif indiciel
Au moment où l’enquêteur part en quête de la clé de l’énigme, tous les éléments constitutifs du crime et nécessaires à sa reconstitution préexistent à l’enquête, puisque le crime a déjà eu lieu. L’objectif de l’enquêteur consiste ainsi à révéler le crime, à en rendre les tenants et aboutissants visibles.
Au niveau de l’intrigue, c’est donc l’interprétation des indices, autrement dit des éventuelles traces laissées par le criminel, qui fait avancer l’enquête. A cet égard, l’enquêteur occupe la fonction de « détecteur de signes qui tente de rétablir les bonnes connexions »[922]. Observant minutieusement les abords du lieu du crime, s’appuyant sur les conclusions du médecin légiste ainsi que sur les différents rapports scientifiques susceptibles d’étayer ses investigations ou encore se fiant à son intuition, l’enquêteur tente de déterminer, dès son entrée en scène, la liste des éléments pouvant être porteurs d’une information quelconque. C’est, en effet, en fonction de son potentiel informatif qu’un détail a priori négligeable, qu’un objet apparemment quelconque peut soudainement être épinglé à la précieuse liste des « indices », glissant de l’univers de l’insignifiant à celui du signe ; Jacques Dubois résume ce processus :
« Aux
yeux du détective, l’indice est, dans son contexte immédiat, un objet sans
valeur, un détail négligeable mais qui soudain fait sens parce qu’il pointe un
autre objet, une autre réalité dans un autre contexte. C’est bien là un geste
d’indexation. »[923]
Ce procédé d’indexation, faisant basculer l’insignifiant dans l’indiciel, révélant un sens jusque-là dissimulé, s’avère être le fait de l’enquêteur et il semble même qu’il émane littéralement de lui. En effet, si le relevé des indices relève globalement de la simple observation, leur interprétation engendre un processus s’apparentant, à certains égards, à la révélation subconsciente.
Un indice n’existe comme tel que
dans la mesure où il demeure partiel : il résulte d’une trace, d’un reste
et ne peut donc être explicite. Pour comprendre l’indice, l’enquêteur doit donc
partir en quête de sa partie cachée, refoulée. Or, c’est généralement après
avoir maintes fois regardé, analysé, commenté un élément a priori
insignifiant, que l’enquêteur, à la lumière d’un nouvel angle de vue ou d’un
quelconque renseignement supplémentaire, finit, à la faveur d’un
« déclic », par transformer le signe jusqu’alors considéré
strictement comme tel, en signal. A partir de cet instant, l’enquêteur/détecteur
de signes devient enquêteur/interprète ; l’indice ne se contente pas
d’exister, il montre, voire démontre. Au terme de ce que le lecteur perçoit
généralement comme un éclair de génie, l’enquêteur peut alors réunir les
différents éléments du puzzle, les contours des différentes pièces le
constituant ayant ainsi été définis, les signifiants ayant finalement retrouvé
leurs signifiés. Dès lors, le propos de l’enquête consiste à réorganiser le
récit en substituant à la présentation anarchique des différents faits et
témoignages une série de liens logiques que l’enquêteur s’efforce de tisser
patiemment.
Etablissant, dans le cadre de l’intrigue, la liaison entre l’enquêteur et le criminel, l’indice fonctionne, au niveau du récit cette fois, comme un véritable point de connexion entre le lecteur et le scripteur. Tandis que l’enquêteur part à la recherche de traces visibles susceptibles d’étayer la reconstitution du crime (empreintes, traces de pas, débris, meubles déplacés, objets incongrus, etc.), le lecteur, sur les traces du récit, se met quant à lui en quête de lisibilité, concentrant son attention autant sur les différents témoignages des suspects que sur les éventuels indices que pourrait laisser échapper l’enquêteur, concernant ses hypothèses, déductions et intuitions. Dans le cadre de la fiction policière, en effet, l’indice est à la fois d’ordre référentiel -dans une perspective intra-textuelle- et narratif -selon une approche extra- voire méta-textuelle-, se nouant dans les deux cas autour de la coexistence du dit et du non-dit, du savoir et de l’énigme. Ce double niveau de fonctionnement de l’indice est notamment commenté par Daniel Couegnas :
« Accepté
comme fragment “innocent” de la réalité, l’indice peut être interprété,
permettant ainsi à l’enquête d’avancer. Considéré maintenant comme élément d’un
édifice intellectuel totalement soumis aux volontés conscientes (sans parler
des autres) de l’écrivain, l’indice procède d’un dosage subtil entre l’information qu’il est censé apporter au
lecteur et le mystère du codage ou de
la rétention de cette information.
L’indice efficace est celui qui, donnant l’impression au lecteur qu’il a fait
un pas en avant dans l’enquête, lui fait faire en réalité deux pas en
arrière. »[924]
Ainsi, tout en donnant l’illusion, au niveau de l’intrigue, de signifier malgré lui, de relever de l’imprévu ou encore du lapsus, l’indice témoigne, au niveau du roman et plus largement de la lecture, de l’élaboration d’une stratégie narrative. Autrement dit, comme l’indique Jacques Dubois, différenciant la « nature » de l’indice, de sa « fonction dans le dispositif textuel »[925] :
« C’est
toute la question de la visibilité de l’indice ou encore de sa marque qui se
trouve ainsi posée. L’alternative est la suivante : au nom de l’énigme, du
jeu herméneutique, les indices demandent à être parsemés dans le texte sans
être désignés pour ce qu’ils sont ; au nom du roman, de sa progression et
de sa cohérence, ils réclament d’être reconnus et commentés par le récit au fil
de la reconstitution. »[926]
Soumise de concert à la nécessaire progression de l’enquête et au respect de l’énigme, la présence/absence de l’indice nécessite l’intervention d’un régulateur en lequel se reconnaît traditionnellement l’enquêteur, à la fois garant de la réussite de ses investigations et de l’intérêt du récit. Afin de préserver l’équilibre quelque peu précaire maintenu entre l’énigme et sa résolution, sous la houlette de l’enquêteur, le récit use alors de certains artifices dont participe notamment le faux-indice. La question de la visibilité de l’indice s’avère être, en ce sens, problématique dans la mesure où le visible peut se faire aussi bien révélateur que trompeur ; détail qui n’échappe pas à l’enquêteur, généralement méfiant à l’égard des indices oubliés ou, à l’inverse, laissés volontairement sur son chemin. Dans la plupart des romans policiers, en effet, l’enquête commence par converger très précisément vers un suspect en particulier, généralement innocent, avant de bifurquer sous l’impulsion de l’enquêteur incrédule vers le véritable coupable.
Influencé par l’enquêteur, le lecteur semble invité à faire preuve de la même méfiance à l’égard du récit. Ainsi initié, par la nature du cadre générique, à la lecture du soupçon, le lecteur sait l’évidence trompeuse, ce qui le conduit à disculper automatiquement tout suspect qui paraîtrait trop explicitement coupable. Mais voilà que certains auteurs de romans policiers finissent par prendre en compte et se servir de cette méfiance du lecteur, en plaçant par exemple le coupable sous les traits du suspect le plus évident, et par là même le moins crédible aux yeux du lecteur.
Présentant la caractéristique d’anticiper -ou de tenter de le faire- l’interprétation de ses lecteurs, le récit policier rappelle, avec la question de l’indice, que le paradigme de lecture qu’il propose se veut, pour une large part, ludique. Selon l’intensité du goût du scripteur pour le jeu, le lecteur a plus ou moins de chance de déceler les vrais indices des faux. Quoi qu’il en soit, c’est bien au niveau de l’indice que lecteur et scripteur se rencontrent, se défient, se comprennent ou se surprennent, donnant finalement l’impression de communiquer au-delà du strict cadre de l’intrigue et, d’une certaine manière, en-deçà des mots, de conscience à conscience.
Etayons notre propos en revenant un instant sur le roman de Fortuné Chalumeau, particulièrement riche en ce qui concerne l’approche des procédés d’écriture développés par le récit policier.
Dans Pourpre est la mer, la question de l’indice trouve une représentation tout à fait pertinente de sa visibilité/lisibilité. Dès l’ouverture du récit, alors qu’il est invité à une réception donnée par la future victime, l’inspecteur Laprée, attiré par une odeur d’ylang-ylang[927], « remont[e] l’odeur »[928] jusqu’aux abords d’un balcon, d’où émane le premier indice de son enquête à venir -puisque le crime n’a pas encore été commis. Il surprend, en effet, une conversation laissant entendre l’intention meurtrière d’une femme, complotant avec son complice. Le cadavre de Beudry retrouvé quelque temps après, le parfum d’ylang-ylang devient une pièce à conviction qui ne va cesser de sous-tendre le déroulement de l’enquête. Ainsi, fidèle à sa fonction symbolique de fin limier, Laprée mène son enquête « flair au vent », humant, par exemple, les draps de la veuve dans l’espoir d’y retrouver une trace d’ylang-ylang[929] ; un examen olfactif qui, sans confirmer l’usage de ce parfum par la veuve, révèle néanmoins la probable liaison entretenue par cette dernière avec Diego Herrera y Santos, ayant laissé sur l’oreiller un nouvel indice, « un cheveu noir et luisant qu’un étudiant débutant à l’école de police aurait tout de suite identifié : un splendide poil latino, macho, légèrement gominé… »[930]. Poursuivant ses investigations, Laprée, avec l’appui de son adjoint, parvient à faire parler l’un de ses indicateurs haïtiens, détenant des informations concernant le passé d’Herrera y Santos, alors qu’il vivait encore à Saint-Domingue ; le parfum d’ylang-ylang fait alors une nouvelle apparition.
Tombé fou amoureux d’une veuve éplorée, Herrera y Santos, alors âgé d’une vingtaine d’années, met au point un stratagème destiné à lui permettre de découvrir les pensées secrètes de celle qu’il chérie. Prenant la place d’un prêtre dans le confessionnal, il ne parvient pas à prononcer le discours préparé, troublé par la présence de la veuve dont le « parfum d’ylang-ylang perce le cœur du faux prêtre »[931]. C’est alors qu’il découvre avec horreur que la veuve, fascinée par le « corps d’ébène » de ses employés, multiplie les liaisons avec plusieurs d’entre eux. Envoûté par le parfum d’ylang-ylang, brisé par les révélations qu’il vient d’entendre, Herrera y Santos se réfugie alors dans un « bordel » où il passe six mois avant de ressortir proxénète, se spécialisant dans « l’import-export » de la femme dominicaine. Tandis que cette anecdote paraît anodine, n’apportant rien de concret au déroulement de l’enquête, elle permet néanmoins au parfum d’ylang-ylang de poursuivre son chemin au sein du récit.
Ainsi, alors que deux des suspects, Odile et Franck, ont pris la fuite à bord d’un voilier, chacun pensant l’autre coupable, leur embarcation heurte un conteneur dont s’échappe une voix. Les deux fugitifs y découvrent onze femmes, dont une seule survivante qui leur livre, par bribes, son histoire : elle vient de Saint-Dominigue, veut gagner de l’argent pour offrir une nouvelle maison à sa mère et un certain don Diego, qui lui a promis de l’aider, lui a offert un flacon de parfum avant son départ. Après quelques heures de délire, la rescapée meurt, délivrant le « secret » qu’elle étreignait dans sa main : la photo de sa mère et le flacon de parfum contenant, sans grande surprise pour le lecteur, une essence d’ylang-ylang.
Signe olfactif pour Laprée, signe visuel voire sonore pour le lecteur, sensible à l’effet d’écho autant qu’à l’originalité voire à l’exotisme véhiculé par le mot, l’ylang-ylang marque différentes pistes tout au long du récit, avant d’imprimer sa trace au sein même du mobile du crime -en tant que parfum-, ainsi qu’au travers des aveux des coupables -en tant que mot. Surveillée par Laprée, Wanda s’exclame ainsi :
« Je
l’ai renvoyé au milieu de la nuit, sous prétexte de dormir seule, disait Wanda.
Il pue, ce porc immonde. Chaque fois que je suis au lit avec lui, il m’imbibe
de son odeur d’ylang-ylang. »
Son deuxième complice lui répète alors ces mêmes mots que Laprée avait surpris le premier soir, près du balcon :
« Ne
t’inquiète pas et patiente un peu, ma chérie. Dans un mois, tout sera fini
d’une façon ou d’une autre. »[932]
L’indice révélant finalement son sens à travers les paroles de Wanda, la boucle peut logiquement être bouclée ; au terme d’une scène d’action, les trois coupables sont neutralisés et Laprée peut partir convoler avec Odile, l’ylang-ylang envoûtant laissant place à « une splendide route bordée de lauriers-roses »[933].
Le principal intérêt du procédé employé par F. Chalumeau réside en ce que l’indice participe simultanément et explicitement de l’intrigue et du récit ; il est à la fois indice référentiel et indice narratif, l’un et l’autre fonctionnant de manière autonome. Les différentes anecdotes liées par l’évocation de l’ylang-ylang, fonctionnent ainsi à la manière de micro-récits indépendants, relevant par ailleurs de l’accomplissement d’une histoire commune, tout comme le procédé indiciaire.
La simple reconnaissance du mot « ylang-ylang » permet ainsi au lecteur d’associer différentes images, différentes histoires apparemment distinctes et éloignées, mais en fait constitutives d’un même référent. En outre, cette reconnaissance visuelle offerte au lecteur tend à suggérer l’existence d’une certaine autonomie textuelle, le récit générant ses propres moteurs indiciels. Afin de compléter notre approche de la question indiciaire, il convient en effet de préciser que l’enquêteur n’est pas nécessairement le seul régulateur, le seul médiateur capable de relever les indices et de leur donner une signification garante de l’avancée de l’enquête.
C’est ainsi qu’en l’absence d’enquêteur -ou de prise en charge, par l’enquêteur, de l’organisation narrative-, le récit parvient malgré tout à générer son propre agencement par le recours à différents effets de transition.
Dans le cas de Tombéza, par exemple, le choix de confier la direction du récit à la victime contrainte au silence, et non aux enquêteurs dépêchés pour l’interroger, n’empêche absolument pas de réduire la distance séparant l’énigme de sa résolution. Dans le roman de R. Mimouni, en effet, le récit mime le fonctionnement de pensée de Tombéza, procédant par recoupements, par rapprochement d’idées, si bien que la moindre évocation s’avère être susceptible d’en engendrer une nouvelle. Fidèle à son rôle d’enquêteur, transformant le moindre élément en indice potentiel, l’inspecteur Rahim se fait en ce sens le catalyseur des révélations de Tombéza : multipliant les propos a priori anodins, les discours stériles, Rahim, « mélange de suave naïveté et de roublardise professionnelle »[934], parvient néanmoins à provoquer des réactions chez son auditeur invité à rebondir significativement sur l’insignifiance du bavardage qui lui est imposé. Chaque parole prétendument anodine de l’enquêteur trouve alors un sens dans le système de pensée de Tombéza, transformant l’insignifiant en indice, nous permettant d’appréhender un contenu référentiel porteur d’éléments reconstituant l’histoire de Tombéza et, par glissement, l’histoire de son mystérieux « accident ». Relié à la parole par le discours de l’enquêteur, Tombéza « s’accroche » alors au moindre mot prononcé par cet enquêteur si différent de lui pour livrer sa propre version, selon son propre système référentiel. Considérons, par exemple, le passage suivant rapportant le sentiment de Tombéza à l’égard des propos que lui tient l’inspecteur Rahim :
« Le
voilà qui m’entretient de l’altercation à laquelle il a assisté en arrivant
entre les deux femmes de ménage chargées du nettoyage du pavillon, et me confie
qu’en les écoutant il avait considérablement enrichi son vocabulaire de
grossièretés. Il se dit choqué par le langage ordurier de ces dames, lui qui
manipule ses phrases avec un luxe de précaution […]. »[935]
Ecœuré par la naïveté émanant des propos de l’enquêteur, Tombéza décide alors de rectifier la version de l’enquêteur, en confrontant à un même signifiant -en l’occurrence le mot « dames »- sa propre définition :
« Désolé,
inspecteur, vous vous êtes trompé de mot, il n’y a pas de dames ici, il n’y a
que Amria et sa collègue, dont les algarades sont devenues si coutumières
qu’elles ne retiennent plus l’attention de personne […]. »[936]
Poursuivant en une digression sur la condition féminine, Tombéza souligne, en filigrane, la nécessité d’un usage correct de la terminologie, autrement dit d’une adéquation réaliste entre signifiant et signifié, à partir de la prise en compte d’un contexte référentiel précis. Chaque mot est porteur d’un sens et signale une réalité ; il ne s’agit pas ici de choisir le mot adéquat à un contexte énonciatif donné, mais d’utiliser celui qui s’approche au mieux de la réalité ou du contexte référentiel auquel il se rapporte.
Aussi, lorsque F. Chalumeau utilise l’enveloppe du mot comme vecteur de sens, R. Mimouni tente de signifier au-delà du signifiant, d’amener le signifié à submerger littéralement les mots. Or, cette tension entre signifiant et signifié, constitutive de l’interprétation indicielle, est explicitement au principe même du récit policier et s’avère être implicitement au cœur de tout récit. Ainsi, comme le souligne notamment Marc Lits :
« Le
roman policier est une pure fiction où la solution est moins d’ordre logique
que rhétorique. La découvrir ne demandera donc pas des connaissances
judiciaires, mais plutôt des compétences en analyse de texte pour mettre au
jour une solution inscrite dans les lignes d’un récit de fiction. »[937]
Il ajoute :
« Si
l’énigme est au centre de nos existences, elle est aussi au cœur de toute
narration […]. Plus fondamentalement encore, si le texte littéraire est par
essence une énigme à déchiffrer, n’est-ce pas déjà le cas du langage lui-même,
des mots ? »[938]
Avant de mettre en scène le récit d’une enquête, la fiction policière propose d’entraîner le lecteur dans une véritable enquête littéraire, dans une entreprise de déchiffrage engageant le récit dans un mouvement réflexif. Le texte policier enferme à la fois l’énigme et sa solution, confronte signifiant et signifié, laisse coexister les traces de la présence du scripteur, concepteur d’une stratégie narrative bien huilée, et l’impression d’un fonctionnement narratif autonome, ou encore tend vers une fin qui n’est autre que la reprise d’un début lacunaire : autrement dit, le texte policier donne l’impression de ne pouvoir se réaliser entièrement qu’en « se mordant la queue » ; récit d’une enquête, il demeure avant tout le récit d’un récit, un roman en quête de lui-même.
2.2- Vers le roman en-quête
Proposant, par principe, une lecture unique et définitive, le roman policier classique reposant sur la base meurtre/enquête/résolution, symbolise, d’une certaine manière, la clôture de l’œuvre sur elle-même, en un « piège où se prend la curiosité du lecteur »[939]. Michel Raimond qualifie, en ce sens, le travail du romancier d’« artisanal »[940] ; une qualification propre au roman en général et plus particulièrement explicite au sein du récit policier dont la réussite dépend de l’intérêt suscité chez le lecteur et par là même du savoir-faire du scripteur. Or, de même que le meurtrier cherche à accomplir le crime parfait, c’est-à-dire indéchiffrable, l’auteur de roman policier tente, quant à lui, d’atteindre le récit parfait, autrement dit le récit capable de soumettre totalement son lecteur. En créant des effets d’attente et en suscitant l’intérêt, le questionnement, l’implication du lecteur dans le déroulement de l’enquête, le récit policier tend à atteindre un seuil de lisibilité extrême, en ce sens que le lecteur est totalement pris en compte au sein de l’économie narrative : il participe à la mise en forme du récit, il fusionne d’une certaine manière avec le scripteur ; c’est, au demeurant, l’impression qui lui est laissée. Toutefois, cette impression ne tarde pas à révéler son caractère illusoire, le lecteur n’étant à certains égards, aux yeux du scripteur, qu’un « animal de laboratoire » lui permettant de tester ses effets. Il est, par conséquent, frappant de constater que le lecteur de romans policiers s’avère être, la plupart du temps, un habitué du genre, voire un adepte et rarement un occasionnel. C’est que le genre policier fascine, nous l’avons déjà souligné, et ce, bien qu’il suscite chez le lecteur des sentiments confinant généralement à la déception : lorsque le lecteur n’est pas déçu par la révélation finale -déception résultant de l’intensité de l’effet d’attente maintenu tout au long du récit-, il se sent trompé, voire trahi par la surprise qui l’envahit à l’annonce du dénouement final, alors qu’il croyait posséder, avec la bienveillance du narrateur, toutes les cartes en main.
Littéralement pris de fascination, le lecteur retombe invariablement dans les mêmes pièges, se laisse prendre aux mêmes leurres et retrouve au terme du roman cette même déception qui ne l’empêche pas néanmoins de recommencer et de se prêter une nouvelle fois à ce jeu truqué. C’est, semble-t-il, en cela que le récit policier peut prétendre à la perfection ; il répond à un besoin du lecteur, il exprime à la fois ses envies et ses incohérences et rend finalement le lecteur dépendant. La vraie question que pose le récit policier réside précisément en cette dépendance ; la clé de l’énigme n’est pas celle que l’enquêteur prétend découvrir, mais repose précisément en amont de cette intention. La véritable énigme est celle qui renferme le secret de cette lecture, nécessairement vouée à l’échec et néanmoins sans cesse reproduite. C’est cette énigme fondamentale que certains se sont efforcés de percer, en s’attaquant au mécanisme même du récit policier classique, en quittant délibérément la littérature policière pour tendre vers la littérature de recherche.
2.2.1- Littérature policière et littérature de recherche
Ainsi que le remarque Jacques Dubois, « les grands textes de la littérature policière enfreignent les lois du genre »[941] ; une infraction qui se manifeste sous différentes formes et selon différents objectifs.
L’infaillibilité de l’enquêteur peut, par exemple, être mise en doute par souci de réalisme. Le coupable peut encore être identifié par le lecteur, voire par l’enquêteur, dès l’ouverture du récit, l’enquête consistant alors à réunir les preuves nécessaires à l’inculpation du criminel et symbolisant la lutte du bien contre le mal, plus que celle de la raison face au mystère. Dans une même perspective, il est possible que le roman s’acheve sur l’échec de l’enquêteur confronté non à un individu criminel, mais à une véritable organisation du crime le laissant impuissant ; autant de variations qui tendent notamment à développer, au sein du récit policier, la perspective d’une représentation réaliste, l’inscrivant dans le cadre d’une littérature de type référentiel.
Ces variations relèvent essentiellement du contenu du récit et témoignent de l’adaptabilité du genre, fortement codifié -par conformité au cadre générique imposant le respect de certaines règles-, mais paradoxalement perméable -par souci d’originalité, puisqu’il s’agit avant tout de surprendre le lecteur. Or, en marge de ces variations tolérables et tolérées, se profile le risque d’une pratique outrancière de cette adaptabilité pragmatique propre au genre policier, pouvant dès lors se faire subversive. Ainsi, certains auteurs n’hésitent pas à prendre le genre en défaut, en exploitant justement sa capacité d’adaptation, en investissant pleinement l’immense latitude qu’il offre à ceux qui s’y essaient.
Les possibles textuels dont résonnent les multiples hypothèses formulées par l’enquêteur ainsi que les différentes versions apportées par les témoins-suspects, participent de cette latitude. Dans la mesure où l’enquêteur met fermement un terme à ces possibles, en imposant sa version du récit du crime, cette latitude finit par se perdre, l’adaptabilité du genre se faisant finalement soumission à un schéma narratif. Aussi, comme le remarque Claude Murcia :
« La
forme policière, dans le “bouclage” qu’elle s’impose, ne va pas jusqu’au bout
de la logique de la duplicité qu’elle contient en germe, la clôture résolutive
venant brutalement combler l’hiatus provoqué par l’énigme et restaurer l’ordre
un instant menacé par la transgression de la faute. La littérature de
recherche, non générique, s’empare en revanche de la structure policière pour
en exploiter tous les “possibles” de désordre et d’incertitude. »[942]
Préservant jusqu’au terme du récit la totalité des possibles textuels, la « littérature de recherche », telle que définie par C. Murcia, accrédite d’une certaine manière la validité de l’enquête à laquelle prétend le récit policier. Confronté au doute, à l’incertitude, à l’absence de solution prédéterminée, le lecteur est propulsé au cœur d’une véritable enquête, apparemment sans trucage, sans repères et surtout sans la certitude de résoudre l’énigme. Marie-Hélène Huet résume notamment les perspectives contradictoires développées d’une part, par le texte policier, d’autre part, par la littérature de recherche :
« Dans
le roman policier, le texte est énigme, c’est-à-dire opaque mais réductible à
une interprétation unique qui dissipe les ombres, efface les contradictions et
permet la représentation. A l’inverse, chez Nabokov, Borges, Robbe-Grillet le
texte propose un long cheminement, une errance infinie au détour de laquelle
chaque question se répète, chaque élément se dédouble, chaque solution se
multiplie. »[943]
Ce qui distingue la littérature policière de la littérature de recherche et ce qui fonde la transgression essentielle infligée à la forme policière, demeure en ce sens inscrit dans le choix déterminant l’orientation finale du récit : le texte policier traditionnel s’achève en une issue claire, démonstrative, directive et définitive en mettant un terme à l’intrigue ; la littérature de recherche, illustrée notamment par le roman-enquête, propose à l’inverse un récit sans fin, sans solution ni conclusion véritablement tranchée. Dans le premier cas, le scripteur capture le récit au sein d’un schéma narratif répondant à des attentes et habitudes de lecture ; le second cas fait apparaître un récit errant, insaisissable, laissant une intrigue inachevée et, à certains égards, un lecteur non rassasié.
Notons à cet égard que le récit policier entretient un rapport privilégié avec son lecteur en ce sens qu’avant même son ouverture, il interpelle déjà le lecteur notamment par le biais du paratexte mettant généralement l’accent sur le caractère extraordinaire de l’intrigue, piquant la curiosité du lecteur ou défiant sa perspicacité et sa vivacité d’esprit. En fait, la seule caractérisation policière du récit suffit à interpeller le lecteur qui s’attend à être propulsé dans un univers familier répondant à la codification du genre, tout en aspirant à être surpris et en l’exigeant même, tant il est vrai que le lecteur amateur de fiction policière ne pardonne généralement pas au récit qui lui est proposé de ne pas avoir su le prendre à contre-pied, lui prouvant par là même le bien-fondé de son intérêt pour cette forme littéraire jugée mineure. Le récit policier présente en ce sens la particularité de solliciter explicitement le lecteur et, de fait, de donner l’impression d’instaurer un dialogue ou plus largement un échange entre le scripteur et lui.
Le récit policier semble vraiment exister exclusivement pour le lecteur, l’interpellant, le défiant et lui promettant une lecture aventurière riche en émotions, soumise à l’incertain, mais vouée in fine à la détermination d’une issue. Nous l’avons souligné précédemment, quelle soit rassurante -comme dans le whodunit- ou amère -à l’instar du modèle livré par le hard-boiled- l’issue est là coïncidant avec l’objectif du récit. Dans le cas où l’énigme n’est pas résolue au terme de l’enquête, où elle demeure imprécise, illogique, irrationnelle, floue et par là même interprétable, l’issue du récit s’avère être reportée et d’une certaine manière confisquée au lecteur. C’est ainsi que le récit semble perdurer au-delà du terme du roman sans pouvoir rompre le lien établi autour de l’énigme entre le lecteur et le scripteur. Le récit policier ainsi détourné de son objectif rend finalement compte de l’inachèvement du roman ; une perspective particulièrement sensible dans le roman de M. Condé, Traversée de la Mangrove, ainsi que le souligne Françoise Lionnet :
« Comme
Lucien Evariste qui interroge en vain Francis “pour tenter de mettre morceau à
morceau le puzzle que constituait sa vie” le lecteur reste sur sa faim :
on ne pénètre pas l’opacité irréductible et voulue du personnage dont le vécu
souligne sa singularité, son étrangeté. Le récit reste lacunaire et la mort de
Sancher souligne que dans le réel comme dans le fictif, il existe des zones de
non-savoir et de non-pouvoir que le lecteur doit apprendre à accepter. Le roman
n’est pas un ensemble achevé ; il est riche d’une pluralité de
possibilités qui donnent une multiplicité de sens à la communauté. »[944]
Le roman de M. Condé cristallise en son sein cette tension entre le dit et le non-dit qui définit les relations établies entre Francis Sancher et les habitants de Rivière au Sel et, par glissement, entre la figure de l’écrivain et la population antillaise.
Les habitants de Rivière au Sel attendait manifestement quelque chose de Sancher ; tous ont fini par venir à lui, mais lui n’a pu répondre explicitement à leur demande. Au terme de la veillée, les habitants de Rivière au Sel comprennent néanmoins que Sancher a bel et bien apporté quelque chose à chacun d’eux, en leur permettant de s’interroger sur eux-mêmes, en les confrontant à leurs désirs aussi bien qu’à leurs peurs ; il a été ce « messager » leur permettant de créer le lien entre leur vie et leur identité profonde. Dans la perspective développée par M. Condé, l’écrivain est un intermédiaire et, dans le cas de Traversée de la Mangrove, il est un intermédiaire prisonnier du passé de ses ancêtres colons, englué dans la culpabilité, enchaîné à une conception passéiste de l’identité créole, tout comme l’avocat de Dieudonné dans La Belle créole.
En mettant en avant l’erreur commise par ces deux figures d’écrivain que sont Sancher et l’avocat, M. Condé semble porter un jugement sur la littérature antillaise en général et appeler à un dépassement de la dialectique Blanc/Noir, maître/esclave. Elle souligne en ce sens son désir d’échapper aux schémas traditionnels en un brouillage des repères habituels. Ainsi, lorsque Dieudonné décide de prendre la mer à bord du voilier « La Belle créole », au terme du roman, il est livré à lui-même et s’offre totalement à l’océan : il ignore sa position, les conditions météorologiques qui l’attendent, ne parvient à comprendre les informations livrées par la radio, mais en dépit de tout « cette vulnérabilité, au milieu de la démesure de l’océan fantasque, lui convenait »[945]. Dieudonné ne sait ce qui l’attend, mais il accepte de se livrer à la démesure et à l’incertain. Finalement, il meurt en quête ; de fait, le lecteur n’assiste pas à cette mort et le cadavre n’est pas retrouvé. Dieudonné a d’une certaine manière échappé au terme du récit et l’approche proposée par M. Condé nous permet d’appréhender plus précisément la distinction séparant la littérature policière de la littérature de recherche.
En effet, si comme le commissaire Llob ou l’inspecteur Larbi, Dieudonné et Sancher disparaissent tragiquement au cours ou au terme du roman, c’est vraisemblablement dans une optique différente. Ainsi, les deux policiers algériens succombent finalement des suites de leur volonté de mettre un terme à leur enquête ; ils meurent d’avoir voulu arrêter les coupables et, par extension, d’avoir tenté de se conformer au schéma du récit policier traditionnel. A l’inverse Sancher et Dieudonné meurent en fugitifs : Sancher est venu se terrer dans le village de Rivière au Sel dans l’espoir d’échapper à la malédiction qui pèse sur les hommes de sa famille, autrement dit dans l’espoir d’esquiver la fin qui lui est promise ; quant à Dieudonné, il décide de prendre la mer pour en finir avec la vie et plus précisément pour refuser de se conformer à la vie que la société, par le biais de son avocat, lui a tracée. Si les héros de M. Condé n’échappent pas à la mort et, d’une certaine manière, à leur destin, ils demeurent encore insaisissables au sein du récit : l’énigme de la mort de Sancher n’est pas résolue et la disparition de Dieudonné n’est pas décrite et fonctionne au sein du récit de manière elliptique.
En somme, le roman-enquête pratiqué par M. Condé avorte la perspective du récit policier clos en son sein pour porter à son comble le code herméneutique sous-tendant son déroulement : ici, la question est certes posée, mais sa résolution n’est pas simplement retardée ; elle est indéfiniment suspendue, transcendant les frontières du récit. M. Condé semble renoncer à assigner un sens au monde, respectant, d’une part, la complexité de la société moderne où le manichéisme notamment ne peut guère plus participer d’une approche réaliste -comme en atteste la perspective développée par les auteurs algériens par exemple- et assumant complètement, d’autre part, le foisonnement dont est porteur par principe le récit policier. A l’instar des Nouveaux romanciers, M. Condé semble en effet avoir trouvé dans le récit policier, et plus précisément dans le détournement de la structure traditionnelle du genre, un moyen de restituer au monde sa réalité. Alain Robbe-Grillet développe cette perspective :
« Les
éléments recueillis par les inspecteurs […] semblent surtout, d’abord, appeler
une explication, n’exister qu’en fonction de leur rôle dans une affaire qui les
dépasse. Voilà déjà que les théories commencent à s’échafauder : le juge d’instruction essaie d’établir un
lien logique et nécessaire entre les choses ; on croit que tout va se résoudre
en un faisceau banal de causes et de conséquences, d’intentions et de hasards…
Mais
l’histoire se met à foisonner de façon inquiétante : les témoins se
contredisent, l’accusé multiplie les alibis, de nouveaux éléments surgissent
dont on n’avait pas tenu compte… Et toujours il faut en revenir aux indices
enregistrés […]. On a l’impression, de plus en plus, qu’il n’y a rien d’autre
de vrai. Ils peuvent bien cacher un mystère, ou le trahir, ces éléments
qui se jouent des systèmes n’ont qu’une qualité sérieuse, évidente, c’est
d’être là. »[946]
Proposant une nouvelle conception du rôle du roman, il ajoute :
« Ainsi
en va-t-il du monde qui nous entoure. On avait cru en venir à bout en lui
assignant un sens, et tout l’art du roman, en particulier, semblait voué à
cette tâche. Mais ce n’était là que simplification illusoire ; et loin de
s’en trouver plus clair, plus proche, le monde y a seulement perdu peu à peu
toute vie. Puisque c’est avant tout dans sa présence que réside sa réalité, il
s’agit donc, maintenant, de bâtir une littérature qui en rende compte. »[947]
Il semble en ce sens qu’avec Traversée de la Mangrove ou encore La Belle créole, le récit, et par glissement le mot, ne fonctionne plus comme « un piège où l’écrivain enferm[e] l’univers pour le livrer à la société »[948] ; en somme, M. Condé ne travaille pas à « l’édification du lecteur ». Par la mise en place d’un récit polyphonique, elle ne soumet pas le lecteur à « une vision totalisante de la société guadeloupéenne »[949], mais elle « met en lumière les contradictions, les discontinuités et les limites mêmes de la narrativisation du réel »[950].
Tout en s’insinuant dans les méandres de la mangrove, elle parvient ainsi à s’engager dans la perspective d’un roman ouvert, jouant de la réflexivité permise par le récit d’énigme et aspirant néanmoins à l’opportunité d’une projection dans le futur et vers l’extérieur.
2.2.2-
Réflexivité et projection du récit policier
La fiction policière met en scène une enquête pouvant notamment être perçue dans une perspective ludique ou donner lieu à une représentation critique de la société. Dans ces deux cas précis, il apparaît que le récit policier fonctionne de manière réflexive, racontant finalement l’histoire de son propre engendrement.
Dans le cas d’un récit exploitant les ressorts ludiques permis par la mise en scène d’une énigme à résoudre, le texte contient nécessairement en filigrane les éléments de son propre aboutissement. Marc Lits souligne notamment que la quête programmée par le récit d’énigme n’est pas « orientée vers un objet extérieur qu’un déplacement géographique, et donc narratif, permet d’atteindre, mais est une enquête limitée à ce qui est inscrit dans le texte, avant que le récit ne commence »[951]. A cet égard, la question du fonctionnement indiciel nous a permis de constater que le récit policier pouvait s’auto-alimenter et générer son propre fonctionnement grâce au recoupement des différents indices et témoignages ou encore par le biais d’associations d’idées illustrant le « génie » de l’enquêteur. Or, pour mener à bien son enquête, ce dernier fonde son raisonnement sur ce qu’il a vu, ce qui a été dit ou fait ; en somme sur ce que le texte a déjà pu relater ou livrer plus ou moins explicitement.
Cette réflexivité propre à la fiction policière, portant en son sein l’objet même de sa raison d’être, se retrouve également dans le cadre d’un récit privilégiant la critique à l’aspect proprement ludique. En effet, la variante noire du roman policier ne cristallise pas la tension du récit sur la résolution de l’énigme mais propose globalement de rendre compte de la noirceur du monde. Tout au long du récit, il s’agit de brosser un tableau de la société, le thème policier proposant un point de vue propice à l’illustration et à la dénonciation du crime et se faisant le vecteur d’un discours idéologique argumentatif et souvent directif, ce que favorise notamment la popularité du cadre générique. Là, le récit relate une enquête légitimée par une situation de crise sociale ; or, la noirceur du cadre légitime dans le même temps la spécificité du texte policier.
Quelle que soit l’orientation empruntée, le récit policier donne en ce sens l’impression de se construire en se regardant ; une impression coïncidant par ailleurs avec la circularité de son mode de fonctionnement. Le terme de l’enquête, et par là même du roman, se propose en effet de restituer le récit manquant du crime, cette « vacance narrative fondatrice » à l’origine de la naissance du récit d’énigme. Autrement dit, le récit policier cherche à combler le manque qui fonde sa légitimité ; il aspire donc à vaincre cette dernière en une forme d’autodestruction, si bien que comme l’indique Uri Eisenzweig :
« Le
réel vu par le récit de détection constitue l’envers symétrique de celui du
roman postbalzacien : il disparaît au fur et à mesure qu’il est
déchiffré. »[952]
Cette forme d’autodestruction propre au texte policier s’exprime au sein du récit par un jeu de la représentation, dans la mesure où, comme le suggère Marie-Hélène Huet, « au départ de l’œuvre […] tout est fini mais rien n’est joué »[953]. C’est donc au sein de cette représentation que le récit policier semble se réfléchir en une projection des spéculations et du cheminement de l’enquêteur. L’enquête consiste à faire surgir au sein du texte le latent, le non-dit, le caché ; elle tend à livrer au grand jour les différents éléments constitutifs du texte absent.
La résolution de l’énigme par l’enquêteur fonctionne ici comme aboutissement et comme limite à ce « déballage » au grand jour. Ainsi, la représentation du crime à laquelle procède l’enquêteur aspire à une projection fermement contrôlée, limitée, encadrée au sein du récit. L’enquête met en scène le récit du crime qui s’avère être lui-même circonscrit aux limites imposées par le scénario du scripteur. L’effet suscité par ce type de projection se fait, en ce sens, à la fois intense et éphémère ; c’est ainsi que certains critiques soulignent, à propos de la fiction policière, qu’elle est généralement « vite lue, vite oubliée ». C’est là précisément, nous semble-t-il, que l’adaptation du genre policier aux littératures francophones des Antilles et du Maghreb parvient véritablement à agir sur l’essence même du récit policier.
Transposée à des espaces littéraires a priori peu enclins à son développement, la structure circulaire propre au récit policier et la perspective de la représentation relative à la révélation du récit absent s’inscrivent dans une posture tout à fait singulière.
En effet, notons en premier lieu que le recours à un cadre générique déjà largement exploité notamment au sein des littératures anglaise, américaine et française, invite les fictions policières antillaises et maghrébines à se positionner en fonction des antécédents du genre et donc en fonction de l’« extérieur ». Bien que la plupart des textes de notre corpus suggèrent leur volonté de rompre avec les modèles de référence, la simple évocation de ces modèles n’est pas sans effet sur la perspective circulaire caractérisant le fonctionnement d’un récit en principe clos sur lui-même. L’intérêt du lecteur pour ces textes antillais et maghrébins susceptibles de passer pour novateurs ou encore la curiosité suscitée par l’adaptation d’un genre aussi populaire au sein de ces espaces littéraires viennent caractériser une lecture déjà soumise à l’établissement d’un contrat passé entre scripteur et lecteur et déterminant la légitimité même du récit. Nous avons vu que pour remédier d’une certaine manière à cette filiation, à cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur, les auteurs de notre corpus veillaient d’une part, à investir, à « habiter » le genre de leur spécificité littéraire et culturelle et pouvaient, d’autre part, le soumettre à la détermination d’un contexte référentiel précis ; deux types de procédé qui ont à leur tour une incidence sur la circularité de la forme policière.
Nous remarquons en ce sens que la mise en avant d’une identité littéraire et culturelle locale se fait parfois revendicative et, à certains égards, outrancière ; il s’agit-là notamment de l’esthétique développée par les auteurs de la créolité. La manière dont ils conviennent d’adapter la fiction policière passe -Le Meurtre du Samedi-Gloria mis à part- par une multitude de transgressions vis-à-vis de la forme de référence, opérant au niveau de la construction même du récit. A cet égard, leur approche du terme de l’enquête paraît capitale, dans la mesure où elle semble surenchérir la perspective d’une parfaite clôture du récit : l’enquête fonctionne de manière si réflexive qu’elle donne l’impression de tourner indéfiniment sur elle-même pour finalement s’enliser dans les profondeurs de son questionnement initial. Ici, l’enquête s’ancre dans une quête sans fin transformant le mouvement circulaire imprimé par la recherche du texte absent en un mouvement tourbillonnaire tendu vers l’infini.
Dans une perspective opposée, nous remarquons que l’ancrage de la fiction au cœur d’un contexte référentiel porteur d’un discours en prise avec l’actualité tend également à agir sur la circularité du mode de fonctionnement du récit. Ainsi, tout en respectant le schéma de base de la fiction policière laissant se succéder le meurtre/texte absent, l’enquête/reconstitution du texte et la résolution de l’énigme/reproduction ou représentation du texte absent, certains romans de notre corpus semblent finalement transcender les limites de la circularité du récit. En effet, il apparaît que la circularité du processus d’élucidation dresse corrélativement les limites textuelles ; or ces limites sont inévitablement franchies par la portée extra-romanesque du discours critique sous-tendant le déroulement de l’intrigue, comme c’est le cas particulièrement en ce qui concerne les textes prenant pour cadre l’Algérie contemporaine. Aussi, dans les romans de Yasmina Khadra et Boualem Sansal, l’aboutissement de l’enquête et le bouclage du récit se voient en quelque sorte devancés par un retour de la violence, soit que le coupable soit neutralisé par la force, parfois même la mort, soit que l’enquêteur succombe lui-même au retour du crime, le terme du récit livrant non plus une représentation du crime absent initial, mais générant l’avènement d’un nouveau crime. Autrement dit, au moment d’être bouclé en son sein, le récit s’échappe finalement dans la violence, retourne à la noirceur du cadre, noirceur elle-même représentative d’une projection dans le contexte réel.
Nous remarquons que l’alternance et la coïncidence de ces différents mouvements de réflexivité et de projection signent en fait la polyvalence du récit policier, capable de s’étendre et d’englober les différents seuils constitutifs de la création littéraire. Il présente, en effet, la particularité de prendre en compte simultanément et en son sein la légitimité, la construction et la réception du texte ; en d’autres termes, il affiche à la fois les raisons, les rouages et les effets de l’œuvre littéraire perçue dès lors dans sa totalité. Il semble ainsi que le texte policier représente une essence de la création littéraire ou encore fonctionne comme une représentation métaphorique de la création, ce qu’il affiche par ailleurs en faisant de l’enquête la quête d’un texte absent.
Jean-Claude Vareille souligne à cet égard que le roman policier est à la fois un « roman de la recherche » et la « recherche d’un roman »[954], l’enquête de fiction se substituant finalement à une véritable quête littéraire, à son tour riche en rebondissements, subterfuges, travestissements, fausses pistes, déceptions et réjouissances ; une quête littéraire dont l’objet dépasse largement les ambitions trop rapidement attribuées à la fiction policière. Alain-Michel Boyer restitue en ce sens au texte policier la valeur artistique qu’il véhicule incontestablement :
« Cette
réflexion sauvage sur la littérature, qui transparaît dans le récit policier
[…], cette mise en place de relais de production,
procèdent d’une théâtralisation de la création, sous la forme, essentiellement,
de l’enquêteur, qui -travesti en détective, en écrivain ou en lecteur- incarne
les principes narratifs qui établissent la fiction -une fiction qui ainsi
répète ce dont elle parle. Mais si le récit donne l’image spéculaire de son
propre engendrement, s’il pratique -avec plus ou moins d’évidences-
l’autoreprésentation, c’est pour édifier une manière d’allégorie de l’écriture.
En plaçant l’enquêteur, l’écrivain et le lecteur dans un cercle d’énigmes, et
en quête, toujours, d’un texte, le roman policier qui apparaît comme la mise en
œuvre métaphorique de toute création, désigne ainsi, en permanence, l’énigme de
toute littérature. »[955]
CONCLUSION
Tout au long de cette étude, le genre policier nous est apparu sous de multiples facettes, dépassant largement les a priori véhiculés par sa réputation de genre « mineur ».
Adaptable, modulable, réactif aux évolutions sociales, le genre policier n’a cessé, depuis son apparition à la fin du XIXème siècle, d’engendrer de multiples variantes déclinées à partir d’un schéma de base tripartite s’ouvrant sur un meurtre ou la découverte d’un cadavre dont la mort demeure inexpliquée, se poursuivant en une enquête menée généralement par un fin limier qui à force de réflexions, de déductions, d’interrogatoires, de recoupements parvient à livrer enfin le troisième et dernier acte du récit en une révélation brillante et spectaculaire des tenants et aboutissants du crime.
Accordant une importance variable à ces différentes étapes, éclairant de manière plus ou moins accentuée quelques-unes des pièces maîtresses de l’intrigue policière, en soulignant par exemple la noirceur du crime, le sang-froid, la cruauté ou l’intelligence du criminel, en insistant sur le profil de la victime ou bien sur la méthode de l’enquêteur ou encore en accordant plus ou moins de valeur au rôle joué par le contexte au sein duquel s’inscrit l’intrigue, chaque fiction policière propose en fait une version différente partant d’une même structure de base. Selon la perspective choisie par le scripteur, mais également selon les prédispositions du lecteur à l’égard du cadre générique, le récit policier prend ainsi une fonction et une orientation tout à fait singulières.
Présentant l’enquête qu’il décrit comme pur jeu de l’esprit et pris au premier degré par un lecteur considérant le roman qu’il est en train de lire comme partie prenante d’un cadre générique dont il connaît les règles, le texte policier répond à des codes, à des attentes de lecture, ramenant la fiction à une dimension ludique. Le lecteur intrigué par le mystère est alors attentif à la progression de l’enquête et s’interroge lui-même sur les tenants et aboutissants du crime, tandis que le scripteur met tout en œuvre pour ralentir le processus d’élucidation de l’énigme, tout en donnant sans cesse l’illusion d’approcher au plus près la résolution. Dans ce type de récit, seuls les éléments relatifs à l’enquête et nécessaires à la reconstitution du puzzle intéressent le lecteur qui se voit, de fait, enfermé au cœur de la fiction, condamné à errer dans l’univers clos au sein duquel le scripteur s’est efforcé de l’entraîner. Ici, le texte policier fonctionne de manière circulaire, se suffisant à lui-même et suscitant une lecture rapide, efficace et unique. Du point de vue de l’histoire du genre policier, ce type de récit correspond à la forme empruntée par le whodunit qui, bien que supplanté par d’autres variantes aujourd’hui, demeure encore le principal modèle de référence du genre lorsqu’il est notamment question de résumer, de « typifier » le roman policier.
Comme nous l’avons souligné en abordant la variante dite hard-boiled, apparue dès les années 1930 aux Etats-Unis et quelques années plus tard en France, sous l’impulsion de Marcel Duhamel et de la collection « Le Masque », le récit policier est progressivement parvenu à s’accommoder de l’évolution d’une société urbaine en pleine mutation tout au long du XXème siècle, prenant également en considération, par glissement, les nouvelles attentes de ses lecteurs. Soucieux de vraisemblance et de crédibilité, le genre policier a, en effet, très tôt laissé la réalité et les évolutions sociales gagner la portée de son discours. Sous l’impulsion du hard-boiled, une nouvelle forme policière est alors née, gommant quelque peu le caractère ludique de la forme initiale pour laisser primer la noirceur du cadre criminel, éclipsant finalement l’énigme sous le crime, bouleversant encore le conservatisme et l’aspect « propret » du roman d’énigme dit « de salon » et de son inébranlable happy-end. Prenant pour cadre les rues de la ville progressivement gangrenées par la soif de pouvoir et livrées à la persistance d’une criminalité d’intérêts, le roman policier est alors devenu « noir », déversant à la fois l’immense amertume et la critique acerbe de justiciers impuissants face au crime. Nous avons constaté par ailleurs que, captivant le lecteur par des décors « plus vrais que nature », le roman noir présentait en outre la particularité de pouvoir aborder des sujets directement en prise avec la réalité et le quotidien du lecteur, jouissant en quelque sorte d’une approche quasi médiatique de la réalité.
Aussi, entre whodunit et hard-boiled, il est apparu que le texte policier oscillait finalement entre un ancrage assumé au cœur de la fiction et l’ambition d’un regard porté sur le réel. Or, il s’avère qu’en dépit de ces divergences de perspective, l’unité du cadre générique demeure intacte autour d’une ambition commune : celle de captiver l’attention du lecteur. En effet, la condition sine qua non de la réussite du récit policier -et ce, quelle que soit la forme dont il relève- repose sur l’intérêt que l’intrigue parvient à susciter auprès du lecteur ainsi que sur l’effet que la révélation de la solution de l’énigme provoque en lui. Autrement dit, pour que le récit réussisse, le lecteur doit être surpris, imposant de fait au scripteur originalité, ingéniosité ainsi qu’un certain attrait pour la duperie, voire le mensonge.
Détenteur des clés du scénario, le scripteur dispose en ce sens d’une multiplicité d’artifices réunis en effets de suspense divers, fausses pistes, rebondissements, révélations de dernière minute maintenant l’ascendant permanent du scripteur sur le lecteur. Au-delà de ces différents procédés relatifs à la constitution même et au déroulement de l’intrigue, le scripteur jouit de la perméabilité structurelle du cadre policier qui, en dépit des codes que lui prête notamment sa réputation, et peut-être du fait même des attentes ainsi suscitées préalablement par l’enveloppe générique, offre un terrain de choix aux transgressions les plus inattendues. Nous avons vu à cet égard que dès 1926, Agatha Christie s’était livrée au jeu de la transgression en faisant du narrateur de son roman Le Meurtre de Roger Ackroyd le meurtrier démasqué au terme du récit. Ce type de transgression, touchant à la structure même du récit, a ainsi très tôt pu révéler le potentiel métadiscursif du genre policier, donnant l’illusion de laisser coïncider simultanément enquête et récit, créant par là même un champ d’interaction entre le scripteur et le lecteur. Le récit est ainsi devenu encore plus explicitement le lieu de l’enquête, subissant textuellement les errements, les illuminations, les doutes, les mensonges, les erreurs constitutifs de l’enquête en train de se faire, donnant finalement à voir une écriture en construction, un texte policier disséqué, autopsié. C’est précisément dans cette perspective que les Nouveaux Romanciers, en France, se sont intéressés, autour des années 1950, au genre policier devenu le prétexte à une réflexion d’ordre métatextuel, proposant un nouvel angle d’approche à des lecteurs invités à percevoir et interroger les rouages du récit de fiction.
Globalement, le récit policier nous est donc apparu selon une double perspective : d’une part, comme fiction se faisant le reflet de la réalité et portant un regard critique sur la société ; d’autre part, comme fiction se regardant en train de se faire, s’interrogeant sur son propre fonctionnement et se considérant finalement dans une véritable perspective littéraire ; une double perspective sous-tendue, en outre, par la singularité d’un cadre générique ne pouvant jamais totalement se départir d’une forme d’« instinct de jeu »[956], ainsi que d’une caractérisation paratextuelle singulières. Quoi qu’il en soit, plongeant le lecteur dans des décors « plus vrais que nature » en lui laissant partager le discours révolté et courageux de justiciers passionnés ou bien lui laissant percevoir les dessous du récit, ou encore l’entraînant au cœur d’un jeu purement fictif et clos sur lui-même, il s’avère que le scripteur de roman policier entretient une relation tout à fait particulière avec son lecteur, notamment dans la mesure où il prend en considération les éventuelles réactions et attentes de ce dernier dans la mise en œuvre même du récit.
Indirectement, le lecteur participe donc réellement de la constitution du texte policier, tandis que la participation à l’enquête de fiction à laquelle il est explicitement invité n’est en fait qu’un leurre. Autrement dit, tout en ayant l’illusion de mener lui-même une enquête à partir des éléments livrés par le récit, le lecteur participe presque malgré lui, et d’une certaine manière à son insu, à la mise en scène élaborée par le scripteur.
Aussi, accueillant parfois simultanément enjeux critiques et esthétiques au sein d’une structure initialement perçue dans une perspective ludique et distrayante, le récit policier présente une multitude de facteurs propices à l’intérêt d’un grand nombre d’écrivains de toutes aires.
Notre étude nous a permis de constater que l’adaptation du genre policier au sein des espaces littéraires francophones des Antilles et du Maghreb relevait de différentes orientations puisées dans les multiples potentialités offertes par le genre.
Il nous est notamment apparu que la variante noire du genre policier, apparentée à la forme du hard-boiled, connaissait un développement important au sein de la sphère maghrébine.
Tout en conservant l’intérêt suscité par le jeu d’énigme, la plupart des auteurs algériens et marocains notamment privilégient, en effet, l’éclairage du crime dont la noirceur se fait prégnante, voire écrasante, tout au long du roman. La reprise du genre policier leur permet, en ce sens, de proposer un discours de fond critique faisant état des nombreux dysfonctionnements gangrenant des sociétés dépeintes comme victimes d’une quête effrénée de pouvoir et d’argent poussant au crime. Puisant une grande partie de la matière de l’intrigue dans la réalité, à travers l’évocation d’évènements précis, de faits historiques, de constats personnels, de témoignages, Yasmina Khadra, Boualem Sansal, mais aussi Jacob Cohen, Rida Lamrini ou encore Jean-Pierre Koffel font le choix d’ancrer la fiction policière au cœur d’un contexte référentiel précis et parfois en prise, qui plus est, avec une « actualité brûlante ». Utilisant les liens étroits que le genre policier parvient à entretenir avec le monde moderne et les évolutions sociales, ces différents auteurs engagent finalement la fiction policière dans une perspective presque documentaire, offrant une tribune à un discours critique engagé se faisant la plupart du temps le vecteur d’une mise en accusation des individus jugés responsables de la crise.
La gravité et le sérieux de la démarche ici adoptée nous a alors révélé, par contraste, la marginalité de l’orientation choisie par les auteurs tunisiens, s’engouffrant sans retenue dans la perspective strictement ludique proposée par le genre policier.
Dans les romans d’Al Sid ou de Charlotte, en effet, la reprise du genre policier ne vaut que d’un point de vue structurel : seuls la mécanique du schéma de base (meurtre/enquête/résolution) et quelques poncifs du genre (personnages stéréotypés et scènes d’actions calquées sur le modèle des séries B américaines) participent de la démarche littéraire propre à la fiction policière. La dimension critique y est quasiment occultée. A cet égard, la reprise d’une forme littéraire « étrangère », inspirée des littératures dites occidentales, participe indirectement d’une volonté -consciente ou non- de regarder ailleurs et de se dérober, tout en donnant l’illusion d’une totale liberté d’action et de pensée puisque, somme toute, la reprise du genre policier en Tunisie relève d’une démarche originale et, comme le souligne Nicole Ben Youssef, relativement « osée ». Ainsi, bien que la perspective de la reprise d’un cadre générique aussi singulier semble participer d’une démarche intéressante pour la littérature tunisienne, il nous a semblé symptomatique que les auteurs ici concernés n’aient pas assumé, au-delà de la structure générique, les audaces, l’originalité et le franc-parler propres à la variante noire du genre.
D’autres romans de notre corpus, y compris ceux privilégiant la structure ludique de la fiction policière, nous ont paru, à l’inverse, plus réceptifs aux potentialités critiques du genre, le contexte local au sein duquel s’inscrit l’enquête n’étant, en ce sens, pour la plupart, jamais purement décoratif.
Ainsi, les auteurs antillais tels que Tony Delsham, Michèle Robin-Clerc, Janine et Jean-Claude Fourrier ou encore Raphaël Confiant -avec Le Meurtre du Samedi-Gloria- laissent au premier plan la structure ludique propre au roman à énigme, tout en s’efforçant d’acclimater le cadre générique à la singularité de l’espace local. Aussi, en marge de l’enquête de fiction, s’esquisse une peinture sociale offrant une certaine profondeur à la légèreté du cadre générique emprunté et, réciproquement, utilisant la popularité, la communicabilité d’un genre destiné à un large public pour proposer un autre regard sur la société antillaise, peut-être plus léger, plus désinvolte et pouvant, de fait, paraître plus proche de la réalité. Dans ces romans, la reprise du roman policier semble donc plus ou moins s’équilibrer entre les enjeux esthétiques véhiculés par le genre autour de la démarche ludique sous-tendant son mode de fonctionnement et la perspective critique supposée par l’installation d’un contexte socioculturel engageant le texte dans une peinture sociale de type référentiel. Or, il s’avère que c’est précisément le maintien de cet équilibre qui est à l’origine des différentes gradations caractérisant, au sein de notre corpus, l’adaptation que chaque auteur propose de la forme policière.
Selon la part ludique de la démarche et l’intensité de la critique véhiculée, le texte policier apparaît comme simple cadre littéraire ou comme vecteur d’un discours. La démarche de Driss Chraïbi nous a, en ce sens, semblé significative car finalement porteuse simultanément de ces deux orientations. Ainsi, les enquêtes de l’inspecteur Ali (Une Place au soleil, L’Inspecteur Ali à Trinity College et L’Inspecteur Ali et la C.I.A.) assument clairement le manque de prétention propre au cadre générique dans sa forme la plus élémentaire : les enchaînements sont grossiers, les intrigues sans grand intérêt, vite oubliées et l’écriture globalement peu travaillée. Or, au-delà de cette première approche se profile néanmoins une démarche moins désinvolte et farfelue qu’il n’y paraît. En marge des frasques de l’inspecteur Ali et des « grosses ficelles » souvent requises par Driss Chraïbi, aussi bien dans le déroulement de l’intrigue que du récit, apparaissent les stigmates d’une double orientation, à la fois critique et littéraire. La désinvolture d’Ali à l’égard des institutions, le regard satirique qu’il se permet parfois de porter sur le fonctionnement du système marocain ou encore du pouvoir royal signent la présence, même à peine esquissée, d’un discours social critique. La manière dont Driss Chraïbi investit sans complexe la forme policière dans ses aspects les plus vulgaires -grossièreté langagière, érotisme exacerbé de certaines scènes, « super-héroïsation » de l’enquêteur-, tout en faisant d’Ali un poète amoureux de « grande littérature » suggère, par ailleurs l’affirmation d’une démarche littéraire à la fois assumée et mise en perspective au sein même du texte.
C’est ainsi qu’il nous a semblé que, laissant le polar s’inscrire au sein de son œuvre à la manière d’une parenthèse teintée d’une certaine touche de provocation, Driss Chraïbi transformait finalement ce que l’on était tenté de qualifier d’« expérience littéraire » en véritable « aventure scripturale ». En effet, au-delà de la démarche adoptée à l’égard du cadre générique et de la manière dont il parvient à véhiculer un discours social critique plus ou moins affirmé et explicite, la reprise du genre policier dans l’œuvre de Driss Chraïbi nous a finalement conduite à nous interroger sur les tenants et aboutissants de la démarche littéraire ainsi empruntée. Cette réflexion nous est apparue d’autant plus nécessaire qu’avant les enquêtes de l’inspecteur Ali, D. Chraïbi avait déjà amorcé une approche du genre policier avec Une Enquête au pays et L’Inspecteur Ali[957] ; deux textes qui, sans se conformer à la structure classique du genre policier nous ont semblé exploiter, d’une certaine manière, la littérarité du texte policier.
Avec Une Enquête au pays, Driss Chraïbi donne ainsi l’impression de créer un roman policier parallèle. Les éléments du récit policier sont en place -deux policiers en mission spéciale dépêchés pour enquêter dans un village de l’Atlas marocain où la famille des Aït Yafelman semble, de toute évidence, avoir des choses à cacher-, mais la logique et la linéarité de la structure classique ne parviennent pas à s’imposer : le chef est un idiot irréfléchi, insensé et incapable de sang-froid ; son subalterne entretient plus d’affinités avec les suspects qu’avec le chef, la police en général et le système marocain tout entier ; l’objet même de l’enquête paraît, quant à lui, des plus douteux. En marge de ce qui aurait pu se passer si la structure policière de base avait été respectée, c’est finalement l’envers du décor que D. Chraïbi donne à voir : c’est bien une enquête sur l’enquête que découvre le lecteur, l’« humanité » des personnages prenant le pas sur les contraintes du cadre générique. Ici, la structure mécanique du genre policier s’enraye face à la complexité et à la vivacité du contexte culturel censé l’accueillir. Nous avons, à cet égard, pu constater que la démarche adoptée par D. Chraïbi, visant d’une certaine manière à interroger les dessous du genre, trouvait quantité d’échos dans le cadre des œuvres de notre corpus, notamment au sein de l’espace antillais.
Les textes des créolistes ont, en ce sens, fait apparaître le refus catégorique d’une reprise classique de la forme policière traditionnelle et plus précisément de ce que sa structure affiche comme certitudes. Dans le texte policier classique, au-delà des rebondissements, du brouillage des pistes, des difficultés rencontrées par l’enquêteur ou encore de la multiplicité déconcertante des issues possibles, le lecteur sait que le retour à l’ordre est programmé et qu’il comprendra in fine ce qui lui était jusque-là paru obscur. A l’inverse, dans les romans créolistes s’inspirant de la forme policière, le lecteur comprend rapidement que l’issue du récit ne peut être qu’incertaine, le texte développant un foisonnement de possibles que l’incapacité des enquêteurs mis en scène ne parviendra sans doute pas à circonscrire. Ici, la structure mécanique du récit policier est rejetée, tandis que l’incertitude induite par les tâtonnements de l’enquête s’empare du déroulement du récit, révélant là encore une démarche littéraire dépassant les enjeux premiers de la fiction policière.
Nous avons dès lors pu constater que, privé de cadre, de structure, de certitudes, le genre policier ainsi pratiqué s’engageait dans la voie du roman-enquête, l’intertexte policier parvenant finalement à faire ressentir sa présence au sein de textes pourtant privés de certains de ses éléments clés. Il est en effet apparu que les romans de Maryse Condé ou encore de Rachid Mimouni utilisaient différentes pratiques énonciatives propres au récit policier -énonciation polyphonique, pluralité de perspectives, écriture du soupçon-, sans pour autant s’inscrire dans la perspective laissant apparaître clairement un meurtre, une enquête policière ou la résolution d’une énigme.
De la démarche adoptée par Yasmina Khadra et Boualem Sansal à celle proposée par Maryse Condé ou encore Rachid Mimouni, la reprise du genre policier au sein des espaces littéraires antillais et maghrébin, constitue globalement un moyen, un biais, un prétexte permettant d’accéder à une autre dimension aussi bien du récit policier que du texte antillais ou maghrébin lui-même. Le cadre policier est ici transcendé pour donner naissance à une démarche littéraire globalement novatrice. Il convient, en ce sens, de revenir plus précisément sur les motifs critiques et esthétiques à l’origine d’une telle démarche. Pour ce faire, il paraît intéressant de se référer à l’ouvrage de D. Chraïbi, L’Inspecteur Ali, qui nous livre différentes pistes susceptibles d’éclairer notre questionnement.
Ainsi que nous le suggérions plus haut, L’Inspecteur Ali n’est en rien un roman policier, mais présente l’intérêt de mettre en scène un écrivain de romans policiers, Brahim Orourke, devenu célèbre grâce aux aventures de l’inspecteur Ali. La manière dont Brahim perçoit son activité scripturale, l’opinion qu’il a du polar ainsi que les réactions de ses lecteurs à l’égard des enquêtes de l’inspecteur Ali nous éclairent globalement sur les raisons ayant pu conduire les auteurs de notre corpus à utiliser le cadre policier.
Alors qu’il est invité à une conférence donnée en son honneur à l’université où il rencontre de nombreux étudiants admirateurs effrénés de ses romans, Brahim découvre avec quel intérêt ses œuvres policières sont étudiées et interprétées par la critique universitaire. Le doyen lui consacre à cet égard un long discours qui, abrégé -parce que Brahim a faim- est ainsi résumé :
« Primo,
en écrivant des romans policiers, Brahim Orourke a fait preuve dès le début du
sens de l’universel ; secundo, il a fait l’économie des complexités de
l’identité culturelle et autres salmigondis où les critiques aiment bien
enfermer nos littérateurs ; tertio, il a des tirages faramineux et gagne
plus d’argent que tous les membres des prix littéraires réunis, y compris le
Nobel. Vive notre écrivain national, vive le Maroc, vive le Roi ! »[958]
Cette présentation apparemment simpliste des motifs et effets de la reprise, par Brahim Orourke, du genre policier au sein de la littérature marocaine, paraît imprégnée du discours de D. Chraïbi qui nous est apparu tout au long de notre étude effectivement attentif à l’universalité du genre policier -ce que nous avons pu notamment constater dans le chapitre I-2.1.3. de la deuxième partie, consacré à l’ouverture, la « neutralité » du discours social tenu par D. Chraïbi-, s’efforçant encore de maintenir ses personnages dans l’apparence d’une identité artificielle, de surface ou encore stéréotypée et enfin éventuellement attiré par la perspective de ventes massives. Concernant ce dernier point, précisons néanmoins que l’objectif commercial de D. Chraïbi peut paraître ici secondaire ou pour le moins maladroitement exploité dans la mesure où le format, l’encadrement et le choix de la collection caractérisant la publication des enquêtes de l’inspecteur Ali ne relèvent pas des méthodes traditionnellement employées dans la perspective d’une publication destinée à un large public. En réalité, les lecteurs des enquêtes d’Ali sont vraisemblablement moins des inconditionnels du genre policier que des amateurs ou simples curieux des « frasques » littéraires de l’écrivain Chraïbi. En fait, s’il y a vraiment là la volonté de mener une entreprise commerciale, la garantie des ventes tient sans doute plus à la personnalité de D. Chraïbi, généreux en matière de provocation, qu’au recours à la forme policière en elle-même.
Quoi qu’il en soit, les trois motifs de reprise du genre policier ici exposés par le doyen s’avèrent être effectivement révélateurs des principaux « atouts » proposés par le genre policier : l’universalité de la forme policière, la légèreté permise dans le traitement de la question culturelle et la popularité, la productivité du genre. Ces trois atouts, diversement exploités par les auteurs de notre corpus, nous ont permis, par glissement, d’appréhender une autre clé essentielle du genre. Nous avons en effet constaté que l’intérêt des auteurs antillais et maghrébins pour le genre policier ne concernait pas seulement l’universalité, la modernité, la vivacité, la portée du discours critique ou les potentialités esthétiques véhiculées par le genre, mais révélait une autre qualité essentielle propre au genre : celle de la liberté d’expression et d’écriture que son manque de « prétention » lui permet finalement d’embrasser. Yasmina Khadra déclare en ce sens :
« L’avantage
qu’a le polar sur le roman classique est qu’il n’a pas la grosse tête. Sa
simplicité lui insuffle un courage qui pourrait faire défaut à de grands
écrivains. De nombreux sujets, extrêmement brûlants, ont été mieux traités par
le polar qu’ailleurs, ce qui devrait le réhabiliter auprès de la “Haute
Bohème”, au lieu de le maintenir au rang de la sous-traitance
intellectuelle. »[959]
Deux ans plus tôt, Yasmina Khadra déclarait encore avoir eu recours au genre policier « par choix pédagogique » et en réponse à la démarche adoptée par d’autres auteurs issus de l’aire maghrébine qui « plaçaient la barre très haut »[960], nuisant selon lui à l’engouement des Algériens pour la lecture.
A la fois courageux et généreux, le genre policier offre une véritable tribune libre et ouverte à la parole, s’exprimant dans les romans qui nous concernent aussi bien dans une perspective critique qu’esthétique. Le genre policier semble ici servir de défouloir où l’indicible devient racontable, où l’abject a finalement la place qu’il mérite. A cet égard, Yasmina Khadra évoque, dans un entretien accordé à Jean-Luc Douin, son « besoin de disséquer l’engrenage de la violence intégriste dans des romans policiers » ; il ajoute significativement : « c’est la place qu’ils méritent, ces gens-là ! »[961]. Le genre policier peut donc mettre en scène les personnages les plus vils, les scènes les plus atroces et, en fait, rien n’est trop noir pour exprimer le chaos algérien et dénoncer les crimes insoutenables.
Sans barrières ni tabous, le genre policier s’offre, en outre, aussi bien à l’insoutenable qu’à une certaine frivolité que ne permettraient peut-être pas d’autres cadres littéraires. C’est ainsi en prenant en compte cette forme de tolérance propre au genre policier que Tony Delsham semble s’être orienté vers ce cadre si singulier, voire risqué, du point de vue de la réception critique. Nous avons ainsi pu constater que l’adaptation que proposait T. Delsham de la forme policière assumait parfaitement le manque de prétention du genre ; perspective confirmée par ailleurs dans un entretien accordé à Antilla, à la sortie de sa deuxième comédie policière intitulée Chauve qui peut à Schoelcher, où T. Delsham présente son roman comme :
« Un roman d’aventure. Un simple roman d’aventure sans prétention et pompeusement baptisé comédie policière. Un polar disent les Français. Les ingrédients du genre, Sea Sex Sun, sont respectés : bien que traitant de choses sérieuses, le rire est prioritaire. »[962]
Comparé au type d’humour pratiqué par les créolistes, dont nous avons pu constater qu’il s’apparentait souvent à une forme d’auto-flagellation douloureuse, il ne fait aucun doute que le rire proposé par T. Delsham à travers le prisme d’une fiction policière inscrite dans une perspective somme toute récréative, s’avère être incroyablement léger et, d’une certaine manière, libérateur. En fait, la démarche adoptée par T. Delsham tend à revendiquer un droit à la légèreté, à la désinvolture ; il s’agit-là, semble-t-il, d’une tentative d’ouvrir la littérature martiniquaise à un type de création se targuant de la critique. Son positionnement au sein du cadre policier souligne par là même son indépendance non seulement vis-à-vis de la critique mais également à l’égard des créolistes. Le roman policier joue ici le rôle de faire-valoir à une indépendance créative revendiquée ; or, c’est également une autre forme d’indépendance que tentent d’affirmer les créolistes dans leur manière singulière d’aborder le cadre policier.
Ainsi, le recours à la fiction policière passe, chez les créolistes, par le dénigrement de tout ce qui constitue les éléments fondamentaux de la forme policière traditionnelle. P. Chamoiseau, R. Confiant ou encore E. Pépin se livrent en ce sens à des polars non pas simplement détournés, mais bien inversés. Les enquêteurs, les représentants de l’ordre et globalement tout ceux qui représentent le pouvoir de l’Etat y sont dénigrés, présentés comme défaillants, incompétents, violents, névrosés et incapables d’assumer leur rôle. Le principe de la raison victorieuse sur l’énigme y est, par ailleurs, globalement nié, car fortement mis à mal par la singularité, la profondeur et la complexité de la culture créole présentée comme nécessairement irréductible à un quelconque pouvoir. De fait, la cohérence, la fluidité et la progression du récit d’énigme, reposant sur la base meurtre/enquête/résolution, ne parviennent pas à soumettre des intrigues encore une fois trop riches, trop complexes, trop vivantes pour demeurer scellées au cœur d’un quelconque schéma narratif. Autrement dit, chez les créolistes, le genre policier classique, inspiré des traditions littéraires anglaise, américaine et française, n’est pas investi par l’univers créole ; il est accaparé par lui, englouti, possédé pour finalement donner à voir un type de roman policier dont on a l’impression qu’il voudrait se faire créole, indépendant de toute démarche antérieure à celle menée par les créolistes.
Aussi, quelle que soit l’orientation choisie, il est toujours question, dans la reprise du genre policier, d’affirmer un discours, un projet, une volonté, et plus largement d’exprimer une certaine liberté d’écriture. Le fait que P. Chamoiseau, R. Confiant, E. Pépin, Y. Khadra, B. Sansal ou encore D. Chraïbi se soient orientés ponctuellement vers le polar souligne finalement l’attraction que peut exercer ce genre qui, au-delà des nombreux atouts que nous nous sommes efforcée de souligner tout au long de notre étude, présente la particularité d’entretenir des rapports tout à fait privilégiés avec son lectorat. Quelle que soit la démarche empruntée, la condition ludique qui sous-tend la structure herméneutique véhiculée par le récit d’énigme implique la réalisation d’un échange entre scripteur et lecteur. Nous avons souligné, au cours de notre réflexion, le fait que cet échange pouvait apparaître factice : en réalité, le lecteur est leurré dans sa quête de vérité, le scripteur tient seul toutes les cartes en mains et, de fait, le jeu s’avère truqué. Or, si au niveau du déroulement de l’intrigue, l’échange entre scripteur et lecteur n’est effectivement qu’illusoire, il demeure néanmoins bien réel en amont du simple déroulement narratif ; il est, en fait, scellé au cœur du contrat de lecture imposé par le cadre générique. Ce contrat implique que le lecteur se plie aux règles du jeu d’énigme, qu’il se laisse gagner par le suspense et, en un sens, qu’il « vive » la fiction qu’il est en train de lire. Le caractère référentiel de la variante noire favorise cette démarche, si bien qu’exprimant la complexité, voire le chaos, d’un monde livré à la noirceur du crime par le biais d’un cadre générique initialement porteur d’une ambition ludique, le texte policier laisse subtilement s’entrecroiser « lecture référentielle » et « lecture fictionnelle » ; une perspective croisée que Marie-Christine Rochmann met notamment en évidence en ce qui concerne le roman de Patrick Chamoiseau, Solibo Magnifique, qu’elle qualifie à cet égard d’« autofiction »[963], l’écrivain Chamoiseau cohabitant au sein du récit avec le narrateur/marqueur de paroles Chamzibié. Il apparaît en ce sens que si le lecteur se fond dans cette forme de « fiction vraie » que cristallise le récit policier, l’écrivain lui-même s’y plonge totalement, laissant percevoir sa présence explicitement, comme le fait P. Chamoiseau à travers la figure du « marqueur de paroles » ou l’imprimant implicitement en laissant entendre l’existence d’un schéma narratif régissant le texte.
Avec le récit policier, le scripteur trouve donc le moyen d’exister pleinement au sein même du texte. A la lumière des travaux de Philippe Lejeune, U. Eisenzweig établit, à cet égard, un parallèle intéressant entre « l’autobiographie, antithèse supposée de la fiction au sein de la production littéraire » et le « roman policier, antithèse supposée de la littérature au sein de la fiction »[964], l’un et l’autre s’inscrivant, d’une part, dans le cadre d’un contrat de lecture, créant une intersection entre le dedans et le dehors du texte, entre l’intra- et l’extra-textuel ; laissant, d’autre part, supposer la présence d’un « auteur réel, en chair et en os pour ainsi dire »[965] au cœur même du récit, soit qu’il y existe en tant qu’objet, soit qu’il s’y montre comme régisseur du récit. Le texte autobiographique et le texte policier ont encore en commun de tendre vers l’accomplissement d’une vérité ; une vérité qui dans ces deux types de récit ne se transmet finalement que par le recours au masque : c’est dans les oublis, les erreurs, les déformations, les silences que le scripteur/autobiographe se révèle réellement ; c’est sous le décor de l’enquête, sous les mensonges des personnages que le scripteur de polar laisse entendre sa voix. Le scripteur est ici personnage de sa propre fiction ; il ne surplombe pas le texte, il s’y projette, y existe pleinement, si bien que finalement, comme le souligne U. Eisenzweig :
« Ce
n’est que grâce au masque (du personnage) que peut être tenue la plume (de
l’auteur). »[966]
Dans la plupart des romans de notre corpus, ce masque s’affiche outrageusement : la structure du récit policier est pervertie, l’énonciation devient plurielle, orientée, mensongère, la narration trompeuse et le scripteur presque malhonnête. Ainsi, après s’être joué du lecteur en ayant utilisé l’étiquette policière comme appât, le scripteur affiche ouvertement tout au long du récit la qualité du piège ainsi tendu.
Avec le détournement de la structure policière traditionnelle, le lecteur est directement confronté à la dimension illusoire du texte. C’est toute la question de l’essence du texte littéraire qui est ici posée. A travers le prisme du récit policier, l’œuvre littéraire apparaît soudain comme simple mise en forme, comme apparat d’un discours, d’une sensibilité ou encore d’une représentation du monde.
Le texte policier est cette mise en forme par excellence ; c’est l’illustration suprême de ce leurre qui est au fondement même du texte littéraire. Le détournement du cadre policier permet finalement d’appréhender le texte dans sa vérité, c’est-à-dire dans le moment de sa création.
A travers la reprise de la forme policière, c’est bien une quête littéraire qui s’achemine et qui s’exprime ; la quête d’une authenticité, d’une spécificité, voire d’une identité, non pas culturelle mais bien scripturale.
ANNEXES
|
ANNEXE 1 |
ENTRETIENS
ET ECHANGES
AVEC
QUELQUES ECRIVAINS DU CORPUS
Fortuné Chalumeau
Après un premier contact établi par voie de courrier électronique, nous avons transmis à Fortuné Chalumeau un texte faisant état de différentes réflexions concernant son roman Pourpre est la mer.
Nous souhaitions obtenir quelques renseignements concernant les circonstances ayant déterminé l’écriture de ce roman. Il nous a semblé également intéressant de mettre l’accent sur la manière dont le cadre ludique du genre policier était utilisé au sein de cet ouvrage, afin d’engager le texte dans la perspective d’une mise en abyme métatextuelle. Nous avons enfin demandé à Fortuné Chalumeau ce qu’il pensait de la reprise du genre policier au sein de la littérature francophone des Antilles.
Nous le remercions d’avoir bien voulu répondre aux questions que nous lui avons fait parvenir le 13 février 2003 et auxquelles il a répondu quelques jours plus tard.
Réflexions et questions :
A première vue, le roman Pourpre
est la mer se présente sous la forme d’un roman policier classique,
reprenant les ressorts et les caractéristiques du genre : il y est
question de conflits d’intérêts sur fond d’adultères, de passions tues, de
manigances orchestrées notamment par une femme névrosée, emportée par sa
jalousie et incapable de distinguer la fiction de la réalité. Le cadre
antillais, son histoire mouvementée, ses conflits à la fois sociaux et raciaux,
mais également ses paysages, ses « coutumes », ses parfums, les
fantasmes qu’il suscite imprègnent le roman, et ce, d’autant mieux que
l’enquêteur débarque de sa Franche-Comté natale. Mais il ne s’agit pas que de
cela et le roman dépasse cette perspective « exotique », pour plonger
en profondeur à la fois au cœur de la société guadeloupéenne et de la fiction
elle-même.
Dans un premier
temps, le roman policier permet d’illustrer les conflits pouvant émailler la
société guadeloupéenne, marquée notamment par les rancœurs, les non-dits,
l’incommunicabilité ou encore l’ambition, source de mépris. Cependant, au-delà
de l’aspect social, imprégné de réalisme, qui se dégage de Pourpre est la
mer, l’approche proprement littéraire esquissée dans le roman me semble
intéressante à bien des égards ; et elle l’est en particulier par l’effet
d’écho distillé tout au long du roman. Différents procédés semblent, en effet,
engager le roman dans une perspective de retour sur lui-même. Ainsi, la
citation de départ de Jack London se retrouve mise en perspective, in fine,
par le soi-disant metteur en scène Jean-Pierre Hasard, promu coordinateur des
mouvements de Laprée. De même, au gré d’une séance improvisée de vaudou, Laprée
se voit subitement prisonnier de sa propre enquête, rejetant presque malgré lui
à la lumière le secret refoulé du meurtre de son père. Relevons encore
l’imbrication, dans le texte, de trois micro-récits (la conversation
surprise ; Saint-Domingue ; la rescapée), fonctionnant de manière
indépendante tout en étant liés entre eux et au reste du texte par un élément
clé commun et marquant : le parfum d’ylang-ylang.
Par le biais
de ces différents procédés intratextuels et intertextuels -dont le premier est
celui qui explique le titre de l’ouvrage, en un écho à la « mer
écarlate » de Saint-John Perse- Pourpre est la mer semble
véritablement fonctionner à un double, voire un triple niveau. Se comportant,
en surface, comme un roman policier classique aboutissant à la traditionnelle happy-end,
il permet de rendre compte d’une certaine réalité sociale, centrée notamment
sur la bourgeoisie créole. Le roman permet enfin, sur un mode ludique, de
mettre en perspective son propre mode de fonctionnement, en jouant avec les
ficelles de la fiction en train de se faire.
Le roman policier, tel que
vous le pratiquez, paraît en ce sens beaucoup plus profond qu’il n’y paraît.
Une perspective qui me pousse à m’interroger sur les raisons qui vous ont
conduit à vous intéresser au genre policier.
Comment définiriez-vous les
atouts et les inconvénients du genre policier ? Pourquoi avez-vous choisi
ce genre ? Qu’offre-t-il que le roman dit « classique » ne
permet pas ?
Le genre
policier n’apparaît que par occurrences sporadiques dans la littérature
antillaise ; mais il semble s’y développer depuis quelques années. Le
roman policier a-t-il, selon vous, des perspectives d’avenir dans la
littérature antillaise ?
Pourpre
est la mer a été écrit en collaboration avec Alain Nueil ; pouvez-vous
m’en dire davantage sur cet auteur ?
Avez-vous
écrit d’autres romans policiers ?
***
Réponse de Fortuné Chalumeau :
D’autres romans policiers ?… Non, pas vraiment ; mais Les vents du Diable (Fleuve Noir, 1997, spécial « grand format »), dont j’ai racheté les droits par ailleurs, est un thriller géopolitique qui n’avait point sa place chez cette éditeur.
Dans Hautes Abîmes (JC Lattès), une « saga » fort animée, il y a bien des éléments du « policier » -enquête, poursuites, meurtres, etc., mais là encore, ce n’est pas un vrai « polar ». Comme vous l’avez remarqué (j’y reviendrai plus longuement) la perspective est bien plus large et le fond littéraire toujours net -tout en s’efforçant de ne pas vraiment le paraître !
En revanche, je vous suggère « Le Condor », « longue nouvelle » de cinquante pages in Noir des Îles (Gallimard, « La Noire »). Vous y trouverez de quoi alimenter vos remarques (très bien senties, je dois le souligner) à propos du Pourpre. Outre le fond « policier », vous y apercevrez des éléments divers -dont l’un m’a valu d’être contacté par un psychanalyste qui trouvait matière à débat ! Et qui m’a permis de prendre conscience d’un aspect assez curieux de la relation auteur/œuvres !
Alain Nueil a écrit d’autres policiers chez Fleuve Noir, et un titre chez Grasset (le premier paru ne 1985 je crois : Reviens Afrique). Nous avons collaboré à ce texte (à partir d’un de mes manuscrits) tout à fait par hasard. Je n’ai plus de relations avec lui, il a disparu depuis des années… Je crois qu’il vit à Paris, mais je n’en sais rien de plus. Il a été marié deux ou trois fois, a plusieurs enfants, et enseigne les Lettres (ou enseignait ?). Il a habité ici en Guadeloupe quelque huit ans, si je ne m’abuse. Nous n’étions pas très liés, à vrai dire.
Pour moi, le « policier » n’est qu’un prétexte, en fait. Si vous lisiez mes œuvres autres, vous verriez que je m’intéresse au contenu de l’esprit humain (entre autres faits) : son éthologie (comportement), ses instincts dominés par sa volonté, son environnement et les effets de celui-ci sur son mental, etc.
La trame de l’histoire me semble bien plus intéressante que le fait en soi ; celui-ci (le meurtre) n’est en sorte qu’un faire-valoir qui permet le déroulement du récit : étude de mœurs, en fait (voir : « Le Condor »). Dès lors, le « policier » pur et dur n’est pas mon genre de prédilection. Vous étonnerais-je en vous disant que je ne lis jamais ce genre de texte ?
Je ne fais pas vraiment le distingo entre roman « classique » ou pas : pour moi, il y a l’histoire de l’homme et ses explications -ses implications- et le style ; le reste, ma foi…
Les atouts du genre : on tient le lecteur en haleine. Et il y a un public pour !
Pour l’auteur, il est toujours passionnant d’étudier la « tératologie » (études des monstruosités) : entendez ici les variations du comportement humain et les applications idoines lorsque « la loi » est résolument ignorée, écartée. Ce qui laisse place à bien des faits « hors normes » !
En fait, en tant qu’écrivain, je me considère apte à écrire quelque texte que ce soit : il suffit de me le demander, de me le commander. Mais oui ! il est très important que vous compreniez ceci, me concernant ( je viens de découvrir que j’aime bien les mémoires imaginaires « mais pas tout à fait imaginées » ! cela me permet de rentrer davantage dans un personnage central, de m’identifier à sa personne).
J’aime beaucoup le symbole, même si cela va chercher très loin (voyez « Eva Erotica », Lattès publié sous le nom de Yann Morgan !), la réalité étant alors tout autre.
Les inconvénients : il faut se plier à ce « genre » ; avoir une écriture plus « plate » et moins « stylée » !; une répétition des schémas assez classiques…
Dans la littérature antillaise, tout est possible -pourquoi pas. Mais il me semble que ce ne soit pas vraiment « la tasse de thé » des auteurs d’ici- à qui je reproche, entre autres, un certain « nombrilisme »… Ce qui est une autre affaire.
JACOB COHEN
Nous sommes parvenue à joindre Jacob Cohen par voie de courrier électronique, afin de lui soumettre quelques questions concernant son choix de recourir au genre policier ; nous l’avons également interrogé sur les conditions de la publication de son roman aux accents souvent polémiques aux Editions Le Fennec, sises au Maroc.
Ne disposant pas d’un matériel informatique suffisamment performant pour lui permettre de communiquer longuement sur le web, Jacob Cohen s’est excusé de n’avoir pu répondre plus précisément à nos questions.
Les brèves
réponses apportées nous paraissent néanmoins intéressantes.
Echange du
12 février 2003
Pourriez-vous
me dire, dans un premier temps, ce qui vous a conduit à opter pour le genre
policier ?
Que pensez
vous de ce genre ?
Quels sont,
selon vous, ses atouts et inconvénients ?
Correspond-il
bien aux attentes de la littérature maghrébine contemporaine ?
Jacob Cohen : Je ne suis pas un auteur de romans policiers. La
suite l’a prouvé.
Si j’ai choisi ce genre, il me semblait que cela s’imposait, étant donné le sujet, les personnages, les domaine de confrontation, un petit suspense.
Je pense que ce genre vaut bien un autre, qu’il est autant utile qu’un autre, l’essentiel est de rendre compte de la société, de ses attentes, de pénétrer au-delà du rideau social.
***
Echange du
06 mai 2003
Est-il « facile » de
publier au Maroc un roman traitant de corruption ou de trafics
d’influence ?
Le fait
d’avoir choisi le roman policier et non l’essai ne résulte-t-il pas d’une
volonté d’atténuer quelque peu le propos ou s’agit-il d’adapter cette question
de politique intérieure de manière à ce qu’elle devienne accessible à un plus
large public ?
Est-ce
réellement possible de mettre librement en scène des policiers et des hauts
fonctionnaires corrompus lorsqu’on est publié au Maroc ?
Si tel est le cas, peut-on
conclure que la liberté d’expression est désormais globalement respectée au
Maroc ?
J’ai eu
l’occasion de voir sur les écrans de cinéma bordelais l’adaptation d’un roman
de R. Lamrini, intitulé « Casablanca », réalisé avec le soutien de
gouvernement marocain et dénonçant néanmoins la vanité et les
dysfonctionnements de la campagne d’assainissement qui a été menée au Maroc en
1996. Peut-on voir, dans l’ouverture d’esprit affichée par le gouvernement, un
réel espoir de « démocratisation », ou ne s’agit-il pas de tenter
d’améliorer l’image véhiculée par des années d’autoritarisme, alimentant les
colonnes des journaux français notamment ?
Jacob Cohen : Il est plus facile aujourd’hui de publier un livre
sur la corruption au Maroc. Le mien n’a pu l’être sous le règne d’Hassan II.
Ceci dit, il y a toujours des domaines sensibles. Je pense qu’il serait
difficile sinon impossible de parler de corruption dans l’armée, ou des
dépenses somptuaires du roi, des nouveaux palais, etc…Au Maroc, tout est
question de nuance, d’auto-censure, de lignes rouges qu’on apprend à flairer et
à respecter.
JEAN-PIERRE KOFFEL
Nous avons pu
obtenir l’adresse postale et le numéro de téléphone de Jean-Pierre Koffel, par
le biais de Simone Balazar, rédactrice en chef de la revue littéraire intitulée
Le Jardin d’essai ; revue qui a déjà accueilli certains textes et
nouvelles de Jean-Pierre Koffel.
Tout à fait
bienveillant à l’égard de l’intérêt que nous portions à ses textes, Jean-Pierre
Koffel s’est montré très disponible, chaleureux, patient et attentif ;
nous lui en sommes vraiment reconnaissante.
Par deux fois,
nous lui avons transmis, par voie de courrier postal, différents groupes de
questions auxquelles il a consciencieusement répondu.
Il nous a
également fait parvenir une « biographie » que nous reproduisons au
terme de l’entretien.
Echange 1 : juillet 2002
Avant de vous
interroger plus particulièrement sur vos romans, j’aurais aimé en apprendre
davantage sur vous. Je crois savoir que vous êtes né au Maroc ; y
avez-vous toujours vécu ? Y enseignez-vous ? Etes-vous Marocain ou
Franco-marocain ?
Jean-Pierre Koffel : Je suis né au Maroc (à Casablanca ; enfance et adolescence à Marrakech) et j’y ai toujours vécu, sauf la dernière année de ma carrière passée à Paris.
J’y ai enseigné, de 1954 à 1992.
Je ne suis ni Marocain, ni Franco-Marocain, mais Français du Maroc. Je ne rejette pas l’appellation de Pied-Noir. Ma mère, née (en 1905) et morte (en 2002) à Paris est originaire du Berry par sa mère, des Landes par son père. Mon père géniteur, né à Paris également, est Alsacien (je ne l’ai pas connu). J’ai été “élevé” par le second époux de ma mère, un Italien originaire de Tunisie.
Dans L’Inspecteur
Kamal fait chou blanc et Des Pruneaux dans le tagine, votre regard
sur la population française présente au Maroc, et notamment les coopérants, se
fait particulièrement percutant : au mépris, au racisme et au sentiment de
supériorité de la plupart s’oppose la générosité et l’idéalisme poussés à
l’extrême d’autres qui ne parviennent à exprimer leur soutien à la population
locale que par la voie criminelle. Peu de personnages nous paraissent sereins
et mesurés sur la question. Cette démesure idéologique, voire affective est-elle
représentative de la réalité ?
JPK : L’action de Des pruneaux dans le tagine se passe à Marrakech en 1954, dans le cadre de la société coloniale. La population française qui y est décrite (il y avait au Maroc 500 000 Européens en 1955) est celle du Protectorat français et est effectivement caractérisée, dans sa grande majorité, par le mépris, le racisme, un sentiment de supériorité, en opposition à l’idéalisme poussé à l’extrême de celle qui ne parvient à exprimer son soutien à la population marocaine que par la voie criminelle. Virna Carlie, l’héroïne, n’est pas Française, mais Italo-Américaine ; elle est colon. Il était très difficile, au plein cœur de la période coloniale, de rester serein et mesuré et ceux qui ont tenté des voies de dialogue (on les entend dans le roman) ont été plutôt inefficaces mais ont ménagé l’avenir.
L’action de L’Inspecteur Kamal fait chou blanc se passe en 1990 à Casablanca dans un Maroc (ni la ville, ni le pays ne sont jamais nommés) indépendant, où une bourgeoisie puante qui tient le haut du pavé a mis en otage tout un peuple et maintenu en esclavage des enfants. Les protagonistes ne sont plus des Français, mais des locaux -autrement dit, des Marocains, que j’ai pris pour modèles. Les Français ne sont plus là que sous la forme de coopérants -à part quelques séquelles de l’époque coloniale en voie de résorption- et il n’y avait aucune raison spéciale de faire d’eux des portraits positifs ; j’ai peut-être un peu poussé le bouchon. Mon justicier, un tout jeune Marocain, exprimera son soutien aux opprimés, les petites bonnes, par la voie criminelle, qui a permis -dans le roman- une salutaire prise de conscience du scandale des enfants exploités.
Je ne vois pas dans les crimes de Virna Carlie et de Jalil Mardi de démesure idéologique, mais un engagement réfléchi pour un passage à l’acte visant à opposer la charité et la justice à des formes de perversion sociale. Pas de démesure affective non plus, mais une grande sérénité, un sentiment de bonté et d’amour. Est-ce que ces manières de voir représentent la réalité ? Hélas non. Les Français qui se sont opposés en prenant des risques physiques à la brutalité coloniale sont une poignée (peut-être une dizaine de personnes sur les deux millions et demi de Pieds-Noirs d’Afrique du Nord ). Les Marocains qui protestent contre les mauvais traitements infligés aux enfants employés de maison, contre le seul fait qu’il y ait des enfants employés de maison, ne le font que par de beaux articles dans la presse, par le cinéma, par le roman , voire par la poésie ou le théâtre. Quant à ceux qui s’opposent de façon militante aux mauvais traitements infligés aux animaux, je n’en connais qu’une, à Tanger (et encore est-elle de mère anglaise!) !
De même que la mouvement Conscience Française -qui fut l’honneur de la France au Maroc- a pris des positions courageuses et engagé un combat d’idées pour la dignité de la personne humaine au Maroc, de même la société civile marocaine actuelle s’engage de plus en plus pour l’avènement d’un État de Droit, militant pour les Droits de l’Homme, incluant ceux de la Femme et ceux de l’Enfant. Des pas en avant. Mon roman a été salué avec sympathie, y compris par des gens qui ont ou ont eu des petites bonnes chez eux.
Dans ces deux
romans, les criminels recherchés par la police se présentent comme défenseurs
des opprimés, abattant froidement profiteurs et autres avatars du colonialisme.
Or, contrairement au schéma classique du genre policier, ces criminels-là
parviennent à échapper aux mains des défenseurs de l’ordre. Pourquoi choisir
cette option ? Est-ce une manière de cautionner ce genre de combat contre
les abus de pouvoir en tout genre ou plutôt une façon de mettre en cause le
bien-fondé du combat mené par les défenseurs de l’ordre, dans des sociétés
marquées par le colonialisme ?
JPK : Pourquoi choisir que mes criminels échappent à la police et aux défenseurs de l’ordre ? D’abord parce que mes héros sont sympathiques et que, dans tous les cas, j’ai horreur de la police et des défenseurs de l’ordre . J’ai choisi mon camp : le leur et ils ont plus de courage que moi. Il est normal qu’ils s’en tirent. Je ne suis pas fâché d’entraîner mon lecteur derrière moi. En fait, s’en tirent-ils ? Virna Carlie est laissée dans un bateau pris au milieu d’une tempête et Jalil Mardi part sans laisser d’adresse, disparaît. Il faut combattre le colonialisme, l’ordre bourgeois, le racisme et faire en sorte que les colonisateurs, les racistes, les exploiteurs soient véritablement vaincus.
Ces deux
romans présentent l’intérêt d’illustrer avec pertinence le malaise d’une
société en crise et les perspectives historiques développées dans Des
Pruneaux dans le tagine confèrent au roman un intérêt supplémentaire non
négligeable. Pourquoi avoir choisi le genre policier, genre dit
« mineur », prisé traditionnellement pour ses vertus ludiques, pour
exprimer ce genre de réflexions profondément ancrées dans la réalité du peuple
marocain ? En quoi le genre policier vous inspire-t-il et quels auteurs
vous ont marqué dans ce domaine-là ?
JPK : Qui dit roman policier dit roman avec des policiers, genre Maigret, voire des détectives, genre Hercule Poirot. Il s’agit en effet d’un genre mineur -pas cher, vite écrit, vite lu, avec cadavre dans la bibliothèque et enquête à la clé-, littérature de quai de gare, sans grande qualité littéraire, en argot bien souvent... Très peu de policiers chez moi. Dans Des Pruneaux dans le tagine, les commissaires sont, encore qu’empruntés à des modèles comme tous les autres personnages, caricaturaux ; les inspecteurs Bertrand et Perrin font plutôt partie du décor, et ont toujours une longueur de retard sur Virna, qui est le principal élément de l’action ; Bertrand finira même par être victime des barbouzes de l’ODAT (Organisation pour la défense anti-terroriste) et Perrin est un mauvais flic qui ne fera pas de vieux os dans la police, surtout pas coloniale. Dans Pas de visa pour le paradis d’Allah, la commissaire Daniéla Van Wasseren, qui est le deuxième héros du roman, mène bien une enquête éclair et couronnée d’un tardif succès (là encore, une petite longueur de retard), parce qu’elle est amoureuse de la victime. Dans L’Inspecteur Kamal fait chou blanc, il y a bien sûr un policier, un play-boy, charmant et artiste, bon flic au demeurant, puisque lui aussi s’approche, et de très près, du coupable, mais qui, comme le titre l’indique, échoue. On retrouvera l’inspecteur Kamal dans mes prochains romans C’est ça que Dieu nous a donné (écrit, en attente d’éditeur) et L’inspecteur Kamal met les pieds dans le pot aux roses (en écriture), où il continuera à faire chou blanc. Dans La Cavale assassinée, il n’y a pas de policier, mais un capitaine des A.I. (Affaires indigènes), qui a tout compris par intuition mais qui ferme les yeux par sympathie non exprimée. Dans Nous l’appellerons Mehdi, les flics, des personnages mineurs et ridicules, se plantent, laissant l’héroïne, Ruth Chesterfield, fort aidée par la providence, aller jusqu’au bout des son amère et nécessaire vengeance. Dans Rapt à Inezlane, il n’y a pas de flic, sinon un vague garçon boucher qui dure une demi-page sur 316. Dans Dalal mon amour (écrit, en attente d’éditeur), il y a bien des flics niçois, folklos, qui arrivent après la bataille. Dans Les Amants de Marrakech (inédit et inéditable au Maroc) , il y a bien un flic pervers, qui d’ailleurs tue le jeune et innocent héros. Donc, je n’écris pas de romans policiers, si l’on entend par là roman avec pour héros un policier aboutissant à trouver le coupable, genre Agatha Christie ou Georges Simenon.
Les mots qui me conviennent le mieux pour définir mes romans -du moins ceux qui entrent dans le cadre de votre recherche- sont : polar, thriller, série noire. J’aime assez parler de littérature noire (il y a eu, dans les années 30 , la blême, que j’aimais bien). Stendhal, Balzac, Sophocle, Racine, pour ne parler que d’eux, sont des auteurs noirs ! Pour moi, un roman noir, n’est pas nécessairement du genre mineur. Le genre a ses chefs-d’œuvre. C’est exact qu’il a des vertus ludiques, mais il n’est pas le seul à en avoir (d’Ormesson, Flaubert, Hugo, Feydeau, Courteline ), et je plains un peu ceux qui n’ont pas ces vertus. On peut faire réfléchir sur une société et s’amuser beaucoup, amuser, en caricaturant, en soulevant des ridicules (c’est ce que faisaient Molière, La Fontaine, La Bruyère), en jouant de bons tours aux salopards objectifs.
En quoi le « genre policier » m’inspire? D’abord, j’ai lu, très jeune, beaucoup de polars. Dévorés. Certains me laissaient quand même insatisfait. Je trouvais les titres superbes : La lune dans le caniveau, Les pieds dans les nuages, 1275 âmes, Monsieur Zéro, Eaux profondes, L’empreinte du faux , Un beau matin d’été, Cent mètres de silence, Une manche et la belle... J’adorais certains auteurs. Simenon et Agatha Christie. Je ne m’ennuyais pas avec eux -admirables restituteurs d’atmosphères- mais alors pas du tout. Ils me racontaient une histoire, des histoires qui se ressemblaient un petit peu entre elles d’une fois sur l’autre, et je me laissais faire délicieusement, fasciné, passionné. L’ennui : j’avais plus de mal à lire Mauriac, Sartre, Camus, Malraux, après. Je laissais tomber un Gide pour avaler un Maigret, vite fait, ou une Miss Marple. De quoi avoir honte !
Moi aussi j’avais envie de raconter des histoires s’inspirant du réel, des histoires que l’on pourrait lire avec la même aisance qu’on a à lire un Chase. D’autant plus que j’étais persuadé que le genre -où il y a effectivement beaucoup de médiocre, de bâclé, d’archétypique, de mauvais, d’ennuyeux, de vulgaire, surtout chez les Français- a ses chefs-d’œuvre, surtout chez les Américains. J’avais à mon tour envie d’écrire ce que j’avais eu plaisir à lire , n’osant pas toucher à la vraie littérature, cette grande dame, à l’exception de la poésie, pour laquelle il n’y avait pas de lecteurs -et je n’en cherchais pas.
Quels auteurs m’ont marqué ? Simenon et Agatha Christie. Tout Simenon, y compris les « psychologiques » -les Maigret en étant déjà. J’étais capable de lire deux fois le même Simenon. À l’époque, on lisait sans zapper, sans faire d’impasses ; on avait trop de respect pour l’auteur. Puis Chase. Tout lu et relu, y compris les supposés fabriqués en équipes, les commerciaux, comme d’ailleurs chez les deux précédents. Éva, admirable. Pas d’orchidées, bien sûr (La fleur de l’orchidée, nettement moins bon). Un beau matin d’été, L’abominable pardessus, l’inattendu et très drôle, très british, Miss Shumway jette un sort, les nouvelles... Chase fut mon maître, m’a ouvert les voies : le naturel des dialogues, le recours à l’italique dans le récit, la fragmentation en séquences, en plan, la vérité de la langue, la fatalité pesant sur les héros -des maudits mais pas des salauds-, l’énergie sans appel qu’ils déploient, les passions mortelles qui les animent... Et derrière Chase, j’ai découvert les écrivains américains. Le rimbaldien David Goodis, le surréaliste Jim Thompson (le Lautréamont de la série noire), Chester Himes, Dashiell Hammett. Et les femmes, plus proches de nous : PD James, bien sûr, Mary Higgins Clark quand même, et surtout, surtout, mon Dieu, Patricia Highsmith, sœur Patricia, la Texane au regard de squaw. Son Art du suspens est ma bible. Pour ce qui est des Français, qui dans l’ensemble m’ennuient -sauf Catherine Simon, Izzo un peu, j’ai horreur des affaires de drogue, de casses de banques, de traites de putes, de gars du milieu-, j’aime bien le premier Exbrayat et Boileau-Narcejac (auteurs d’un bon ouvrage théorique sur le roman noir).
On constate
également, à la lecture de vos ouvrages, une profonde réflexion sur la langue,
son métissage (français, arabe, berbère, « pataouète ») et sur le
bagage historique qu’elle véhicule (avec par exemple les réminiscences d’un
langage de guerre ou encore la prégnance d’un vocabulaire à connotations
racistes). Comment pourriez-vous définir votre rapport à la langue
française ? Vous semblez vouloir mêler les langues, est-ce une manière
d’exprimer et d’assumer un double héritage culturel ?
JPK : Julien Gracq a dit : « Pour faire un roman, il faut, premièrement, un sujet d’histoire, deuxièmement, la géographie, et enfin, la langue ». Et vous, vous avez vu complètement juste sur mes rapports avec la langue, avec les langues. Je ne sais pas comment on peut écrire un roman en arabe classique qui n’a qu’un seul niveau de langue. La langue de base de mes romans est le français. J’ai fait des études littéraires classiques, donc j’ai appris le français avec les apports du grec et du latin, impliquant des référents culturels et une réflexion sur la vie des mots, leurs voyages, leurs flexibilités, leurs inflexibilités. J’aime la langue littéraire et je me freine quand je m’en sers -mais je m’en sers- ; j’ai horreur de me regarder écrire, horreur des écrivains qui se regardent écrire, surtout quand ils peinent. Donc le français littéraire pour la narration, la description, l’analyse. Mais aussi le français parlé, selon la personne qui parle, son âge, son niveau culturel, son métier. Julien Mermaz dit « ton automobile », quand des beurs de banlieue disent « ta bagnole, ta tire, ta charrette » Tous les niveaux de langue doivent être sollicités et accueillis. Étant myope, j’ai développé l’ouïe, et j’ai toujours une oreille qui traîne partout et qui capte, qui mémorise, dans le métro parisien, dans les cars du Maroc, dans la rue (Rabelais avait une oreille qui traînait aux Halles). J’aime les accents et je les imite (sauf l’accent pied-noir que je n’ai jamais pu encaisser). J’ai beaucoup appris sur les façons de parler, les intonations, les mots qui plaisent, les mots qui fâchent, tous ceux qui véhiculent la nouvelle cuistrerie , en écoutant -je dis bien écouter- les émissions débiles de la télé française (comme par exemple celle de Christine Bravo que je “regardais” en 92/93 au grand désespoir de mes élèves parisiens qui ne comprenaient que, moi, je puisse m’intéresser “à une connasse pareille”). La Série noire, le roman tout court d’ailleurs, veut des personnages qui parlent vrai, comme dans la vie -même si l’auteur et ses lecteurs complices doivent s’en amuser. Je mène des enquêtes sur la langue, très à l’affût des nouveautés, je prends des notes ; par exemple, un bernard, ça vient d’arriver, ça désigne un bon Français hexagonal par opposition aux beurs et aux blacks. Là où je souffre le plus, c’est quand il me faut rendre compte de manières de parler disparues. J’ai beaucoup écouté ma mère, morte à presque 97 ans le 22 juin dernier (2002), j’essaie de retrouver dans ma mémoire des expressions qui ne fonctionnent plus, notamment de la langue pied-noire. Autres langues que l’on trouvera dans mes romans : le berbère marocain (Rapt à Inezlane est la version amputée et déberbérisée de Tislatine ounzar, La ceinture du ciel) ; l’arabe marocain, la darija (il y a des dialogues en darija dans Des pruneaux..., une chanson en darija dans L’Inspecteur Kamal... ; un passage écrit dans toutes les langues parlées ensemble dans le Maroc d’aujourd’hui dans Pas de visa...) ; l’italien et l’espagnol, qui ont laissé des traces importantes dans la darija et qui étaient des langues parties prenantes de la langue pied-noire (différente du pataouète), la majorité des Pieds-Noirs étant d’origine italienne ou espagnole.
Ce que j’ai apporté à la langue française ? L’aptitude à prendre en compte les langues parlées au Maroc (le français du Maroc, celui des Européens d’abord, puis celui des Marocains maintenant, infiltré d’arabe, d’espagnol et d’italien ; l’arabe marocain, la darija, un dialecte qui a la malchance de ne pas disposer de code écrit, sous-produit de l’arabe littéraire -une langue qui n’a pas de statut oral d’échange ni de niveaux de langues-, infiltré de berbère -la langue originaire du Maroc lui a légué sa syntaxe, ses expressions idiomatiques, et quelques mots-, de français (beaucoup ; l’apport du français à la darija est très important, bien enraciné, indéracinable malgré les efforts des arabistes), d’espagnol, d’italien, et maintenant, avec le web et MacDo, l’anglais étasunien. Mon idéal (j’ai tenté de le réaliser dans certaines de mes nouvelles) est de parler français à la surface, et, sous la couche, arabe dialectal (de tels écrits ne sont totalement et spontanément accessibles qu’à des marocains francophones). Classez-moi donc parmi les écrivains marocains de langue française.
Oui, je mêle les langues et j’assume un double héritage culturel : la culture classique occidentale, qui prend ses sources dans le grec et le latin et la culture populaire marocaine qui prend ses sources dans l’arabe et le berbère (le tamazight).
***
Echange
2 : août-septembre 2002
Votre éditeur marocain sollicite-t-il de nombreux remaniements de vos romans ?
JPK : Oui. Mon éditrice tient à ce que chacun de mes manuscrits perde des kilos. Nous l’appellerons Mehdi a perdu un cinquantaine de pages et s’appelait Requiem pour un Tanagra. C’est moi qui ai procédé aux enlèvements et proposé le titre. Des Pruneaux dans le tagine, qui a failli s’appeler Elle aimait les chevaux, les roses et la mort, a perdu de mon fait une centaine de pages et des obscénité en arabe dialectal. Pas de visa pour le paradis d’Allah, -qui n’a pas changé de titre !- a été mis en attente deux ans : mon éditrice l’avait confié à Marion Scali pour qu’elle le remanie et bien sûr l’allège ; finalement, Marion m’a rendu son tablier et j’ai procédé moi-même aux dégraissements. L’Inspecteur Kamal fait chou blanc est une ancienne nouvelle, Échappement libre, que j’ai transformé en petit roman. J’ai déjà dit que Rapt à Inezlane était la déberbérisation de Tislatine ounzar (Arcs-en-ciel), devenu La ceinture du ciel, et récrit avec des sacrifices sur les conseils d’un de mes lecteurs les plus enthousiastes, Henri Boyé, délégué général d’EDF au Maroc. L’édition bat de l’aile au Maroc, et, à part mes Pruneaux dans le tagine qui sont épuisés (comme mon éditrice), mes autres titres, qui ont été tirés à 2000 exemplaires chacun ont encore pas mal d’invendus. La Cavale assassinée, éditée chez Traces du présent à Marrakech, a été tirée à 500 exemplaires et je n’ai aucune nouvelle des ventes, l’éditeur ayant refusé de passer par les distributeurs.
Avez-vous envisagé de faire éditer vos
romans hors du Maroc ? Quels sont, selon votre propre expérience, les
avantages et les inconvénients d’une publication au Maroc ?
JPK : J’ai fait des pieds et des mains pour être édité en France, en Belgique. Fiasco. J’ai eu des propositions de traduction en Italie et en Allemagne. Mon, éditrice, qui dispose des droits, n’a pas donné suite, ou plus exactement n’a pas insisté. J’ai eu des propositions d’adaptation cinématographique (une jeune docteur en cinéma, strasbourgeoise originaire de Marrakech, Elsa Nagel, a écrit le scénario de Pas de visa... pour Souheil Benbarka qui finalement l’a refusé ; le scénario est déposé en France aux Droits d’auteurs et Wahid Chakib en fera peut-être quelque chose un jour ; il a d’ailleurs l’exemplaire qu’Elsa m’avait laissé). Le cinéaste maroco-norvégien, Nordine Lakhmari, et Moody Hassini, qui me relance en ce moment, sont intéressés.
Les avantages d’une édition au Maroc sont qu’on est édité, diffusé au Maroc, pas en France : les livres édités au Maroc sont présents en France lors des salons du livre, présents à l’Institut du Monde Arabe (le diffuseur Vilo était absolument inefficace et dur à la détente et mon éditrice a cessé sa collaboration avec lui) ; ils ne bénéficient d’aucune presse, d’aucune présence en librairie (sauf de très rares exceptions). Dans un article du Monde, Catherine Simon (nous sommes devenus amis et j’aime beaucoup son polar « algérien » Un baiser sans moustache) m’a cité deux fois et m’a traité d’« incontournable ». Je suis pratiquement inconnu en France et je dois une pensée à mes compatriotes de passage au Maroc qui sont devenus mes lecteurs et m’ont écrit. Les inconvénients d’une édition au Maroc sont la faiblesse numérique du lectorat et le côté symbolique des droits d’auteur (j’ai perçu pour l’année 2001, pour l’ensemble de mes titres, 1600 DH, soit 150 euros).
Votre choix du polar est-il un « choix littéraire » ?
JPK : Oui, si je considère comme de vrais littéraires mes maîtres David Goodis, Jim Thomson, Patricia Highsmith, Chase quand même, et bien sûr Simenon. Pour certains autres, je ne suis pas tellement fier d’être en leur compagnie, mais je ne les nommerai pas. Vous avez raison : parler du réel (même dans la fiction) est essentiel ; offrir un plaisir de lecture est ce que je souhaite : ne pas ennuyer, tenir en haleine, « étonner, émouvoir, ravir » (je ne suis pas sûr d’y parvenir et je tiens compte des remarques des lecteurs qui sont freinés par endroits) ; effectivement le genre a un caractère profondément moderne qui me convient et il autorise des potentialités stylistiques dont je profite à fond, dont je me régale ; un petit peu genre mineur quand même, effectivement à la fois codifié (mais pas trop) et perméable (qui peut donc accueillir les réalités marocaines sans les défigurer, les engoncer, les normaliser, les canaliser dans des catégories) ; c’est vrai que pour moi le polar est une tribune, la seule tribune où je peux revendiquer, attaquer, défendre, mieux que la politique : défendre les victimes du racisme, du colonialisme, de la violence, pour prôner le triomphe des faibles, des opprimés, des enfants martyrs de la bourgeoisie, prôner l’amour. Mes romans sont des combats où triomphe le bien : Virna Carlie, la végétarienne Ruth Chesterfield, Jalil Mardi, Daniéla van Wasseren, Mérad sont des justiciers et les victimes (Ruben, Oussama, la cavale) sont là pour générer le pathétique dont j’ai absolument besoin pour proposer une glorification esthétique de l’amour.
Le polar peut-il servir une
écriture qui se veut en prise avec la réalité et qui semble également prétendre
à engager une réflexion et une recherche sur l’Histoire ?
JPK : Oui. Une réflexion sur l’Histoire (surtout avec H) peut-être pas mais une recherche sur une époque absolument ( pour l’année 1954, marques de voitures, noms des rues, numéros de téléphones, façons de téléphoner, radios écoutées, chanteurs en vogue, auteurs lus, acteurs, président français, chef de région militaire à Marrakech, artistes peintres à Marrakech -Orana, Holbing, Cheylan, Azéma, Hassan El Glaoui-, résurrection de personnages de la vie marrakchie de ces années-là, même sous des noms autres que les leurs : docteur Dieu = docteur Diot, Jean du Cerf = Jean du Pac, Prisac = Pusic, Brémont = Frémont, Hippolyte Dumouriez = Henri Demacon, Julien Mermaz = Lucien Péray, Priscilla Dumouriez = Véra Demacon, colonel Ortéga = colonel Arbola (qui m’avait condamné à mort et celui qui devait m’exécuter s’appelait Azmi, je ne sais plus quel nom je lui ai donné dans le roman ; le type est devenu gouverneur par la suite !), Béatrice Marcilhac de Vermont = Mme Merveilleux Duvigneau, Germaine Montserrat = Denise Masson, etc.) Je ne voudrais pas vous décoder tout le roman et je me demande si j’en serais capable ; un monsieur français de Marrakech, qui avait 80 ans en 1995, avait emprunté mes Pruneaux à la bibliothèque catholique de la ville et avait écrit au crayon les vrais noms de mes personnages ; son épouse, ayant appris la chose, a à son tour emprunté le livre, ne l’a pas lu mais a gommé tout ce que son époux avait écrit ; cela m’a été rapporté par Mlle Andrée Mazel, mon ancien professeur de sciences au lycée Mangin, qui est toujours à Marrakech et, à 90 ans, est toujours en vie, mais qui ne figure pas dans mes Pruneaux. J’ai effectivement voulu que ce livre soit une peinture de la société européenne de la Marrakech des dernières années du Protectorat, où mes yeux de 20 ans étaient sans complaisance. Un polar est d’abord un roman réaliste qui ne souffre pas l’à-peu-près et requiert un souci maniaque de l’historicité. Tout doit être crédible et une seule erreur peut décrédibiliser le tout (ainsi la formule « la valise ou le cercueil » est née en Algérie en 1956 et c’est par erreur que je l’avais imputée au Maroc de 1955 ; c’était la seule erreur que l’un de mes premiers lecteurs, Nadir Yata, rédacteur en chef du quotidien communiste Al Bayane et ami très cher, tragiquement disparu, avait relevée dans mon manuscrit. Ce sont en fait des pans d’histoire que j’ai supprimés de mon manuscrit pour sa première édition (et d’autres encore pour son éventuelle réédition), notamment un bilan exhaustif des batailles livrées entre l’armée d’occupation coloniale et la résistance (dite dissidence) entre 1912 et 1936 ; ces pages alourdissaient l’intrigue, mais m’avaient demandé des mois de travail ; elles pourraient être publiées à part et elle étaient un peu la justification idéologique de mon action.
Le polar, tel que vous le concevez,
n’est-il pas le genre idéal pour enquêter sur
l’Histoire du peuple marocain et tenter d’en esquisser un bilan ?
JPK : Enquêter sur des pans d’Histoire, oui, esquisser un bilan, non : ce n’est point ma spécialité.
BIOGRAPHIE DE JEAN-PIERRE
KOFFEL
KOFFEL Jean-Pierre Charles. Français. Né à Casablanca (Maroc) le 21-11-32.
Etudes primaires et secondaires au lycée Mangin de Marrakech (Maroc)
Etudes supérieures à l’Institut des Hautes Etudes Marocaines (IHEM, Rabat)
Licencié es-lettres classiques (latin-grec ; 1ère LVE : arabe classique)
Certificat d’arabe classique de l’IHEM. Agrégé de lettres classiques
Professeur de français dans l’enseignement marocain de 1954 à 1973 (Settat, Casablanca, Agadir). Inspecteur de français auprès du Ministère marocain de l’Education Nationale de 1973 à 1987. Professeur formateur de professeurs au Centre Pédagogique de Rabat (87-89). Animateur culturel à la Délégation de l’Enseignement de Khémisset (89-92). Professeur de lettres classiques au lycée Henri IV à Paris (dernier poste avant la retraite)
Secrétaire général du ciné-club d’Agadir et des Amitiés Musicales d ‘Agadir (70-73). Fondateur et animateur de l’Atelier de création poétique de Kénitra (80-91) : dix recueils de poésie des membres du groupe (une centaine), une trentaine de récitals de poésie sur différentes scènes du Maroc. Secrétaire général des Amitiés Poétiques et Littéraires du Maroc depuis 1987, concepteur de la revue de poésie du Maroc, Agora, annuelle, 8 numéros, et de récitals de poésie (spectacles Hugo, Marceline Desbordes-Valmore, et des poètes du Maroc)
Mise en scène de plusieurs pièces de théâtre, dont des œuvres pour et avec des enfants et des adolescents.
Action politique anticolonialiste. Adhésion en 1957 au Parti Communiste Marocain (PCM) et collaboration à la presse du parti ainsi qu’à celle du syndicat UMT (L’Avant-garde). Rédacteur, signataire de la motion des 481 (1958) adressée au Général de Gaulle, Président français, pour demander l’indépendance immédiate de l’Algérie . Sanctionné à la suite de cette action et radié de la fonction publique française (jusqu’en 1969 ; réintégré à la suite d’une lettre personnelle au Général de Gaulle) ; refus d’obéir à un ordre de rejoindre la France et resté au Maroc sous la protection du Roi (Mohamed V) et du peuple marocains (audience royale en 1959)
Prix du Maroc de poésie 1947. Cinq prix de poésie en France. Œuvre poétique inédite en grande partie. Romans publiés : Nous l’appellerons Mehdi (Le Fennec 1994, Prix Atlas 1995), Des Pruneaux dans le tagine (Le Fennec, 1995), Pas de visa pour le paradis d’Allah (Le Fennec, 1997), L’Inspecteur Kamal fait chou blanc (Le Fennec 1998), La Cavale Assassinée (Traces du présent, Marrakech, 1998), Rapt à Inezlane (La Ceinture du Ciel) (Le Fennec 2001). Traductions en vers (du grec) de tragédies de Sophocle : Antigone, Œdipe à Colonne ; en cours, Œdipe roi. Collaboration à Al Bayane (le quotidien du PPS), animation de la page hebdomadaire Al Bayane-Création ouverte à tous les créateurs. Collaboration à Téléplus et au nouveau bimestriel Au Maroc
Inédits ; Les Amants de Marrakech, roman noir, sous le pseudonyme de Zakaria Imansar et d’Alexis Gardiner ; C’est ça que Dieu nous a donné, roman noir, déposé à Le Fennec et chez Plon ; Dalal mon amour, roman noir, déposé chez Plon ; Nouvelles noires ; théâtre, poésie...
NICOLE BEN YOUSSEF
POUR LES
EDITIONS ALYSSA
Après avoir découvert, par le biais de la librairie de l’Institut du Monde Arabe, deux ouvrages publiés aux éditions Alyssa (Charlotte, Le Meurtre de Sidi Bou Saïd, 1991 ; Al Sid, Machettes coconuts et grigris à Conakry, 2000), nous avons contacté Nicole Ben Youssef, directrice des Editions Alyssa, sises à Sidi Bou Saïd en Tunisie, afin de l’interroger sur les raisons de son intérêt pour le genre policier et sur la résonance de cette orientation éditoriale singulière au sein de la littérature tunisienne dans son ensemble.
Nous remercions chaleureusement Nicole Ben Youssef d’avoir répondu précisément et avec enthousiasme à nos questions.
Nous faisons suivre une reproduction du courrier qu’elle nous a bien voulu nous faire parvenir.
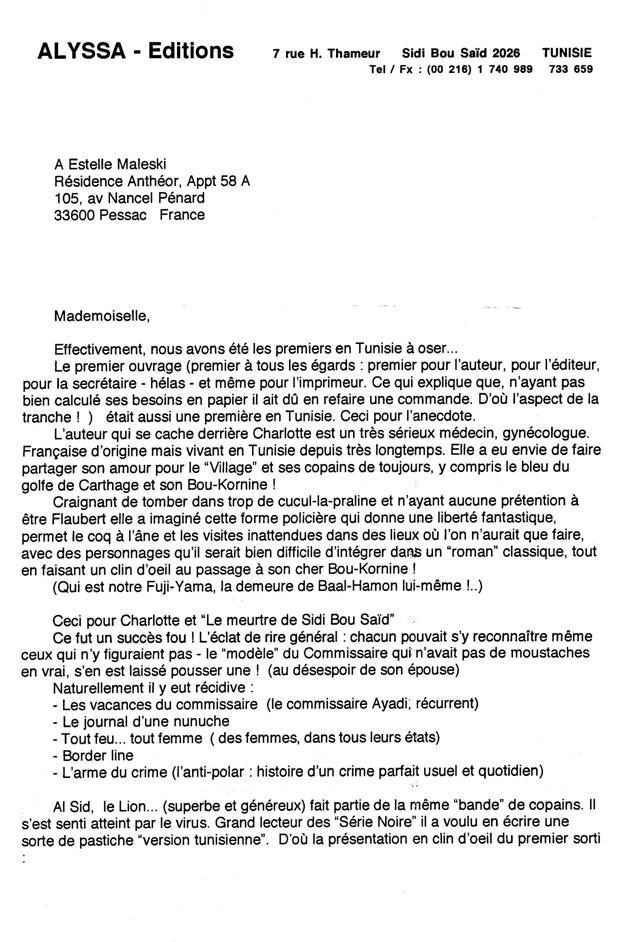
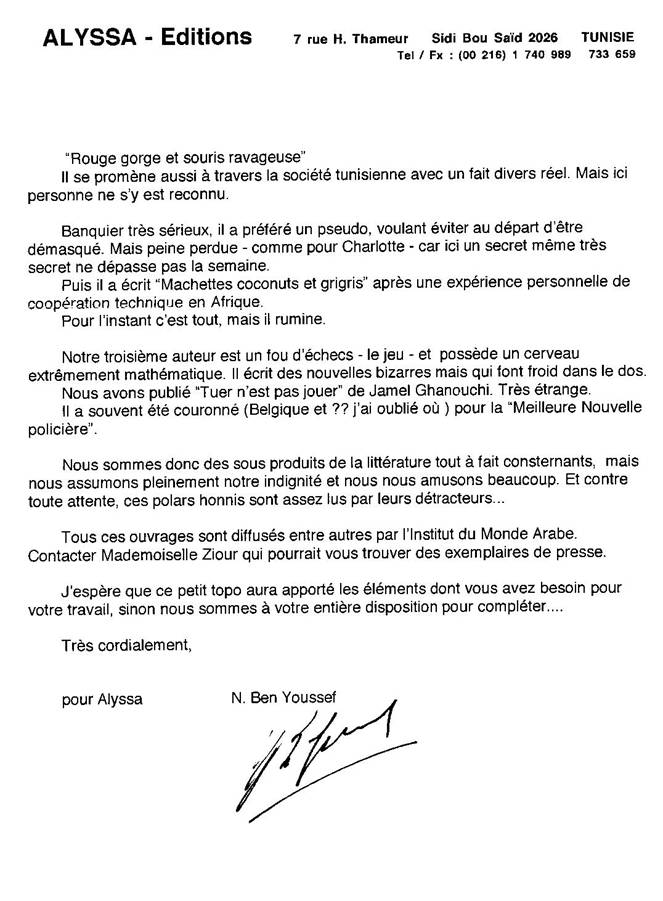
TONY DELSHAM
Nous sommes entrée en contact avec Tony Delsham grâce à l’intermédiaire de l’hebdomadaire Antilla dont il est le rédacteur en chef.
Contacté par téléphone, le 18 février 2002, il a accepté de répondre à nos questions qui concernent aussi bien son roman Panique aux Antilles, que les relations qu’il entretient avec les auteurs de la créolité. Sachant que Tony Delsham et Patrick Chamoiseau avaient collaboré par le passé, notamment autour de la bande-dessinée Coutcha, et constatant par ailleurs de profondes divergences portant sur la « stratégie » aussi bien scripturale qu’éditoriale adoptée par chacun d’eux, nous avons tenté d’obtenir l’opinion de Tony Delsham sur le sujet créoliste. Relativement prudent dans ses propos, Tony Delsham s’est néanmoins montré fidèle à la droiture et la franchise qui le caractérisent.
Nous tenons à préciser ici que notre rencontre avec Tony Delsham -nous avons eu l’occasion de lui rendre visite à Schoelcher en juin 2002- a été déterminante pour notre étude et plus largement quant à notre perception de la littérature martiniquaise dans son ensemble. Si la voix des créolistes nous est inévitablement familière en métropole, il est regrettable que celle de Tony Delsham, ayant fait le choix de publier ses ouvrages à la Martinique, ne s’y fasse pas plus résonante.
Au terme de l’entretien, nous faisons suivre une brève réflexion que nous a inspirée cette rencontre.
Précisons que l’entretien et le commentaire ont été publiés dans un ouvrage réalisé sous la direction de Christian Lerat, Le Monde caraïbe. Echanges transatlantiques et horizons post-coloniaux, Pessac, MSHA, 2003, p. 237-245.
Panique
aux Antilles montre du doigt les
dangers, les excès entraînés par le développement touristique à outrance.
Pourquoi avez-vous choisi d’illustrer cette question préoccupante pour l’avenir
des Antilles par le biais du roman policier, ou plus exactement de la comédie
policière qui s’inscrit dans une perspective relativement ludique ?
Tony Delsham : En 1970 le constat est simple. Il plane une grande misère à la Martinique. En effet, une large fraction de la population, notamment celle des communes, est de plus en plus rejetée par la société de consommation. Cette misère matérielle, conséquence d’un chômage endémique, se double d’une misère morale où on utilise de moins en moins ses propres repères lui préférant des référents extérieurs. L’élite politique et syndicale dénonce l’assistanat mais réclame de plus en plus de mesures sociales, creusant d’avantage l’écart entre l’économie et le social. Le fossé entre le discours et la pratique du quotidien est grand, on se déclare indépendantiste mais on émarge aux caisses de l’état que l’on prétend combattre, on dénonce l’aliénation mais à Noël on se noie dans le champagne, on s’étrangle avec les huîtres, on s’empiffre avec la dinde aux marrons, délaissant rhum boudin et pois d’angole.
Mais ce qui me choquait le plus c’est bien la négation de notre propre image dans une société où la stratégie du lapo sové faisait encore recette. Bien sûr, il y avait Césaire. La pensée de Césaire. Hélas, de l’homme qui poussa le grand cri nègre, le citoyen de base ne retenait que les manœuvres électorales de tôles et de peintures distribuées, d’autorisation d’installation en zone des cinquante pas, ou de patentes accordées par une municipalité qui employait tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Certes, le Sermac venait de naître, mais ce même citoyen de base ne comprenait une patate des envolées accessibles aux seuls messieurs et dames ayant une parfaite maîtrise de cette langue que l’on disait tueuse de spontanéité et pénalisante pour la créativité, cela dès les bancs de la maternelle de l’école française. Bref notre élite dans ces années là, courtisait des gens déjà convaincus, des gens ayant déjà fait leur prise de conscience enclenchée dès leur rencontre avec l’autre dont le regard forçait à assumer sa différence.
C’est mon constat des années 70.
J’ai donc voulu parler à ceux qui me paraissaient désorientés par l’abandon d’une littérature élitiste qui décidément laissait trop de monde sur le bord de la route. Il fallait parler au peuple et non parler, au nom du peuple, à des oreilles extérieures distributrices de lauriers. Il me semblait que l’urgence était de partir à la reconquête d’une image niée. Saccagée par l’extériorité avec la complicité d’une élite, tellement soumise au modèle européen, qu’elle n’accordait son admiration qu’à celui ou à celle qui œuvrait en littérature ou en peinture, avec les règles, les interdits, les autorisations de l’autre, en tentant de camoufler sa servilité sous un prétendu universalisme, d’ailleurs, invention du colonisateur. Quand en plus, cette élite de gauche s’affirmait anticolonialiste, cela ressemblait à un bal de macaques. Pour ma part, je pensais que nous ne pouvions séduire l’extérieur qu’en affirmant notre différence, or notre différence c’est se révéler à l’autre. Se révéler à l’autre c’était officialiser cette différence. Il fallait donc anoblir l’image saccagée en la présentant avec respect et déférence dans nos écrits, dans nos chansons, dans nos peintures. J’ai donc commencé par le commencement. Déjà affranchi intellectuellement, il me restait à l’être dans les moyens. J’ai donc refusé d’être journaliste à R.F.O ou à France-Antilles, à un moment où le mot chômage n’existait pas dans le métier, comme ceux qui forment actuellement les cadres de ces deux organes de presse et j’ai crée mes propres journaux. Une rapide enquête du marché, et dans une île où lorsque vous marchez trop vite vous tombez dans l’eau, une enquête du genre est très facile à mener, me démontra que les meilleurs véhicules pour parler au plus grand nombre étaient la Bande dessinée et le roman photo, j’ai donc crée une bande dessinée et un roman photo. M.G.G (Martinique Guyane Guadeloupe) mensuel de B.D a donc été la première bande dessinée des Antilles-Guyane. Mon premier gros problème a été de trouver des dessinateurs martiniquais, je veux dire dessinant martiniquais. Car à l’époque à la Martinique on dessinait avec le modèle blanc collé aux doigts. Mes exigences étaient simples, je voulais deviner l’Africain, mais pas reconnaître l’Africain. Je ne suis pas Africain. Je voulais deviner l’Européen, mais pas reconnaître l’Européen. Je ne suis pas Européen. Les dessinateurs, âgés de 17 à 22 ans, ont alors fait leur révolution culturelle. Le résultat fut tout simplement génial.
Le
Retour de Monsieur Coutcha ?
TD : Oui. Mais c’est là le titre de l’un des album publiés. Il y en a eu trois ou quatre. M.G.G (Martinique Guyane Guadeloupe) a d’abord été un mensuel de B.D et d’informations culturelles ; il y a 3 ou 4 albums du genre. Le succès a été foudroyant parce que le lecteur se reconnaissait, enfin dans un journal structuré, avec des histoires élaborées où il y avait enfin ses gestes, sa façon d’être, sa façon de parler : en créole, en français ou en fwansé bannanne. Je voulais, par l’écrit et par l’image, restituer une atmosphère, un vécu collectif. J’ai ensuite crée un roman-photo avec les mêmes objectifs, mais il a fallu attendre cinq ans avant que la Martinique ne s’équipe de l’offset nécessaire .
Lorsque je décidai de me lancer dans le roman, les buts et objectifs étaient les mêmes : repérer et officialiser, l’environnement immédiat, capter l’atmosphère martiniquaise, la saveur martiniquaise, à la fois dans la forme et dans le fond, traduire tout cela par des mots et par des phrases simples accessibles au plus grand nombre. Voilà expliqués ces choix : bande dessinée, roman-photo, roman policier.
Cette
volonté de capter l’attention du plus grand nombre correspond en effet tout à
fait au genre policier ; l’humour peut s’exprimer vraiment au sein du
roman policier et Panique aux
Antilles joue d’ailleurs beaucoup
sur ce registre là…
TD : Panique aux Antilles, Les Larmes des autres, en effet j’ai utilisé toutes les méthodes pour dire au plus grand nombre qu’il se passait quelque chose de différent. En clair je lui disais : « Je nous regarde de l’intérieur et voilà ce que cet intérieur provoque en moi ».
Votre
héros Pierre Corneille semble symboliser un véritable syncrétisme
culturel : il porte « le nom du papa du Cid » tout en étant
surnommé l’Antillais, il pratique les arts martiaux comme il sait manier le
coutelas, il parle aussi bien un créole paysan qu’un français soutenu et il
symbolise parfaitement ce syncrétisme à travers son amour pour toutes les
femmes. Faites-vous de ce personnage un modèle dans la mesure où il est capable
d’assumer ses différentes composantes culturelles, ce qui semble difficile à réaliser
par le peuple antillais dans la façon dont il nous est présenté, à nous,
métropolitains ?
TD : Je ne sais pas si j’ai voulu en faire un modèle . En tous cas c’est une réalité. J’ai décrit des gens fascinants, les gens de la société d’aujourd’hui. Le miroir reconstitué en aucun cas ne saurait nier l’une des composantes de ma personnalité. Le peuple martiniquais ne saurait être noir tout noir ou tout blanc. Malheur à ceux qui l’affirment. Nous sommes un peuple métis et nous avons des origines diverses -Asie, Afrique, Europe Eradiquer, nier l’une de nos composantes, même s’il y a eu viol au départ, serait tuer artificiellement le père. On ne peut tuer le père que si on l’a d’abord identifié, si on passe son temps à ne jamais le reconnaître, on ne le tue jamais. Alors cela donne cette fuite en avant permanente de certains d’entre nous. Donc, Pierre Corneille est le personnage qui a fasciné les années 70. L’un de ceux qui commençaient à ne plus être traumatisés par le viol et qui avaient appris à faire avec. On ne peut pas dire qu’il soit aliéné. Aliéné par rapport à quoi d’ailleurs? A partir de combien de siècles la répétition des gestes empruntés à l’autre cesse d’être aliénation pour devenir gestes naturels ?
Pierre Corneille a un comportement très identique à l’inspecteur martiniquais de l’époque, est né dans un département sous influence coloniale . Cette influence coloniale se joue sur un terrain extrêmement original, puisque la colonisation martiniquaise ne peut en aucun cas être comparée à la colonisation africaine ou asiatique. Nous ne pouvons examiner la société martiniquaise avec le même regard que nous examinerions la société algérienne ou marocaine. La naissance du peuple martiniquais est d’une originalité folle et au cours des ans il est devenu à la fois l’un et l’autre. Pierre Corneille est le Martiniquais des années 70. Il serait intéressant de savoir ce qu’il est devenu en 2002.
A
travers ce personnage, vous accentuez un élément, l’érotisme, qui peut paraître
tabou pour un lecteur extérieur. La question de la sexualité dans la
littérature antillaise peut sembler délicate, de par les préjugés racistes qui
ont pu circuler sur la question. Est-ce que votre statut d’écrivain populaire
vous offre la liberté d’aborder n’importe quel sujet sans craindre de froisser
votre lectorat et est-ce que le fait d’aborder librement le thème de la
sexualité peut renforcer la connivence que vous entretenez avec le lectorat
martiniquais ?
TD : Sans doute. Mais je crois que c’est d’abord l’autorité du journaliste qui m’a permis de dire avec insolence tout ce que j’avais à dire. Je suis né en littérature en annonçant très fort que j’étais un provocateur, que je n’appartenais à aucune chapelle et que, tout en explorant de façon minutieuse le passé, il n’était pas question pour moi de faire arrêt sur image. Donc j’ai eu un langage très clair, très fort, de provocateur, dès le départ. Effectivement cela provoquait quelques remous… J’ai été par exemple l’un des rares, sinon le seul dans cette période plutôt agitée où le nationalisme commençait à montrer les dents, à écrire qu’un Béké était Martiniquais au même titre qu’un Nègre. A l’époque cela avait provoqué des turbulences. Maintenant, en 2002, tout le monde dit la même chose. J’ai donc d’abord démontré ma totale liberté par rapport aux partis politiques, aux chapelles, aux courants littéraires, avec une volonté inébranlable celle de porter haut les valeurs martiniquaises, ce qui à l’époque me valait des menaces d’être traduit devant la haute cour de sûreté de l’Etat. Parce que dire dans les années 70 « je suis martiniquais », c’était courir le risque de se retrouver devant le tribunal de la cour de sûreté de l’Etat. Il y avait donc une espèce d’agacement quant à mon attitude parce que mes détracteurs ne pouvaient affirmer que mon discours était celui de l’aliéné, celui du « béni oui-oui », celui de la France, bien au contraire, je prenais toutes mes distances par rapport à la France, par rapport à la domination française, mais en même temps, je n’avais pas ces cris de haine envers l’une des composantes de ma personnalité, le blanc.
C’est
pour cette raison que vous avez choisi de vous éditer vous-même, pour garder
cette liberté ?
TD : Oui et non. D’abord, effectivement, avoir sa propre maison d’édition c’est produire ses propres journaux avec la garantie d’une liberté totale. L’autre aspect de la question est que lorsque, toujours en 70, j’entrais dans une librairie, je constatais qu’il n’y avait aucun journal martiniquais, sauf des feuilles de chou de partis politiques, aucun livre écrit par un auteur martiniquais, alors que nous étions inondés, car à l’époque les Martiniquais étaient de très grands lecteurs, de livres de l’étranger, de l’extérieur. Les librairies se portaient bien, il y en avait plus d’une trentaine et l’industrie du livre marchait très bien, mais rien de martiniquais dans toutes ces propositions du libraire. Je me suis dit qu’il était temps que le Martiniquais agisse de l’intérieur. Avec des ingrédients martiniquais soulignant sa différence, il devait pouvoir conquérir le monde. C’était un pari, un rêve. J’ai essayé de le réaliser..
Le
problème est que les métropolitains qui s’intéressent à la littérature
antillaise, ont à disposition tout ce qui est publié chez Gallimard et
consorts, mais il est très difficile d’obtenir par exemple vos ouvrages.
TD : Sans doute. Mais ou l’on choisit le prestige de la maison d’édition française, nation française que l’on prétend d’ailleurs combattre à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre, ou l’on choisit d’attendre que les choses avancent. Conclusion, lorsque l’on attend avec patience on s’aperçoit qu’une étudiante de Bordeaux ou de Paris ou du Canada, peut désormais vous appeler pour discuter de vos oeuvres. Vous êtes quand même la sixième étudiante de l’extérieur qui fait appel au martiniquais qui de chez lui discute avec le restant du monde sans l’aide d’une maison d’édition française. Il existe déjà quatre mémoires sur ma production… Désormais on peut trouver mes livres dans toutes les Fnac de France et dans les principales villes de France. Cela s’élargit de plus en plus. Autrement dit c’est un choix, le choix d’une stratégie difficile, sans gloire probablement mais qui commence à porter ses fruits.
Que pensez-vous alors d’un
auteur comme Chamoiseau qui est publié chez Gallimard, qui prétend également
parler du peuple martiniquais et le faire connaître dans sa créolité au monde
entier, sans pour autant recueillir une très grande popularité chez lui aux
Antilles.
TD : Ces auteurs-là font ce qu’ils estiment devoir faire. Je n’ai pas de jugement de valeur à porter à ce niveau-là. Ils conduisent leur barque comme ils l’entendent et vous avez fait vous-même le constat en vous apercevant qu’ils ne sont pas très populaires chez eux. Ça veut simplement dire qu’il y a un décalage entre leur société et eux.
Est-ce
que vous vous sentez des affinités avec le mouvement de la créolité ou avec son
esthétique littéraire ?
TD : Les garçons de la créolité sont des garçons de ma génération.
Vous
avez fait vos débuts avec Chamoiseau…
TD : Chamoiseau a fait ses débuts avec moi, oui. Il était la principale vedette de la bande dessinée. Nous avons le même terroir, nous avons le même souffle, nous avons le même refus de l’aliénation, le même refus de l’écrasement, il est donc normal que nous ayons très souvent les mêmes cris et que nous nous reconnaissions très souvent, à des détails près, chez l’un et chez l’autre.
Comment
évaluez-vous la distance qui vous sépare d’un auteur comme lui qui choisit
d’être publié à l’extérieur ?
TD : Je ne l’évalue pas. Je ne suis pas fasciné par l’extérieur. Mon pari est réussi à 100%, c’est-à-dire vaincre l’intérieur. Je suis le premier et le seul écrivain antillais à avoir été d’abord reconnu de façon spontanée et immédiate par Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne. Je suis le seul. Césaire a été reconnu par l’intellectuel Breton ; Chamoiseau d’une manière générale a été imposé par la presse française. Jamais le style Chamoiseau, c’est ma conviction et je l’ai souvent dit, n’aurait eu l’aval des enseignants martiniquais, par exemple, si le Goncourt n’était venu affirmer son talent, car ce talent existe. A l’époque, toucher à la langue française était un crime de lèse majesté pour le milieu intellectuel. D’ailleurs on en a entendu de belles à la sortie de Chronique des sept misères. Ces critiques ont cessé de façon définitive après le prix.
Avez-vous
été tenté de suivre la même voie que lui, la voie de l’extérieur ?
TD : Non pas du tout. Mais je commence à y penser parce que j’ai la satisfaction, désormais de dire que j’ai conquis et séduit l’intérieur. Fort de cette conquête, peut-être vais-je commencer à faire des clins d’œil à l’extérieur. Mais je vous avoue que je vivrais cela comme un échec.
Est-ce
que je peux vous demander à combien d’exemplaires sont vendus vos romans ?
TD : Non, vous ne pouvez pas. (rires)
On
peut dire que vous êtes un des plus lus ?
TD : Le plus lu. Ce n’est pas moi qui le dit mais le libraire…
Peut-on dire en ce sens que
vous êtes un écrivain populaire, au sens de défenseur et d’illustrateur du
« petit peuple » ?
TD : Défenseur ? J’ignore si je suis le défenseur de quoi que ce soit. Je suis un créateur. Je suis peuple, je ne parle pas au nom du peuple, je parle de moi. Je me présente aux autres à qui je dis « voilà une histoire que je te raconte, je te la raconte comme ça parce que je pense que c’est la façon de chez nous. ». Je ne me sens pas investi d’une mission de quoi que ce soit. J’écris. D’abord écrire est un virus. Je ne peux pas passer une journée sans écrire. J’ai la chance de plaire à ma société, bravo! Mais j’écris d’abord pour moi. J’ai quand même écrit mon premier roman à l’âge de 14 ans. On ne pense à rien d’autre à cet âge. Et cela a continué. J’écris pour moi, sans penser aux autres, il se trouve que j’intéresse les autres. Bravo! Je suis très content et même très heureux, c’est ce qui peut arriver de mieux à quelqu’un qui écrit. J’aborde tous les bobos de la société martiniquaise, tous les tabous, je rentre dedans bille en tête -les békés, l’immigration, l’impuissance, le handicap mental, les rapports hommes femmes, etc. Tous ces problèmes qui paralysent notre société, je les traite de façon délibérée parce que je suis un provocateur.
Envisagez-vous
de retenter l’expérience du roman policier ?
TD : Oui sans doute. J’en ai trois dans mes tiroirs…
***
Commentaire :
Cet entretien a été réalisé dans le cadre d’une journée d’étude consacrée aux champ et contre-champs de l’histoire littéraire antillaise, afin d’étayer une réflexion concernant une approche comparative des écrivains martiniquais Tony Delsham et Patrick Chamoiseau, à partir de deux romans en particulier, Panique aux Antilles et Solibo Magnifique, qui présentent notamment l’intérêt commun de s’inspirer plus ou moins directement du genre policier.
L’intérêt de cette étude consistait à mettre en évidence l’existence de divergences profondes inhérentes notamment au contexte de réception de l’œuvre, entre ces deux auteurs qui, néanmoins semblent inspirés par les mêmes souffles, poussés par les mêmes cris. En effet, au-delà des affinités sensibles dans l’expression d’un même un référent populaire antillais, T. Delsham et P. Chamoiseau se démarquent par des tonalités et des intentions -éditoriales entre autres- divergentes. Quand T. Delsham confère à ses textes, et notamment à Panique aux Antilles, une tonalité légère, ludique et triviale tout en abordant des questions essentielles relatives à l'identité profonde du peuple martiniquais, P. Chamoiseau semble exprimer un rire grinçant, amer et inscrire son écriture dans une forme de résonance intertextuelle censée ouvrir son texte à l’universalisme. T. Delsham exprime la nécessité de reconquérir une image niée, de décrire le peuple en reconstituant un miroir brisé, d’œuvrer à la réalisation d’un syncrétisme culturel, faisant du métissage une force, un trait d’union entre les êtres tandis que P. Chamoiseau prétend déchirer le réel, mettre en avant les contradictions, apprendre à vivre ses différences dans l’opposition, la confrontation voire le conflit. L’un prône la réalisation d’une mosaïque unifiée, possible dans l’acceptation et la réunion des différentes composantes identitaires ; l’autre inscrit son écriture dans une mosaïque fragmentée unie dans les contradictions, les paradoxes et les conflits identitaires. L’écriture de T. Delsham attire, parce qu’elle se veut plus optimiste et vivifiante, mais pas seulement ; la lucidité du regard, tout en entretenant une certaine connivence avec le lectorat local, parfois, il est vrai, flatté, confère au texte une tonalité juste et touchante. L’écriture de P. Chamoiseau, elle, semble effrayer davantage le lectorat local qui ne peut véritablement se reconnaître dans la complexité des tableaux brossés, qui peut éprouver des difficultés à reconnaître cette langue créolisée qu’on fait sienne, qui éprouve peut-être quelques réticences face à cet écrivain local qui choisit de s’exprimer par la voie de la métropole, par le biais d’une prestigieuse maison d’édition métropolitaine ; sa poétique se révèle être complexe, s’inscrivant finalement davantage dans une problématique d’écriture que d’identité : contrairement à ce que l’on attend peut-être de lui, tant en Martinique qu’en métropole, P. Chamoiseau semble se ressentir Ecrivain avant de se ressentir Martiniquais ; au fil des années et des productions littéraires, Chamoiseau-Ecrivain semble supplanter Chamoiseau-Martiniquais et sa projection sur la figure du marqueur de paroles semble signer cette transition. T. Delsham lui se veut Martiniquais ; il est écrivain, il est journaliste mais avant tout il est peuple et en parlant de lui et pour lui, il ne peut que toucher le lectorat martiniquais au plus profond, naturellement, simplement, sans tabous.
Parler du peuple, au nom du peuple, parler tout court…Est-ce simplement possible de parler tout court quand on est écrivain antillais ? Il me semble que le lectorat métropolitain attend les œuvres antillaises avec une certaine curiosité, pas toujours complètement saine ; le lectorat antillais, lui, les attend au tournant…Les questions de choix d’écriture, de stratégie éditoriale, de devoir culturel me paraissent consubstantielles de toute écriture relevant d’espaces identitaires collectifs troublés, tels que peuvent l’être les sociétés post-coloniales. Ce genre de divergences opposant deux écrivains issus d’un même espace, inspirés par le même terroir, animés par un même refus de l’aliénation, poussés par les mêmes souffles semblent inévitables en même temps que nécessaires. Elles expriment la richesse d’une culture, d’une littérature aux composantes et aux inspirations multiples, vivante, en mouvement perpétuel et qui n’en finit pas de se rechercher, comme toute entité vouée à perdurer.
|
ANNEXE 2 |
EXTRAITS DE LA
BANDE-DESSINEE
LE RETOUR DE MONSIEUR
COUTCHA[967]
Extrait 1
Cet extrait illustre l’affrontement opposant Man Courbaril aux forces de l’ordre et plus précisément au brigadier Bouaffesse, accompagné de ses supérieurs. Il rend parfaitement compte à la fois de la détermination et de l’insoumission de la marchande -qui n’est pas sans rappeler Doudou-Ménar, la majorine mis en scène dans Solibo Magnifique- et la situation inconfortable dans laquelle se trouve Bouafesse, véritablement pris entre deux feux.



Alors que Bouaffesse est mis en difficulté par la marchande, ses supérieurs le somment de rétablir la situation, ce qui ne manque pas de l’agacer :



Extrait 2
Alors que Bouaffesse informe ses supérieurs qu’un redoutable major arpente les rues de la ville, il s’agit, pour Abel/Chamoiseau et T. Delsham de mettre en scène un représentant blanc de la métropole, reconnaissable au mépris, à un sentiment de supériorité indéfectible et à un racisme primaire ; c’est-là, sous une forme ludique, un plaidoyer anticolonialiste.

Extrait
3
Quatrième de couverture de la bande-dessinée Le Retour de Monsieur Coutcha.
Nous retrouvons ici la singularité du style de Bouaffesse, dont le roman Solibo Magnifique sera largement imprégné.

|
ANNEXE 3 |
EXTRAIT
DES AVENTURES ILLUSTREES
DES FRERES DEHOHÊME
Les illustrations consacrées aux frères Déhohême sont signées Abel, pseudonyme de Patrick Chamoiseau. Elles ont été régulièrement publiées par l’hebdomadaire Antilla au cours des années 1980.
Toutes ces planches mettent en scène le difficile combat des frères Déhohême contre l’oppresseur colonial ; le ton est acerbe, ironique, cinglant et si le discours de fond de Patrick Chamoiseau est encore teinté aujourd’hui des stigmates de ce combat anti-colonialiste, la manière a indéniablement changé ; le lieu de publication également.

BIBLIOGRAPHIE
I- CORPUS
1- Ouvrages de base
1.1-
Aire maghrébine
AL
SID, Rouges gorges
et souris ravageuses, Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, Série
« Glauque », 1997.
AL
SID, Machettes
coconuts et grigris à Conakry, Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, Série
« Glauque », 2000.
CHARLOTTE, Le Meurtre de Sidi Bou Saïd,
Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, 1991.
CHARLOTTE, Les Vacances du commissaire,
Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, 1992.
CHRAÏBI, Driss, Une Enquête au pays, Paris, Editions du Seuil, 1981.
CHRAÏBI, Driss, Une Place au soleil, Paris, Denoël, 1993.
CHRAÏBI, Driss, L’Inspecteur Ali à Trinity College, Paris, Denoël, 1996.
CHRAÏBI, Driss, L’Inspecteur Ali et la C.I.A., Paris, Denoël, 1997.
COHEN, Albert, Les Noces du commissaire, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 2001.
KHADRA, Yasmina, Le Dingue au bistouri, Alger, Editions Laphomic, 1990 (éd. réf. : Flammarion, 1999).
KHADRA, Yasmina, La Foire des enfoirés, Alger, Editions Laphomic, 1993.
KHADRA, Yasmina, Morituri, Paris, Editions Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1997 (éd. réf. : Folio policier, 1999).
KHADRA, Yasmina, Double blanc, Paris, Editions Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1997 (éd. réf. : Folio policier, 2000).
KHADRA, Yasmina, L’Automne des chimères, Paris, Editions Baleine, Collection « Instantanés de polar », 1998.
KOFFEL, Jean-Pierre, Des Pruneaux dans le tagine, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 1996.
KOFFEL, Jean-Pierre, L’Inspecteur Kamal fait chou blanc, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 1999.
LAMRINI, Rida, Les Puissants de Casablanca, Rabat, Editions Marsam, 1999.
MIMOUNI, Rachid, Tombéza, Paris, Editions Robert Laffont, 1984.
SANSAL, Boualem, Le Serment des Barbares, Paris, Gallimard, 1999.
1.2-
Aire antillaise
CABORT-MASSON, Guy, La Mangrove mulâtre, Fort-de-France, La Voix du peuple, 1991.
CABORT-MASSON, Guy, Qui a tué le béké de Trinité ?, Fort-de-France, La Voix du peuple, 1991.
CHALUMEAU, Fortuné (avec la collaboration d’Alain Nueil), Pourpre est la mer, Genève, Bompiani Eboris S.A., 1995.
CHAMOISEAU, Patrick, Solibo Magnifique, Paris, Gallimard, 1988.
CONDE, Maryse, Traversée de la Mangrove, Paris, Mercure de France, 1989.
CONDE, Maryse, La Belle créole, Paris, Mercure de France, 2001.
CONFIANT, Raphaël, Le Meurtre du Samedi-Gloria, Paris, Mercure de France, 1997.
CONFIANT, Raphaël, La Dernière java de Mama Josepha, Paris, Mille et une nuits, 1999.
CONFIANT, Raphaël, Brin d’amour, Paris, Mercure de France, 2001.
DELSHAM, Tony, Panique aux Antilles, Fort-de-France, Editions M.G.G., 1985.
FOURRIER, Janine & Jean-Claude, Morts sur le morne, Paris, Editions caribéennes, Série « Tropicalia », 1986.
PEPIN, Ernest, L’Homme-au-Bâton, Paris, Gallimard, 1992.
ROBIN-CLERC, Michèle, Au Vent des fleurs de canne, Pointe-à-Pitre, Jasor, 2000.
2. Lectures complémentaires
2.1-
Aire maghrébine
AKKOUCHE,
Mouloud, Causse
toujours !, Paris, Editions Baleine, Collection « Le
Poulpe », 1997.
AMARI, Chawki, De Bonnes nouvelles d’Algérie, Paris, Editions Baleine, Collection « Canaille/Revolver », 1998.
BEGAG, Azouz, Le Passeport, Paris, Editions du Seuil, 2000.
BELAÏD, Lakhdar, Sérail killers, Paris, Gallimard, Collection « Série
noire », 2000.
BELAÏD, Lakhdar, Takfir sentinelle,
Paris, Gallimard, Collection « Série noire », 2002.
CHRAÏBI, Driss, L’Inspecteur Ali, Paris, Denoël, 1991 (éd. réf. : Folio, 1995).
DAENINCKX, Didier, Meurtres pour mémoire, Paris, Gallimard, Collection « Série noire », 1984.
DIB, Djamel, L’Archipel du Stalag, Alger, ENAL, 1989.
EL’OCIN, L’Arme du crime, Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, 2000.
GHANOUCHI, Jamel, Tuer n’est pas jouer, Sidi Bou Saïd, Alyssa Editions, Série « Glauque », 1999.
KHADER, Youcef, Délivrez la Fidayia !, Alger, SNED, 1970.
KHADER, Youcef, « Halte ! au plan Terreur », Alger, SNED, 1970.
KHADRA, Yasmina, Les Agneaux du Seigneur, Paris, Julliard, 1998.
KHADRA, Yasmina, A quoi rêvent les loups, Paris, Julliard, 1999.
KHADRA, Yasmina, L’Ecrivain, Paris, Julliard, 2001.
KHADRA, Yasmina, L’Imposture des mots, Paris, Julliard, 2002.
KOFFEL, Jean-Pierre, Pas de visa pour le paradis d’Allah, Casablanca, Editions Le Fennec, Collection « Noire », 1997.
LAMRINI, Rida, Les Rapaces de Casablanca, Rabat, Editions Marsam, 2000.
SIMON, Catherine, Un Baiser sans moustache, Paris, Gallimard, 1998.
2.2-
Aire antillaise
CARRAUD, Jypé, Tim-Tim Bois-Sec, Paris, Rivages, 1997.
CHALUMEAU, Fortuné, CONFIANT, Raphaël, DEPESTRE, René, PEPIN, Ernest, TAUBIRA-DELANNON, Christiane, PINEAU, Gisèle, Noir des îles, Paris, Gallimard, 1995.
DELSHAM, Tony, ABEL (pseudo. de P. Chamoiseau), Le Retour de Monsieur Coutcha, Fort-de-France, Editions M.G.G., 1984.
DE
GRANDMAISON, Daniel, Rendez-vous
au Macouba, Paris, Littré, 1948.
DE
GRANDMAISON, Daniel, Le
Bal des créoles, Paris, La Pensée universelle, 1976.
JUMINER,
Bertène, Les
Héritiers de la presqu’île, Paris, Présence africaine, 1979.
LACROSIL,
Michèle, Demain
Jab-Herma, Paris, Gallimard, 1967.
MADAL,
Georges (pseudo. de
René Jadfard), L’Assassin joue et perd, Paris, Editions caribéennes,
1941.
MOURREN-LASCAUX, Patrice, Canal Laussat, Paris, l’Harmattan, 1994.
II- CRITIQUE
LITTERAIRE
1. Ouvrages généraux
ALLEMAND, Roger-Michel, Le Nouveau Roman, Paris, Ellipses, 1996.
COQUIO, Catherine, SALADO, Régis, Fiction et connaissance. Essais sur le savoir à l’œuvre et l’œuvre de fiction, Paris, l’Harmattan, 1998.
DUGAST-PORTES, Francine, in H. Mitterand (dir.), Le Nouveau Roman. Une césure dans l’histoire du récit, Paris, Nathan, 2001.
EVRARD, Franck, L’Humour, Paris, Hachette, 1996.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Editions du Seuil, Collection « Poétique », 1972.
GENETTE, Gérard, Nouveau discours du récit, Paris, Editions du Seuil, Collection « Poétique », 1983.
HAMON, Philippe, Du Descriptif, Paris, Hachette Université, Série « Recherches littéraires », 1993.
LUKACS, Georg, La Théorie du roman, Ferenc Janossy, 1920 (éd. réf. : Denoël, trad. J. Clairevoye, 1968).
MILLY, Jean, Poétique des textes, Paris, Nathan, Collection « Littérature », 1992.
RABATE, Dominique, Le Roman français depuis 1900, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Que sais-je ? », 1998.
RABATE, Dominique, « Le Secret et la modernité », in Modernités, n°14, Presses Universitaires de Bordeaux, 2000, p. 9-32.
RAIMOND, Michel, Le Roman depuis la révolution, Paris, Armand Colin, 1981.
RAIMOND, Michel, Le Roman, Paris, Armand Colin, Collection « Cursus », 1987, 2000.
REUTER, Yves, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Bordas, 1991 (éd. réf. : Dunod, 2ème édition revue et corrigée, 1996).
RICARDOU, Jean, Problèmes du Nouveau Roman, Paris, Editions du Seuil, Collection « Tel quel », 1967.
ROBBE-GRILLET, Alain, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961 (éd. réf. : 1996).
SARRAUTE, Nathalie, « L’Ere du soupçon », in Temps modernes, février 1950 (éd. réf. : Folio Essais, 2001).
SARTRE, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948 (éd. réf. : Folio Essais, 1997).
2. Ouvrages et articles consacrés au genre policier
2.1- Critique
AUDEN, Wystan Hugh, « Le Presbytère coupable. Remarques sur le roman policier par un drogué », in U. Eisenzweig (dir.), Autopsies du roman policier, Paris, Union générale d’éditions, 1983, p. 113-132.
Le texte a été publié une première fois sous le titre The Guilty Vicarage. Notes on the Detective Story, by an Addict, New York, Random House (trad. : C. Gilbert), 1948. BAUDOU, Jacques, SCHLERET, Jean-Jacques (dir.), Le Polar, Paris, Larousse, Collection « Totem », 2001.
BAYARD, Pierre, Qui a tué Roger Ackroyd ?, Paris, Editions de Minuit, 1998.
BESSIERE, Jean, « Crime et roman : la réalité nue de l’homme et de la société. Crime et Châtiment, Sanctuaire, L’Air d’un crime», in J. Bessière (dir.), Romans et crimes. Dostoïevski, Faulkner, Camus, Benet, Paris, Honoré Champion Editeur, 1998, p. 143-171.
BLANC, Jean-Noël, Polarville : images de la ville dans le roman policier, Lyon, Presses Universitaires, 1991.
BOILEAU, Pierre, NARCEJAC, Thomas, Le Roman policier, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Que sais-je ? »,1975.
BOOF-VERMESSE, Isabelle, CESARI-STRICKER,
Florence, « Les Règles du jeu dans Sanctuary », in J-M. Santraud (dir.), Americana,
n°13, 1996, p. 67-76.
BOOF-VERMESSE, Isabelle, « Les Détectives n’existent pas : Sanctuary, roman policier ? », in K. Haddad-Wotling (dir.), Romans du crime, Paris, Ellipses, 1998, p. 47-59.
BOURDIER, Jean, Histoire du roman policier, Paris, Editions de Fallois, 1996.
BOYER, Alain-Michel, « Cain, Sherlock Holmes et Sigmund Freud : vers une logique du secret », in Modernités, n°2, Presses Universitaires de Nantes, 1988, p. 1-38.
BOYER, Alain-Michel, « Portrait de l’artiste en policier », in Modernités, n°2, Presses Universitaires de Nantes, 1988, p. 217-269.
CALLE-GRUBER, Mireille, « Le crime-fiction d’Alain
Robbe-Grillet », in C. Foucard (dir.), Crimes et criminels dans la
littérature française. Actes du
CHASTAING, Maxime, « Le Roman policier “classique” », in Europe, n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 26-50.
COUEGNAS, Daniel, Introduction à la paralittérature, Paris, Editions du Seuil, 1992.
COUEGNAS, Daniel, Fictions, énigmes, images. Lectures (para ?) littéraires, Limoges, PULIM, 2001.
DELOUX, Jean-Pierre, « Philip Marlowe : portrait-robot », in Le Magazine littéraire, n°211, octobre 1984, p. 34-36.
DI MANNO, Yves, « Roman policier et société » in Europe, n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 117-125.
DUBOIS, Jacques, Le Roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992.
EISENZWEIG, Uri, « Introduction. Quand le policier devint genre », in U. Eisenzweig (dir.), Autopsies du roman policier, Paris, Union générale d’éditions, 1983, p. 7-31.
EISENZWEIG, Uri, Le Récit impossible. Forme et sens du roman policier, Mesnil-sur-l’Estrée, Editions Bourgois, 1986.
ENDREBE, Bernard, « Pérennité du roman d’énigme », in Europe n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 50-53.
ESCOLA, Marc, « Pierre Bayard contre Hercule Poirot, derniers rebondissements dans l’affaire Ackroyd », in Acta Fabula, Revue en ligne des parutions en théorie littéraire.
http://www.fabula.org/revue/cr/7.php
FERNANDEZ RECATALA, Denis, Le Polar, Paris, M.A. Editions, 1986.
FERNIOT, Christine, « La Folie du polar », in Lire n° 299, octobre 2001, p. 46-56.
FONDANECHE, Daniel, Le Roman policier, Paris, Ellipses, 2000.
GALLIX, François, « Formes du roman de détection. Quelques
approches de la critique moderne », in J-M. Santraud (dir.), Americana, n°13,
1996, p. 11-25.
GAUGAIN, Claude, « Réflexions sur le roman noir américain », in Modernités, n°2, Presses Universitaires de Nantes, 1988, p. 163-184.
GAUGAIN, Claude, « Trahir pour survivre. Traduction et adaptation dans la “Série noire” », in Modernités, n°2, Presses Universitaires de Nantes, 1988, p. 185-196.
GIDDEY, Ernest, Crime et détection. Essai sur les structures du roman policier de langue anglaise, Berne, Editions Peter Lang S.A., 1990.
GIRARD FRANCOIS, Marion, Parodie et transposition dans le roman policier contemporain. Exemples français et espagnols, Thèse de Doctorat présentée sous la direction du Professeur Claude Burgelin, Université Lumière-Lyon II, 2000.
HALEN, Pierre,
« Criminels et sectateurs. Quelques enjeux du récit d’énigme dans le
contexte colonial », in C. Foucard (dir.), Crimes et criminels dans la
littérature française. Actes du
HUET, Marie-Hélène, « Enquête et représentation, dans le roman policier », in Europe, n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 99-104.
JOLY, Jean-Luc, « Le Crime est un roman. Aspects esthétiques
du crime », in Le crime dans la
littérature. La littérature du crime, Actes du
LACASSIN, Francis, Mythologie du roman policier, Paris, Union générale d’éditions, 1974 (éd. réf. : Mesnil-sur-l’Estrée, Editions Bourgois, 1993, nouvelle édition augmentée et mise à jour).
LIPSKY, Eleazar, « Le Suspense », in S. Bourgoin (dir.), Polar : mode d’emploi. Manuel d’écriture criminelle, Amiens, Encrage Editions, 1989, p. 99-105.
LITS, Marc, Le Roman policier : introduction à la théorie et à l’histoire d’un genre littéraire, Liège, Editions du CEFAL, 1993.
MANDEL, Ernest, Meurtres exquis : une histoire sociale du roman policier, Montreuil, Presse-Edition-Communication (trad. : M. Acampo), 1986.
MESPLEDE, Claude, Les Années « Série Noire », 1945-1959, vol.I, Amiens, Encrage éditions, 1992.
MURCIA, Claude, « L’Air d’un crime ou l’apprentissage de la duplicité », in J. Bessière (dir.), Romans et crimes. Dostoïevski, Faulkner, Camus, Benet, Paris, Honoré Champion Editeur, 1998, p. 123-142.
O’BRIEN, Geoffrey, Hard-boiled U.S.A. : histoire du roman noir américain, Ed. Van Nostrand Reinhold, 1981 ; éd. réf. : Amiens, Encrage éditions (trad. : S. Bourgoin), 1989 (édition augmentée).
PESSO-MICQUEL, Catherine, « Le Chevalier, le
gentleman, la dame et la putain : codes chevaleresques dans le roman
noir », in J-M. Santraud
(dir.), Americana, n°13, 1996, p. 77-104.
PEYRONIE, André. « La Double enquête du roman policier à énigme », in Modernités, n°2, Presses Universitaires de Nantes, 1988, p. 129-162.
RIVIERE, François, « La Fiction policière ou le meurtre du roman », in Europe, n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 8-25.
RIVIERE, François, « Fascination de la réalité travestie », in Europe, n°571-572, novembre-décembre 1976, p. 104-117.
SCHWEIGHAEUSER, Jean-Paul, Raymond Chandler. Parcours d’une œuvre, Amiens, Encrage éditions, 1997.
STORELL, Sven, « San Antonio, un inspecteur de
police bien français ou le fin limier à gauloiseries “à prendre ou à
lécher” », in C. Foucard (dir.), Crimes et criminels dans la
littérature française. Actes du
VAREILLE, Jean-Claude, L’Homme masqué, le justicier et le détective, Lyon, Presses Universitaires, 1989.
VILAR, Jean-François, « Noir c’est noir », in E. Mandel, Meurtres exquis : une histoire sociale du roman policier, Montreuil, Presse-Edition-Communication (trad. : M. Acampo), 1986, p. 7-12.
2.2- Lectures complémentaires
CHANDLER, Raymond, The Big sleep, New York, A.A. Knopf, 1939 ; Le Grand sommeil, Paris, Gallimard, Collection « Série noire » (trad. B. Vian), 1948 ; éd. réf. : Folio policier, 1999.
CHANDLER,
Raymond, The High Window, New-York, A.A. Knopf,
1942 ; La Grande fenêtre, Paris,
Gallimard, Collection «
Série noire » (trad. R. Vavasseur, M. Duhamel), 1949 ; éd.
réf. : Folio policier, 1999.
CHRISTIE, Agatha, The Murder of Roger
Ackroyd, Dodd Mead & Company Inc., 1926 ; Le Meurtre de Roger Ackroyd, Paris, Librairie des Champs-Elysées
(trad. M. Dou-Desportes), 1927 ; éd. réf. : Le Livre de poche, 1991.
FAULKNER,
William, Sanctuary, New York, J. Cape & H.
Smith, 1931 ; Sanctuaire, Paris, Gallimard (trad.: R-N. Raimbault, H.
Delgove), 1972 ; éd. réf.: Folio, 1998.
HIMES,
Chester, The
Five cornered square, 1957 ; La Reine des pommes, Paris, Gallimard
(trad. M.
Danzas), 1958 ; éd. réf. : Folio policier, 1999.
HIMES,
Chester, All
shot up, 1959 ; Imbroglio Negro, Paris, Gallimard (trad. J. Fillion), 1960 ; éd.
réf. : Paris, Gallimard, « Série noire », 1997.
HIMES, Chester, Be calm, 1961 ; Ne nous énervons pas!, Paris, Gallimard
(trad. J. Fillion), 1961 ; éd. réf. : Folio policier, 1999.
III-
OUVRAGES ET ARTICLES CRITIQUES
RELATIFS A
L’AIRE MAGHREBINE
1. Histoire et société
ADDI, Lahouari, « L’Armée algérienne confisque le pouvoir », in Le Monde diplomatique, février 1998, p. 16-17.
ADDI, Lahouari, « Information biaisée et démocratie en devenir », in Confluences Méditerranée, Paris, l’Harmattan, n°25, printemps 1998, p. 165-173.
ALI-BENALI, Zineb,
« Voici venir le temps des possibles ? », in N. Redouane,
Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie: rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les Editions la Source, 1999, p. 43-54.
ALLOUACHE, Merzak, COLONNA, Vincent, « Editorial : Algérie voilée et dévoilée», in M. Allouache et V. Colonna (dir.), Algérie, 30 ans. Les enfants de l’Indépendance, Série « Monde », Hors-série n° 60, mars 1992, p. 12-16.
BOUZAR, Wadi, « 1989 en Algérie : espoir et désenchantement », in N. Redouane, Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie : rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les éditions la Source, 1999, p. 16-42.
BRÛLE, Jean-Claude, MUTIN, Georges, « Industrialisation et urbanisation en Algérie », in Maghreb Machrek, n°96, avril-mai-juin 1982, p. 41-65.
CARLIER, Omar, « Avril 1999 : l’élection présidentielle comme analyseur de la société politique algérienne contemporaine », in G. Meynier (dir.), L’Algérie contemporaine. Bilan et solutions pour sortir de la crise, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 205-265.
CHAULET-ACHOUR, Christiane, « 1989, chronique d’une année d’espoir… », in N. Redouane, Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie: rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les éditions la Source, 1999, p. 95-109.
DJELLOULI, Abdenour, « La Ville absente », in Les Violences en Algérie, Paris, Editions Odile Jacob, Collection « Opus », 1998, p. 111-141.
ELLYAS, Akram, « Les
Leçons oubliées des émeutes d’octobre 1988 », in Le Monde diplomatique,
mars 1999, p. 8.
ELLYAS, Akram, BENCHIBA, Lakdar, « Le Mur de l’argent fragmente la société algérienne », in Le
Monde diplomatique, octobre 2000, p. 14-15.
ESCALLIER, Robert, « Le Système urbain marocain : métropoles et petites villes », in Maghreb Machrek, n°96, avril-mai-juin 1982, p. 19-38.
ESCALLIER, Robert, « L’Image de la ville arabe dans la littérature de gare : le cas S.A.S. », in Cahiers de la Méditerranée, n°60, Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, juin 2000, p. 65-72.
GHEMATI, Abdelkrim, « A qui profite l’escalade dans l’horreur ? », in Confluences Méditerranée, n°25, Paris, l’Harmattan, printemps 1998, p. 109-115.
GOUMEZIANE, Smaïl, « Une Economie à bout de souffle », in G. Meynier (dir.), L’Algérie contemporaine. Bilan et solutions pour sortir de la crise, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 155-165.
GRANDGUILLAUME, Gilbert, « Comment a-t-on pu en arriver là ? », in Les Violences en Algérie, Paris, Editions Odile Jacob, Collection « Opus », 1998, p. 7-59.
HADJADJ, Djilali, « Une Population à la dérive », in Le Monde diplomatique, septembre 1998, p. 20.
HADJADJ, Djillali, « Cette corruption partout présente », in Le Monde diplomatique, septembre 1998, p. 21.
JULIEN, Charles-André, Le Maroc face aux impérialismes, 1415-1856, Paris, Editions I.A., 1978.
MARGENIDAS, Marc, « L’Information asservie en Algérie », in Le Monde diplomatique, septembre 1998, p. 19.
MARTINEZ, Luis, La Guerre en Algérie, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales, Paris, Karthala, 1998.
MONGIN, Olivier, PROVOST, Lucile, « 1997 : normalisation politique et violences massives », in Les Violences en Algérie, Paris, Editions Odile Jacob, Collection « Opus », 1998, p. 209-239.
SIMON, Catherine, « Le Maroc est engagé dans une vigoureuse lutte contre la corruption », in Le Monde, 19 février 1996, p. 4.
STORA, Benjamin, « Repossession identitaire », in Confluences Méditerranée, n°25, Paris, l’Harmattan, printemps 1998, p. 159-163.
STORA, Benjamin, La Guerre invisible. Algérie, années 1990, Paris, Presses de Sciences-Po, 2001.
STORA, Benjamin, Algérie, Maroc. Histoires parallèles, destins croisés, Paris, Maisonneuve et Larose, Collection « Zellige », 2002.
TANGEAOUI, Saïd, Les Entrepreneurs marocains. Pouvoir, société et modernité, Paris, Karthala, Collection « Les Afriques », 1993.
TROIN, Jean-François, « Vers un Maghreb des villes de l’an 2000 », in Maghreb Machrek, n°96, avril-mai-juin 1982, p. 5-18.
VERMEREN, Pierre, Histoire du Maroc depuis l’Indépendance, Paris, La Découverte, Collection « Repères », 2002.
2. Littérature
2.1- Ouvrages généraux
BONN, Charles, KHADDA, Naget, MDARHRI-ALAOUI, Abdallah (dir.), Littérature maghrébine d’expression française, Vanves, Edicef/Aupelf, Collection « Universités francophones », 1996.
BONN, Charles, GARNIER, Xavier, LECARME, Jacques, Littérature francophone, t.I : « Le Roman », Paris, Hatier, 1997.
BONN, Charles, BOUALIT, Farida, Paysages littéraires maghrébins des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, Paris/Montréal, l’Harmattan, 1999.
BONN, Charles, « Le Roman algérien au tournant du siècle : d’une dynamique de groupe émergent à une dissémination “postmoderne” », in B. Bechter-Burtscher et B. Mertz-Baumgertner (dir.), Subversion du réel : stratégies esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, Etudes littéraires maghrébines, n°16, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 252-258.
DEJEUX, Jean, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 1984.
DUGAS, Guy, « Dix ans de littérature maghrébine en langue française », in Notre Librairie, n°146, octobre-décembre 2001, p. 60-65.
MDARHRI ALAOUI, Abdallah, « Roman algérien actuel et violence socio-politique : tendances thématiques et narratologiques », in N. Redouane, Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie: rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les éditions la Source, 1999, p. 129-144.
MILIANI, Hadj, « Le Roman policier algérien », in C. Bonn et F. Boualit (dir.), Paysages littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, Paris, l’Harmattan, 1999, p. 105-117.
2.2- Etudes consacrées au roman policier maghrébin
BELHADJOUDJA, Rhéda, « Le Polar ? Je connais ! », in Horizons, 6 novembre 1987.
BELHADJOUDJA, Rédha, Traitement de la notion de suspense dans le roman policier algérien ou la naissance du polar en Algérie, Thèse de Magister sous la direction du Professeur Christiane Achour, Université d’Alger, 1993.
BENHACENE, C., « Treize, boulevard du crime », in Révolution africaine, 2 août 1987.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, Entre affirmation et critique. Le développement du roman policier algérien d’expression française, Thèse de doctorat réalisée sous la direction des Professeurs Guy Dugas et Robert Jouany, Universités Paris IV-Sorbonne et Innsbruck, 1998.
BECHTER-BURTSCHER, Beate,
« Le Roman policier algérien : d’une écriture idéologique à une
écriture critique », in Le Maghreb littéraire, vol. II, n°4, 1998,
p. 38-53.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, « Naissance et enracinement du roman policier en Algérie », in Algérie Littérature/Action, n° 31-32, mai-juin 1999, p. 221-229.
DUGAS, Guy, « Années noires, roman noir », in Algérie Littérature/Action, vol. XXVI, décembre 1998, p. 132-141.
DUGAS, Guy, « 1989, An I du polar algérien », in N. Redouane, Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie : rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les éditions la Source, 1999, p. 111-127.
KAZI-TANIL, Nora Alexandra, « Le Roman policier en Algérie », in Langues et Littératures, vol. VI, 1995, p. 31-38.
OURAMDANE, Nacer, « Enigmes », in Algérie Actualité, n°1471, 21-27 décembre 1993, p.30.
SIMON, Catherine, « Le Polar au bled », in Le Monde, 6 octobre 2000, p. 6.
2.3- Bibliographie sélective des ouvrages et articles consacrés à quelques auteurs en particulier
Driss Chraïbi
ABESCAT, Michel,
« L’Inspecteur Ali et la C.I.A. de Driss Chraïbi », in Le Monde,
17 janvier 1997, p. 6.
BELHALFAOUI, Aïcha, ABDELKRIM, Amar, « Driss Chraïbi : l’ancêtre redouble de vélocité », in Algérie Actualité, n°1471, 21-27 décembre 1993, p. 31-32.
BENCHAMA, Lahcen, L’Oeuvre de Driss Chraïbi. Réception critique des littératures maghrébines au Maroc, Paris, l’Harmattan, 1994.
BEN JELLOUN, Tahar, « La Revanche de Chraïbi », in Le Monde, 14 janvier 1994, p. 3.
BONN, Charles, « Driss Chraïbi, Une Place au soleil », in Hommes et migrations, n°1174, mars 1994, p. 49.
CHRAÏBI, Driss, « Entretien », in Algérie Actualité, n°1471, 21-27 décembre 1993, p. 31-32.
DEJEAN DE LA BATIE, Bernadette, « L’Inspecteur Ali enquête sur Driss Chraïbi : Une place au soleil et L’inspecteur Ali à Trinity College comme nouvelle version ou subversion du roman policier », in Nottingham French Studies, vol. XXXVII, n°2, Automne 1998, p. 73-86.
DEJEAN DE LA BATIE, Bernadette, Les Romans policiers de Driss Chraïbi. Représentations du féminin et du masculin, Paris, l’Harmattan, 2002.
LINARD-BENE, Michèle, « Le Bon sauvage et le paradis perdu dans Une Enquête au pays de Driss Chraïbi », in Recherches sur l’imaginaire, Cahier n°17, Université d’Angers, 1987, p. 217-233.
NOIVILLE, Florence, « Comment peut-on être marocain ? », in Le Monde, 22 novembre 1991, p. 21.
NOIVILLE, Florence, « Driss Chraïbi, l’homme libre », in Le Monde, 19 mai 1995, p. 5.
Djamel Dib
ATTOUCHI, Fettouma, « Djamel Dib persiste et signe », in Horizons, 22 février 1988, p. 1.
Youcef Khader
KHADER, Youcef, « La Critique, art difficile », in El Moudjahid, 8 août 1970.
Yasmina Khadra
ABBAS, Djaouida, « Rencontre avec Yasmina Khadra. L’écrivain tente une mise au point », in Liberté, 9 avril 2002, p. 6.
ABBAS, Nabil, « Le Polar algérien se distingue au pays de Daniel Pennac », in La Tribune, 21 octobre 1997.
ABESCAT, Michel, « Etats-mafias », in Le Monde, 13 juin 1997.
AÏT MANSOUR, Dehbla, « Yasmina Khadra à Liberté. Ecrire pour réinventer ma vie », in Liberté, 30 janvier 2001.
AÏT MANSOUR, Dehbla, « L’Ecrivain, dernier roman de Yasmina Khadra. L’histoire d’un cadet », in Liberté, 30 janvier 2001, p. 11.
AÏT MANSOUR, Dehbla, « Entretien », in Liberté, 30 janvier 2001, p. 11.
ARRACHE, Khaled, « Yasmina Khadra : “Rien ne changera avec ce pouvoir !” », in Le Matin, 24-25 août 2001, p. 5.
AUBENAS, Florence, « Ce que Khadra génère », in Libération, 30 septembre 1999.
BACHI, Salim, « “Je ne crois plus en l’Algérie”. Propos recueillis par Didier Jacob », in Le Nouvel Observateur, n°1890, 25 janvier 2001, p. 100.
BELAGHOUEG, Zoubida, « Yasmina Khadra, l’autre écriture », in Algérie Littérature/Action, n°43-44, septembre-octobre 2000, p. 222-224.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, « Le Roman policier algérien : d’une écriture idéologique à une écriture critique », in Le Maghreb littéraire, vol. II, n°4, 1998, p. 38-53.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, « Enquêtes sur la crise algérienne. La série noire de Yasmina Khadra », in N. Redouane, Y. Mokaddem (dir.), 1989 en Algérie: rupture tragique ou rupture féconde, Toronto, Les éditions la Source, 1999, p. 157-172.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, « Alger la noire. Lecture des
images de la ville dans les romans policiers de Yasmina Khadra », in Rapports-Het
Franse Boek, vol. LXIX, n°1,
1999, p. 12-20.
BECHTER-BURTSCHER, Beate, « Yasmina Khadra. Entretien », in Le Maghreb Littéraire, vol. IV, n°7, 2000, p. 79-90.
BELLOULA, Nacéra, « Yasmina Khadra. Composite rencontre », in Liberté, 20 septembre 2001, p. 11.
BELLOULA, Nacéra, « Yasmina Khadra. La culture des non-dits », in Liberté, 9 avril 2002, p. 6.
BELLOULA, Nacéra, « Le Privilège du Phénix de Mohamed Moulessehoul. L’autre “écrivain” », in Liberté, 8 octobre 2002, p. 11.
BEN ACHOUR, Bouziane, « Les Agneaux du Seigneur… », in El Watan, 14 juin 1999.
BEN ACHOUR, Bouziane, « Nafa Walid ou A quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra », in El Watan, 31 août 1999.
BENCHICOU, Mohamed, « Qui a tué Yasmina Khadra ? », in Le Matin, 21 février 2002.
BENMALEK, Samir, « Conférence-débat avec Yasmina Khadra. Parcours d’écrivain », in Le Matin, 9 avril 2002, p. 17.
CHAMPENOIS, Sabrina, « Bombe algérienne », in Libération, 8 mai 1997.
CHAMPENOIS, Sabrina, « Yasmina Khadra : reconduire le diable en enfer », in Libération, 9 juillet 1998.
CHENIKI, Ahmed, « L’auteur de A quoi rêvent les loups révèle son identité. Yasmina Khadra : un pseudonyme pour un officier supérieur de l’ANP », in Le Quotidien d’Oran, 13 janvier 2001, p. 5.
DEDET, Joséphine, « Yasmina Khadra sous le soleil des Satans », in Jeune Afrique/L’intelligent, n° 2176, 23-29 septembre 2002, p. 111-113.
DEJEAN DE LA BATIE, Bernadette, « Du masculin et du féminin dans les polars de Yasmina Khadra », in Palabres, vol. III, n°1-2, avril 2000, p. 191-202.
DOUIN, Jean-Luc, « Yasmina Khadra lève une part de son mystère », in Le Monde, 10 septembre 1999, p. 10.
DOUIN, Jean-Luc, « Yasmina Khadra se démasque. Entretien », in Le Monde des livres, 12 janvier 2001, p. 5.
GASTEL, Adel, « Morituri. Un roman qui s’attaque à la mafia politico-financière », in El Watan, 13 août 1997.
GASTEL, Adel, « Double blanc. La récidive de Yasmina Khadra », in Algérie Littérature/Action, n°12-13, septembre 1997, p. 177-179.
GASTEL, Adel, « Les Autrichiens découvrent notre Agatha Christie », in El Watan, 28 juin 1998.
GASTEL, Adel, « Vive l’Algérie, ses soldats et ses flics », in El Watan, 28 mai 1998.
GASTEL, Adel, « Une Agatha Christie à l’algérienne ? », in Algérie Littérature/Action, n°22-23, juin-septembre 1998, p. 189-192.
GLUSKSMANN, Raphaël, « Yasmina Khadra à la rencontre du public algérien », in Le Soir d’Algérie, 9 avril 2002, p. 9.
HAMDAOUI, Lotfi, « L’Imposture des mots ou le grand malentendu », in Le Matin, 13 février 2002, p. 17.
KAOUAH, Abdelmajid, « L’Histoire dévoilée de Yasmina Khadra », in Notre Librairie, n°146, octobre-décembre 2001, p. 70-73.
KHADRA, Yasmina, « A ceux qui crachent dans nos larmes », in Le Monde, 13 mars 2001, p. 13.
KHADRA, Yasmina, « A propos de l’ANP », in Le Quotidien d’Oran, 21 août 2001.
KHAMES, Djamel, « Yasmina Khadra. L’Ecrivain », in Hommes et Migrations, n°1231, mai-juin 2001.
LANCELIN, Aude, « Yasmina Khadra c’est moi », in Le Nouvel Observateur, n°1890, 25-31 janvier 2001, p. 96-97.
LE FORT, Gérard, COLMANT, Marie, « Entretien avec Yasmina Khadra sur France Inter », in Liberté, 24-25 septembre 1999, p. 11.
LEPROUST, Karen, « Yasmina Khadra et le commissaire Llob », in Les Cahiers de l’Orient, vol. LI, septembre 1998, p. 149-153.
LOUNES, Abderrahmane, « Le Dingue au bistouri de Commissaire Llob. Le polar et la manière », in El Moudjahid, 30 juillet 1991.
MABROUKI, Azzedine, « Dixit Mohamed Moulesshoul », in El Watan, 22 janvier 2001.
MILIANI, Hadj, « Le Crépuscule des détraqués », in World, n° 3, juillet-août 1998.
MOKHTARI, Rachid, « Des Thrillers en qamis », in Le Matin, 5 janvier 2000, p. 9.
MOKHTARI, Rachid, « La Seconde vie du roman algérien. Entretien avec Yasmina Khadra », in Le Matin, 29 août 2002, p. 7.
MOSTEFAOUI, Belkacem, « Yasmina Khadra enquête au cœur du tragique », in El Watan, 8 décembre 1999.
OURAMDANE, Nacer, « Enigmes », in Algérie Actualité, 21-27 décembre 1993, p. 30.
PIEILLER, Evelyne, « Llob, flic algérien », in L’Humanité, 1er juillet 2000.
SEMIANE, Sid Ahmed, « Entretien avec Yasmina Khadra », in Le Matin, 8 février 2001, p. 7-9.
SIMON, Catherine, « Yasmina Khadra : l’“inévitable universalité” du roman policier », in Le Monde, 6 octobre 2000, p. 6.
TALLANDIER, François, « Les Miroirs de l’exil », in Le Figaro, 7 février 2002.
VIROLLE, Marie, « Quand la série noire s’écrit à l’Algérienne », in Algérie Littérature/Action, n°10-11, avril-mai 1997, p. 171-173.
ZAMOUM, Fatma Zohra, « Le Roman noir d’une société », in Le Monde diplomatique, n°540, mars 1999, p. 9.
ZERROUKY, Hassane, « Yasmina Khadra menacé par les islamistes », in Le Matin, 17 octobre 2001.
Jean-Pierre
Koffel
KOFFEL, Jean-Pierre,
« La Violence dans l’écriture quand on est souverainement
pacifiste », in C. Jurquet (dir.), Le Crime dans la littérature. La
littérature du crime, Actes du
MOURIDE, Abdelaziz, « L’Inspecteur Kamal fait chou blanc de J.-P. Koffel. Le polar au service de la critique sociale », in Le Temps du Maroc, n°208, 22-28 octobre 1999.
Rachid Mimouni
AÏT MOHAMED, Salima, « Mimouni : l’intellectuel, ce guetteur », in Algérie Actualité, n°1425, 3-9 février 1993, p. 30-31.
BENCHEIKH, Mustapha, « La Notion de pouvoir dans le roman de Rachid Mimouni et ses incidences intellectuelles », in Prologues : revue maghrébine du livre, Casablanca, n°15, 1998, p. 77-80.
CHAULET-ACHOUR, Christiane, « Les Femmes et leur statu(e)t romanesque dans Tombéza », in N. Redouane (dir.), Autour des écrivains maghrébins. Rachid Mimouni, Toronto, Les Editions la Source, 2000, p. 153-166.
CHENIKI, Ahmed, « Entretien avec Rachid Mimouni », in Révolution africaine, n°1191, 26 décembre 1986.
MIMOUNI, Rachid, « Rachid Mimouni accuse », propos recueillis par Mourad Bourboune, in Jeune Afrique, n°1240, 10 octobre 1984, p. 76-80.
STAALI, Keltoum, « Quatre version pour un thème », in Révolution africaine, n°1191, 26 décembre 1986, p. 62-64.
Boualem Sansal
AUBENAS, Florence,
« La Foire d’Alger au régime Sansal », in Libération, 30
septembre 1999.
BERMOND, Daniel, « Interview de Boualem Sansal », in Le Quotidien d’Oran, 7 septembre 2000, p. 13.
CASTERAN, Claude, « Un Ivoirien et un Algérien secouent la littérature française », in La Tribune, 6 août 2000, p. 16.
CHAULET-ACHOUR, Christiane, « Noir le texte, noir le pays… », in Algérie Littérature/Action, n°43-44, septembre-octobre 2000, p. 117-127.
FRACHON, Alain, « Les Tourments de Boualem Sansal », in Le Monde, 21 juillet 2001, p. 26.
GAILLARD, Philippe, « Les Islamistes ont bon dos », in Jeune Afrique, 2-8 novembre 1999, p. 74-75.
GHANEM, Ali, « L’Actualité ça se vend, l’Algérie aussi », in Le Quotidien d’Oran, 24 septembre 2000, p. 6-7.
HADJADJ, Sofiane, HELLAL, Selma, « Boualem Sansal dans un entretien à La Tribune », in La Tribune, 4 octobre 1999, p. 6-7.
HAMDINE, Aziz, « Autour d’un café avec Boualem Sansal », in Liberté, 22 septembre 1999, p. 11, 13.
HAMDINE, Aziz, « Du supplice de Sansal au procès de Hermès… », in Liberté, 29-30 octobre 1999, p. 11.
HAMIDECHI, Boubakeur, « Du Serment de Barbares à celui du Mansourah », in Le Matin, 27 février 2001, p. 5.
LE FOL, Sébastien, « Boualem Sansal : Algérie, le bout de l’horreur », in Le Figaro, 2 septembre 1999.
LEPAPE, Pierre, « L’Histoire contre la mort », in Le
Monde, 27 août 1999, p. 2.
MOKHTARI, Rachid, « Le Fils de la ville », in Le Matin, 3 janvier 2000.
MOUFFOK, Ghania, « De Boudjedra à Sansal. Le malaise des barbares », in La Tribune, 22-23 octobre 1999, p. 12-13.
NOUASRI, Rabea, « Le prix Tropiques décerné à Boualem Sansal », in La Tribune, 13 janvier 2000, p. 16.
RAÏKOUM, Raïna, « Sansal’s french cancans », in Le Quotidien d’Oran, 24 septembre 2000, p. 7.
REDOUANE, Najib, « Boualem Sansal : du hasard à la nécessité de création », in Notre librairie, n°146, octobre-décembre 2001, p. 78-81.
IV- OUVRAGES ET ARTICLES CRITIQUES
RELATIFS A L’AIRE ANTILLAISE
1. Histoire et société
A.D.V., « Première opération de prévention primaire de lutte contre les toxicomanies », in Antilla, n°1050, 31 juillet 2003, p. 35-36.
BUTEL, Paul, Histoire des Antilles françaises, XVIIème-XXème siècles, Paris, Editions Perrin, 2002.
CORZANI, Jack (dir.), Dictionnaire encyclopédique des Antilles et de la Guyane, t. I à VII., Fort-de-France, Désormeaux, 1992-1997.
DELSHAM, Tony, Papa est-ce que je peux venir mourir à la maison ?, Fort-de-France, Editions M.G.G., 1999.
DRU, Pierre, « Inspirations, pratiques et origines du danmyé. De l’ancienne Egypte à la Martinique de nos jours », in Les Périphériques vous parlent, n°13, printemps 2000, p. 18-30.
2. Littérature
2.1- Ouvrages généraux
ANTOINE, Régis, La Littérature franco-antillaise : Haïti, Guadeloupe et Martinique, Paris, Karthala, 1992.
ANTOINE, Régis, Rayonnants écrivains de la Caraïbe, Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 1998.
BURTON, Richard, Le Roman marron : études sur la littérature martiniquaise contemporaine, Paris/Montréal, l’Harmattan, 1997.
CHAMOISEAU, Patrick, CONFIANT, Raphaël, BERNABE, Jean, Eloge de la créolité, Paris, Gallimard, Saint-Joseph, Presses universitaires créoles, 1989.
CHAMOISEAU, Patrick, Ecrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997 (éd. réf. : Folio, 2002).
CHANCE, Dominique, L’Auteur en souffrance, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
CONDE, Maryse, (dir.), L’Héritage de Caliban, Pointe-à-Pitre, Editions Jasor, 1992.
CONDE, Maryse, COTTENET-HAGE, Madeleine (dir.), Penser la créolité, Paris, Karthala, 1995.
CORZANI, Jack, La Littérature des Antilles-Guyane françaises, t. I à VI, Fort-de-France, Désormeaux, 1978.
CORZANI, Jack, HOFFMANN, Léon-François, PICCIONE, Marie-Lyne, Littératures francophones, t. II : « Les Amériques. Haïti, Antilles-Guyane, Québec », Paris, Belin, Collection « Lettres Sup », 1998.
DAHOMAY, Jacky, « Habiter la créolité ou le heurt de l’universel », in Chemins critiques, vol. I, n°3, décembre 1989, p. 109-133.
DEGRAS, Priska, « La Littérature caraïbe francophone : esthétiques créoles », in Notre Librairie, n°127, juillet-septembre 1996, p. 6-16.
DEGRAS, Priska, « La Nouvelle génération littéraire caraïbe », in Notre Librairie, n°146, octobre-décembre 2001, p. 84-87.
DELAS, Daniel, Littératures des Caraïbes de langue française, Paris, Nathan, 1999.
DELPECH, Catherine, ROELENS, Maurice (dir.), Société et littérature antillaises aujourd’hui. Actes de la rencontre de novembre 1994 à Perpignan, in Cahiers de l’Université, n°25, Perpignan, Presses universitaires, 1997.
DE RUYTER-TOGNOTTI, Danielle, VAN STRIEN-CHARDONNEAU, Madeleine, Le Roman francophone actuel en Algérie et aux Antilles, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1998.
GARNIER, Xavier, « Caraïbes », in C. Bonn, X. Garnier, J. Lecarme (dir.), Littérature francophone, I-Le Roman, Paris, Hatier, 1997, p. 108-137.
GIRAUD, Michel, « La Créolité : une rupture en trompe-l’œil », in Cahiers d’études africaines, n°148, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences-sociales, 1997, p. 795-811.
GLISSANT, Edouard, Faulkner, Mississippi, Paris, Editions
Stock, 1996.
LAURETTE, Pierre, RUPRECHT, Hans-George, Poétiques et imaginaires. Francopolyphonie littéraire des Amériques, Paris, l’Harmattan, 1995.
MAXIMIN, Colette, Littératures caribéennes comparées, Pointe-à-Pitre, Jasor, Paris, Karthala, 1996.
MODILENO, Lydie, L’Ecrivain antillais au miroir de sa littérature, Paris, Karthala, 1997.
MOURA, Jean-Marc, Lire l’exotisme, Paris, Dunod, 1992.
NDIAYE, Christiane, « De Césaire à Condé : quelques retours au pays natal », in C. Ndiaye et J. Semujanga (dir.), De Paroles en figures, Montréal, l’Harmattan, 1996, p. 137-172.
RINNE, Suzanne, VITIELLO, Joëlle (dir.), Elles écrivent des Antilles : Haïti, Guadeloupe, Martinique, Paris, l’Harmattan, 1997.
SEGALEN, Victor, Essai sur l’exotisme. Une esthétique du divers, Saint-Clément, Editions Fata Morgana, 1978.
SPEAR, Thomas C., « Jouissances carnavalesques: représentations de la sexualité », in M. Condé et M. Cottenet-Hage (dir.), Penser la créolité, Paris, Karthala, 1995, p. 135-152.
2.2- Bibliographie sélective des ouvrages et articles consacrés à quelques auteurs en particulier
Patrick
Chamoiseau
BESSIERE, Jean, « Patrick Chamoiseau et les récits de l’inédit. Poétique explicite, poétique implicite », in P. Laurette et H-G. Ruprecht (dir.), Poétiques et imaginaires. Francopolyphonie littéraire des Amériques, Paris, l’Harmattan, 1995, p. 279-312.
CHIVALLON, Christine, « Espace et identité créole chez Patrick Chamoiseau », in Notre Librairie, n°127, juillet-septembre 1996, p. 88-107.
DELTEIL, Danielle,
« Le Récit d’enfance antillais à l’ère du soupçon », in M. Mathieu
(dir.), Littératures autobiographiques de la francophonie, Actes du
DETRIE, Catherine, « De l’identité collective à l’ipséité : l’écriture de Patrick Chamoiseau », in J. Bres, C. Detrie et P. Siblot (dir.), Figures de l’interculturalité, Université Montpellier III, 1996, p. 99-140.
LUCAS, Rafaël, « L’Aventure ambiguë de la Créolité antillaise », in Palabres, Revue d’études francophones, historiques et anthropologiques de l’Université de Brême, 1999.
MC CUSKER, Maeve, « De la problématique du territoire à la problématique du lieu : un entretien avec Patrick Chamoiseau », in The French Review, vol. LXXIII, n°4, mars 2000, p. 724-733.
PERRET, Delphine, « La Parole du conteur créole : Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau », in The French Review, vol. LXVII, n°5, avril 1994, p. 824-839.
PRAT, Michel, « Patrick Chamoiseau : un émule martiniquais de Gadda ? », in Francofonia, n°17, Automne 1989, p. 113-125.
REJOUIS, Rose-Myriam, « A reader in the
room », in Callaloo, n°22-2, 1999, p. 346-350.
ROCHMANN, Marie-Christine,
« Une Autofiction : Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau », in
M. Mathieu (dir.), Littératures autobiographiques de la francophonie,
Actes du
RUYTER-TOGNOTTI, Danièle, « L’Emergence de la parole dans l’œuvre de Patrick Chamoiseau », in D. de Ruyter-Tognotti et M. Van Strien-Chardonneau (dir.), Le Roman francophone actuel en Algérie et aux Antilles, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1998, p. 121-133.
Maryse Condé
ARAUJO, Nara,
« Préface. La Raison du mouvement : hommage à Maryse Condé », in
L’Oeuvre de Maryse Condé : questions et réponses à propos d’une
écrivaine politiquement incorrecte, Actes du
BLERARD-NDAGANO, Monique, L’Oeuvre romanesque de Maryse Condé : féminisme, quête de l’ailleurs, quête de l’autre, Thèse de Doctorat réalisée sous la direction du Professeur Jack Corzani, Bordeaux III, janvier 2000.
CHAMOISEAU, Patrick, « Reflections on Maryse Condé’s Traversée de la Mangrove », in Callaloo, n°14.2, 1991, p. 389-395.
CONDE, Maryse, « Habiter ce pays, la Guadeloupe », in Chemins critiques, vol. I, n°3, décembre 1989, p. 5-14.
DEGRAS, Priska, « Maryse Condé : l’écriture de l’histoire », in L’Esprit créateur, vol. XXXIII, n°2, été 1993, p. 73-82.
DE SOUZA, Pascale, « Traversée de la Mangrove : éloge de la créolité, écriture de l’opacité », in The French Review, vol. LXXIII, n°5, avril 2000, p. 822-833.
KORMOS, Danielle, « A propos de Traversée de la Mangrove », in M. Condé (dir.), L’Héritage de Caliban, Pointe-à-Pitre, Jasor, 1992, p. 103-110.
LIONNET, Françoise, « Traversée de la Mangrove de Maryse Condé : vers un nouvel humanisme antillais ? », in The French Review, vol. LXVI, n°1, octobre 1992, p. 475-486.
MARSAN, Hugo, « La Belle Créole de Maryse Condé », in Le Monde des livres, 3 août 2001.
PERRET, Delphine, « L’Ecriture mosaïque de Traversée de la Mangrove », in M. Condé (dir.), L’Héritage de Caliban, Pointe-à-Pitre, Jasor, 1992, p. 187-200.
PFAFF, Françoise, Entretiens avec Maryse Condé, Paris, Karthala, 1993.
PIRIOU, Jean-Pierre,
« Modernité et tradition dans Traversée de la Mangrove », in L’Oeuvre
de Maryse Condé : questions et réponses à propos d’une écrivaine politiquement
incorrecte, Actes du
REA, Annabelle, « Le
Roman-enquête : Les Fous de Bassan, un modèle pour Traversée de
la Mangrove », in L’Oeuvre de Maryse Condé : questions et réponses
à propos d’une écrivaine politiquement incorrecte, Actes du
SOURIEAU, Marie-Agnès, « Entretien avec Maryse Condé : de l’identité culturelle », in The French Review, vol. LXXII, n°6, mai 1999, p. 1091-1098.
Raphaël
Confiant
BOSMAN, Christine, « Antilia ou l’éloge de la créolité », in D. de Ruyter-Tognotti et M. Van Strien-Chardonneau, Le Roman francophone actuel en Algérie et aux Antilles, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1998, p. 135-147.
DOUIN, Jean-Luc, « Mamzelle sorcière », in Le Monde des livres, 23 mars 2001, p. 1.
FREY, Pascale, « Raphaël Confiant », in Lire, n°249, octobre 1996, p. 30.
SPEAR, Thomas, « Les Perles de la parlure », in M. Condé (dir.), L’Héritage de Caliban, Pointe-à-Pitre, Jasor, 1992, p. 253-263.
Tony Delsham
DELSHAM, Tony, « Chauve qui peut à Schoelcher ou la “Négritude” et la “Créolité” vues par Tony Delsham », in Antilla, n°1044, 19 juin 2003, p. 38-40.
Ernest Pépin
PEPIN, Ernest, « Itinéraire d’un écrivain guadeloupéen », in M. Condé et M. Cottenet-Hage (dir.), Penser la créolité, Paris, Karthala, 1995, p. 205-210.