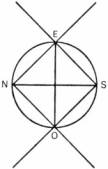Université
Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II
Exil
et quête de soi chez
J.M.G.
Le Clézio (Voyage à Rodrigues),
Paulo
Coelho (L’Alchimiste) et
Rachid
Boudjedra (Timimoun)
Emmanuel
Thérond
Maîtrise
de Lettres modernes
Sous
la direction de
Mlle
Lila Ibrahim-Ouali
2001
Même texte au format Acrobat Reader (respectant la
mise en pages papier)
« Comme dans un tunnel où je suis
emporté, sucé vers l’orifice béant de blancheur, vers le ciel pâle, immense
entonnoir de lumière, suivant cette route qui part des ténèbres et me conduit
au sein du gouffre serein, même plus suivant cette route, mais cette route
elle-même, glissement extatique vers la source de vie et de bonheur, long
étirement de moi-même, encore enraciné dans le néant, vers la plus grande des
libertés, je marche vers cet être que j’ignore, je m’approche de lui, je
perçois déjà la profondeur infinie de son éther, je goûte déjà à l’ivresse de
mon épanouissement en lui, sous forme de neige qui fond, d’évanescent parfums
qui fuient et fouillent dans l’agglomérat de molécules, et je m’élance, je
m’élance, je monte sur ma ligne horizontale, je pénètre, je me glace doucement,
je viens à toi, je viens à toi, je suis, je suis, je suis… »
J. M. G. Le Clézio[1]
I. Sommaire
1. La littérature de fin de siècle
IV. Exil et déracinement :
une « Descente aux Enfers »
1. La rupture initiale : un exil volontaire
V. Exil et
expérience : le cheminement vers soi-même
A. Adjuvants et
opposants à la quête
1. Quête amoureuse et/ou quête de soi
2. L’hospitalité
inhospitalière
2. La
fonction messianique du langage
3. Une
perpétuelle quête de soi ?
II. Introduction
A la fin du XXè siècle, l’Homme se pose beaucoup de questions quant à l’avenir qui l’attend. L’essor grandissant de la société de consommation et du capitalisme dévorant emprisonne l’individu dans un système duquel il se sent profondément étranger. Son impuissance face au monde qui l’entoure provoque en lui un certain malaise difficile à anesthésier complètement. Confronté à un système qu’il rejette mais dont il reste malgré lui profondément dépendant, l’homme moderne ne peut que se sentir mal à l’aise. Comment être heureux quand on appartient à un système qui dicte votre conduite sans prendre en compte votre personnalité profonde ? Cette question rejoint celle de l’identité. C’est quand on doute de soi que l’on se sent étranger au monde. La psychanalyse est arrivée au moment propice pour répondre à cette angoisse universelle : elle a permis à tout un chacun de se délivrer de ses démons en prônant une réconciliation avec soi-même. Elle est et restera la méthode du XXè siècle pour accéder à la quête de soi. Mais elle ne manque pas de défaut. Il est effectivement difficile de « changer de peau » dans un système qui cautionne l’uniformité et réprimande la différence ou l’originalité. Dans un monde déshumanisé, la peur d’être soi-même est grande. La seule solution pour réaliser une véritable recherche identitaire resterait donc la fuite dans un monde qui ne soit pas industrialisé, un monde où l’exilé puisse enfin se réaliser par une quête de soi sans être conditionné par un système répressif.
L’influence de ce problème social sur la littérature est grande. La quête identitaire a toujours intéressé les écrivains, au point de devenir un thème universel dans le milieu des Lettres. Raconter l’itinéraire d’une personne qui se cherche en parcourant le monde, tel est par exemple l’objectif du roman picaresque, qui apparaît en Espagne au XVIè siècle et dont l’influence mondiale est incontestable : Lesage s’inspire ainsi du succès grandissant de ce type de récit pour écrire Histoire de Gil Blas de Santillane[2] aux alentours de 1720. En Allemagne, Grimmelshausen écrit de la même manière Les Aventures de Simplicius Simplicissimus en 1668. En Angleterre, Daniel Defoe trouve sa voix en écrivant dans la même veine picaresque Moll Flanders en 1722. Le roman d’apprentissage, au XIX è siècle, revendique également une filiation picaresque. C’est le cas en Angleterre de David Copperfield de Dickens (1829), et en France des Illusions Perdues[3] (1837-1843) de Balzac ou de Le Rouge et le Noir[4] (1830) de Stendhal. Les écrivains postmodernes, à la fin du XX è siècle, se sont beaucoup penchés sur cette question de la quête identitaire et ont utilisé tous les genres littéraires pour la faire valoir. Il est donc intéressant de ne pas se borner au seul genre du roman pour parler de l’Initiation.
Après avoir écrit son roman Le Chercheur d’or[5], J. M. G. Le Clézio se lance dans la rédaction du Journal adapté de ce premier récit et ayant pour titre Voyage à Rodrigues[6]. Cet ouvrage fait partie du corpus « mauricien » de l’auteur, avec Sirandanes[7] , Le Chercheur d’or et « La Saison des pluies », nouvelle extraite de Printemps et autres saisons[8]. Le Clézio raconte dans son Journal son voyage à l’île Rodrigues, où il s’est rendu dans le but de chercher les traces de son grand-père, qui après avoir fait faillite, met tous ses espoirs dans la recherche d’un trésor qu’aurait laissé un pirate nommé le Privateer. Ses années d’errance lui auront été finalement inutiles d’un point de vue financier car la cachette du trésor se révèlera vide. Mais Alexis Le Clézio est parvenu au terme de cette quête à trouver un autre trésor : la réconciliation avec soi-même. L’auteur lui-même se rendra compte que son exil à Rodrigues lui a été bénéfique d’un point de vue identitaire. Voyage à Rodrigues aurait put être le premier volet de l’aventure du chercheur d’or car l’auteur y explique l’importance de la quête de son aïeul pour son histoire personnelle et celle de sa famille. Germaine Brée suggère d’ailleurs au lecteur de lire Voyage à Rodrigues avant Le Chercheur d’or.
Dans son roman Timimoun[9], l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, condamné à mort pour avoir traduit en arabe certaines de ses œuvres, raconte l’itinéraire d’un guide touristique chargé de transporter des passagers d’Alger à Timimoun. Le narrateur a choisi de passer ses jours en plein désert par désir de fuir un monde qui le rejetait. Cette errance dans le Sahara l’emmène à rencontrer Sarah, une femme dont il tombe amoureux mais qui se refuse à lui. Cette rencontre inattendue est pour le narrateur source d’atroces souffrances car cela lui rappelle ses souvenirs d’adolescence où déjà il était frustré sexuellement. Au terme de son voyage, l’auteur finira par se rendre compte de son identité véritable et assumera pleinement son homosexualité.
Le Brésilien Paulo Coelho a trouvé une renommée internationale grâce à son conte philosophique L’Alchimiste[10]. Dans ce dernier ouvrage, l’auteur se réfère aux rites alchimiques pour raconter l’histoire d’un jeune berger qui part d’Espagne dans le but de trouver un trésor aux pieds des pyramides d’Egypte. Au terme de son voyage, après avoir connu la souffrance et traversé le désert, le jeune andalou se rendra compte que le plus beau trésor qui soit consiste à réaliser ce que l’auteur nomme sa « Légende Personnelle ».
Nous nous demanderons donc si l’exil est une condition sine qua non pour la quête de soi en nous appuyant sur Timimoun de Rachid Boudjedra, Voyage à Rodrigues de J. M. G. Le Clézio et L’Alchimiste de Paulo Coelho. Il s’agira donc d’étudier dans une première partie quelles sont les causes de l’exil. Nous verrons que si les personnages s’exilent, c’est d’une part parce qu’ils semblent afficher une marginalité certaine : ils sont solitaires, sauvages et ne sont pas encore entrés dans l’âge adulte. D’autre part, nos personnages veulent s’exiler parce que ce départ serait pour eux une promesse évidente de bonheur : du fait qu’ils mènent une vie stérile et sans surprise, ils se réfugient dans le rêve et imaginent pouvoir un jour découvrir un trésor ou vivre dans un lieu édénique.
Nous analyserons dans une deuxième partie pourquoi l’exilé, une fois le départ effectué, doit subir une véritable « Descente aux Enfers » en quittant le lieu des origines. Cette souffrance est due au fait que le personnage se retrouve seul dans un univers inconnu où il n’a aucun repère et où il regrette avec amertume sa vie d’avant le départ. Cette nostalgie le plongera dans un état d’abandon à la limite de la folie.
L’exilé, et ce sera le sujet de notre troisième partie, semble acquerir beaucoup d’expérience au cours de son périple. En progressant dans son itinéraire, il rencontre des personnes qui l’aident à avancer : il se fait dès lors aidé par des « pères » spirituels et rencontre la femme de sa vie, qui l’épaule dans son périple. L’errance lui permet en outre d’acquérir une expérience certaine, de franchir des difficultés qui se présentent comme de véritables rituels initiatiques.
Une fois passé outre toutes ces étapes, nous verrons dans une dernière partie que l’exilé retourne sur le lieu des origines en ayant une sagesse étonnante : le lieu de départ lui apparaît complètement différent. L’exilé semble aussi ne plus être la même personne qu’auparavant. La réalisation de la quête de soi est alors perçue comme une nouvelle naissance : le héros sera même sacralisé, tout comme l’écrivain et le lecteur qui par le biais de l’écriture et de la lecture effectuent une véritable initiation. Mais nous verrons que la quête de soi n’est pas intégralement réalisable, et ce malgré tous les efforts engendrés pour y mettre un terme.
III.
Les causes de l’exil
A.
Des héros
marginaux
1.
La littérature
de fin de siècle
« La
carapace partout, sur moi, la clôture de mon corps et de mon esprit, étanche,
sans faille, sans délicieuse fenêtre par où viendrait la douce lumière
hétérogène »
J. M. G. Le
Clézio[11]
Tandis que l’exode est une entreprise collective de déplacement vers un
ailleurs réel ou imaginaire, l’exil n’a de sens qu’en terme de voyage
solitaire. L’exil est « la situation de quelqu’un qui est obligé de
vivre ailleurs que là où il est habituellement »[12].
Le pronom indéfini « quelqu’un » désigne une personne singulière et
indéterminée. En outre, la quête effectuée est une quête « de soi »,
le pronom réfléchi se référant non pas à plusieurs personnes mais à une
personne en particulier.
Les trois œuvres de notre corpus rendent l’idée d’exil solitaire encore
plus probante car elles s’inscrivent dans la tradition postmoderne. En
littérature, cette dernière désigne l’ensemble des récits de la fin du XXè
siècle qui tendent à s’opposer radicalement aux œuvres modernistes d’après
guerre, jugées généralement inaccessibles car élitistes. C’est ce qu’explique
Antoine Compagnon : « il s’agit de se débarrasser d’une longue série
d’oppositions contraignantes, et jugées typiques du modernisme : celles du
réalisme et du fantastique, des partisans de la forme et de ceux du contenu, de
la littérature pure et de la littérature engagée, de la fiction pour l’élite et
du roman de gare. L’un des griefs constants des postmodernes contre les
modernes est l’ascèse qu’exige la réception de leurs œuvres : austères et
ambitieuses, dit-on, elles sont difficiles d’accès et ne donnent pas de
plaisir. C’est même cela qui les rend élitistes. Les œuvres postmodernes se
soucient en revanche du bien-être de leurs lecteurs »[13].
Et ce plaisir de lecture passe par la réhabilitation du personnage, que le
Nouveau-Roman prenait plaisir à décrier. La post-modernité littéraire accordera
donc au héros une place majeure et elle se voudra l’ardente défenseuse du
personnage romanesque. Les textes nous mettront donc face à des personnages
principaux marginalisés autour desquels le récit gravite. C’est ce que souligne
Dominique Viart : « au premier rang des proscriptions de la décennie
précédente, figure le « sujet ». Non qu’il fut malséant d’en parler
comme à l’époque classique (où « le moi » était
« haïssable ») mais il a été relégué au second plan par le privilège
accordé à la « structure ». Tout, y compris les mythes ou l’inconscient,
est structure, et parler du sujet relevait d’un idéalisme ou d’un essentialisme
dépassé. Les années 80, au cours desquelles se dissolvent les grandes
idéologies collectives, marquent un retour de l’individualisme sous toutes ses
formes »[14].
L’écrivain créera donc un personnage individualisé en s’inspirant de sa
propre situation. Celui qui écrit le fait de manière solitaire. Il est seul
face à sa feuille. Le Clézio considère même « la solitude de
l’écrivain » comme un « problème »[15]
fondamental dans l’univers littéraire de fin de siècle. C’est peut-être la
raison pour laquelle l’auteur a choisi le genre du Journal intime pour
s’exprimer dans Voyage à Rodrigues.
Il peut ainsi dire « je » librement et concéder à son récit une part
autobiographique indéniable. Philippe Lejeune considère d’ailleurs le Journal
comme une variante libre de l’autobiographie. Selon lui, cette dernière est un
« récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre
existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur
l’histoire de sa personnalité ». Le Journal respecte toutes ces
conditions, sauf une : « la perspective rétrospective du récit »[16].
Le Clézio dit d’ailleurs de son roman Le
Chercheur d’or, duquel est inspiré le Journal, qu’il était « le seul
récit autobiographique qu[‘il a] jamais eu envie d’écrire » [17]
! Germaine Brée écrit que
« le « je » du Journal nous réfère à l’écrivain lui-même,
absorbé par sa quête et s’interrogeant sur elle. Le « je » du roman
de format autobiographique, est celui du grand-père qu’imagine son petit-fils,
à partir des documents qu’il a en main, de la légende encore vivante dans les
îles et la famille, et des recherches, nous dit Le Clézio, qu’il a faites sur
place dans les archives des îles »[18].
Rachid Boudjedra et Paulo Coelho apparaissent également entre les lignes
de leurs romans, volontairement ou à leur insu. Paulo Coelho d’abord, même si
ce n’est pas dévoilé clairement dans L’Alchimiste : « en
réalité je suis tous les personnages de mes livres. Le seul personnage que je
ne suis pas, c’est l’Alchimiste. Parce que l’Alchimiste sait tout, tandis que
moi je sais que je ne connais pas tout, j’ignore beaucoup de choses. Il est
évident que dans L’Alchimiste, je
suis le Berger, le Marchand de Cristaux, et même Fatima »[19]. Quant à Boudjedra, il écrit ceci :
« tous mes romans racontent mon expérience personnelle, ma vie, ma façon
de voir les choses »[20].
Le « je » anonyme de Timimoun peut effectivement être
apparenté à Boudjedra : comme le narrateur ce dernier est condamné à mort
par les intégristes islamistes et comme lui il a été traumatisé par la mort
prématurée de son frère aîné. On peut donc facilement qualifier Timimoun
de « roman personnel », variante selon Philippe Lejeune de
l’autobiographie car ce genre ne dévoile pas explicitement « l’identité de
l’auteur et du narrateur »[21].
Nos écrivains sont également isolés (exilés ?) d’un point de vue
identitaire. Boudjedra et Le Clézio sont respectivement partagés entre le
français et l’arabe, et entre le français et l’anglais. L’un est français et
mauricien, l’autre français et arabe. Ils sont donc situés entre deux pôles
distincts et n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre : il leur est
difficile de trouver le bon équilibre. C’est ce qu’explique Jany Le Bacon à
propos de Boudjedra : « il s’agit de montrer aux Algériens qu’il
existe une culture arabe prestigieuse qu’ils ne doivent pas ignorer et dont ils
peuvent se réclamer, aux Français que les Maghrébins possèdent un riche passé
culturel en dépit de la colonialisation »[22].
Mais, écrit Jacques Noiray, « il n’y pas de bilinguisme facile, surtout
lorsque les deux langues rivales ne sont pas sur un même pied d’égalité, mais
reproduisent le rapport de dominant à dominé instauré par le régime
colonial »[23]. Le Clézio
affirme également hésiter entre son héritage français et sa vocation
mexicaine : « c’est assez difficile de passer de l’un à l’autre.
C’est vrai, j’ai l’impression d’être une sorte de schizophrène
intercontinental ! Il y a des moments où je suis vraiment double. […]
C’est vrai que l’idéal serait de vivre de façon permanente dans l’un ou l’autre
de ces continents. Je le sens très bien : ce n’est pas confortable d’être
entre deux mondes »[24].
Rachid Boudjedra essaie quant à lui à travers ses récits de redonner à l’Algérie
l’identité qu‘elle mérite, mais il n’est pas convaincu du résultat :
« j’ai vendu plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, j’ai eu des
centaines de lecteurs en Algérie, malgré cela l’impact de mes récits est
nul »[25]. Ces
quelques mots montrent par conséquent à quel point le lecteur est distant
vis-à-vis de ce qu’il lit. Ce que peuvent susciter les récits n’est au plus
qu’un sentiment de révolte avortée. Rares sont les œuvres littéraires sources
de révolutions. Seul devant les lignes qui s’offrent à lui, le lecteur est a
fortiori impuissant. Comme le personnage, la seule chose qu’il lui
conviendra de conquérir sera son identité propre.
2. Des personnages solitaires
Parce qu’il est conscience, l’homme est d’emblée exilé du monde et du
milieu naturel. Il n’a plus avec la nature le même contact qu’ont avec elle les
animaux. Mais il peut aussi être exilé parmi les Hommes du fait de la place
qu’il occupe dans la société. Le narrateur de Timimoun est un chauffeur
de bus célibataire, qui apparemment ne voit plus sa propre famille :
« je me sentis perdu dans cette famille »[26]
écrit-il. Il est en outre alcoolique, et l’alcool est une drogue qui isole de
manière dévastatrice : « je fêtais solitairement ma nouvelle
acquisition »[27],
« seul à seul avec ma bouteille de vodka »[28].
Sa frustration à l’égard des femmes ne fait que l’éloigner encore plus d’une
quelconque relation humaine durable : « pendant quarante ans, je suis
resté à l’écart de toutes ces histoires d’amour et de sexe. Pendant quarante
ans, j’ai subi sans broncher et même avec un sentiment d’orgueil les sarcasmes
libidineux des hommes, leurs moqueries hystériques. Pendant quarante ans, j’ai
souffert des malentendus et des réactions de colère des femmes que je
repoussais, bien malgré moi, douloureusement »[29].
Paulo Coelho annonce la solitude du personnage principal dès le titre du
roman. Il emploie l’article défini « le » pour souligner l’unicité de
son héros, et la majuscule au nom « Alchimiste » montre que nous
avons affaire à une personne en particulier. Sa profession de berger l’oblige
également à vivre seul : « j’ai quitté mon père, ma mère, ce château
de la ville où je suis né. Ils s’y sont fait, je m’y suis fait »[30].
En ce qui concerne le narrateur de Voyage
à Rodrigues, il s’agit de Le Clézio lui-même. Il raconte son Voyage à Rodrigues, sur les traces de son
grand-père, à travers un Journal qu’il a écrit, comme Rachid Boudjedra, à la
première personne du singulier. Ici, pour reprendre Lejeune, « le pacte
autobiographique » est total car il y a « identité de l’auteur,
du narrateur et du personnage »[31].
Parce que le narrateur de Voyage à
Rodrigues dit « je », il est un personnage solitaire, un nomade qui ne trouve jamais le port
d’attache idéal. Le Clézio écrit également que son grand-père vivait dans un solitude
immense : « celui dont je ressens ici la présence est un homme sans
âge, sans racine, sans famille, un étranger au monde, comme l’était sans doute
le Corsaire dont il cherche la trace »[32].
Parce qu’ils sont solitaires, nos personnages apparaissent donc aux yeux
d’autrui comme des sauvages.
3. Des « sauvages »
Le Clézio pense que l’écrivain a toujours été considéré de manière
négative depuis le XIXème siècle. Pour l’auteur de Onitsha,
l’écriture est et restera une activité marginale pour gagner sa vie :
« c’est contraire à toutes les règles de la bienséance et de l’efficacité,
et de la vie de tout le monde. Ecrire, ça implique qu’on ne vit pas comme tout
le monde »[33]. Qui plus
est, l’auteur de La Quarantaine fait figure de « sauvage »
dans le milieu intellectuel bien-pensant car il rejette en bloc les notions de
culture, de connaissance, voire d’éducation scolaire. En effet, selon lui, les
mots exilent : un Homme ayant accumulé des savoirs divers n’aura de la
nature qu’une image déformée, faussée. Il ne pourra pas rendre compte de sa
beauté intrinsèque de manière directe. Un parallèle évident peut être fait avec
le mythe du « bon sauvage » que
l’on trouvait dans la littérature française du XVIIIème siècle[34].
Ce type de personnage pouvait décrire très justement la société dans laquelle
il était exilé car en portant un regard neuf sur le monde extérieur, il avait
un point de vue totalement neutre. Parce qu’il n’était pas empreint de culture,
il était d’une crédibilité surprenante. Jean Onimus explique que Le Clézio a
aussi une conception négative de la culture en général : « il nous
faut donc parler d’un anti-humanisme, d’une révolte contre la chape livresque
des traditions intellectuelles, d’une volonté de faire éclater les conformismes
séculaires, d’une nostalgie […] de l’intouché. Comme si le seul contact de la
pensée, le simple recourt aux mots étaient déjà une ternissure ! »[35].
Paulo Coelho a lui aussi été un anticonformiste, tour à tour hippie,
drogué et parolier de rock. Il prend lui aussi beaucoup de recul vis-à-vis de
la culture. Selon lui, on apprend plus en regardant autour de soi qu’en lisant
un livre : « le jeune homme avait lui aussi un livre, qu’il avait
essayé de lire dans les premiers jours du voyage. Mais il trouvait beaucoup
plus intéressant d’observer la caravane et d’écouter le vent. Dès qu’il eut
appris à mieux connaître son chameau et qu’il commença à s’attacher à lui, il
jeta le livre. C’était un poids superflu »[36].
Lilas Voglimacci analyse bien cela dans son essai sur L’Alchimiste : « il se
passerait à cet instant du souvenir un très étonnant remue ménage dans le
savoir des livres et la fragile vérité des sciences. Voilà encore un des
préceptes du conte. Apprendre que les pouvoirs en place, qu’ils soient
politiques, scientifiques ou même religieux, sont parfois fondés sur des
erreurs grossières. C’est la voix des peuples proches de la Nature qu’il faut
entendre. Les plus sages n’ont pas tout découvert dans les livres »[37] .
James Burty David dit aussi de Paulo Coelho qu’il est un rebelle : « cet
auteur brésilien nous dérange dans nos certitudes, bouscule notre logique
mathématicienne […] « je crois beaucoup à la rébellion intérieure »,
disait Paulo Coelho dans une interview accordée au Courrier de l’Unesco
en mars 1998. Sans cette insurrection capable de remettre en cause
l’impérialisme des dogmes, les illusions idéologiques et les discours
insuffisants de la raison, l’existence humaine se réduirait à un parcours
absurde de la naissance à la mort. L’Alchimiste nous offre les
instruments de cette rébellion. L’auteur révèle des caches secrètes au fond de
l’âme, élabore des stratégies de refus aux croyances imposées […] Par contre,
la pédagogie du conditionnement, elle, vise à mater notre côté rebelle et à
mettre les hommes au rythme de l’idéologie dominante. Paulo Coelho nous pousse
à d’autres audaces : croire à l’impossible, même si cela devrait ébranler
les fondements de la logique »[38].
Rachid
Boudjedra, a contrario, soutient l’importance de la connaissance dans
l’acte d’écrire : « l’érudition fait intégralement partie de
l’écriture. Car au départ, rien n’est acquis, rien n’est donné. La lecture par
exemple est essentielle dans ma vie. Cela fait partie du travail de l’écrivain.
Lire les autres. Approfondir les textes des autres. Comprendre les mécanismes
techniques des autres pour en profiter d’une manière personnelle, pour avancer
dans sa propre démarche »[39]. Il n’en demeure pas moins, comme le souligne
Najib Redouane, que Timimoun est un
« roman qui se caractérise par un récit simple et linéaire, un style
dépouillé et une forme libre, accessible à un grand public [ et qui ] constitue
une nouvelle démarche dans la production romanesque de ce romancier »[40].
Boudjedra est donc à l’opposé de Coelho et Le Clézio en ce qui concerne
le concept d’érudition. Mais comme le romancier maghrébin dans Timimoun, ils adoptent une écriture
simple, un style limpide, accessible, proche du monde. Paulo Coelho met en
scène un Alchimiste et ce-dernier montre combien le savoir est inefficace pour
la compréhension du monde : « il n’y avait là que dessins,
instructions codées, textes obscurs »[41].
Dès lors, mieux vaut vivre de manière saine et être berger.
Dans Voyage à Rodrigues, les
plans du grand-père de l’auteur sont complètement hermétiques du fait de leur
prétendue scientificité, alors que l’aïeul de l’auteur vivait en harmonie avec
la nature : « devant la beauté de ce paysage simple et pur :
lignes des collines pelées, lignes de la mer, blocs de lave émergeant de la
terre sèche, chemin de ruisseau sans eau, je pense aux tracés compliqués de mon
grand-père, ces plans, ces réseaux de lignes, pareils à des toiles
d’araignées »[42]
écrit Le Clézio. La communion du grand-père avec le milieu naturel était
effectivement très forte. L’aïeul de Le Clézio aimait par exemple s’asseoir et
regarder autour de lui : « mon grand-père est assis, donc, sur cette
pierre plate, tournant le dos au ravin, regardant vers l’estuaire. Il tient
comme toujours une cigarette (de tabac anglais, son seul luxe véritable) entre
le pouce et le médian, à l’horizontale, comme un crayon, dont il secoue la
cendre de temps en temps. Son visage maigre est brûlé par le soleil, ses yeux
bleu sombre sont plissés par la lumière qui se réverbère sur les roches de la
vallée. Ses cheveux longs, d’un châtain presque brun, sont renvoyés en arrière,
et le bas de son visage est caché par une barbe romantique »[43].
Le narrateur anonyme de Timimoun,
cet « épouvantail pleurnichard »[44],
a lui aussi la négligence physique et vestimentaire du
« sauvage » : « un désert dont la figuration me saute au
visage, me gerce les lèvres, y creuse des petites cicatrices qui brûlent
cruellement ma peau, mes paupières et mes poumons chiffonnés et grêlés, à la
fois, par la sécheresse incroyable de l’air »[45].
De plus, le chauffeur de bus affiche ouvertement sa révolte. Il a donné à son
car le nom d’Extravagance et il stipule qu’ « au fond, Extravagance
[lui] ressemble »[46].
le personnage principal se révolte aussi contre la tradition en buvant
énormément : « je contrevins à la tradition religieuse en buvant mon
premier verre de vodka ; le
lendemain des funérailles »[47].
L’insoumission au père peut aussi être une forme de sauvagerie en soi :
« je devins pilote pour embêter mon père qui voulait faire de moi un
ingénieur »[48].
Santiago, le personnage principal du roman de Coelho, s’est lui aussi
opposé à la volonté de ses parents en devenant berger : « un beau
soir, en allant voir sa famille, il s’était armé de courage et avait dit à son
père qu’il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager »[49]. Comme le personnage de Boudjedra, il
s’oppose à la tradition en buvant du vin : « L’Alchimiste ouvrit une
bouteille et versa un liquide rouge dans le verre de son invité. C’était du
vin, et l’un des meilleurs qu’il eût jamais bu de son existence. Mais le vin
était interdit par la loi. « Le mal, dit l’Alchimiste, ce n’est pas ce qui
entre dans la bouche de l’homme. Le mal est dans ce qui en sort » »[50].
Selon la théorie jungienne, les véhicules sont des images du moi. Ils
reflètent les divers aspects de la vie intime. Comme les personnages, ils
seront donc la figuration d’une sauvagerie incontrôlable : « Extravagance
donne l’impression d’une brutalité intolérable et sauvage. Somptueuse » [51].
Le Clézio a d’ailleurs une conception identique des voitures : « pour
moi, ce sont des moteurs qui avancent. ça
a quelque chose d’inhumain et, en même temps, de très quotidien, de très proche
de la vie de tous les jours. […] Ce sont des bêtes, pas très sympathiques, tout
le temps présentes, et que les êtres humains brutalisent »[52].
Un passage de Désert est d’ailleurs étrangement similaire à l’incipit de
Timimoun. La description du bus est
quasiment identique dans les deux romans : « l’autocar roule sur la
piste de poussière, monte en haut des collines. Partout, il n’y a que terre
sèche, brûlée, pareille à une vieille peau de serpent. Au-dessus du toit du
car, le ciel et la lumière brûlent fort, et la chaleur augmente dans la
carlingue comme à l’intérieur d’un four. Lalla sent les gouttes de sueur qui
coulent sur son front, le long de son cou, dans son dos. Dans l’autocar les
gens sont immobiles, impassibles. Les hommes sont enveloppés dans leurs
manteaux de laine […] Seul le chauffeur
bouge, grimace, regarde dans le rétroviseur. Plusieurs fois son regard
rencontre celui de Lalla […] La radio, le bouton tourné à fond, siffle et
crache […] Quelquefois, l’autocar s’arrête au milieu d’une plaine désertique
parce que le moteur a des faiblesses […] Puis l’autocar repart, cahote sur les
routes, monte les collines, comme cela, interminablement, dans la direction du
soleil couchant […] »[53].
Dans Voyage à Rodrigues, le navire Segunder
est lui aussi pris d’une fureur indomptable : « je pense au navire Argo,
tel que le fit construire Minerve, prêt à appareiller pour son voyage irréel.
Un navire invincible, triomphant, qui pouvait affronter toutes les tempêtes, un
navire plein de puissance divine »[54].
Mais la sauvagerie bestiale ne caractérise pas seulement les moyens de
transport. Dans nos oeuvres, les trois auteurs animalisent également les
personnages. Et c’est cette force primale exercée dans la solitude qui leur
donnera le courage de partir vers l’inconnu : « cela se voit à mes
yeux, sans cils, de chien battu. […] Je n’ai jamais embrassé une femme de toute
ma chienne de vie »[55] écrit
Boudjedra. Ironie du sort, L’Islam fait du chien l’image de ce que la création
comporte de plus vil[56].
Le narrateur pense aussi qu’il ressemble à d’autres animaux : « le pire, c’est la Vodka. Elle m’a
donné ce cou de poulet déplumé […] Toujours aussi cette allure de vieille tortue
au cou criblé de vagues taches de rousseur »[57].
Chez Coelho, Santiago ressemble à ses moutons : « comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à
celle des moutons »[58] .
Dans le Journal de Le Clézio, les personnages sont aussi animalisés : le grand-père
de l’auteur tout d’abord, dont l’itinéraire ressemble au « cheminement
absurde et obstiné d’un insecte »[59]. Les
enfants ensuite : « une petite fille de huit ou neuf ans, très mince, au
visage sculptural de Noire, mais dont la peau est de la couleur cuivrée des
métis, est assise juste derrière nous, sur une racine en surplomb. C’est à elle
que je m’adresse d’abord, sans trop la regarder, comme on tend la main aux
écureuils sans avoir l’air de s’occuper d’eux »[60].
Cet extrait permet également de se rendre compte que les enfants sont
pour nos auteurs les seules personnes qui peuvent encore prétendre pouvoir
choisir leur avenir.
4.
Des enfants
« Les
hommes ne croient pas aux trésors »
Paulo Coelho[61]
Si l’enfance a autant marqué nos auteurs, c’est parce qu’elle est
symbole de simplicité naturelle, instinctive, mais surtout d’innocence. Elle
est l’état antérieur à la faute, autrement dit l’état édénique. C’est un âge où
le rêve est encore possible ; le seul âge où l’on puisse encore être heureux
et où toutes les croyances –même les plus utopiques- sont autorisées. Seuls les
enfants croient aux trésors, dit Paulo Coelho.
Chez l’auteur de L’Alchimiste, les personnages principaux sont
régulièrement des jeunes personnes. Elie, le prophète de La Cinquième
montagne, sort apparemment tout juste de l’adolescence, et dans L’Alchimiste, Santiago est régulièrement
qualifié par l’auteur de « jeune homme». Quand il se confie à Juan Arias,
Paulo Coelho répète que tout Homme a en lui une part d’enfance qu’il ne peut
pas supprimer et dont il devrait se servir dans la vie pour faire face à ses
difficultés : « ce qui n’est pas possible, c’est de tuer l’enfant qui
est en nous. Je pense que mes livres sont lus surtout par l’enfant que chacun
porte en soi »[62] ;
« je m’efforce de conserver un regard enfantin, c’est ce qui me permet
d’avancer »[63]. Lilas
Voglimacci a bien remarqué l’importance du thème de l’enfance dans L’Alchimiste : « « il
s’appelait Santiago… » Ainsi commencent les contes, ainsi commence la
belle histoire de ce berger visité par les songes, protégé par la Vie. Cet
enfant sans malice errant à la recherche de sa part de chance. Il ne faut pas
s’y tromper, ce héros n’est pas un chevalier courageux, une terreur musclée, un
fou de Dieu. C’est Candide aux portes du troisième millénaire qui sait les
leçons du précepteur Pangloss sans avoir lu Voltaire […] C’est l’enfant d’un
père qui le destinait à être moine.[…] Un esprit simple, visité en songe par un
enfant. Dans L’Alchimiste de Paulo
Coelho les enfants parlent aux enfants »[64].
Notons que l’auteur met souvent en scène des conteurs, des gens qui racontent
des histoires aux enfants : « les chameliers […] se réunissaient
autour des foyers pour conter les histoires du désert »[65]
écrit Paulo Coelho. Lilas Voglimacci répète d’ailleurs que L’Alchimiste est un « conte de fées »[66] !
Il existe aussi des éditions illustrées des romans de Paulo Coelho destinées à
un jeune public[67], et J. M.
G. Le Clézio et l’auteur de Véronika décide de mourir ont contribué à
l’écriture du recueil Histoires d’enfance[68],
publié par l’association « Sol En Si ».
Quand il commence d’écrire, J. M. G. Le Clézio n’a que sept ou huit ans,
et il affirme ne pas avoir vu le temps passer depuis : « je n’ai pas
le sentiment que quelque chose m’ait mûri, ni vieilli, ni même déçu »[69].
Il a donc toujours eu une affection particulière pour les enfants. Jean Onimus
parle même de lui comme d’un conteur : « Dire que Le Clézio est
plutôt conteur que romancier peut paraître un paradoxe quand on pense au
caractère typiquement « baroque » de ses livres, avec leur intense,
leur exubérante vitalité, la variété des tons et des styles, la tragique
obsession de la mort, le dédain pour les stylisations classiques. Pourtant,
n’est-il pas l’auteur de contes pour enfants ? »[70].
Effectivement, une grande partie de ses écrits leur sont destinés. Citons par
exemple Villa Aurore suivi de Orlamonde[71],
Lullaby[72] ou Celui
qui n’avait jamais vu la mer suivi de La Montagne du dieu vivant[73].
Le Clézio opte pour le genre du conte car ce-dernier laisse une grande place à
l’imagination du lecteur et de l’auteur. Le Chercheur d’or pourrait
faire figure de conte, parce qu’il y est question de trésor, de cartes, de
pirates, comme dans L’Ile au trésor ; bref, de tout ce qui attise
l’imagination de celui qui lit.
Le Clézio a donc gardé une sensibilité d’enfant, et c’est la raison pour
laquelle il n’ait guère de textes chez lui où n’apparaissent des silhouettes de
jeunes personnes. Alexis n’a que huit ans lorsque commence Le Chercheur d’or, Esther n’a pas encore atteint l’âge de raison au
début d’Etoile errante[74]
et les contes de Le Clézio mettent toujours en scène des enfants, à l’instar de
Jon dans La montagne du Dieu vivant[75].
L’auteur de Pawana a quarante six ans quand il écrit Voyage à Rodrigues. Il n’est donc plus
un enfant mais il garde cette pureté d’esprit et cet émerveillement que peu de
personnes ont conservés en entrant dans l’âge adulte. Quand il suit le parcours
de son grand-père dans le journal de Voyage
à Rodrigues, Le Clézio cherche à annuler le cours des années pour pouvoir
revenir aux origines de son enfance : « pourquoi suis-je venu à
Rodrigues ? N’est ce pas, comme pour le personnage de Wells, pour chercher
à remonter le temps ? »[76].
Parallèlement, ce que son aïeul voulait retrouver (sans vouloir se l’avouer)
n’était rien d’autre que le lieu des origines, à savoir la maison Euréka
« où tant d’enfants ont joué, ont découvert le monde »[77].
D’ailleurs, l’auteur parle du langage « enfantin »[78]
employé par son grand-père. Dans La Montagne du Dieu vivant, Jon se
retrouve face à un personnage emblématique : « - Tu parles comme si
tu étais très vieux, dit Jon. Pourtant tu n’es qu’un enfant ! »[79].
Boudjedra souligne souvent
l’importance de l’enfance dans son œuvre : « il me semble que la
littérature authentique s’insère à son origine dans l’enfance. A travers la
littérature, l’enfance joue un rôle important. On dit aussi que l’artiste, le
créateur, l’écrivain, sont des gens, des personnes qui n’ont pas su quitter
leur enfance ou plutôt qui n’ont pas pu accepter l’âge adulte. En écrivant mes
romans j’ai toujours été obsédé par cette enfance qui m’a permis justement de
faire jouer la mémoire comme une donnée essentielle de mon travail ; et
cette mémoire évidemment passe par l’enfance.
Grâce à un certain nombre de romans où l’enfance était présente, j’ai
toujours eu l’impression en écrivant que c’était l’enfant que j’ai toujours été
qui écrivait comme pour exorciser cet âge d’aujourd’hui, l’age adulte »[80].
On retrouve ce retour d’enfance dans Timimoun :
le narrateur, âgé d’une quarantaine d’années, garde de son enfance des
souvenirs émus mais difficiles : « huit ans. Découverte derrière la
porte de la cuisine de chiffons imbibés de sang noirâtre »[81].
Si l’enfance est traduite par le biais de souvenir, elle l’est aussi par la
présence de jeunes personnes dans les romans de Rachid Boudjedra : les héros sont souvent de jeunes hommes à
peine sortis de l’adolescence, comme dans La Répudiation[82],
L’Insolation[83] ou La
Macération. Boudjedra lui-même a écrit un poème intitulé « enfance »[84].
Dans Timimoun, il y a aussi jeunes personnes : Sarah est une «
gamine de vingt ans »[85] ;
le frère aîné du narrateur est « décédé bêtement à l’âge de vingt
ans »[86], etc. De
plus, le narrateur emploie un terme affectif lié à l’enfance pour parler de sa
mère. Il l’appelle « maman »[87].
Il se reproche aussi « d’étaler comme ça un tel infantilisme »[88].
A tout point de vue, le narrateur de Timimoun peut donc faire figure de
mystique[89]. Jean
Déjeux montre que le rire est parfois indispensable pour anesthésier
cette réminiscence infantile: « au point de départ on a besoin de
parler d’une déchirure, d’un malaise vécu depuis la naissance. Cependant s’il y
a conflit et affrontement, perte et drame, un humour franc et un rire tonique
dominent la plupart du temps, ce qui n’est pas toujours le cas dans les romans
publié au Maghreb »[90].
Nous verrons effectivement que Boudjedra est un adepte incontesté de la
narration ironique.
Si nos personnages s’exilent, c’est certes du fait de leur marginalité,
mais aussi parce que pour eux
l’ailleurs est une promesse de bonheur.
B.
La promesse du
bonheur
« Loin, loin de moi, cet autre monde vers lequel je glisse
doucement, doucement, comme sur de la vase »
J . M.
G. Le Clézio[91]
1.
Le rêve
Porteurs de cet esprit d’enfance, les personnages de nos romans ne
peuvent que croire en la réalisation de leur(s) rêve(s). Tout laisse alors
penser que les protagonistes sont prédisposés à quitter le lieu des origines
pour visiter des contrées qu’ils ne connaissent pas. Ils n’ont donc pas honte
de rêver : cette activité est une véritable invitation au voyage.
Le Clézio tout d’abord, qui en
écrivant se prend à toutes sortes de rêveries : « il me semble que le
plus agréable des rêves, c’est le rêve inutile, le rêve qu’on fait pour rien.
Ce qui est bien, c’est de rêver, à six heures du matin, qu’on a écrit le plus
beau roman du monde, et de se rendormir, et de l’oublier. […] L’idéal de
l’écriture c’est d’arriver à rejoindre ça […] Ecrire sans savoir où l’on va, en
laissant les choses se faire d’elles-mêmes, sans aucun plan […], écrire en
jetant des phrases, en les regardant s’ajouter les unes aux autres. C’est
laisser dériver le fil »[92].
Pour Le Clézio, l’écrivain rêve quand il écrit. Mais le lecteur rêve en lisant
ce que l’écrivain produit. Celui qui se laisse transporter par les mots du
Journal de Le Clézio se retrouve plonger au cœur des îles Mascareignes. Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio rend le
rêve réel : il mentionne régulièrement des récits d’explorateurs, comme
ceux de Pingré[93] par exemple.
Il parle aussi de Valerius Flaccus[94],
des Clavicules de Salomon[95]
ou de l’History of Pyrates de Charles Johnson[96].
A côté de ces références éparses, l’auteur reproduit –comme dans le Procès
Verbal[97]
- des extraits de journaux, des dessins, des schémas, des croquis, tout se
passant comme s’il voulait donner à son Journal une crédibilité inattaquable.
C’est un moyen très efficace pour faire voyager le lecteur. L’auteur est
conscient que l’aventure est une source intarissable de rêve :
«Pour une première marque une pierre de pgt. En prendre la 2° V. Là
faire S. Nord un cullot de même. Et de la source Est faire un angle comme un
organeau La marque sur la plage de la source. Pour une marque e/o, passe à la
gauche Pou là chacun de la marque Bn She - Là frottez contre la passe, sur quoi
trouverez que pensez Cherchez :: S Faire ´ 1 do-m de la diagonale dans la direction du
Comble du Commandeur. Prendre N Nord 24° B-39 pas 2° Sud »[100]
Mais Le Clézio déteste les voyages touristiques, l’aventure facile. En
parlant de Lévi-Strauss, il dit : « non, ce qu’il n’aime pas, en
effet, et il le dit clairement, ce sont les voyages organisés : le voyage
« fonction de dépaysement », le voyage conçu comme une distraction,
un amusement. Et je le comprends très bien »[101].
Les voyages qui font rêver Le Clézio sont ceux qui se déroulent hors des
sentiers battus. Un peu comme son grand-père qui souhaitait être un nouveau
Robinson partant explorer des territoires vierges : « quand il
débarque pour la première fois à l’Anse aux Anglais, il est bien le premier, et
le seul, comme Robinson »[102] ;
son rêve, c’est « le rêve de Robinson, le rêve d’un domaine unique où tout
serait possible, nouveau, presque enchanté. Où chaque être, chaque chose et
chaque plante serait l’expression d’une volonté, d’une magie, aurait un sens
propre. Le rêve d’un nouveau départ, d’une dynastie. Qui n’a pas rêvé d’être le
premier d’un règne, le commencement d’une lignée ? »[103].
Dans Timimoun, le narrateur est également un grand rêveur. Tout
d’abord parce qu’il adore la lecture. Il « aimai[t] lire aussi. Une vraie
boulimie qui faisait ricaner [ses] amis »[104]. Mais
la lecture est dangereuse car elle peut influencer grandement le comportement
de certaines personnes avides de sensations fortes. Pour l’auteur de Timimoun,
il est en effet ridicule de se comparer à des héros de roman d’aventure :
« il m’arrive de faire semblant de m’ensabler pour la plus grande joie des
touristes qui veulent de l’aventure à tout prix. Pendant quelques heures ils
ont le grand frisson. Ils se dépêchent de sortir caméras, appareils photos,
stylos, alors. Ils s’imaginent qu’ils vont rester là. Qu’ils vont mourir de
soif. Que les survivants mangeront la chair de ceux qui sont morts. Enfin, tout
ce qu’ils ont lu dans certains livres »[105].
Dans L’Alchimiste, la plupart
des personnages sont des rêveurs car ils aiment lire : l’Anglais
« avait fréquenté les meilleures bibliothèques du monde, achetés les
ouvrages les plus importants et les plus rares concernant l’Alchimie »[106]
et l’Alchimiste possède un volume d’Oscar Wilde[107].
Quant au personnage principal, il a toujours un livre sur lui. Mais Paulo
Coelho se moque de la naïveté de son personnage, qui se laisse influencé par ce
qu’il lit : « il avait choisi
[…] d’être un aventurier semblable aux personnages des livres qu’il avait
l’habitude de lire »[108].
Ironie de Paulo Coelho, Santiago – «encore un rêveur ! »[109] -
n’a pas changé de livre depuis deux ans ! Mais si le berger a décidé de
partir, c’est parce qu’il a fait un rêve qu’il a voulu réaliser[110] :
il s’est effectivement vu aller aux pyramides d’Egypte. Le rêve a dès lors une fonction
prémonitoire, prospective qui se présente, comme le souligne Jung, « sous
la forme d’une anticipation surgissant dans l’inconscient, de l’activité
consciente future ; elle évoque une ébauche préparatoire, une esquisse à
grandes lignes, un projet de plan exécutoire »[111].
Si nos protagonistes rêvent de se rendre sur les lieux de leurs rêves, c’est
parce que ces-derniers doivent incontestablement ressembler à un Paradis
terrestre.
2. L’Eden
« Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l’homme puisse se
réjouir à la vue des palmiers »
Paulo Coelho[112]
L’Eden est dans l’imaginaire collectif un lieu où les Hommes vivent en harmonie
(terme cher à Le Clézio !) avec la nature ; un lieu où les Hommes
n’ont besoin - comme les brebis du berger de Paulo Coelho - que d’un peu d’eau
et de nourriture pour être heureux[113].
Un tel endroit fait forcément rêver tout être humain. Mais les personnages de
nos récits étant de grands idéalistes, ils chercheront à trouver dans la
réalité ce Paradis terrestre. Autrement dit, un lieu où la végétation est
luxuriante et les Hommes en harmonie avec elle. L’oasis de Fayoum, irriguée par
le Nil, peut correspondre à un tel endroit. Depuis l’époque pharaonique,
le Fayoum a une grande réputation de beauté et de fertilité : « elle
comprenait trois cent puits, cinquante mille dattiers, et un grand nombre de
tentes de couleur disséminées au milieu des palmiers »[114].
De plus, c’est un lieu de paix, un terrain toujours neutre en cas de
guerre parce que « la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient
des femmes et des enfants ». Bref, Fayoum est un lieu
« d’asile »[115].
En outre, cette région est de forme triangulaire d’après l’Encyclopaedia
Universalis : trois étant pour les chrétiens représentatif de la
perfection de l’Unité divine, Fayoum pourrait bien correspondre à une sorte
d’Eden. En outre, le triangle correspond à une facette divine de l’architecture
des pyramides d’Egypte. De plus, l’ancien nom de Fayoum est
« Crocodilopolis ». Dans la mythologie égyptienne, le crocodile est
le dieu de la fécondité, à la fois aquatique, solaire et chtonien. On se
rapproche du mythe de l’origine égyptienne de l’humanité !
L’oasis de Timimoun, situé dans la région du Gourara dans le Grand Erg
Occidental, est également assimilée au Paradis terrestre car elle a vu
« durant des siècles des vagues de réfugiés berbères, zénètes, juifs,
noirs et arabes s’y cacher, s’y agglomérer et s’y installer définitivement pour
créer, à force de travail et d’ingéniosité, une sorte d’Eden »[116].
 Dans Voyage
à Rodrigues il y a également de nombreuses références bibliques tendant à
montrer que la maison Euréka est un Paradis terrestre : « maison
immense et silencieuse, abstraite dans le secret de son jardin d’Eden »[117] .
La maison est ici symbole de féminité, avec le sens de refuge, de mère, de
protection. L’île elle-même, malgré sa sécheresse, est un « refuge où la
beauté de la nature et de la mer faisait penser au paradis terrestre »[118]
(cf. photo). Rodrigues étant un ancien volcan, elle pourrait aussi faire figure
de montagne divine et de Paradis terrestre Les prophètes Isaïe et Ezéchiel
considèrent en effet l’Eden comme une montagne. Comme l’écrit Claude Dis,
« la recherche du trésor est moins l’espoir de futures richesses que le
désir de retrouver un autre paradis terrestre »[119].
Toute île a en outre une forme pyramidale, divine donc. Si nos personnages rêvent de reconquérir ces
Edens inexplorés, ces refuges, c’est certes pour avoir une vie plus saine mais
aussi dans l’espoir d’y trouver quelque trésor enfoui.
Dans Voyage
à Rodrigues il y a également de nombreuses références bibliques tendant à
montrer que la maison Euréka est un Paradis terrestre : « maison
immense et silencieuse, abstraite dans le secret de son jardin d’Eden »[117] .
La maison est ici symbole de féminité, avec le sens de refuge, de mère, de
protection. L’île elle-même, malgré sa sécheresse, est un « refuge où la
beauté de la nature et de la mer faisait penser au paradis terrestre »[118]
(cf. photo). Rodrigues étant un ancien volcan, elle pourrait aussi faire figure
de montagne divine et de Paradis terrestre Les prophètes Isaïe et Ezéchiel
considèrent en effet l’Eden comme une montagne. Comme l’écrit Claude Dis,
« la recherche du trésor est moins l’espoir de futures richesses que le
désir de retrouver un autre paradis terrestre »[119].
Toute île a en outre une forme pyramidale, divine donc. Si nos personnages rêvent de reconquérir ces
Edens inexplorés, ces refuges, c’est certes pour avoir une vie plus saine mais
aussi dans l’espoir d’y trouver quelque trésor enfoui.
3. La chasse au trésor
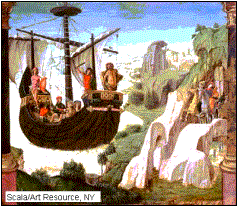 Nos ouvrages se rapprochent beaucoup du
roman d’aventure de par leur aspect « folklorique » : on y
trouve en effet tout ce qui a trait à ce genre littéraire dont l’emblème est L’île
au trésor de Stevenson[120].
Il y est question d’enfance, de voyage, de cartes, de vie sauvage, d’îles, etc.
Chez nos trois auteurs, le leitmotiv de la chasse au trésor motive aussi
l’écriture. Par exemple, le mythe de la « Toison d’or » apparaît
clairement dans Voyage à Rodrigues.
D’ailleurs, Le Clézio considère son grand-père comme « un personnage de
roman »[121]. L’auteur
ne cesse de comparer l’aventure de Jason avec celle de son aïeul: « j’ai
pensé souvent à Jason, à sa quête en Colchide. […] C’est ici, à Rodrigues, que
j’ai le mieux ressenti cela : Jason errant à la recherche d’un
hypothétique trésor, allant toujours plus loin, se jetant dans les tempêtes
meurtrières, dans les combats, rencontrant même l’amour dévorant de Médée, tout
cela me semblait plus réel à présent, sur cette île, grâce à la mémoire de mon
grand-père »[122].
De plus, le navire du grand-père ressemble étrangement, d’après Le Clézio, à
celui du chef des Argonautes(cf. image ci-contre[123]) :
« la rencontre du Segunder et du capitaine Bradmer était un espoir,
une ivresse comme il n’en avait pas connu auparavant. Malgré moi, encore je
pense au navire Argo, tel que le fit construire Minerve »[124]
Le Clézio lui-même se demande en arrivant s’il n’est pas venu ici dans le même
but que son aïeul : « et si j’allais, moi, enfin trouver ce
trésor ? »[125].
Mais si le grand-père de l’auteur est venu ici dans le but de chercher un
trésor, c’était pour répondre à des soucis financiers : « mon grand-père,
lui, n’abandonne pas sa quête. Même lorsque tout est contre lui, lorsque
l’argent manque, lorsque les créanciers sont de plus en plus impatients,
lorsque surtout survient la catastrophe, et qu’il est chassé de la maison par
sa propre famille »[126] ;
« penser que cet homme […] a passé la plus grande partie de sa vie à
poursuivre une chimère, qu’il a placé là tous ses espoirs – la revanche sur
tous ceux qui l’avaient maltraité et ruiné : payer ses dettes, racheter la
maison de sa famille d’où il avait été expulsé, assurer l’avenir de ses enfants-
penser à cette folie […] : c’est cela que je trouve émouvant »[127].
Si le grand-père de l’auteur est venu à Rodrigues dans le but de chercher un
« très-or » matériel, J. M. G. Le Clézio, lui, vient sur l’île pour
retrouver les traces de son aïeul (un peu comme dans Ailleurs, où l’auteur part à la recherche de la maison où son
grand-père maternel a vécu, dans la région de Milly-la-forêt). Cette recherche
du grand-père est aussi une chasse au trésor. Il y a donc une véritable mise en
abyme dans Voyage à Rodrigues. Le
Clézio suit les traces de son grand-père qui suivait lui-même les traces du
corsaire inconnu. Le Clézio se sert du journal de son grand-père qui lui-même a
utilisé celui du corsaire : « celui dont je ressens ici la présence
est un homme sans âge, sans racines, sans famille, un étranger au monde, comme
l’était sans doute le Corsaire dont il cherche la trace », « je vois
ce que je suis venu chercher réellement à Rodrigues : les traces visibles
de cet homme, restées apparentes par le miracle de la solitude »[128].
Nos ouvrages se rapprochent beaucoup du
roman d’aventure de par leur aspect « folklorique » : on y
trouve en effet tout ce qui a trait à ce genre littéraire dont l’emblème est L’île
au trésor de Stevenson[120].
Il y est question d’enfance, de voyage, de cartes, de vie sauvage, d’îles, etc.
Chez nos trois auteurs, le leitmotiv de la chasse au trésor motive aussi
l’écriture. Par exemple, le mythe de la « Toison d’or » apparaît
clairement dans Voyage à Rodrigues.
D’ailleurs, Le Clézio considère son grand-père comme « un personnage de
roman »[121]. L’auteur
ne cesse de comparer l’aventure de Jason avec celle de son aïeul: « j’ai
pensé souvent à Jason, à sa quête en Colchide. […] C’est ici, à Rodrigues, que
j’ai le mieux ressenti cela : Jason errant à la recherche d’un
hypothétique trésor, allant toujours plus loin, se jetant dans les tempêtes
meurtrières, dans les combats, rencontrant même l’amour dévorant de Médée, tout
cela me semblait plus réel à présent, sur cette île, grâce à la mémoire de mon
grand-père »[122].
De plus, le navire du grand-père ressemble étrangement, d’après Le Clézio, à
celui du chef des Argonautes(cf. image ci-contre[123]) :
« la rencontre du Segunder et du capitaine Bradmer était un espoir,
une ivresse comme il n’en avait pas connu auparavant. Malgré moi, encore je
pense au navire Argo, tel que le fit construire Minerve »[124]
Le Clézio lui-même se demande en arrivant s’il n’est pas venu ici dans le même
but que son aïeul : « et si j’allais, moi, enfin trouver ce
trésor ? »[125].
Mais si le grand-père de l’auteur est venu ici dans le but de chercher un
trésor, c’était pour répondre à des soucis financiers : « mon grand-père,
lui, n’abandonne pas sa quête. Même lorsque tout est contre lui, lorsque
l’argent manque, lorsque les créanciers sont de plus en plus impatients,
lorsque surtout survient la catastrophe, et qu’il est chassé de la maison par
sa propre famille »[126] ;
« penser que cet homme […] a passé la plus grande partie de sa vie à
poursuivre une chimère, qu’il a placé là tous ses espoirs – la revanche sur
tous ceux qui l’avaient maltraité et ruiné : payer ses dettes, racheter la
maison de sa famille d’où il avait été expulsé, assurer l’avenir de ses enfants-
penser à cette folie […] : c’est cela que je trouve émouvant »[127].
Si le grand-père de l’auteur est venu à Rodrigues dans le but de chercher un
« très-or » matériel, J. M. G. Le Clézio, lui, vient sur l’île pour
retrouver les traces de son aïeul (un peu comme dans Ailleurs, où l’auteur part à la recherche de la maison où son
grand-père maternel a vécu, dans la région de Milly-la-forêt). Cette recherche
du grand-père est aussi une chasse au trésor. Il y a donc une véritable mise en
abyme dans Voyage à Rodrigues. Le
Clézio suit les traces de son grand-père qui suivait lui-même les traces du
corsaire inconnu. Le Clézio se sert du journal de son grand-père qui lui-même a
utilisé celui du corsaire : « celui dont je ressens ici la présence
est un homme sans âge, sans racines, sans famille, un étranger au monde, comme
l’était sans doute le Corsaire dont il cherche la trace », « je vois
ce que je suis venu chercher réellement à Rodrigues : les traces visibles
de cet homme, restées apparentes par le miracle de la solitude »[128].
Chez Rachid Boudjedra, pas de chasse au trésor. Mais le narrateur de La
Macération part sur les traces de son père en prenant pour points de repères les cartes postales que ce dernier
a envoyées à sa famille pendant toutes ses années d’errance : « je
fis à mon tour les mêmes voyages réalisés par le père, comme dans son sillage,
comme le suivant à la trace ; pour essayer de crever ce silence observé
(édifié) par tout le monde, autour de ce pourrissement familial »[129].
Un écho de cela apparaît dans Timimoun :
« lui, passait sa vie à nous inonder de cartes postales qui nous
parvenaient de tous les coins du monde comme pour recouvrir son absence,
m’obliger, à distance, à faire des études d’ingénieur »[130].
Dans L’Alchimiste, le départ
du protagoniste est, comme chez Le Clézio, motivé par la découverte d’un
trésor : « tu dois aller jusqu’aux pyramides d’Egypte. Je n’en avais
jamais entendu parler, mais si c’est un enfant qui te les a montrées, c’est
qu’elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un
homme riche »[131].
Et comme chez Le Clézio, Santiago part à la recherche de la « Toison
d’or ». De la boucle du mouton du berger à Jason, la distance est
effectivement bien mince. Mais tout laisser tomber pour partir n’est pas
évident. Si nos personnages fuient de la sorte la terre des origines, c’est
sans doute parce qu’ils étaient lassés de mener une vie stérile.
C.
La lassitude
de la vie
1. Un enracinement perpétuel
« Est-ce éternellement que le sort me condamne
A dépérir ainsi dans ce climat profane ?
Oh ! ne pourrai-je donc, libéré de mes fers,
Pèlerin vagabond sur de nouvelles rives,
Promener quelque jour mes passions actives
A travers l’Océan, à travers les déserts ? »
Philotée O’Neddy[132]
Un écrivain a généralement du mal à se détacher de son passé littéraire, et les ouvrages qu’il produit ont souvent une filiation thématique et/ou structurale avec d’autres écrits. Les trois œuvres de notre corpus sont bel et bien enracinées d’un point de vue littéraire. Paulo Coelho ne renie par exemple pas l’influence d’autres écrivains sur son œuvre : « Borges a beaucoup influencé mes ouvrages. J’adore sa prose et sa poésie […] J’adore tout ce qu’il a écrit. Ses poésies, je les ai lues mille fois, j’en connais beaucoup par cœur »[133].
Quant à Rachid Boudjedra, il avoue aussi que son métier d’écrivain passe systématiquement par l’influence d’autres auteurs : « On apprend le métier dans la fréquentation assidue et la pratique patiente des textes. Il y a d’abord les auteurs qui non seulement sont mes auteurs préférés mais certainement mes maîtres aussi. Toute la littérature nouvelle, tout le roman nouveau, non seulement en France mais aussi bien en Amérique qu’ailleurs dans le monde. Je pense à Flaubert, Proust, Joyce, Faulkner, Dos Passos, Claude Simon, Günter Grass, etc. Ce sont là essentiellement des auteurs qui m’ont beaucoup aidé dans l’apprentissage de mon métier, simplement par la fréquentation de leurs propres textes »[134].
Gérard de Cortanze souligne l’influence de Lautréamont et de Michaux sur L’écriture de Le Clézio. Ce-dernier avoue effectivement cette filiation littéraire, malgré la différence entre les deux auteurs : « Lautréamont est vraiment à l’opposé de Michaux ; avec tout cet aspect canularesque qu’il est si difficile de percevoir […] J’ai eu accès à Lautréamont d’assez loin, par des amis qui m’avaient conseillé de le lire. Michaux, bien que je ne m’en souvienne plus avec précision, cela a eu lieu plus spontanément. Peut-être au hasard d’une librairie »[135]. Nos auteurs ne peuvent donc pas nier leur héritage culturel ni leur enracinement littéraire : ils appartiennent à une tradition d’écriture qu’ils ne peuvent pas remettre en cause.
Les personnages des œuvres que
nous étudions sont également enracinés dans une société de laquelle ils peuvent
difficilement fuir. De facto, ils semblent démotivés par la vie
routinière qu’ils mènent. Pour eux, toutes les journées se ressemblent et rien a
priori ne laisse supposer une quelconque évolution. En un mot, le
conditionnement social régule la vie des individus. Shmuel Trigano écrit que
« l’exil s’abat sur un homme avec la soudaineté de la tempête. Elle vient
le débusquer là où il se trouve, immergé dans l’inertie de l’existence et de
l’évidence, pour l’en sortir avec violence. Cette brutalité est à la mesure de
l’insouciance que cet attachement ébranle à jamais. Avant de connaître l’exil,
l’homme ne sait pas exister en effet. Il existe et son existence se suffit à
elle-même comme s’il était le fruit d’une sécrétion naturelle ou le produit
d’un terroir, d’une culture, d’une tradition familiale… Il ne s’appartient pas,
même s’il vit comme si tout lui appartenait, au point de faire corps avec son
monde. L’exil vient rompre cette relation d’identité de l’individu avec son
milieu »[136]. Dans Timimoun, Rachid Boudjedra
(« l’homme aux racines » d'après le sens donné à son patronyme en
langue arabe ! ) parle de la société algérienne traditionnelle, société de
laquelle il est difficile de s’échapper. Il évoque tout d’abord le système
patriarcal maghrébin, dans lequel le mâle, véritable régisseur d’une société
phallocentrique, a une place centrale : c’est lui qui décide de la vie que
doivent mener femmes et enfants. Le narrateur de Timimoun garde de son père des souvenirs difficiles :
« il était très riche, grand voyageur et trop égoïste. Atteint de la
maladie des nomades, il ne savait pas tenir en place. D’une affaire l’autre.
D’un continent l’autre. D’une femme l’autre. […] Lui passait sa vie à nous
inonder de cartes postales […] comme pour recouvrir son absence, m’obliger, à
distance, à faire des études d’ingénieur agroalimentaire et tenir ma mère à
l’œil »[137]. Cette
situation désastreuse est à l’origine du traumatisme du narrateur, qui évoque
aussi la place importante de la religion en Algérie. L’Islam semble ne pas avoir
évolué depuis des siècles tant il est monotone et rébarbatif. Le jour de
l’enterrement du frère aîné, Boudjedra écrit que « les complaintes
coraniques [sont] répétées et ressassées sur le même ton »[138].
Mais là n’est pas le pire : l’auteur n’omet pas de signaler que l’Islam
est une religion au nom de laquelle on commet des meurtres atroces et
injustifiés. Boudjedra met cette idée en évidence en inscrivant dans son récit
de courtes phrases reprenant les informations que le chauffeur et les passagers
du bus entendent à la radio : «… UNE FEMME DE MENAGE AGEE DE 46 ANS ET MERE DE 9
ENFANTS A ETE ABATTUE DE DEUX BALLES DANS LA TETE ALORS QU’ELLE REVENAIT DE SON
TRAVAIL… »[139].
L’auteur mentionne également la transmission d’objets de génération en
génération. La société traditionnelle algérienne se perpétue ainsi à travers
les siècles, les enfants prenant la succession des adultes :
« j’avais hérité [des boîtes] du frère décédé, avec des cahiers remplis de
mots gribouillés à l’encre rouge »[140].
De même, à Timimoun, rien ne semble avoir évolué depuis longtemps : la
ville « est un ksar rouge très ancien, avec ses murailles construites en
pisé ocre. Il se love sur une longue terrasse qui domine d’une vingtaine de
mètres la palmeraie. Son minaret soupçonneux […] surveille le désert alentour.
Avec ses dunes gigantesques et très mobiles. Ses anciennes routes de l’or et du
sel. Ses oasis qui ont vu durant des siècles des vagues de réfugiés berbères,
zénètes, juifs, noirs et arabes s’y cacher »[141].
Dès lors, tout se passe comme si la société n’avait pas évolué depuis des
siècles ; comme si le temps s’était arrêté : la mère du narrateur
« était quelqu’un de très particulier. Il n’y avait rien dans son regard.
Seulement, peut-être, cette entêtante, neutre et, sans doute, imaginaire sensation
de moiteur, de virginité, de claustration et de temps immobilisé arbitrairement
par son époux »[142] ; « le
temps n’a pas bougé »[143].
Cette immobilité (volontaire ?) est également soulignée par l’image du bus
qui s’enlise : « il m’arrive de faire semblant de m’ensabler pour la
plus grande joie des touristes »[144].
De même, le vieux tacot reproduit le même parcours, inlassablement, jour après
jour. Le narrateur emprunte « depuis dix ans »[145]
l’itinéraire Alger – Timimoun – Alger : « le statisme que reproduit,
en apparence, le roman se vérifie encore dans la coïncidence du point de départ
et du point d’arrivée du périple saharien. Le déplacement répétitif nierait, en
quelque sorte, la possibilité d’un changement ou d’une évolution et inscrirait
le trajet dans l’immobilisme »[146],
souligne Lila Ibrahim-Ouali. L’emploi de l’imparfait de l’indicatif est
également représentatif de cette idée de perpétuité inaltérable, d’action qui
dure interminablement, de temps immobilisé. De plus, comme l’écrit ensuite Lila
Ibrahim-Ouali, nous ne connaissons du personnage que sa fonction dans la
société : « pour le narrateur, la parenthèse saharienne répondrait
même à un besoin de vide existentiel. En s’acquittant de sa tâche de
conducteur-guide, il s’efface en tant qu’individu et ne laisse percevoir que sa
raison sociale » [147].
Un peu comme le personnage des 1001 années de la nostalgie, qui n’ayant
pas d’identité personnelle, se fait appeler « S. N. P. »,
c’est-à-dire « Sans Nom Patronymique »[148].
J. M. G. Le Clézio, dans Voyage à
Rodrigues, décrit brièvement la vie des Rodriguais. Une fois encore, la société est marquée par
l’importance de la tradition. Tout se transmet de génération en
génération : « chacun de leurs gestes semble continuer le plan du
destin afin de brouiller davantage la piste, comme s’ils étaient devenus,
malgré eux, à l’égal des roches noires et des vacoas, les gardiens du
trésor du Privateer»[149].
Ainsi, la fable du trésor semble ne jamais devoir mourir : « mon
grand-père a su inspirer des suiveurs dans son rêve, puisque c’est lui qui, le
premier, a inventé la légende du trésor de Rodrigues. La légende vit
encore »[150]. Par
ailleurs, Le Clézio a bel et bien hérité des plans de son grand-père. Cette
transmission d’objets de père en fils est également signe d’enracinement :
« j’ai lu ses documents, écrits d’une main extraordinairement fine et
lisible, ornés de dessins, de plans tracés à la plume, coloriés à l’aquarelle,
tout cela qui retraçait ses années de recherche, sa quête inlassable de la
cachette du Corsaire »[151].
De même, l’auteur du journal voit sur le sol les marques laissées par son
grand-père au début du siècle, et rien ne semble devoir les effacer un
jour : « je vois les traces de coups laissées par mon grand-père.
Deux plaies au fond du ravin, que le temps n’a pas encore effacées »[152].
Comme chez Rachid Boudjedra, il y a donc chez Le Clézio cette idée de temps
immobilisé depuis des siècles. Cela traduit bien l'enracinement perpétuel d’une
société traditionnelle : « tout est là, immobile depuis tant
d’années, immobile pour l’éternité, semble-t-il, comme si les pierres noires et
les buissons, les vacoas, les aloès, tout avait été disposé là pour
toujours »[153].
D’ailleurs, quand l’auteur parle de son grand-père, il emploie le présent de
l’indicatif, tout se passant comme si les deux hommes avaient vécu à la même
époque : « mon grand-père est assis donc , sur cette pierre
plate, tournant le dos au ravin, regardant vers l’estuaire. Il tient comme
toujours une cigarette […] entre le pouce et le médian, à l’horizontale, comme
un crayon, dont il secoue la cendre de temps en temps »[154].
Cette « réduction temporelle » trouve son apogée quand Le Clézio fini par s’assimiler à son aïeul :
« ce que j’ai voulu, dès le début, c’est revivre dans le corps de mon
grand-père, être lui, dont je suis la parcelle vivante »[155].
Dans L’Alchimiste, Paulo
Coelho fait référence à la vie monotone que mène le personnage principal avant
son grand départ. Là aussi, l’auteur emploie l’imparfait de l’indicatif pour
indiquer une action qui se perpétue constamment : « au bout de deux
années passées à parcourir les plaines de l’Andalousie, il connaissait par cœur
toutes les villes de la région »[156].
Dans le village où se trouve la femme que Santiago aime, tout semble
définitivement figé et statique : « chaque jour était semblable au
précédent »[157].
Quand le berger arrive au village, celui-ci est d’ailleurs endormi, comme
plongé dans une léthargie inébranlable. Ainsi, les habitants n’ont aucune
conscience du temps qui passe. Leur vie ainsi préservée de cette dimension est
identique à celle des animaux : « le seul besoin qu’éprouvaient les
moutons, c’était celui d’eau et de nourriture. Et tant que leur berger
connaîtrait les meilleurs pâturages d’Andalousie, ils seraient toujours ses
amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres »[158].
Là aussi, les personnages sont enracinés dans un contexte duquel ils ne peuvent
s’échapper ou trouver une issue définitive. Paulo Coelho fait aussi référence
–comme Rachid Boudjedra, bien sûr- à l’importance qu’a la religion dans les
pays du Maghreb. L’islam semble régir définitivement la vie des
individus : « Le Prophète nous a donné le Coran, et nous a imposé
seulement cinq obligations à observer au cours de notre existence. La plus
importante est celle-ci : il n’existe qu’un Dieu et un seul. Les autres
obligations sont : la prière cinq fois par jour, le jeûne du Ramadan, et
le devoir de charité envers les pauvres . […] La cinquième obligation de tout
bon musulman est de faire un voyage. Nous devons, au moins une fois dans notre
vie, aller à la ville sainte de La Mecque »[159].
Dans l’alchimie (comme dans le soufisme), le Maître a également à sa charge un
apprenti qu’il doit former. Il y a donc un héritage qui se perpétue entre un
homme d’expérience et un néophyte. Cette tradition caractéristique de
l’alchimie souligne aussi le caractère perpétuel de ce mouvement
initiatique : « deux personnes,
cependant, souriaient : l’Alchimiste, parce qu’il avait trouvé son
véritable disciple, et le chef suprême, parce que le disciple avait entendu la
gloire de Dieu »[160].
Toutes ces traditions séculaires ont pour conséquence l’immobilisation du
temps, comme chez Boudjedra et Le Clézio : « chaque jour porte en lui
l’éternité »[161] ;
« du haut des Pyramides, les siècles le contemplaient en silence »[162].
Preuve en est, le personnage du marchand de pop-corn, qui mène une vie on ne
peut plus stérile. James Burty David en parle dans son ouvrage sur le roman de
Paulo Coelho : « dans l’Alchimiste, le marchand de pop-corn
est à l’opposé même du voyageur. Il a pris racine et s’est installé dans la
routine. Pour lui, l’école de la vie a été plutôt une école-caserne. Aucune
ouverture sur des univers infinis. Rêves étouffés. Désirs bloqués »[163].
D’ailleurs, nous ne connaissons des personnages que leur raison sociale :
le personnage principal n’est que très rarement appelé Santiago. L’auteur
préfère en effet les qualificatifs de « jeune homme » ou
« berger ». C’est aussi le cas de l’Alchimiste, de l’Anglais, ou du
Marchand de Cristaux.
La vie que mène ce dernier personnage, pour lequel travaille le jeune
homme, est aussi emblématique de l’existence routinière que peuvent mener
certaines personnes : il « vit le jour se lever et ressentit la même
impression d’angoisse qu’il éprouvait chaque matin. Il était depuis près de
trente ans dans ce même endroit […] Maintenant, il était trop tard pour changer
quoi que ce fût »[164] ;
« j’ai peur de réaliser mon rêve et n’avoir ensuite plus aucune raison à
continuer à vivre […], tout ce que je veux, c’est rêver de La Mecque »[165]
. Retranché dans une vie stérile, ce personnage de L’Alchimiste est
malheureux parce qu’il n’ose pas choisir son destin. Mais « c’est
justement –pour reprendre un précepte cher à Coelho-, la possibilité de
réaliser un rêve qui rend la vie intéressante »[166]
2. La place mineure du rêve
« notre siècle n’est plus un siècle à trésors »
J. M. G. Le
Clézio[167]
Nos trois auteurs semblent apparemment ne pas apprécier les sociétés
occidentales. Les modes de vie des populations dites civilisées accordent
effectivement au rêve une place mineure, car tout y est mécanisé, ordonné de
manière rigoureuse, notamment dans les villes. Nos auteurs ont sans doute à
l’esprit l’image de Babylone la Grande, qui représente le symbole inversé de la
ville, l’anti-ville, c’est-à-dire la mère corrompue et corruptrice, qui, au
lieu d’apporter vie et bénédiction, attire la mort et les malédictions.
L’organisation de l’espace urbain traduit bien cette impression. Chez Le Clézio
tout d’abord, qui déteste la tristesse et la froideur des métropoles, comme le
signale Jean Onimus : « N’y a-t-il donc aucune poésie dans les
grandes métropoles ? Les surréalistes n’ont-ils pas tenté d’exercer leur
imagination créatrices dans les rues, poétisant les affiches déchirées, les
remugles des soupiraux, le jeu des devantures et les reflets de la pluie sur
les trottoirs ? Et que dire de l’impressionnante beauté d’un complexe
échangeur d’autoroute, d’une vaste avenue illuminée, des grands ponts modernes
et du dynamisme des formes qu’autorise le béton armé ! Rien de cela chez
Le Clézio ! Rien que des murs tristes ; des rectangles de béton, des
cubes de briques et, sur les toits, les potences des télévisions ; dans
les rues rien que des individus mécanisés qui se croisent dans
l’indifférence »[168].
On retrouve cette image dépréciative des habitations modernes dans Voyage à Rodrigues : « cette
cachette […] est d’une ingénieuse simplicité qui met à néant la légendaire et
absurde complication de maçonneries et de travaux en béton »[169] ;
« paysage d’éternel refus. Qu’allait-il me donner à moi, venu de mon
siècle de vanité et de confort […] ? »[170] ;
« aussi n’est ce pas à la maison telle qu’elle existe encore, rafistolée
comme un vieux navire, condamnée à être bientôt démolie pour laisser place aux
lotissements des promoteurs chinois, que je veux penser »[171].
 Dans Timimoun,
les villes sont aussi décrites en termes dépréciatifs car il y règne une
violence latente : « il valait mieux mourir dans ce désert […] plutôt
que dans une de ces villes atrophiées, surpeuplées et agressives »[172].
Condamné à mort, le narrateur du roman mène à Alger une vie terriblement
stressante. La ville est pour lui invivable. Il est toujours sur ses
gardes : « dès que je revenais à Alger, je perdais le sens de la
réalité. Je changeais de domicile tous les trois jours. Je vivais sur le
qui-vive, mes capsules de cyanure à portée de la main »[173].
Ensuite, l’auteur assimile Constantine (cf. photo[174])
à un labyrinthe infernal où l’Homme s’égare et se perd facilement. La ville
semble avaler celui qui s’aventure dans ses entrailles[175] :
« j’avais l’impression que la ville dégringolait sur moi. Cette ville qui
est comme perchée. Constantine, donc, avec ses ponts suspendus, ses
ponts-levis, son ravin vertigineux, ses casbahs éparpillées sur l’ocre des
falaises interminables et des rochers comme effrités ». Timimoun est aussi
une ville labyrinthique mais la présence de l’eau lui confère cet aspect
idyllique que Constantine n’a pas : « la casbah de Timimoun se résume
à ces rangées de ruelles labyrinthiques »
[176] ;
« chaque opération de partage de l’eau donne l’occasion d’une répartition
du débit initial en débits dérivés, puis en débits sous-dérivés, donc en
nouvelles canalisations dont le nombre se multiplie à l’infini »[177].
Dans Timimoun,
les villes sont aussi décrites en termes dépréciatifs car il y règne une
violence latente : « il valait mieux mourir dans ce désert […] plutôt
que dans une de ces villes atrophiées, surpeuplées et agressives »[172].
Condamné à mort, le narrateur du roman mène à Alger une vie terriblement
stressante. La ville est pour lui invivable. Il est toujours sur ses
gardes : « dès que je revenais à Alger, je perdais le sens de la
réalité. Je changeais de domicile tous les trois jours. Je vivais sur le
qui-vive, mes capsules de cyanure à portée de la main »[173].
Ensuite, l’auteur assimile Constantine (cf. photo[174])
à un labyrinthe infernal où l’Homme s’égare et se perd facilement. La ville
semble avaler celui qui s’aventure dans ses entrailles[175] :
« j’avais l’impression que la ville dégringolait sur moi. Cette ville qui
est comme perchée. Constantine, donc, avec ses ponts suspendus, ses
ponts-levis, son ravin vertigineux, ses casbahs éparpillées sur l’ocre des
falaises interminables et des rochers comme effrités ». Timimoun est aussi
une ville labyrinthique mais la présence de l’eau lui confère cet aspect
idyllique que Constantine n’a pas : « la casbah de Timimoun se résume
à ces rangées de ruelles labyrinthiques »
[176] ;
« chaque opération de partage de l’eau donne l’occasion d’une répartition
du débit initial en débits dérivés, puis en débits sous-dérivés, donc en
nouvelles canalisations dont le nombre se multiplie à l’infini »[177].
Dans L’Alchimiste, Tanger est
dépeinte comme une ville désorganisée, faite de « ruelles étroites »[178]
et dont la place centrale devient pendant les jours de marché un « énorme
fouillis »[179].
Dès lors, on comprend pourquoi « le jeune homme ne quitt[e] plus des yeux
son nouvel ami » quand il arpente les rues de la ville, tant la foule est
immense et agitée, à l’instar d’ « une colonie de fourmis au
travail »[180].
La fourmi suggère donc une idée d’activité industrieuse, dégradante. L’Oasis de
Fayoum est également surpeuplée et agitée. Il est donc facile de s’y
égarer : « au lieu d’un puits entouré de quelques palmiers […], il
s’apercevait que l’Oasis était beaucoup plus grande que bien des villages
d’Espagne. Elle comprenait trois cents puits, cinquante mille dattiers et un
grand nombre de tentes »[181].
La ville est donc dans nos œuvres décrite comme effrayante, agitée voire même
« tentaculaire », pour reprendre un terme d’Emile Verhaeren[182]
. Elle ne laisse pas le temps de rêver à celui qui participe à son agitation.
D’autant plus que toute relation humaine semble être à notre époque non pas basée
sur les sentiments mais sur l’argent.
Le narrateur anonyme du roman de Boudjedra dénonce ainsi l’arrivisme de
son père : « il était très riche, grand voyageur et trop égoïste. […]
D’une affaire l’autre. D’un continent l’autre »[183].
D’ailleurs, l’influence paternelle sur l’enfant est grande. Quand le narrateur
va à Genève, c’est également pour ses affaires et son intérêt professionnel.
C’est dans cette ville suisse qu’ont eu lieu « les péripéties
rocambolesques de l’achat du vieux tacot »[184].
Dans L’Alchimiste, Paulo
Coelho dénonce aussi les méfaits de l’argent, sa superficialité et le danger
qu’il représente pour tout un chacun. C’est effectivement en ville que le jeune
homme se fait voler son argent : « c’était ici un port, et la seule
chose vraie que ce type lui eût dite était celle-ci : un port est toujours
plein de voleurs »[185].
L’attirance pour l’argent est également visible à travers le personnage de
l’Anglais, qui a pour objectif, comme tout Alchimiste, de transformer le métal
en or. Santiago n’était pas au courant de cette possibilité. Jamais il n’a
était informé de l’enrichissement personnel que pouvait engendrer l’alchimie.
Après cette découverte, le berger se laisse aussi manipuler par l’argent. Son
attirance pour l’or croît considérablement .Du coup, après cette révélation,
« l’intérêt du jeune homme pour l’alchimie devint encore plus grand »[186]
écrit Paulo Coelho.
Le Clézio a aussi une vision négative de l’argent, de la monnaie :
« Je hais l’argent. Vivre avec l’argent, ce n’est pas facile. Le papier-monnaie
représente tout ce qu’il y a de limité, de raisonneur, de chichement équilibré
dans la société des hommes. Le goût de l’argent, c’est le goût des choses
futiles, des objets qu’on achète, de la gloire limitée. C’est le
trompe-la-mort, la réalité qu’on dit pratique, le mensonge. L’argent gêne mes
rapports avec les autres. Je ne sais pas comment payer, et je n’aime pas qu’on
me paye »[187].
L’or du Corsaire symbolise aussi le pervertissement et l’exaltation impure des
désirs : « espérait-il vraiment […] quelque chose de matériel, l’or
du Privateer, ce qu’on appelle un butin ? Comment imaginer que
cette quête […] puisse déboucher sur un tas d’or et de diamants, sur des verroteries ? »[188].
Le mépris de Le Clézio pour l’argent apparaît bien à travers le terme péjoratif
« verroteries ». L’emploi de ce substantif ironique permet à l’auteur
de faire un pied de nez à la valeur matérielle du trésor cherché par son
grand-père. D’ailleurs, il clame ouvertement que « l’or aveugle et
aliène »[189].
L’argent exerce donc un pouvoir
attractif sur les hommes, qui s’obstinent à voir en lui la promesse du bonheur,
la fin des difficultés matérielles et une prise de pouvoir immense sur autrui.
L’homme riche oublie tout ce qu’il y a d’humain et de sentimental en lui.
L’argent est sa raison de vivre. Malheureusement, cela lui enlève
incontestablement la part de rêve qu’il avait conservée depuis l’enfance. La
mécanisation du monde est également à l’origine de l’absence de rêve dans les
sociétés occidentales. Dans nos trois œuvres, ce qui est mécanisé est déprécié
par les auteurs. Les objets modernes apparaissent ainsi comme violents, froids,
secs, métalliques. Dans Timimoun tout
d’abord. Le narrateur trouve certes du réconfort dans l’alcool, mais il en
trouve aussi dans les moyens de transports modernes. Ces derniers offrent
incontestablement des sensations de vitesse grandioses, mais ceux qui les
conduisent mettent leur vie en danger à chaque instant : « Fuite
toujours dans quelque chose. L’alcool d’abord, déjà, à quinze ans et demi. Les
vieilles guimbardes de l’aéro-club, déjà à seize ans. Les avions de chasse,
déjà à vingt ans. Les vieux bus transsahariens, déjà, à trente ans »[190].
L’auteur met donc sur le même plan la drogue et les moyens de transport, tout
se passant comme si chacun représentait à sa façon un danger pour l’être
humain. Boudjedra écrit d’ailleurs qu’ « Extravagance était atteinte d’une
sorte d’immobilité donnant paradoxalement l’idée même de vitesse, de bestialité
et de mort »[191]
. Parallèlement, les objets modernes issus des pays occidentaux sont
invariablement associés à des idées négatives. Les machines à coudre sont par
exemple en relation avec la claustration féminine : « elle s’était
enfermée dans son mutisme et dans sa chambre où elle restait attelée, du matin
jusqu’au soir, à sa machine à coudre. Ou plutôt à ses machines à coudre parce
que mon père n’arrêtait pas de lui en acheter de nouvelles malgré les
protestations répétées mais naïves de ma pauvre mère. Comme si le maître des
lieux voulait, par ce subterfuge subtil et cynique, la clouer là à ses machines
stupides qu’il faisait venir du monde entier. Des marques toujours nouvelles.
Toujours le dernier modèle. Le dernier cri. Il voulait, ainsi, l’attacher et la
bâillonner pour cacher ou pour compenser ses interminables errances »[192].
En outre, les informations diffusées à la radio dans le bus font toujours
références à des attentas atroces souvent meurtriers : « j’ouvre la
radio de bord pour oublier vite mon envie de boire une vodka glacée et écouter
les informations : … LE PROFESSEUR BEN SAID A ETE SAUVAGEMENT ASSASSINE CE MATIN A HUIT
HEURES TRENTE A SON DOMICILE SOUS LES YEUX DE SA FILLE AGEE DE VINGT ANS PAR
LES INTEGRISTES ISLAMISTES… je
coupai vite le son. J’eus envie d’une vodka très froide. Mes mains devinrent plus
moites. Je sentis Sarah s’agiter sur son siège, dans mon dos. Elle avait très
bien entendu l’information macabre qui venait d’être donnée par le poste »[193]
. Un autre objet moderne est associé à
des idées funèbres : l’appareil photo. « Je ne cessais pas de
photographier Sarah comme si je voulais l’immobiliser une fois pour toutes sur
la pellicule. Une façon de la tuer, en fait ! »[194].
Jean Onimus montre que Le Clézio est hanté par la mécanisation du
monde : « l’impérialisme de la
technique a toujours rebuté les philosophes ; pour Heidegger c’est
l’ennemie par excellence de la pensée.
Pour Le Clézio c’est l’horreur : elle stérilise, elle pétrifie la vie,
elle est le ressort de cette énorme guerre que la raison technique mène
contre la nature ; elle nous éloigne de la paix, du bonheur des origines,
elle nous entraîne vers un enfer de violences inouïes »[195].
La destruction de la maison Euréka symbolise bien la bestialité effrayante
qu’exerce le monde capitaliste sur la nature inviolée : « aussi n’est
ce pas à la maison telle qu’elle existe encore, rafistolée comme un vieux
navire, condamnée à être bientôt démolie pour laisser place aux lotissements
des promoteurs chinois, que je veux penser »[196]
. Cette guerre que l’homme livre à la nature est l’apanage du monde occidental.
Mais comme Boudjedra –qui est condamné à mort et poursuivi par les
intégristes-, Le Clézio fait référence dans son oeuvre à la vraie guerre, celle
des hommes qui se battent entre eux, celle qui fait sombrer dans l’horreur les
endroits du monde les plus reculés et qui porte atteinte à la paix naturelle de
la vie sauvage. Cette guerre arrache le grand-père de Le Clézio à la quête du
trésor : elle fait entrer brusquement l’Histoire collective dans
l’Histoire individuelle d’un homme seul. Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio fait référence à la première guerre
mondiale, qui mit un terme à la quête du grand-père : « et puis, il y
a la guerre à nouveau, cette guerre qui va bientôt commencer au loin, en
Europe, et qui, on le sait déjà, va s’étendre au monde entier par le jeu des
alliances, qui va peut-être donner en proie aux Japonais toutes les îles de
l’océan Indien. Tout cela (et la ruine pour sa famille, l’espoir à jamais perdu
de retrouver le bonheur d’Euréka) fait sombrer le rêve de Rodrigues »[197].
Cet extrait fait écho à un passage du Chercheur d’or, dans lequel Le
Clézio raconte l’horreur vécue par son grand-père pendant la guerre
1914-1918 : « partout, autour de nous, les rues crevées, les maisons
effondrées. Sur la voie ferrée miraculeusement intacte, les wagons sont
renversés, éventrés. Des corps sont accrochés aux machines, pareils à des
pantins de chiffon. Dans les champs qui entourent le village, il y a des
cadavres de chevaux à perte de vue, gros et noirs comme des éléphants morts.
Les corbeaux voltigent au-dessus des charognes, leurs cris grinçant font
sursauter les vivants. Entrent dans la ville des cohortes de prisonniers,
lamentables, minés de maladies et de blessures. Avec eux, des mules, des
chevaux boiteux, des ânes maigres. L’air est empoisonné »[198].
Le monde occidental apparaît donc comme profondément décadent. Dans nos
trois récits, le symbole de la Chute signale un monde en voie de perdition.
Dans Timimoun, le motif de la
hauteur, et inversement de la profondeur, rend compte de la Chute proche des
valeurs occidentales : « autour de moi, l’univers s’affaisse, alors,
dans un coma profond. Progressivement. Sans en avoir l’air ! […] Je me
sentis perdu […] dans cette ville avec ses labyrinthes aperçus de la fenêtre de
ma chambre […] La ville dessine un volume énorme et boursouflé qui dégringole
par paliers successifs et niveaux multiformes entre la Casbah et le rocher sur
lequel Constantine est construite. La casbah vieille et fragile […] ne cesse de
se dégrader et de s’effriter. Comme si elle se fanait chaque jour un peu plus.
Elle se couvre de lézardes, de fissures et de trous »[199] ;
« j’avais l’impression que la ville dégringolait sur moi. Cette ville qui
est comme perchée. Constantine, donc, avec ses ponts suspendus, ses
ponts-levis, son ravin vertigineux, ses casbahs éparpillées sur l’ocre des
falaises interminables et des rochers comme effrités […] A Timimoun aussi.
C’est-à-dire ce que mon œil voyait d’abord monter vers lui, lorsque j’arrivais
en face du ksar. Sorte de guillemets et de détails agglomérés au premier plan,
d’une façon si évidente que l’on a peur de s’y fracasser le visage. Puis ces
agglomérats et ces agrégats de volumes ocre, rouges et verts dégénéraient peu à
peu. Au fur et à mesure de la succession des plans : la ville moderne, le
ksar, la palmeraie qui deviennent […] des détails de plus en plus brouillés,
flous, brisés »[200].
Le coucher de soleil représente lui aussi le passage du jour à la nuit, du tout
au rien, du monde au néant. La Chute d’un monde : « c’est avec le
coucher de soleil que la réalité bascule. Le monde n’a plus de sens. Ou plutôt,
il le perd »[201].
Dans Voyage à Rodrigues, on
retrouve ce leitmotiv de la Chute : « ces traces de coups, ces
anciens trous comblés, ces tranchées m’émeuvent comme s’il s’agissait de
ruines. Ce sont les vestiges d’une activité perdue, d’une vie perdue »[202] ;
« peut-on trouver le bonheur quand tout parle de destruction ? »[203],
etc.
Dans le roman de Paulo Coelho, même si l’inscription temporelle n’est
pas précise, on retrouve cette symbolique d’un monde matérialiste décadent à
travers l’image de la chapelle abandonnée : « Le jour déclina
lorsqu’il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Le
toit s’était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à
l’emplacement de la sacristie. […] Il fit entrer toutes ses brebis par la porte
en ruine. […] Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au
travers du toit à moitié effondré »[204]
. L’Homme moderne semble donc se désintéresser aux valeurs de l’Eglise et ne
plus croire aux valeurs spirituelles. Encore une fois, c’est le matérialisme
stérile qui vide le monde de sa beauté en annonçant sa Chute imminente.
Le départ des personnages sera donc motivé par ce désir de fuir un monde
décadent. Mais ils découvriront rapidement que l’objectif de leur exil est
différent, que le départ n’a pas seulement était motivé par ce désir de fuite,
que derrière ce projet initial se cache un autre projet, plus profond mais
moins évident. En un mot, que le but liminaire du départ n’était qu’une excuse.
Le trésor recherché par les personnages de Coelho et Le Clézio n’est donc celui
qu’ont croit. Le butin n’est pas seulement matériel. Cette ambivalence du
trésor est traduite par la présence du masque que découvre le personnage principal
de L’Alchimiste dans le coffre au
terme de son voyage. Mais là est le problème. Les personnages ne
découvriront le véritable trésor qu’a la fin de leur recherche, après avoir
choisi l’exil et subi le déracinement.
IV. Exil et déracinement : une « Descente
aux Enfers »
A.
La solitude
1. La rupture initiale : un exil
volontaire
C’est après avoir décidé de partir que les personnages se retrouvent
plongés dans la solitude. Conscients de cela, ils hésiteront d’abord à quitter
le lieu des origines. Dans L’Alchimiste
en premier lieu. « « Me voici entre mes brebis et le trésor »,
pensait-il. Il devait se décider, choisir entre quelque chose à quoi il
s’était habitué et quelque chose qu’il aimerait bien avoir ». Puis la
résolution de partir sera ferme. Santiago sera comme attiré par l’aventure,
comme appelé par le désert : « le levant s’était mis à souffler plus fort, et
il le sentit sur son visage. Il amenait les Maures, sans doute, mais il
apportait aussi l’odeur du désert et des femmes voilées. Il apportait la sueur
et les songes des hommes qui étaient un jour partis en quête de l’Inconnu, en
quête de l’or, d’aventures… et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la
liberté du vent, et comprit qu’il pouvait être comme lui. Rien ne l’en
empêchait, sinon lui-même » [205].
En ce qui concerne Le Clézio, il semble être venu à Rodrigues de manière
spontanée et volontaire. Jamais il n’a hésité à faire ce voyage. Lui aussi a
été appelé par l’aventure : « aurais-je fait ce long voyage jusqu’à cette
vallée aride devant la mer, ce lieu sans passé ni avenir, si je n’y avais pas
été attiré comme malgré moi par les jalons laissés par mon
grand-père ? » [206].
Si le grand-père s’en va, c’est aussi pour ne plus être dans le besoin :
« pour mon grand-père accablé de dettes, menacé d’être déchu de sa charge
de juge (car un magistrat ne saurait être endetté), spolié par sa propre
famille et chassé de la maison où il était né, avec sa femme et ses enfants,
sachant alors que l’horizon étroit de Maurice s’était fermé sur lui, la seule
aventure c’était donc partir, aller en mer, aller vers l’horizon, chercher le
lieu de son rêve »[207].
Et dans le prénom « Alexis », on retrouve en anagramme le verbe
« exiler » conjugué au passé-simple à la deuxième personne du
singulier !
Il en va de même pour le personnage de Boudjedra. C’est l’attirance pour
le désert qui le fait devenir chauffeur de bus : « j’avais
l’impression d’avoir terminé ma vie, le jour où j’ai acheté ce vieux car à
Genève. J’avais en fait décidé de m’enterrer dans le Sahara. Tant qu’à faire !
Il valait mieux mourir dans ce désert qui m’a toujours fasciné parce que
méchant, dur et invivable plutôt que dans une de ces villes atrophiées »[208].
L’exil est donc pour nos personnages une entreprise volontaire, qui ne
leur a pas été imposé mais qu’ils ont choisi d’effectuer de leur plein gré.
Shmuel Trigano explique que l’exil est effectivement un choix : « il
nous faut apprendre à voir l’exil comme un choix libre, un projet créatif que
l’homme fait dans la condition déracinée ou […] dans la condition existentielle
qui est le lot de tout homme : le choix de vivre cette condition sur le
mode de l’exil et non du déracinement ou de l’errance. L’exil est en effet un
choix, une attitude envers l’épreuve de séparation inhérente à toute existence »[209].
Nos auteurs sont d’ailleurs de grands voyageurs. Ils ne connaissent pas la peur
du départ. Boudjedra a vécu en France et en Algérie, Le Clézio au Nouveau
Mexique, au Panama, en France, et Paulo Coelho ne cesse de parcourir la planète
pour faire la promotion de ses récits. Ainsi, nos personnages se retrouveront
seuls après avoir quitté leur patrie d’origine (dans « exil », il y a
la particule latine « ex »-, qui signifie « hors de ») pour
se réfugier dans des lieux désertés par l’Homme.
2. Des lieux désertiques
« Un homme de lumière.
Un homme sans ombre ?
Celui qui a marché dans le désert
l’a compris :
C’est l’enfer ! »
Jean-Yves Leloup[210]
Les lieux de l’exil sont dans nos romans désertés par l’homme. Celui qui
s’y rend se retrouve seul avec lui-même. L’île Rodrigues est effectivement
sauvage. Elle est perdue dans l’océan indien et elle se trouve à 600 kms de
l’île Maurice. Elle est également éloignée des grandes voies maritimes et le
tourisme n’y est que très peu développé. Le Clézio rend bien compte de cela
dans son Journal. Rodrigues est une île qui repousse toute trace humaine,
« un monde vide d’hommes, où règnent les rochers, le ciel et la mer »[211].
Rodrigues est une terre « qui expulse les hommes »[212] ;
elle est « un paysage du refus, paysage hautain et impénétrable »[213].
Privé de toute trace humaine, Rodrigues est également dénué de toute
végétation. Le Clézio décrit cette austérité dans son journal, comparant
régulièrement ce lieu de l’exil soit à
la « lune »[214],
soit à un désert à part entière, un
« rocher désert, usé, brûlé » où « la pauvreté, la faim, la soif
font la vie difficile »[215].
Le Clézio a d’ailleurs écrit un roman ayant pour titre Désert. Il en
arrive même à affirmer que Rodrigues ressemble « à une vue de la planète
Mars »[216]. Et cette
dernière planète est souvent considérée dans l’imaginaire collectif comme
maléfique, du fait de sa couleur rouge.
Une même description est faite du désert dans Timimoun. Boudjedra ne cesse de répéter que le Sahara est une terre
qui repousse l’homme : « le Sahara est méchant. Il est dur. Il est
insupportable »[217] ;
« impression que le désert est hargneux, méchant, dur à vivre,
granuleux »[218].
Comme à Rodrigues, la végétation est inexistante dans le Sahara. Tout est
minéralisé, sec, « composé d’amoncellements désordonnés, de dunes interminables,
de montagnes schisteuses et d’éboulis en tout genre qui saturent l’espace, le
bouleversent et le rendent essentiel et concret »[219].
Comme Le Clézio, Boudjedra évoque en outre l’aspect « lunaire » du
Sahara[220].
Dans L’Alchimiste,
la description que le romancier brésilien fait du Sahara est équivalente. Le
désert est difficile à vivre, il est
bel et bien un lieu qui repousse les hommes : « dans le désert, il
n’y avait rien d’autre que le vent éternel, le silence, les sabots des
bêtes »[221]. Si un
homme va dans le désert, il doit se plier aux exigences de ce dernier : «
si la caravane arrivait devant un bloc de pierre, elle le contournait : si
c’était un amoncellement rocheux, elle décrivait un large détour. Quand le
sable était trop fin pour les sabots de chameaux, on cherchait un passage où le
sable était plus résistant »[222]. Les lieux désertiques sont par conséquent
sources de souffrance. Ceux qui les parcourent vivent un véritable enfer.
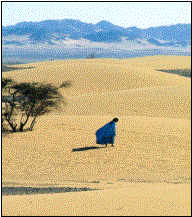 Ce
vide extérieur provoquera dès lors chez le personnage un vide intérieur. Le
désert ne sera plus hors du personnage mais en lui. L’homme sera vidé de ce qui
faisait de lui un individu à part entière. C’est ce qu’explique Marie-Madeleine
Davy : « au désert, l’homme est tout d’abord invité à subir une cure de
désintoxication, comme on le ferait dans certaines stations thermales pour le
corps. Il va désencombrer sa mémoire, son mental et son cœur et se débarrasser
ainsi de tout savoir conceptuel. Telle est au départ sa principale
ascèse […] C’est ensuite qu’il pourra s’adonner à l’écoute de la parole
intérieure et s’entraîner afin de s’approcher et découvrir son fond secret»[223].
Le personnage principal de Timimoun fait effectivement état de cette
vacuité intérieure que provoque le désert : « toujours, aussi, ce
sentiment quand je roule sur le sable que je perds tous mes sens, toute la
signification du monde, tous les contours de mon propre corps »[224].
On retrouve la même image dans le conte de Paulo Coelho : « ils
poursuivirent leur marche dans le désert. Au fur et à mesure que les jours
passaient, le cœur du jeune homme devenait de plus en plus silencieux : il
ne se souciait plus des choses du passé ou de l’avenir, et se contentait de
contempler lui aussi le désert » [225].
En ce qui concerne Le Clézio, il écrit de son grand-père Alexis qu’il avait été
« jeté hors de lui-même »[226]
en allant chercher le trésor à Rodrigues. L’auteur lui-même affirme s’être vidé
en se rendant sur l’île : « je crois que j’ai oublié un instant qui
j’étais, de quel temps, de quel monde »[227].
Venir à Rodrigues, « c’était se mesurer à l’inconnu, au vide, et dans les
dangers et les jours d’exposition et de souffrance, de découvrir
soi-même : se révéler, se mettre à nu »[228].
Le désert, comme la mer, est un donc
lieu où l’on se perd pour se retrouver : « la mer, le seul
lieu du monde où l’on puisse être loin, entouré de ses propres rêves, à la fois
perdu et proche de soi-même »[229]
écrit Le Clézio. Ainsi, tout se passe comme si l’exil dans le désert privait le
personnage de sa vieille identité. Une fois dépouillés de toutes leurs racines,
les personnages pourront progressivement combler ce vide et découvrir leur
personnalité véritable. Nous avons donc affaire au « regressus ad
uterum » des psychanalystes : le personnage revient dans le
désert pour retourner vers la mère et accéder ainsi à une nouvelle naissance.
Mais pour trouver cette dernière, ils devront subir des épreuves difficiles,
qui leur apporteront chaque fois un enseignement sur eux-même. La perte de
repère que provoque l’exil dans le désert est ainsi une des étapes de la quête
de soi.
Ce
vide extérieur provoquera dès lors chez le personnage un vide intérieur. Le
désert ne sera plus hors du personnage mais en lui. L’homme sera vidé de ce qui
faisait de lui un individu à part entière. C’est ce qu’explique Marie-Madeleine
Davy : « au désert, l’homme est tout d’abord invité à subir une cure de
désintoxication, comme on le ferait dans certaines stations thermales pour le
corps. Il va désencombrer sa mémoire, son mental et son cœur et se débarrasser
ainsi de tout savoir conceptuel. Telle est au départ sa principale
ascèse […] C’est ensuite qu’il pourra s’adonner à l’écoute de la parole
intérieure et s’entraîner afin de s’approcher et découvrir son fond secret»[223].
Le personnage principal de Timimoun fait effectivement état de cette
vacuité intérieure que provoque le désert : « toujours, aussi, ce
sentiment quand je roule sur le sable que je perds tous mes sens, toute la
signification du monde, tous les contours de mon propre corps »[224].
On retrouve la même image dans le conte de Paulo Coelho : « ils
poursuivirent leur marche dans le désert. Au fur et à mesure que les jours
passaient, le cœur du jeune homme devenait de plus en plus silencieux : il
ne se souciait plus des choses du passé ou de l’avenir, et se contentait de
contempler lui aussi le désert » [225].
En ce qui concerne Le Clézio, il écrit de son grand-père Alexis qu’il avait été
« jeté hors de lui-même »[226]
en allant chercher le trésor à Rodrigues. L’auteur lui-même affirme s’être vidé
en se rendant sur l’île : « je crois que j’ai oublié un instant qui
j’étais, de quel temps, de quel monde »[227].
Venir à Rodrigues, « c’était se mesurer à l’inconnu, au vide, et dans les
dangers et les jours d’exposition et de souffrance, de découvrir
soi-même : se révéler, se mettre à nu »[228].
Le désert, comme la mer, est un donc
lieu où l’on se perd pour se retrouver : « la mer, le seul
lieu du monde où l’on puisse être loin, entouré de ses propres rêves, à la fois
perdu et proche de soi-même »[229]
écrit Le Clézio. Ainsi, tout se passe comme si l’exil dans le désert privait le
personnage de sa vieille identité. Une fois dépouillés de toutes leurs racines,
les personnages pourront progressivement combler ce vide et découvrir leur
personnalité véritable. Nous avons donc affaire au « regressus ad
uterum » des psychanalystes : le personnage revient dans le
désert pour retourner vers la mère et accéder ainsi à une nouvelle naissance.
Mais pour trouver cette dernière, ils devront subir des épreuves difficiles,
qui leur apporteront chaque fois un enseignement sur eux-même. La perte de
repère que provoque l’exil dans le désert est ainsi une des étapes de la quête
de soi.
3. La perte de repères
Dans Le Temps de l’exil,
Shmuel Trigano montre qu’une personne en situation d’exil souffre du fait de
son éloignement du lieu des origines. Elle est contrainte à se séparer de ses
attaches familiales ou amicales. En laissant derrière lui ses racines, l’exilé
se retrouve donc seul et cette rupture est toujours difficile à vivre :
« celui qui devient un exilé perd tout, d’un coup, part en laissant tout
derrière lui, l’héritage tiré des générations qui l’ont précédé et sa propre
consistance existentielle qui fait corps avec le milieu où elle s’est
développée. Quelle conscience pourrait assumer une telle charge ? A cet
instant, le moi défaille et ploie sous le poids de la totalité, d’autant plus
que ce « tout » est mis en balance avec le rien, le plus souvent
quelques vestiges d’un bonheur passé rassemblés dans un bagage. L’exilé d’un
côté, la totalité de l’autre côté… Le moi est projeté dans une sorte
d’apesanteur où il flotte sans point de repère. Toute une vie ne suffira pas
pour méditer sur ce « tout » et ce « rien » dont l’épreuve
l’aura bouleversé. L’exil est avant tout une expérience de la perte, de la
disparition, de l’absence. Qu’est ce qui se dérobe et que l’on perd ? Tout
ce qui portait le moi se retire et l’isole dans la solitude »[230].
Malgré leur exil volontaire, les personnages, suite à leur départ,
souffriront de l’absence de leur entourage. Dans nos trois récits, les
protagonistes se retrouveront effectivement privés de leurs attaches familiales
ou amicales après être partis. Cette perte sera inexorablement source de
souffrance. Le guide touristique de Timimoun
a par exemple du mal à oublier son frère aîné : « depuis des années,
le premier nom qui me vient à l’esprit, à chaque réveil, c’est celui de mon
frère aîné, décédé bêtement à l’âge de vingt ans ; avec l’image de son
corps chétif, sa tête clownesque, sa petite taille d’adolescent qui a, déjà,
assisté à la naissance du monde et à sa fin »[231].
Le narrateur souffre donc de l’absence de sa famille autour de lui, et cela
l’empêche de prendre ses marques de manière définitive. Le désert est
effectivement « le lieu où tous les repères s’effacent à une vitesse
prodigieuse »[232].
Mais le narrateur savait que le désert était le lieu de la souffrance.
Mieux : il est venu dans le Sahara pour souffrir, pour exorciser de
manière quasi-masochiste son traumatisme originel : « c’est pour cela
que j’y viens. Pour la souffrance. Seulement pour la souffrance »[233].
Le narrateur avoue même vouloir mourir dans le désert : « le désert
était mon mode de suicide »[234]
avoue-t-il.
Dans Voyage à Rodrigues, Le
Clézio se rend compte que son grand-père a dû beaucoup souffrir de l’absence de
sa famille lors de ses années d’exil : « la seule déchirure qu’il a
dû ressentir, c’est chaque fois qu’il a laissé la femme qu’il aimait, et ses
enfants, pour partir vers ce désert »[235].
L’auteur insiste aussi sur le supplice qu’a été pour la famille de son aïeul la
séparation de la maison familiale : « à cause de ce bannissement, la
famille de mon grand-père perd ses attaches, elle devient errante, sans
terre […] L’exil loin de la maison natale est, pour tous ceux de cette
fraction, le commencement de l’instabilité, du précaire, parfois même de la
misère ». Le Clézio lui-même affirme souffrir de cette absence subite de
racines familiales : « la perte d’Euréka me concerne aussi, puisque
c’est à cela que je dois d’être né au loin, d’avoir grandi séparé de mes
racines, dans ce sentiment d’étrangeté, d’inappartenance »[236].
Quand le berger andalou arrive en terre marocaine, il se fait déposséder
de ses biens et regrette alors d’avoir entrepris son voyage :
« il se trouvait dans un pays différent, étranger sur une terre étrangère,
où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il
n’était plus berger, et n’avait plus rien à lui, pas même l’argent nécessaire
pour revenir sur ses pas et tout recommencer »[237].
Le personnage de Paulo Coelho perd donc lui aussi ses repères en arrivant sur
le territoire africain. La différence de langue provoque également chez le
personnage une déstabilisation certaine : « dans la hâte du grand
départ, il avait oublié un détail, un seul petit détail, qui pouvait bien le
tenir éloigné de son trésor pendant un long temps : dans ce pays, tout le
monde parlait arabe »[238].
Santiago a d’ailleurs du mal à comprendre certains mots :
« « Mektoub, dit finalement le Marchand. – Qu’est ce que c’est que
ça ? – Il faudrait que tu sois né arabe pour comprendre. Mais la
traduction doit être quelque chose comme « c’est écrit » »[239].
Parallèlement, les ouvrages alchimiques semblent difficiles d’accès. Peu de
personnes arrivent à en percer le sens : « c’étaient des livres bien
étranges. Ils parlaient de mercure, de sel, de dragons et de rois, mais il n’y
comprenait rien du tout »[240] ;
« quand il voulait apprendre à son tour de quelle façon parachever le
Grand Œuvre, il se trouvait complètement désorienté. Il n’y avait là que
dessins, instructions codées, textes obscurs »[241].
Dans Voyage à Rodrigues, la
différence de langue pose aussi des problèmes de communication au
narrateur : « est-ce qu’il y a une source par ici ? Je rectifie
en créole : une fontaine ? Plus haut, oui »[242].
Le Clézio a d’ailleurs signé en 1990 un recueil de devinettes mauriciennes, Sirandanes,
en version bilingue, créole et française. L’auteur a rédigé cet ouvrage en deux
langues pour éviter toute incompréhension : « Mo nwar dan no
boner, mo ruz dan no maler ? – Crevet. Je suis noire dans mon bonheur,
rouge dans mon malheur ? – La crevette »[243].
Dans notre récit, la difficulté qu’a le narrateur pour comprendre le monde
extérieur est accentuée par l’extrême obscurité des plans du grand-père.
L’auteur a beaucoup de mal à comprendre le langage de son aïeul :
« il y a un secret fébrile dans ces traces, et je ne puis le comprendre,
car cela vient d’une époque pour moi inconnue, dont je ne peux percevoir que
des bribes, cela parle d’une vie d’homme pour moi aussi étrangère que si elle
avait été vécue il y a mille ans »[244].
Dans le roman de Rachid Boudjedra, il n’y a pas a priori de
problème de langue. Cependant, le narrateur n’arrive pas à instaurer une
véritable communication avec la femme qui le fascine, Sarah. Entre ces deux
personnes, aucun échange verbal : « Sarah, c’est peut-être son nom,
était donc peu diserte. Peu bavarde. Peu communicative. Comme absente. Passive.
Impassible. Indolente » ; « elle tenait à mettre de grandes
distances entre elle et les autres »[245].
La mère du narrateur est –comme Sarah- constamment cloîtrée dans un mutisme
oppressant. Si elle ne parle pas, c’est incontestablement parce que la
société interdit aux femmes toute sorte de manifestation inutile: « elle
était donc toujours muette, hors de portée, comme recouverte d’une sorte de
chagrin épais »[246].
Les difficultés de communication sont donc pour nos trois personnages source de
souffrance. Ne pouvant exprimer ouvertement ce qu’ils pensent, ils doivent
préalablement à tout effort communicatif se réfugier dans un silence
contraignant. Ce sera l’occasion pour eux de s’ouvrir au monde extérieur puis
intérieur et d’affronter l’inconnu par le regard.
B.
L’inconnu
1. L’exotisme
Victor Segalen définit l’exotisme en ces termes : « et en
arriver très vite à définir, à poser la sensation d’Exotisme : qui n’est
autre que la notion du différent ; la perception du Divers ; la
connaissance que quelque chose n’est pas soi-même ; et le pouvoir
d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir autre »[247].
Le dépaysement né par conséquent de la différence. Dans nos trois oeuvres, les
protagonistes sont donc fascinés par l’univers inconnu dans lequel ils évoluent
après leur départ parce que cet univers est perçu comme différent du leur. Or,
c’est parce que nos personnages sont en terre étrangère qu’ils sont confrontés
à un univers perçu comme exotique. Tout se passe alors comme si l’exotisme était
indissociable de l’idée de déplacement spatial : « l’exotisme,
souligne Jean-Marc Moura, est en effet lié à ce thème fondamental de la
littérature mondiale, le voyage. Sans départ, au moins imaginaire, pas de
découverte ni de rêve concernant des horizons lointains »[248].
Les personnages seront donc dépaysés par l’Ailleurs où paradoxalement ils se
trouvent. Car « Etre Ailleurs » n’est pas impossible a la fin du 20ème
siècle. Le développement grandissant des moyens de communication réduit en
effet les distances à néant, et permet à tout un chacun d’aller où bon lui
semble. C’est ce que note Jean-Marc Moura : « cette
« disparition de la géographie » affecte les formes de l’inspiration
exotique. Aucune zone de notre planète ne peut plus prétendre être véritablement
exotique. Ne subsiste alors qu’un exotisme stéréotypé (cocotiers, sable
chaud…), celui de la consommation touristique et de la paralittérature. Une
liaison systématique s’établit entre exotisme et tourisme »[249].
Un des objectifs des auteurs sera donc de décrire ces lieux de l’exil, parfois
grossièrement, car tout écrivain est conscient de l’attrait qu’exerce
l’exotisme sur les sociétés occidentales : « Aujourd’hui encore, on
sent l’attrait des dépliants touristiques qui créent ce sentiment d’évasion, d’exotisme,
d’enchantement. Nous nous surprenons à rêver de liberté devant les affiches
publicitaires du bleu des océans infinis, de ces plages dorées par le soleil ou
de ces vertes montagnes dont le sommet enveloppé de nuages, donne l’impression
de forcer les portes du ciel. Les îles lointaines, les déplacements
interplanétaires, les voyages qui mènent au centre de la Terre, à vingt mille
lieues sous les mers, ou dans le merveilleux pays d’Alice continuent à exercer
sur nous la magie du dépaysement »[250].
James Burty David souligne ici que tous les moyens sont bons pour offrir du
rêve. Même les livres. Dans nos oeuvres, le lecteur verra donc le monde à
travers les yeux des personnages dont il suit l’histoire, le but de nos auteurs
étant de dépayser l’un et l’autre avec
plus ou moins d’ironie.
Le propre du conte est de nous émerveiller. Dans L’Alchimiste, Paulo Coelho trouve néanmoins une certaine
complaisance à décrire les mœurs et coutumes des pays visités par le jeune
berger, employant pour cela des stéréotypes faciles. Les modes de vie étrangers
surprennent toujours celui qui n’a pas parcouru le monde :
« « quel étrange pays que l’Afrique ! » pensa le jeune
homme. Il était assis dans une sorte de café, identique à d’autres cafés qu’il
avait pu voir en allant parcourant les ruelles étroites de la ville. Des hommes
fumaient une pipe géante, qu’ils se passaient de bouche en bouche. En l’espace
de quelques heures, il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par
la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet de
hautes tours et se mettaient à chanter, tandis que tout le monde à l’entour
s’agenouillait et se frappait la tête contre le sol. « Pratiques
d’infidèles », se dit-il »[251].
On voit là l’ironie de l’auteur vis à vis de la naïveté candide de Santiago.
Paulo Coelho semble aussi se moquer de son lecteur en définissant des mots
relatifs aux mœurs arabes, autrement dit en mettant en doute la culture
générale du lecteur : « il s’assit sur le trottoir et l’invita à
fumer avec lui le narguilé, cette curieuse pipe que fument les Arabes »[252].
Les noms de lieux sont eux aussi source d’exotisme : Fayoum[253],
Ceuta, Tanger[254], etc. Le
personnage principal se nomme Santiago : clin d’œil de l’auteur à Santiago
de Compostelle. L’auteur parle aussi des « Mille et Une Nuits »[255],
bref, de tout ce qui fait l’intérêt de la culture arabe auprès d’un jeune homme
n’ayant auparavant jamais quitté l’Andalousie.
Chez Rachid Boudjedra, il y a également de nombreux éléments propres à
une littérature exotique. D’emblée, le titre du roman fait « aveu
d’exotisme »[256]
car il s’agit du nom d’une ville algérienne située dans la région du Gourara,
en plein Sahara : Timimoun. L’auteur évoque également d’autres lieux comme
El Goléa, Constantine[257]
ou Alger[258]. Il relate
également le déroulement de certaines coutumes locales, comme les fêtes
orgiaques organisées dans des fumeries secrètes : « j’en connais une
où on chante pendant toute la nuit le même chant, le Ahlellil, à la fois
érotique, païen, mystique et religieux, du crépuscule à l’aube. Le même chant
que l’on répète à l’occasion des fêtes religieuses, des mariages, des
circoncisions et des offrandes à la centaine de marabouts, de zaouïas et de
confréries ». L’auteur emploie donc des noms se référant aux traditions
régionales pour dépayser le lecteur. Mais comme Paulo Coelho, il s’amuse à
détruire cet exotisme en définissant des mots que le lecteur non averti ne peut
pas connaître. Là aussi il y a de la part de Boudjedra une ironie certaine qui
tend à démystifier « un pittoresque de pacotille prévisible »[259] :
« le chott est une sorte d’interminable papier glacé qui fut jadis un
grand lac » [260]. Boudjedra
rapproche même au début du roman deux termes culturellement opposés : la
« climatisation », communément appelée la « clim. », qui est
un luxe occidental, et les « klims », qui sont l’apanage des sociétés
orientales. En outre, il dénonce l’attitude ridicule des touristes lors des
voyages organisés : « j’ai peint de gigantesques palmiers
entrecroisés sur les deux côtés [d’Extravagance]. Rose bonbon et vert pistache.
Je n’aime pas ce genre de peinture naïve et kitsch mais Kamel Raïs et Henri
Cohen avaient été formels : la clientèle touristique aime ce genre de
guimauve »[261].
Le parcours que le chauffeur fait dans le Sahara est en outre sans surprise
parce que l’itinéraire est toujours identique. Mais peu importe : le
touriste apprécie particulièrement ces voyages pseudo-exotiques. Dans Les
1001 années de la nostalgie, un lexème convient particulièrement bien pour
dénoncer la platitude des voyages organisés. Boudjedra qualifie ce genre
d’excursion de « découverte-du-mode-en-dix-huit-jours-tout-compris »[262] !
Le titre du Journal de Le Clézio est lui aussi un aveu d’exotisme car
l’auteur parle d’emblée d’un lieu géographique peu connu : Rodrigues. Dans
son récit, d’autres noms enrichissent cet exotisme littéraire : Maurice,
Inde[263]
etc. L’auteur fait également mention dès l’incipit d’un vocabulaire exotique,
relatif à la faune et à la flore rodriguaise : Comble du Commandeur,
rivière Roseaux, badamier, aloès, cactus, palmiers[264],
etc. Les références aux récits de navigateurs sont aussi source de
dépaysement : « Dumont d’Urville, Bougainville, Jacob de Buccquoy,
D’Après de Mannevillette, l’Abbé Rochon, Ohier de Grandpré, Mahé de la
Bourdonnais, Lislet Geoffroy »[265].
Le Clézio, aux yeux des autochtones, fait d’ailleurs figure de touriste
ambitieux (même si Rodrigues n’est pas à proprement parler une île
touristique) : « peut-être qu’avec mon sac à dos, mon appareil photo et
mes cartes à la main elle m’a pris pour un prospecteur »[266].
Chez Le Clézio aussi, il y a une dénonciation du tourisme de masse, non
respectueux de la nature environnante. Les personnages de nos romans se
trouvent donc dans des terres qui font rêver celui qui les contemple. La
contemplation d’un paysage inconnu permet à l’individu de se retrouver seul
face à lui-même.
2. La contemplation
La contemplation est une activité individuelle qui se fait toujours en
silence. C’est en se taisant que l’individu se retrouve face à lui-même, comme
le souligne Bachelard : « l’attitude contemplative est une si grande
valeur humaine qu’elle donne une immensité à une impression qu’un psychologue
aurait toute raison de déclarer éphémère et particulière »[267].
Dans nos trois romans, les personnages sont en effet régulièrement plongés dans
un silence expectatif. Dans L’Alchimiste
en premier lieu. James Burty David
souligne l’importance du silence dans le roman de Coelho : « Le
désert, ce lieu de nudité, du vide et du silence est également celui de la
découverte de soi et de la re-naissance. L’épreuve du désert, constate-t-on, a
une dimension initiatique par excellence. Elle bouscule et empoigne l’homme, le
contraignant, face à l’autorité du silence, à écouter la voix intérieure »[268].
Dans le roman, les personnages sont en effet souvent plongés dans le
silence : le jeune berger sait qu’il existe « un langage au-delà des
mots »[269] ;
« il se mit alors à observer en silence la marche des animaux et des
hommes à travers le désert » ; « le désert est si vaste, les
horizons si lointains, qu’on se sent tout petit et qu’on garde le
silence »[270].
Le Sahara lui-même est un lieu silencieux nous dit Paulo Coelho[271].
Dans Timimoun, le narrateur et
Sarah s’affronte dans un face à face muet et la mère du guide touristique est
emprisonnée dans son mutisme. Les passagers du bus gardent aussi le silence
dans le désert : « l’un des passagers du bus laisse échapper une
quinte de toux. Il est aussitôt imité par la plupart des autres voyageurs
libérés de tout ce silence pesant »[272].
Dans L’Extase matérielle, Le
Clézio dit qu’ « être vivant, c’est d’abord savoir regarder »[273].
C’est la raison pour laquelle les personnages accordent une importance moindre
à la parole dans ses œuvres. L’île aussi reste et restera silencieuse :
« puis revient le silence, cette force qui appuie sur la vallée, qui met
une menace dans chaque forme, dans chaque ombre. Le silence qui exile »[274].
Dans l’univers Le Clézien, le silence exile l’homme dans l’univers primitif de
sa nature profonde.
Notons que chez Boudjedra et Le Clézio les personnages fument :
fumer est un signe de disponibilité, de non-activité (Jean Onimus considère Le
Clézio comme un non-actif), un temps pendant lequel l’homme peut s’ouvrir au
monde extérieur. Dans Extravagance, « quelques passagers fument silencieusement »[275].
Si la contemplation passe par le silence, elle passe aussi par le regard. C’est
le cas dans Voyage à Rodrigues :
Le Clézio dit d’Alexis qu’il est un « guetteur éternel »[276]
et le champ sémantique du regard apparaît de manière constante dans le récit.
C’est aussi le cas dans Timimoun :
« je vis l’indication : El Goléa –Timimoun passer comme un flash
back »[277] ;
« tout mourait en elle, sauf ses grands yeux ouverts, braqués
impitoyablement sur les autres » [278]
. Dans L’Alchimiste, le regard tient
aussi une place majeure. C’est en regardant autour de soi que l’on apprend des
choses : « chaque fois qu’il regardait la mer ou le feu, il pouvait
passer des heures sans dire un mot, plongé au cœur de l’immensité et de la
puissance des éléments »[279].
Une fois cette disposition à la contemplation effectuée, le personnage
accordera à tout ce qui l’entoure une attention toute particulière. Ainsi, le
désert n’apparaîtra plus comme une terre vide et vierge. Elle sera un lieu de
vie. Par exemple, Boudjedra personnifie le désert en affirmant que
« l’espace saharien avait une autonomie totale et une spécificité
intrinsèque »[280].
Quant à Le Clézio, il affirme que l’île veut lui parler : « pourtant
l’île me dit autre chose, elle me signifie autre chose que je ne peux encore saisir
tout à fait. Elle m’annonce quelque chose, comme un fait encore caché de ma
vie, comme un signe pour l’avenir, je ne sais. Quelque chose brûle ici, sous la
pierre, au fond de moi. Quelque chose parle, ici dans le vent qui glisse sur
les parois de basalte »[281] .
Dans L’Alchimiste le désert est aussi
un lieu de vie : « « je n’arrive pas à rencontrer la vie
dans le désert, dit le jeune homme. Je sais qu’elle existe mais je n’arrive pas
à la trouver. – La vie attire la vie » répondit l’Alchimiste »[282].
Les personnages découvriront même l’importance et la présence de
l’infiniment petit dans des lieux désertiques immenses. L’Alchimiste dit ainsi
à son apprenti : « il suffit de contempler un simple grain de sable,
et tu verras en lui toutes les merveilles de la Création »[283].
Dans L’Extase matérielle, Le Clézio
révèle à son lecteur son amour du minuscule : « je ne suis jamais
autant ému que par les choses microscopiques. C’est en elles que je disparais
le mieux. Ce sont elles qui me révèlent le plus exactement la vérité de la
nature solide. Cette fourmi
noire qui grimpe le long du mur, vers un but qu’elle ne voit même pas. Six
pattes […] »[284].
D’ailleurs, l’auteur dit de Rodrigues qu’elle est un « domaine pour les
fourmis, les scolopendres et les crabes de terre »[285].
Quant à l’auteur des 1001 années de la nostalgie, il fait une
description minutieuse des oiseaux qu’il a contemplés maladivement pendant son
adolescence : « je les voyais entrer dans les arbres du jardin avec
leurs petits yeux qui se découpaient nettement sur leurs têtes. Leurs becs
brillants étaient de couleur rose rayé d’un peu de jaune citron […] »[286]. Macrocosme
et microcosme finiront ainsi par se rejoindre.
L’infiniment grand sera source d’infiniment petit. Le vide désertique se
révèlera plein. Le « tout » apparaîtra dans le « rien ».
« Tout est une seule et unique chose »[287]
répète Paulo Coelho.
L’homme se sentira faire partie intégrante de la Création et deviendra
même transparent au monde en s’intégrant en lui, dans un ultime acte de
communication totale, que Paulo Coelho nomme Amour[288].
C’est ce qui permet au jeune berger de parachever le Grand Œuvre et d’accéder à
la consécration suprême en se transformant en vent[289].
De même, Santiago et Fatima sont certes des noms de personnes, mais ils sont
aussi des noms de villes. L’humain rejoint l’artificiel naturel. Le symbolisme
du berger comporte aussi un sens de sagesse exaltée et expérimentale. Le berger
représente la veille ; sa fonction est un permanent exercice de
vigilance : il est éveillé et il voit.
Dans Timimoun, le narrateur se
fond progressivement dans le désert : « toujours, aussi, ce sentiment
quand je roule sur le sable que je perds tous mes sens, toute la signification
du monde, tous les contours de mon propre corps. Parfois j’éprouve une jubilation
extatique […] Goût dans ma bouche du sable […] C’est à ce moment-là que je suis
réellement subjugué par une extase presque transparente »[290].
L’onomastique permet aussi, et l’auteur le fait très bien, de rapprocher
linguistiquement les noms propres Sarah et Sahara.
Quant
au grand-père de Le Clézio c’est dans ce paysage « hostile à toute vie
humaine, qu’il recevait cette communication exceptionnelle »[291].
Sa quête était donc bel et bien celle de « l’harmonie du monde »[292]
selon son petit-fils. Dans L’Extase matérielle,
l’auteur parle de sa fusion avec le paysage quand il le contemple :
« les paysages sont vraiment beaux. Je ne m’en rassasierai jamais. Je les
regarde, comme ça, le matin, à midi, ou le soir, parfois même la nuit, et je
sens mon corps s’échapper, se confondre. Mon âme nage dans la joie, vaste,
immense, dans la joie étendue de la plaine jaune bordée de montagnes, arbres,
ruisseaux, lits de cailloux, arbustes effilochés, trous, ombres, nuages, air
dansant gonflé de chaleur. Plénitude ou vide total, je ne sais pas »[293].
Dans Voyages de l’autre côté, l’héroïne se transforme tour à tour en
vent, en flamme, voire même en fumée de cigarette : « la fumée entre
dans ses poumons. Elle l’exhale longuement, avec précaution. Alors, en même
temps que la fumée sort de ses lèvres, Naja Naja s’en va »[294].
Cette communion avec le monde permettra aux personnages principaux de se
retrouver face à eux-même et de
découvrir le sens véritable de leur existence. Mais ils auront du mal à
intégrer l’univers qui les entoure : celui-ci se présentera sous leurs
yeux comme merveilleux.
3. L’incursion du merveilleux
Parce qu’ils sont face à un univers inconnu qu’ils n’ont jamais vu auparavant, les personnages seront régulièrement emmenés à rencontrer des choses étonnantes au cours de leur périple. Mais ce qu’ils verront ne les surprendra pas pour autant car ils pensent que tous les voyages réservent des surprises. Effectivement, dans les œuvres de notre corpus, des choses étranges apparaissent sans que l’on soit pour autant étonné par leur caractère inconcevable. Le lecteur se trouve donc dans un cadre merveilleux, ce dernier représentant un univers à l’intérieur duquel le surnaturel se voit naturalisé.
C’est dans L’Alchimiste que le merveilleux apparaît le plus clairement, puisque nous avons affaire à un conte. Lilas Voglimacci souligne cet aspect du récit de Paulo Coelho : « quelque chose va être révélé qui nous touche au plus intime : l’envie de croire à l’incroyable. Le besoin de frôler ce que la raison défend d’approcher »[295]. Le désert est en effet le lieu où surgit le merveilleux, où le rêve côtoie inlassablement la réalité. Ainsi, l’apparition brutale de l’alchimiste en plein désert nous plonge d’emblée dans un univers quasi-onirique : « soudain, il entendit comme un grondement et fut jeté brusquement à terre, sous le choc d’une rafale de vent d’une violence inouïe. L’endroit fut envahi par un nuage de poussière qui arriva presque à masquer le clair de lune. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque se cabra, avec un hennissement effrayant […] Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé de noir, avec un faucon sur l’épaule gauche […] Il semblait être le messager du désert, mais il avait davantage de présence que quiconque au monde»[296]. Parallèlement à l’apparition récurrente de personnages extraordinaires, le merveilleux est présent dans le conte de Coelho à travers l’utilisation fréquente que les personnages font de la magie. Dès lors, le lecteur n’est pas surpris de voir Santiago se transformer en vent ou lire l’avenir dans le vol des éperviers. Les références nombreuses à l’alchimie donnent aussi au texte un aspect magique. Tout le monde rêve par exemple de pouvoir transformer le plomb en or !
Dans le Journal de Le Clézio, beaucoup d’éléments merveilleux apparaissent, même si ce n’est pas généralement de manière explicite : « Ne cherchez pas le magique dans l’irréel, le supra-sensible : il est là, sous vos yeux. Il suffit de regarder »[297], écrit Jean Onimus à propos de Le Clézio. Effectivement émerveillé par l’extraordinaire beauté des paysages qui l’entourent, le narrateur de Voyages à Rodrigues ne peut pas s’empêcher par exemple de les qualifier de « magiques »[298]. Cette communion avec le naturel est telle que Le Clézio en arrive même à affirmer que l’île lui parle : « pourtant l’île me dit autre chose »[299] écrit-il. L’évocation d’éléments alchimiques renforcent le caractère magique de la quête du grand-père. L’auteur fait notamment référence aux Clavicules de Salomon dont se servait son aïeul pour trouver la clé du trésor : « les Clavicules ajoutent une magie à cette chimère. Salomon – Suleïman -, fils de David et roi d’Israël, est aussi le chef des djinns, celui qui a pouvoir sur les êtres surnaturels et qui connaît les secrets de l’univers »[300]. Le langage obscur employé dans ce texte de Salomon a aussi un aspect mystérieux dans la mesure où nombre de personnes, comme le grand-père de l’auteur, se sont acharnés à le décrypter pour essayer d’en saisir la signification profonde.
Rachid Boudjedra introduit également dans son roman Timimoun des éléments merveilleux. Ces derniers sont dus au fait que le personnage ne cesse de contempler les étendues désertiques et apercevoir des mirages. Il a du mal à distinguer le rêve de la réalité. Par exemple, la nuit est la période de la journée où la réalité saharienne bascule : « la nuit est froide. Elle s’installe carrément maintenant et finit par tout fausser »[301] ; « le désert, la nuit, est une véritable imposture. On croit rêver. On perd le sens du réel. On y voit des chamelles beiges cicatrisées de rose en train de nomadiser. Des palmiers verts pousser sur les dunes safran. Mais tout cela est faux »[302] ; « je ne sais jamais quand je quitte réellement le sommeil, ni à quel moment je fais irruption dans la réalité »[303]. Cette vision déformée de la réalité est due au fait que le personnage regarde toujours le monde par l’intermédiaire d’un miroir. Le narrateur ne voit donc pas la réalité mais une image faussée de celle-ci : « je la regardai dans le rétroviseur. Elle soutint mon regard. Je vis ses yeux remplis de larmes »[304]. Qui plus est, le pare-brise d’Extravagance fait barrage entre le narrateur et le monde extérieur. Il ne permet pas de saisir parfaitement la réalité. Il fausse lui aussi l’image du monde. D’autant plus que la vitre du bus n’est pas transparente mais quasi-opaque du fait de la poussière déposée sur sa surface : « des giclées granuleuses se collent sur les vitres du car. Elles se transforment très vite en traces grenues, sous forme de lamelles. On aurait dit des balafres sinueuses mais subtiles sur les vitres extérieures du véhicule »[305]. En outre, quand il se regarde dans le miroir, le narrateur ne se voit pas tel qu’il est. Le miroir ne reflète pas sa véritable identité. L’image dans le rétroviseur est en effet celle du frère du narrateur : « je regarde mon visage dans le rétroviseur, il me paraît vieilli, hagard, poussiéreux, cireux, comme celui de mon frère aîné, le jour de son enterrement »[306]. La quête d’identité nécessitera donc un passage de l’autre côté du miroir. La présence du merveilleux dans les œuvres de notre corpus est donc due au fait que les personnages évoluent dans un monde désertique méconnu de l’homme, où la réalité et le rêve n’ont pas de limites distinctes. Cette difficulté à discerner les choses provoque un sentiment de frustration inévitable chez le personnage, doublé par une nostalgie du lieu des origines.
C. La nostalgie des origines
Shmuel Trigano note que l’exilé éprouve des difficultés pour oublier ses racines, qu’il ferait n’importe quoi pour retourner sur sa terre d’origine et revivre ce qu’il a vécu avant son départ. Mais pour cela, il faudrait qu’il fasse le trajet en sens inverse, et cela prendrait trop de temps. Un véhicule permet cependant de revivre ce qui a été : le langage. Il permet à l’exilé de livrer une pensée sur son ancienne identité : « le langage est le seul véhicule disponible pour évoquer un absent. En somme, c’est le moment où la présence réapparaît dans l’absence, qui est ici décrit. Le moment d’étrangeté réveille alors la puissance du langage ainsi libéré pour délivrer la réflexion du moi sur lui-même. L’étranger dans la demeure renvoie au moi son image en miroir, son image de même tout autant qu’il la décentre et la met en mouvement, alors qu’il était auparavant assigné à résidence […] A cet instant, l’exilé dépend, tout entier, de la puissance du langage, ainsi promu créateur d’un monde nouveau, d’une aventure et d’une vision encore inédites pour la conscience et qui ne peuvent se dire, de toute façon, qu’avec des mots »[307]. Cette réflexion que fait l’exilé sur son identité ne peut donc avoir lieu qu’en situation d’exil : c’est parce que le personnage est parti qu’il peut désormais considérer avec recul son identité d’avant le départ.
1. Les souvenirs
Après avoir affronté la solitude et l’inconnu dans une véritable
« Descente aux Enfers », nos personnages regretteront d’avoir quitté
le lieu des origines. Ils prendront conscience que leur départ était sans doute
une erreur. C’est le cas de Santiago qui, après s’être fait voler son argent
sur le port de Tanger, se maudit d’avoir quitté sa vie de berger :
« il songea que, lorsque ce même soleil s’était levé ce matin là, il se
trouvait, lui, sur un autre continent, il était berger, possédait soixante
moutons, et avait rendez-vous avec une jeune fille »[308].
Dans un autre passage, il se maudit d’avoir « rencontré ce vieux »[309]
roi à l’origine de son départ. Dans Voyage
à Rodrigues, Le Clézio ne cesse de remettre en question la légitimité de
cette quête du grand-père : « mais qui suis-je pour juger
cela ? »[310],
« pourquoi suis-je venu à Rodrigues ? »[311],
etc. Dans Timimoun, le personnage
principal éprouve également beaucoup de regrets. Notamment celui de n’avoir
jamais été attiré par les femmes : « c’est cette nuit-là que je
regrettai, pour la première fois, d’être passé à côté des femmes, de leur
tendresse, de leur corps, de leur sexe, de leur humidité »[312].
Mais ce que regrette le chauffeur de bus, c’est surtout, au début, d’avoir
rencontré Sarah : « quelle malchance que ça m’arrive à quarante ans.
Trop tard ou trop tôt. Sarah a dû comprendre ma situation. Pour elle je ne peux
être qu’un vieux con d’alcoolique tombé en sénilité d’une façon brutale »[313].
S’il n’avait pas fait ce voyage, le chauffeur de bus n’aurait pas souffert de
ce coup de foudre… Le regret du départ est donc source de souffrance pour nos
personnages.
Les souvenirs, parce qu’ils sont souvent empreints de nostalgie,
surenchérissent pareillement le malaise fondamental dont sont victimes les
exilés après leur départ. La promenade géographique est aussi une promenade
intérieure : « L’instant du départ récapitule ainsi ce qui est
désormais irrémédiablement mis au passé »[314]
écrit Shmuel Trigano. Nos personnages seront donc entièrement tourné vers le
passé. Ils ne se préoccuperont que de ce qui a été. Le souvenir fait ainsi
partie intégrante du récit de Boudjedra : si « tout écrivain
écrit le même roman fonctionnant à partir d’un fantasme central et racontant un
vécu personnel, un itinéraire individuel, une implantation irrémédiable et névrotique
de l’enfance » comme le déclare Boudjedra, « peu d’œuvres
l’illustrent de façon aussi systématique que la sienne »[315].
Il y a effectivement dans Timimoun,
une réminiscence des obsessions de l’auteur. Il n’arrive pas à oublier son
histoire individuelle, son vécu personnel, « le Sahara représentant une
sorte d’archive où s’entasseraient les souvenirs livrés aux ravages de l’oubli,
en attendant d’être redécouverts »[316].
Le narrateur se trouve dans « un contexte général difficile à décrypter
[…] dont l’explication était profondément enfouie dans [son] passé »[317].
Quand il regarde dans le rétroviseur du bus, le chauffeur regarde derrière lui,
dans les deux sens de terme. Corrélativement, les verbes du souvenir abondent
dans le récit : « je me souviens des étés de mon adolescence »[318] ;
« depuis aussi longtemps que je me souvienne j’ai toujours aimé la vodka[319] » ;
« je garde encore dans mon souvenir les traces de cette confusion
vocale » etc. Ces souvenirs se déclenchent souvent au contact de certaines
odeurs ou de certains sons, comme dans l’œuvre de Proust : « je n’ai
gardé de ces jours vagues qu’une mémoire olfactive et sonore »[320].
D’un point de vue intertextuel, on retrouve alors dans Timimoun les souvenirs obsédants de l’enfance qui ont marqué
les autres œuvres de l’auteur : l’absence du père, le silence de la mère, la
stratégie des cartes-postales, l’accident de Tramway, l’enterrement du frère
aîné (aimé ?), le mûrier, le dégoût pour le sang menstruel, etc.
Dans Voyage à Rodrigues, Le
Clézio essaie de replonger dans son passé familial, de s’imaginer ce qu’a pu
être la vie de son grand-père à Rodrigues : « j’imagine aussi
quelque naufragé ayant semé la-dessus ses légumes » [321] ;
« la seule déchirure qu’il a dû ressentir»[322],
« il a dû apprendre à les connaître »[323],
etc. Le souvenir imaginé du grand-père se déclenche comme chez Boudjedra au
contact de certains objets : « je marche sur ses traces, je vois ce
qu’il a vu. Il me semble par instants qu’il est là, près de moi, que je vais le
trouver assis à l’ombre d’un tamarinier, près de son ravin, ses plans à la
main, interrogeant le chaos des pierres hermétiques. C’est cette présence qui
me donne sans doute ce sentiment de déjà vu. Parfois, mon regard s’accroche à
un détail, le trou d’une grotte au loin, ou bien une roche étrange, une couleur
différente de la terre, près du lit de la rivière. Cela fait bouger quelque
chose d’imperceptible au fond de moi, à la limite de la mémoire »[324].
En parlant de la photo de son aïeul, l’auteur écrit : « c’est cette
image que je garde de lui, maintenant, ici, sur l’île qu’il a interrogée avec
tant de fièvre pendant un quart de siècle. C’est cette image qui est dans ma
mémoire, se substituant à tout autre souvenir, créant l’impression d’une
proximité inévitable »[325].
Si l’auteur parle de son grand-père, il parle aussi de son enfance
personnelle : « il a dû lire, comme moi, dès l’enfance »[326].
Le Clézio retrace donc ici un itinéraire familial, ayant pour point d’ancrage
la maison Euréka : « c’est cette maison à laquelle il faut que je
revienne maintenant, comme au lieu le plus important de ma famille, cette
maison dans laquelle ont vécu mon père, mes deux grands-pères (qui étaient
frère), mon arrière-grand-père (Sir Eugène) et mon arrière-arrière-grand-père
(Eugène premier) qui l’avait fondée autour de 1850 »[327].
Cette maison est un leitmotiv Le Clézien. On la retrouve évidemment dans
Le Chercheur d’or : « les
lieux magiques sont ceux où l’on est ému, blessé de souvenirs, exalté de
désirs. Telle la maison du Boucan avec sa varangue et son grand toit de bardeaux
bleus. Elle fonctionne, dans Le Chercheur d’or, comme un leitmotiv, avec
son aura de nostalgie, de féerie, dominée par les falaises noires de Mananave,
où se dirige chaque soir un couple de pailles-en-queue. Ses réapparitions
émeuvent comme les rappels de thème dans un opéra de Wagner »[328],
écrit Jean Onimus.
Même si le berger de L’Alchimiste
n’évoque jamais ses racines, il aime à se rappeler la vie bucolique qu’il
menait en Andalousie au milieu de ses moutons. La « puissance du souvenir
dans l’écriture » - pour reprendre Pierre Bergounioux[329]
– est à cet égard très forte dans le roman de Paulo Coelho : « un
berger peut aimer les voyages, mais jamais il n’oublie ses brebis »[330]
persiste à croire Santiago au début du roman. Preuve en est, le jeune homme, en
avançant dans le désert, se rappelle les choses du passé, comme le narrateur de
Timimoun : « il était
difficile de ne pas penser à ce qui était resté en arrière. Le désert, avec son
paysage toujours semblable, ne cessait de s’emplir de rêves. Le jeune homme
voyait encore les palmiers dattiers, les puits, et le visage de la femme aimée.
Il voyait l’Anglais et son laboratoire, et le chamelier qui était un maître et
ne le savait pas »[331].
Nos personnages, tant qu’ils n’arriveront pas à oublier le passé pour croire en
l’avenir, tomberont dans un état d’abandon profond.
2. L’abandon
Cet état de démission – cette volonté de se fuir - que connaît tout
exilé passera d’abord par la tentation du suicide. Si ce n’est pas tellement le
cas chez Le Clézio, on retrouve bel et bien cela chez Boudjedra et Coelho. Dans
L’Alchimiste, c’est ce qui arrive à
Santiago : « plus de trésor, plus de pyramide. C’était comme si le
monde tout entier était devenu muet parce que l’âme du jeune garçon faisait
silence. Il n’y avait ni douleur, ni souffrance, ni déception : simplement
un regard vide qui traversait la petite porte du bar, et une immense envie de
mourir, de tout voir finir pour toujours à cette minute même »[332].
Le narrateur de Timimoun,
désespéré de ne pas plaire à Sarah et d’être poursuivi par les intégristes
islamistes, a lui aussi des pulsions suicidaires : « foutu à quarante
ans. Menacé, maintenant, par des tueurs à gages qui se font passer pour les
gardiens de la morale religieuse. Quelque peu suicidaire. Toujours cinq capsules
de cyanure à portée de la main. Prêt à m’en aller. Si je n’aimais pas la vodka,
ce désert fabuleux et les 27 façons de résoudre une équation du 3ème
degré, selon Khayyâm, qui ne cessent de m’intriguer, j’aurais peut-être essayé
le suicide »[333].
Ces envies de mourir décuplent dans le Sahara : « le désert était mon
mode de suicide »[334]
écrit le narrateur. D’ailleurs, le Sahara est « cette désintégration
lunaire où la rocaille, le sable, les dunes, les crevasses et les pics
majestueux donnent envie de mourir tout de suite ». « Je n’ai jamais
parlé de la mort, de la tentation de la folie et du suicide, dans le désert, à
mes clients »[335]
ajoute le guide. Adolescent déjà, le narrateur voulait se suicider :
« Constantine où j’ai toujours eu, déjà, à seize ans, ce même visage et où
la tentation du suicide est plus grande que dans n’importe quelle ville du
monde »[336]. La mort
est un leitmotiv de Timimoun.
Le narrateur a des envies de mort parce qu’il la côtoie chaque jour. Les
annonces à la radio parlent d’assassinats, les titres de journaux sont
particulièrement révoltants. Le narrateur a aussi assisté à l’enterrement de
son frère qui s’est suicidé. Il propose à des touristes croyant mourir de soif
la visite d’un cimetière et il photographie Sarah pour la tuer, la voyant même
morte à la fin du récit.
Dans Voyage à Rodrigues, Le
Clézio souligne que la quête de son aïeul n’a pas été chose facile. Il
fréquentait la mort tous les jours, et même si l’idée de suicide ne lui est pas
venue à l’esprit, chaque instant était un incroyable moment de
« survie »[337].
Il risquait donc sa vie en permanence, conscient que « la mer, c’est aussi
la promesse de la mort »[338].
Le grand-père n’était donc à l’abri de rien, d’autant plus qu’il y a « une
tentation profonde en tout homme, la tentation du suicide ».[339]
L’état d’abandon des personnages se trouve aussi dans leur extrême état
de pauvreté. Mais il s’agit avant tout d’un esprit de pauvreté, qui rapproche
l’homme de Dieu. Cette pauvreté est
très généralement le symbole du dépouillement de l’esprit dans la quête
ascétique. Le Clézio fait l’apologie du pauvre dans L’Extase matérielle : « pauvreté. Dénuement. Détachement.
Patience. Infirmité. Abandon à soi. Ce qui est le plus important dans ce
désert habité : l’esprit de pauvreté. Ne rien avoir à soi de sûr, ne
reposer sur rien, ne rien posséder. Ce qui compte, ce qui est important, c’est
la conscience systématique de soi »[340].
Cette pauvreté (que connaissent les paysans rodriguais) est une « pauvreté
essentielle »[341]
écrit Le Clézio dans son Journal. Elle est positive, bénéfique ; elle
rapproche l’homme de lui-même. Il ne s’agit donc pas de misère. Mais pour
accéder à cette pauvreté heureuse il faut d’abord passer par le dépouillement
matériel.
Le désintérêt vestimentaire est une étape pour rapprocher l’homme de
lui-même en le réduisant à son plus simple appareil. Le jeune homme de L’Alchimiste « avait encore sa
vieille besace de berger. Elle était en piteux état, et il avait bien failli
oublier jusqu’à son existence »[342].
Des trous ou des tâches dans une tunique évoquent des cicatrices ou des
blessures de l’âme. Le grand-père de Le Clézio est vêtu comme tout chercheur
d’or qui se respecte, c’est-à-dire de manière modeste voire négligée :
« pantalon de grosse toile, bottes tachées de poussière, chemise ouverte sans
col, manches retroussées, coiffé du chapeau de paille des manafs »[343].
Rachid Boudjedra ne parle pas de la tenue vestimentaire du narrateur de Timimoun mais il n’omet pas de signaler
l’allure d’ « épouvantail »[344]
du narrateur. Il décrit régulièrement l’état de décrépitude du personnage
principal. Son visage est « vieilli, hagard, poussiéreux, cireux »[345].
Les personnages affectent donc une négligence physique certaine, tout se
passant comme s’ils étaient dépossédés malgré eux de tout ce qui a trait aux
valeurs matérielles.
L’argent par exemple. Santiago, dès qu’il se trouve en possession de
quelques pièces d’or, les perd quasi-instantanément. Il se fait d’abord voler
sa bourse sur une place de Tanger. A peine a-t-il amassé une certaine somme que
des guerriers du désert la lui échangent contre sa vie, et enfin, alors qu’il
cherche le trésor au pied des pyramides d’Egypte, des brigands volent l’or que
son Maître lui a offert peu de temps auparavant. Dans Voyage à Rodrigues, le grand-père de Le Clézio arrive sur l’île
sans un sous en poche. Il s’est effectivement fait destituer de sa fonction de
magistrat et une tempête a détruit tout ce qu’il possédait. S’il entreprend sa
quête, c’est pour gagner de quoi survivre. Dans le roman de Rachid Boudjedra,
l’auteur ne mentionne pas explicitement la pauvreté du chauffeur de bus.
Cependant, dans l’incipit où il est question de l’achat du véhicule, on se rend
compte que le narrateur n’est pas fortuné car il négocie pendant plusieurs
heures le prix d’un tacot qui n’a aucune valeur, et qu’il achète finalement
« pour rien » : « le vendeur suisse me trouvait tellement
pitoyable qu’il voulait me rembourser la somme dérisoire que je venais de lui
verser […] Je refusai quand même d’être remboursé du prix de la guimbarde
qu’il voulait […] m’offrir sans aucune contrepartie »[346].
Ainsi dépouillés de toute valeur matérielle, les personnages
retrouveront une maigre consolation à leur état pitoyable en s’abandonnant dans
les drogues (Paulo Coelho est d’ailleurs un ancien adepte de drogues !
) : « une bouteille de vodka ça s’essore. Ca se laisse faire. ça donne l’oubli et le sommeil ».[347]
Le narrateur de Timimoun a commencé
de boire à l’âge de « quinze ans et demi »[348],
pour ne plus s’arrêter et avaler désormais deux bouteilles de vodka par jour.
Boudjedra retranscrit d’ailleurs dans un style décousu et haché les propos du
narrateur lors d’une soirée trop arrosée : « je dis comme ça :
prends une bière toi aussi… prends une 33 Lux… ça vaut toutes les femmes du
monde … […] garçon une bière 33 Lux pour mon ami Kamel Raïs ça lui évitera
d’aller fourrer sa chose dans un machin… en plus il doit payer pour ça le con…
une 33 Lux bien fraîche garçon… »[349].
Le chauffeur de bus boit, mais il lui arrive régulièrement de fumer jusqu’à
l’excès : « j’essaie d’emmener Sarah dans une fumerie clandestine de
Timimoun pour lui faire comprendre, discrètement et en douceur, combien ces
soûleries et ces fumeries de mon adolescence avaient été prodigieuses »[350].
Boudjedra n’omet pas de mentionner le plaisir que prennent les gens à fumer
« le narguilé »[351].
Notons que Sarah se libère également en dansant, rituel qui procure en elle une
véritable « extase »[352].
Dans L’Alchimiste, le
personnage ne rechigne pas lui aussi à fumer le « narguilé »[353]
et à consommer du vin : « de boire, le jeune homme commençait à se
sentir tout à fait bien. Mais l’Alchimiste lui faisait un peu peur. Ils
allèrent s’asseoir à l’extérieur de la tente, à contempler le clair de lune qui
faisait pâlir les étoiles. « Bois et prends un peu de bon temps »,
dit l’Alchimiste, notant que le jeune homme devenait de plus en plus gai »[354].
Selon le Dictionnaire des symboles, le symbolisme bachique du vin est
utilisé en Islam pour désigner l’ivresse mystique, étape parallèle à la quête
d’identité. Notons que le grand-père de Le Clézio est en état d’ivresse quand
il contemple la mer : « il n’est plus question de trésor, ni de Privateer,
mais c’est une ivresse telle que la liberté de l’oiseau ou de l’espadon »[355].
Les personnages peuvent aussi s’abandonner en se confiant à autrui. Ils
se libèrent ainsi d’un poids qui les insupporte. Ils font le vide en eux,
prélude nécessaire pour une expérience de Soi. La confession est une volonté de
se dénouer du mal de la faute. C’est la raison pour laquelle Le Clézio utilise
le genre du Journal intime : « en écrivant cette aventure, en mettant
mes mots là où il amis ses pas, il me semble que je ne fais qu’achever ce qu’il
a commencé ». Il se délivre donc d’une charge qui lui été imposée car il
n’a « fait qu’obéir à [la] volonté »[356]
de son grand-père. C’est à peu près la même chose chez Rachid Boudjedra. En
confiant au lecteur sa frustration sexuelle, le narrateur se délivre d’un poids
immense. La confession et la prise de parole sont d’autant plus faciles que le
narrateur a consommé de l’alcool : « je n’ai rien jamais rien compris
à un sexe de femme non plus… ça me renverse… chez l’homme c’est tragi-comique
c’est burlesque… chez la femme c’est carrément tragique… tout ce magma de peaux
rosâtres de grandes lèvres de petites lèvres de clitoris de plis de replis de
vulve de poils… comment peuvent-elles gérer toutes ces choses humides… »[357].
L’idéalisation de la femme passe donc par sa désincarnation. Il y a là une
propension à la vulgarité qui semble soulager le narrateur du mal dont il
souffre, à savoir l’appréhension des femmes : « Les femmes, j’en
avais peur. Pas vraiment d’ailleurs. Je ressentais vis-à-vis d’elles un
sentiment confus de crainte, d’inhibition, de remords et de culpabilité »[358].
Cette déconsidération maladive des femmes est aussi due à la peur qu’a le
narrateur du sang menstruel : « huit ans. Découverte derrière la
porte de la cuisine de chiffons imbibés de sang noirâtre, dégageant une odeur
fétide. Entre chaque morceau un filament gélatineux. Le soleil tombait en
plaques fauves et aveuglantes sur l’ignoble paquet […] Je compris que c’était
du sang de femme. Je vomis pour la première fois. Toute ma vie j’ai rêvé de
morceaux de coton ensanglantés qui attiraient un grand nombre de mouches et de
bestioles avides de sang féminin. Je rêvais aussi que toutes les femmes, dont
ma mère, étaient mortes et qu’elles étaient parties en ne laissant pour toute
trace de leur existence qu’une petite flaque de sang en train de coaguler sous
l’effet de la chaleur »[359].
Boudjedra avoue aussi ce traumatisme à Hafid Gafaïti : « j’ai,
peut-être, une vision de la femme qui est de l’ordre du fantasmatique, de la
peur. Je ne pense pas qu’il s’agisse là d’un problème d’ordre social, c’est
plutôt une difficulté psychologique dont souffrent la plupart des hommes. Cela
est dû à l’éducation, aux tabous et à la mythologie dans laquelle baigne
l’enfance algérienne. Quelque part, parce que j’ai fait apparaître le corps de
la femme en particulier qui était camouflé, interdit et fermé dans la
littérature arabe ; on m’en a voulu parce que j’ai eu l’audace de déflorer
le non-dit, de déplacer le tabou »[360].
Dans L’Alchimiste, un passage
montre que le personnage principal s’est confié à l’Alchimiste. Il lui a parlé
de tous ses problèmes pour anesthésier un quelconque traumatisme. Il s’est
abandonné à lui : « les pierres constituaient la preuve qu’il avait
bien rencontré un roi – un roi qui connaissait son histoire personnelle, qui
était au courant de ce qu’il avait fait avec l’arme de son père, et de sa
première expérience sexuelle »[361].
L’état d’abandon dans lequel tombent les personnages les emmène donc à
se confier sans pudeur à autrui. Le désespoir dans lequel les a plongés
l ‘exil les poussera à s’interroger sur la folie dont ils pensent être
sans doute victimes
3. La folie
« Le guerrier semble fou, mais ce n’est qu’un masque »
Paulo
Coelho[362]
Prenant ainsi conscience de leur être profond en se dévoilant à autrui
et en étant livrés à eux-mêmes, les personnages se demanderont s’ils ne sont
pas fous du fait de leur marginalité. L’inspiré, le poète, l’initié, paraissent
souvent des fous, par quelque aspect de leur comportement, car ils échappent
aux normes communes. Mais chacun est fou à sa manière. Nous considérerons donc
la folie dans le sens freudien du terme, à savoir comme pathologie universelle.
Boudjedra confie cela à Hafid Gafaïti : le délire a « une fonction
mythologisante dans la mesure où le mythe devient une forme de provocation et
une forme de remise en question qui est un dépassement de la réalité pour mieux
la contenir, la maîtriser, la réaliser, la rationaliser . Je crois que le
mythe, comme Platon nous l’a répété, c’est simplement une manière de faire
éclater les limites du réel pour le rendre universel. C’est une didactique et
une pédagogie en même temps. C’est dans ce sens-là que je déploie le délire. Le
délire permet de faire ce travail. La parole du délirant est celle de tout le
monde. Le délire est le même partout. Il a ses propres lois internes qui
fonctionnent d’une façon récurrente, mythologique, donc universelle ; où
tout le monde se trouve»[363].
Paulo Coelho a la même conception de la folie.
Cette conception rejoint d’ailleurs celle fondamentale de l’identité.
Tout homme se demande qui il est vraiment et cela apparaît clairement dans nos
oeuvres : « ainsi, peut-être ne suis-je ici que pour cette question,
que mon grand-père a dû se poser, cette question qui est à l’origine de toutes
les aventures, de tous les voyages : qui suis-je ? »[364]
écrit Le Clézio dans son Journal. Pour Paulo Coelho, la quête la plus importante
est celle de l’identité. C’est ce que dit le roi de Salem au jeune
berger : « accomplir sa Légende Personnelle est la seule et unique
obligation des hommes »[365].
Quant au narrateur de Timimoun, il
affirme également être « passé à côté de l’essentiel »[366].
La folie est une étape de cette quête. Derrière ce mot « folie » se
cache en effet celui de transcendance. Lila Ibrahim-Ouali, qui étudie
l’écriture subversive de Boudjedra, souligne que «l’individu en proie à la
démence réclame un nom, subit douloureusement la non-reconnaissance par la
société de ses normes subjectives, son altérité. La perte de l’unité
personnelle de même que le morcellement des affects ne font que confirmer ce
manque d’être »[367].
Paulo Coelho a d’ailleurs été interné à plusieurs reprises dans un hôpital
psychiatrique parce qu’il faisait… du théâtre ! Il retrace cette
expérience dans son roman Véronika décide de mourir : « soyez
fous, mais comportez-vous comme des gens normaux. Courez le risque d’être
différents, mais apprenez à le faire sans attirer l’attention. Concentrez-vous
sur cette fleur, et laissez se manifester votre Moi véritable »[368]
écrit l’auteur.
Dans le roman que nous étudions, le personnage principal se demande
aussi s’il n’est pas pris de folie. Peut-être parce que le désert « rend
les hommes fous »[369]
écrit Paulo Coelho. De même, l’Alchimiste est décrit comme celui « qui
soigne toutes les maladies du village »[370].
Et Santiago d’aller le consulter… On peut également noter que le personnage est
victime de visions : « le jeune homme eut une soudaine et brève
vision : une troupe armée envahissait l’Oasis »[371].
A priori, c’est là un signe de démence.
La Répudiation, L’Insolation et La Macération sont considérés comme les trois romans de
Boudjedra où se déploie une écriture du délire. Le leitmotiv boudjedrien
de la folie apparaît nettement dans Timimoun.
Comme chez Paulo Coelho, le désert influe de manière néfaste sur le mental des
personnages : « les gens, autour d’elle, nageaient dans le magma
médiocre de leur désir consistant à ne rien rater de ce Sahara dont les mirages
et les légendes les avaient comme dopés, drogués, rendus malades ».
Scruter le désert trop longtemps est dangereux dit le narrateur, « c’est
comme cela qu’on devient fou »[372].
Quand on sait que celui-ci le contemple constamment du fait de sa profession,
sa folie ne fait aucun doute. En outre, le personnage de Sarah affiche une
schizophrénie débordante. Elle essaie effectivement d’éviter tout contact avec
autrui. Ne dit-elle pas qu’« elle tenait à mettre de grandes distances
entre elles et les autres » ?[373].
En ce qui concerne le narrateur, sa folie vient aussi de sa rencontre
avec Sarah. Il considère effectivement l’amour qu’il a pour elle comme une
maladie : « Sarah, dont le regard me rend très vulnérable, comme
tétanisé, presque malade » ; « pourquoi c’est à quarante ans que
cette drôle de maladie qu’est l’amour me tombe dessus ? »[374].
Quand le narrateur fait croire à ses clients qu’il est malade[375],
il n’a donc pas tout à fait tort… D’un point de vue psychanalytique, le personnage
est un névrosé. Il est pris entre les exigences du principe de plaisir
(conquérir Sarah) et les exigences du principe de réalité (la peur des femmes).
On peut ainsi opposer le « j’étais carrément amoureux de Sarah » [376] au « il m’arrivait d’avoir des envies
de tuer Sarah »[377].
De cette tension naîtra sa folie : « je perdais carrément la
tête ».[378] Cette
névrose est aussi due à la volonté désespérée de se venger d’un père absent. Le
frère du narrateur est confronté semble-t-il au même problème névrotique. Il est
amoureux d’une femme qu’il ne peut pas fréquenter du fait de sa classe sociale.
De là pourrait naître sa démence : « il en pleurait de rage et
d’amour parce qu’il était fou de la jeune chanteuse »[379].
Comme son frère qui s’amuse à prendre le tramway en marche, le narrateur prend
aussi plaisir à jouer avec la mort. Il effectue par exemple au péril de sa vie
des acrobaties en avion. Un parallèle évident peut être fait avec Icare qui
chercha à s’échapper du labyrinthe grâce à des ailes de cire mais qui se tua
parce que le soleil fit fondre son invention. Réincarnation d’Icare, le
narrateur, parce qu’il effectue comme lui des actes insensés, est victime de la
folie des grandeurs. Sa mégalomanie révèle une déformation maladive du
psychisme, un intellect devenu incontestablement irresponsable. Notons que le
narrateur est alcoolique. Et l’alcoolisme n’est rien d’autre qu’une maladie.
Le Clézio s’est très tôt intéressé à la folie : « je m’étais
inscrit […] à un cours de psychologie à l’université, dans le seul but de
pouvoir pénétrer dans un asile, en compagnie d’étudiants, sans être donc, ni un
sujet, ni un objet d’étude, ni véritablement un analyste. Je me situais au
milieu. J’étais un observateur »[380].
Dans Voyage à Rodrigues l’auteur
considère souvent l’entreprise de son grand-père comme une folie :
« ce qui m’étonne le plus, dans cette aventure qu’ a vécu mon grand-père,
c’est tant de visions dans un espace aussi restreint, ou, pour mieux dire, tant
de folies et de chimères exprimées avec tant de précision »[381].
Dès lors, « son obstination à rechercher ce trésor de chimère n’était-elle
pas de la folie ? »[382].
Le Clézio lui-même avoue que l’aspect désertique de l’île fait perdre à tout
homme son bon sens : « ici, l’on est enfermé dans sa propre folie,
tourné vers la pierre, vers le stérile, l’infranchissable »[383].
L’exilé devra donc oublier un passé désastreux et passer outre cette
folie pour se construire un avenir prometteur. La lutte sera donc nécessaire
pour pouvoir progresser. Dans nos œuvres, les personnages apparaissent comme de
véritables combattants prêts à affronter les dangers qui se présentent à eux.
Même dans les pires situations, ils n’abandonneront jamais leur entreprise. Le
narrateur de Timimoun ne cesse de répéter qu’il doit
« résister » : « je dois résister et ne pas céder.
C’est-à-dire ne pas arrêter le véhicule. Ne pas descendre »[384] ;
« je me dis qu’il faut que je résiste, que je m’y habitue et continue à
conduire Extravagance sur ces pistes impraticables et interdites pour avoir
tout l’espace à moi et à mes clients »[385].
Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio écrit également que son aïeul faisait
preuve d’une témérité exemplaire : « mon grand-père, lui, n’abandonne
pas sa quête. Même lorsque tout est contre lui, lorsque l’argent manque,
lorsque les créanciers sont de plus en plus impatients, lorsque surtout
survient la catastrophe, et qu’il est chassé de sa maison par sa propre
famille, et doit chercher une autre de meure, une autre terre »[386].
Dans le conte de Paulo Coelho, l’auteur écrit que rien n’arrête celui qui croit
à ses rêves : « Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l’Univers
conspire à te permettre de réaliser ton désir »[387].
Dans Le Manuel du guerrier de la lumière, Paulo Coelho montre la
nécessité de se battre pour parvenir à une quête de soi. Ainsi, après avoir
subi l’épreuve du déracinement, les personnages devront prendre leurs
marques sur le sol de terres qu’ils ne connaissent pas.
V. Exil et expérience : le cheminement vers
soi-même
A.
Adjuvants et
opposants à la quête
1. Quête amoureuse et/ou quête de soi
Dans nos trois œuvres, la découverte de l’amour par les personnages arrive au moment propice. C’est quand les personnages sont abandonnés de tous qu’ils subissent le coup de foudre et s’éprennent d’une femme. C’est cet amour qui poussera les personnages principaux à poursuivre leur quête sans céder au désespoir. La femme devient initiatrice.
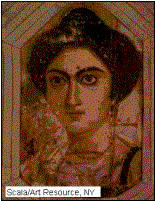 La
rencontre avec l’âme sœur est effectivement foudroyante : « le jeune
homme s’avança vers elle pour l’interroger au sujet de l’Alchimiste. Et ce fut
comme si le temps s’arrêtait, comme si l’Ame du monde surgissait de toute sa
force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui
hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus
essentielle et la plus savante du Langage que parlait le monde, et que tous les
êtres de la terre étaient capable d’entendre en leur cœur. Et cela s’appelait
l’Amour, quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même, et
qui pourtant resurgissait toujours avec la même force, partout où deux regards
venaient à se croiser comme se croisèrent alors ces deux regards près d’un
puits »[388]. Encore
une fois, on voit là l’importance du
regard dans le roman de Paulo Coelho (cf. Image[389]).
Il est un réacteur et un révélateur réciproque du regardant et du regardé.
Coelho s’est sans doute inspiré de la Fatima islamique pour créer son
personnage. Comme la femme du roman, Fatima, la fille de Mahomet et épouse
d’Ali, fut la première femme en Islam dont le silence fut considéré comme un
consentement au mariage… Et Lilas Voglimacci d’écrire : « comme
toujours dans les contes de fées, tout se passe dans un regard, comme au
ralenti. Instant infiniment court qui saisit deux êtres pour les souder à
jamais l’un à l’autre dans un espace et un temps hors du monde des autres
protagonistes de la scène. C’est, dans le bleu du ciel, sur l’or du sable des
légendes, ce dont nous rêvons tous, un amour né des yeux qui s’aimantent pour
la vie. Autrement dit, nous assistons émerveillés à un « coup de foudre » »[390].
Malheureusement, l’instant qui suit le coup de foudre convaincra le personnage
d’abandonner sa quête pour se consacrer au seul trésor qui vaille : la
femme aimée. Santiago éprouve un tel sentiment d’attirance irrésistible :
« l’amour exigeait la présence auprès de l’être aimé »[391]
dit-il. Le berger n’est donc pas loin d’abandonner la quête. La tentation est
grande de tout laisser tomber : « j’ai Fatima. C’est un plus grand trésor
que tout ce que j’ai réussi à conquérir »[392].
Lilas Voglimacci explique cela dans son essai sur L’Alchimiste : « cette jeune fille, gracieuse et ingénue,
est aussi un piège et une tentation pour l’aventurier Santiago, pèlerin encore
incertain de son destin mythique. Il hésite à mettre en danger la Providence
qui lui permet de recevoir ce don de l’amour de Fatima. Il tremble à l’idée de
faire vaciller l’équilibre magique de l’instant superbe. Perdre un tel trésor
serait un crime plus grand que celui de quitter sa terre natale. Parce que la
véritable terre de l’homme, c’est l’Amour, et Santiago, qui a beaucoup lu, sait
cela. On a le droit de se demander s’il est bien indispensable de mettre en
péril son bonheur pour continuer sa quête. On a le devoir de croire que le but
de tous les actes d’une vie c’est la seule rencontre bénie, celle qui nous attribue
la chance d’être aimé par celle qu’on aime »[393].
Mais heureusement, Fatima finira par convaincre Santiago de la nécessité de
poursuivre sa quête. Et elle a la force d’assumer son destin d’attente :
« je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu
chercher »[394]
dit-elle à Santiago. Aveuglé par l’amour qu’il porte à cette femme du désert,
le jeune berger ne pourra qu’obéir à ses ordres et poursuivre sa quête. La
femme relance l’exilé dans l’aventure. Elle devient adjuvant de son histoire.
La
rencontre avec l’âme sœur est effectivement foudroyante : « le jeune
homme s’avança vers elle pour l’interroger au sujet de l’Alchimiste. Et ce fut
comme si le temps s’arrêtait, comme si l’Ame du monde surgissait de toute sa
force devant le jeune homme. Quand il vit ses yeux noirs, ses lèvres qui
hésitaient entre le sourire et le silence, il comprit la partie la plus
essentielle et la plus savante du Langage que parlait le monde, et que tous les
êtres de la terre étaient capable d’entendre en leur cœur. Et cela s’appelait
l’Amour, quelque chose de plus vieux que les hommes et que le désert même, et
qui pourtant resurgissait toujours avec la même force, partout où deux regards
venaient à se croiser comme se croisèrent alors ces deux regards près d’un
puits »[388]. Encore
une fois, on voit là l’importance du
regard dans le roman de Paulo Coelho (cf. Image[389]).
Il est un réacteur et un révélateur réciproque du regardant et du regardé.
Coelho s’est sans doute inspiré de la Fatima islamique pour créer son
personnage. Comme la femme du roman, Fatima, la fille de Mahomet et épouse
d’Ali, fut la première femme en Islam dont le silence fut considéré comme un
consentement au mariage… Et Lilas Voglimacci d’écrire : « comme
toujours dans les contes de fées, tout se passe dans un regard, comme au
ralenti. Instant infiniment court qui saisit deux êtres pour les souder à
jamais l’un à l’autre dans un espace et un temps hors du monde des autres
protagonistes de la scène. C’est, dans le bleu du ciel, sur l’or du sable des
légendes, ce dont nous rêvons tous, un amour né des yeux qui s’aimantent pour
la vie. Autrement dit, nous assistons émerveillés à un « coup de foudre » »[390].
Malheureusement, l’instant qui suit le coup de foudre convaincra le personnage
d’abandonner sa quête pour se consacrer au seul trésor qui vaille : la
femme aimée. Santiago éprouve un tel sentiment d’attirance irrésistible :
« l’amour exigeait la présence auprès de l’être aimé »[391]
dit-il. Le berger n’est donc pas loin d’abandonner la quête. La tentation est
grande de tout laisser tomber : « j’ai Fatima. C’est un plus grand trésor
que tout ce que j’ai réussi à conquérir »[392].
Lilas Voglimacci explique cela dans son essai sur L’Alchimiste : « cette jeune fille, gracieuse et ingénue,
est aussi un piège et une tentation pour l’aventurier Santiago, pèlerin encore
incertain de son destin mythique. Il hésite à mettre en danger la Providence
qui lui permet de recevoir ce don de l’amour de Fatima. Il tremble à l’idée de
faire vaciller l’équilibre magique de l’instant superbe. Perdre un tel trésor
serait un crime plus grand que celui de quitter sa terre natale. Parce que la
véritable terre de l’homme, c’est l’Amour, et Santiago, qui a beaucoup lu, sait
cela. On a le droit de se demander s’il est bien indispensable de mettre en
péril son bonheur pour continuer sa quête. On a le devoir de croire que le but
de tous les actes d’une vie c’est la seule rencontre bénie, celle qui nous attribue
la chance d’être aimé par celle qu’on aime »[393].
Mais heureusement, Fatima finira par convaincre Santiago de la nécessité de
poursuivre sa quête. Et elle a la force d’assumer son destin d’attente :
« je veux que tu poursuives ta route en direction de ce que tu es venu
chercher »[394]
dit-elle à Santiago. Aveuglé par l’amour qu’il porte à cette femme du désert,
le jeune berger ne pourra qu’obéir à ses ordres et poursuivre sa quête. La
femme relance l’exilé dans l’aventure. Elle devient adjuvant de son histoire.
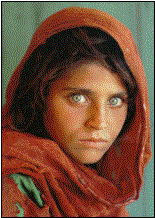 Dans
Timimoun, il suffit d’un regard pour
que le narrateur s’éprenne de Sarah : « la rencontre et la relation
amoureuses que retranscrit Timimoun sont construites sur des silences,
des sous-entendus, des aveux non formulés ou déguisés. Dans le face à face muet
des deux individus, le regard tient lieu de langage et de lien. Seuls les yeux
parlent pour l’un et pour l’autre et trahissent parfois des émotions
violentes »[395].
Sans cesse le narrateur-guide fait référence à la beauté des yeux de Sarah, à
la fascination qu’ils exercent sur lui : « ses yeux changeaient de
couleur. D’un bleu à l’autre. Du plus délavé au plus noir. D’un violet à
l’autre. Du plus clair au plus foncé. Elle attirait tout à elle : les
gens, les ruines, les Ksour, les casbahs, les oasis et même les chats »[396].
Là aussi le coup de foudre est immédiat : « depuis le premier jour où j’ai
vu Sarah monter dans le car, j’ai eu ce sentiment qu’un tropisme m’attirait de
façon irrésistible »[397].
Si le coup de foudre n’est pas avoué directement, le narrateur devra rapidement
se rendre à l’évidence des sentiments qu’il a pour elle : « j’étais
carrément amoureux de Sarah »[398].
Ainsi, ayant découvert l’âme sœur, le narrateur retrouvera comme Santiago
confiance en l’avenir : « Sarah était le seul être capable de m’aider
à m’en sortir. Je la croyais capable d’arriver à me guérir de mes tares »[399].
Conscient des bienfaits que la jeune femme apporte à son existence désastreuse,
le narrateur finit par considérer Sarah comme la seule chose importante dans sa
vie : « à quarante ans j’avais l’impression d’être passé à côté de
l’essentiel. L’essentiel c’était Sarah, maintenant »[400].
Comme Santiago qui refuse de poursuivre sa quête après être tombé amoureux, le
personnage de Boudjedra refuse de quitter Timimoun sans celle qu’il aime :
« il n’était pas question de continuer sans Sarah. Il me fallait
l’attendre »[401]. Si la femme est a priori celle dont le pouvoir de séduction pourrait
mettre un terme à la quête du personnage principal, elle sera finalement l’être
qui déclenchera la poursuite de l’itinéraire initiatique du héros :
« Sarah a proposé de me payer pour que son amant puisse poursuivre le
voyage avec nous. J’ai refusé son argent et accepté son amant. Je devais donc
le supporter pour ne pas perdre la face, jusqu’à Alger »[402].
Tout laisse à supposer que le chauffeur de bus n’aurait pas continué sa
traversée du Sahara sans celle qu’il aime et qu’il désire physiquement. Car
Boudjedra met sur le même plan, à la différence de Paulo Coelho et Le Clézio,
amour spirituel et amour physique. Boudjedra juxtapose d’ailleurs dans une même
phrase ces deux facettes de l’amour : « je découvrais le sentiment
amoureux, le désir sexuel »[403]
avoue-t-il. Selon lui, c’est la seule manière d’arriver au terme d’une
quête identitaire, comme le souligne Giuliana Toso Rodinis : « cette
fusion permet à l’amant d’être totalement investi de l’image de l’aimé et d’y
disparaître. Réalisation ultime de l’amour mystique ou de la quête
d’absolu »[404]
Dans
Timimoun, il suffit d’un regard pour
que le narrateur s’éprenne de Sarah : « la rencontre et la relation
amoureuses que retranscrit Timimoun sont construites sur des silences,
des sous-entendus, des aveux non formulés ou déguisés. Dans le face à face muet
des deux individus, le regard tient lieu de langage et de lien. Seuls les yeux
parlent pour l’un et pour l’autre et trahissent parfois des émotions
violentes »[395].
Sans cesse le narrateur-guide fait référence à la beauté des yeux de Sarah, à
la fascination qu’ils exercent sur lui : « ses yeux changeaient de
couleur. D’un bleu à l’autre. Du plus délavé au plus noir. D’un violet à
l’autre. Du plus clair au plus foncé. Elle attirait tout à elle : les
gens, les ruines, les Ksour, les casbahs, les oasis et même les chats »[396].
Là aussi le coup de foudre est immédiat : « depuis le premier jour où j’ai
vu Sarah monter dans le car, j’ai eu ce sentiment qu’un tropisme m’attirait de
façon irrésistible »[397].
Si le coup de foudre n’est pas avoué directement, le narrateur devra rapidement
se rendre à l’évidence des sentiments qu’il a pour elle : « j’étais
carrément amoureux de Sarah »[398].
Ainsi, ayant découvert l’âme sœur, le narrateur retrouvera comme Santiago
confiance en l’avenir : « Sarah était le seul être capable de m’aider
à m’en sortir. Je la croyais capable d’arriver à me guérir de mes tares »[399].
Conscient des bienfaits que la jeune femme apporte à son existence désastreuse,
le narrateur finit par considérer Sarah comme la seule chose importante dans sa
vie : « à quarante ans j’avais l’impression d’être passé à côté de
l’essentiel. L’essentiel c’était Sarah, maintenant »[400].
Comme Santiago qui refuse de poursuivre sa quête après être tombé amoureux, le
personnage de Boudjedra refuse de quitter Timimoun sans celle qu’il aime :
« il n’était pas question de continuer sans Sarah. Il me fallait
l’attendre »[401]. Si la femme est a priori celle dont le pouvoir de séduction pourrait
mettre un terme à la quête du personnage principal, elle sera finalement l’être
qui déclenchera la poursuite de l’itinéraire initiatique du héros :
« Sarah a proposé de me payer pour que son amant puisse poursuivre le
voyage avec nous. J’ai refusé son argent et accepté son amant. Je devais donc
le supporter pour ne pas perdre la face, jusqu’à Alger »[402].
Tout laisse à supposer que le chauffeur de bus n’aurait pas continué sa
traversée du Sahara sans celle qu’il aime et qu’il désire physiquement. Car
Boudjedra met sur le même plan, à la différence de Paulo Coelho et Le Clézio,
amour spirituel et amour physique. Boudjedra juxtapose d’ailleurs dans une même
phrase ces deux facettes de l’amour : « je découvrais le sentiment
amoureux, le désir sexuel »[403]
avoue-t-il. Selon lui, c’est la seule manière d’arriver au terme d’une
quête identitaire, comme le souligne Giuliana Toso Rodinis : « cette
fusion permet à l’amant d’être totalement investi de l’image de l’aimé et d’y
disparaître. Réalisation ultime de l’amour mystique ou de la quête
d’absolu »[404]
Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio ne mentionne pas la femme qu’a rencontrée son grand-père Alexis lors de ses années d’errance. Par contre, l’auteur y fait explicitement référence dans Le Chercheur d’or. On voit dans ce dernier roman l’importance du personnage d’Ouma dans la quête du grand-père. Le rapprochement du prénom « Ouma » avec le nom « amour » peut facilement être fait. La passion qu’a Le Clézio pour l’onomastique ne peut pas laisser croire à un simple hasard orthographique. Alexis Le Clézio a été fasciné par cette jeune femme qui lui a sauvé la vie alors qu’il était gravement malade au milieu de l’île. Elle lui apportera un soutien psychologique énorme. D’instinct, le narrateur saura qu’Ouma est la femme de sa vie[405]. La fulgurance de la rencontre laisse supposer un coup de foudre : « tout cela s’est passé si vite que j’ai du mal à croire que je n’ai pas imaginé cette apparition, cette jeune fille sauvage et belle qui m’a sauvé la vie »[406]. Comme dans Timimoun et L’Alchimiste, le héros sera amoureux de cette femme à un point tel qu’il hésitera à continuer sa recherche du trésor du Corsaire : « il me semble que maintenant plus rien d’autre n’a d’importance » avoue le narrateur du roman. Mais chez Le Clézio aussi c’est la femme qui aidera les personnages à avoir foi en la vie. Alors que le narrateur du Chercheur d’or s’apprête à sombrer dans le désespoir quand il découvre que la cachette du trésor est vide, Ouma s’impose et lui permet de relativiser son malheur : « quand je lui dis que j’ai trouvé la deuxième cachette du Corsaire, et qu’elle était vide, Ouma éclate de rire : « Alors il n’y a plus d’or, il n’y a plus rien ici ! » Je suis d’abord irrité, mais son rire est communicatif et bientôt je ris avec elle. Elle a raison. Quand nous nous sommes aperçus que le puits était vide, notre tête devait être comique ! »[407]. Là aussi on peut croire que sans le soutien moral de la jeune femme, le héros aurait sombré dans le désespoir.
La femme occupe donc une place majeure dans l’initiation du personnage. Véritable substitut de la mère dans la fonction qu’elle occupe, elle contraint les personnages à l’abstinence sexuelle. Les instincts primaires des personnages doivent être spiritualisés. Cette étape est incontestablement nécessaire à une quête de soi. C’est le cas notamment du narrateur de Timimoun. Faute de pouvoir assouvir ses pulsions sexuelles avec Sarah, il doit se résigner et ne la posséder qu’en la prenant en photo de manière intempestive. Si la femme a une fonction maternelle dans notre corpus -n’oublions pas que la vertu d’obéissance de la Sarah biblique, épouse d’Abraham, lui vaut d’être désignée comme la mère des chrétiens dans la 1ère Lettre de Pierre (III, 6)- , elle est nous l’avons vu l’emblème par excellence de l’ambiguïté : à cause d’elle ou grâce à elle, le héros continuera ou arrêtera sa quête. D’autres personnages de nos oeuvres représentent de telles contradictions.
2. L’hospitalité inhospitalière
Dans notre corpus, les personnages seront régulièrement confrontés au cours de leur périple à la misanthropie évidente de certaines personnes. Sans cesse des individus viendront parfois malgré eux leur barrer la route et s’opposer à ce qui deviendra au fil des pages une quête de soi. Ceux qui sont chargés de protéger le héros le détruiront à petits feux : c’est le cas par exemple, quand le narrateur de Timimoun évoque ses souvenirs d’enfance, du père, des religieux, de tante Fatma mais aussi de Kamel Raïs et Henri Cohen, ses amis, qui se sont toujours moqués de l’inhibition sexuelle du narrateur : « c’est à Sarah que j’ai envie de parler. Kamel Raïs et Henri Cohen seraient morts de rire. Je les entends s’esclaffer d’ici »[408]. Mais c’est aussi le cas, dans le temps du récit, de l’amant de Sarah. En venant s’interposer entre le narrateur et la femme que celui-ci aime, il deviendra un opposant à l’aventure intérieure du personnage principal. Ce dernier voue une haine quasi-raciale à cet intrus inattendu : il en devient « jaloux comme un macaque » et « sent des bouffées de racisme monter en lui, à l’encontre de ce superbe éphèbe noir, joueur d’amzad, qui s’est installé carrément dans l’autobus »[409]. Si l’amant de Sarah perturbe le bon déroulement de la quête amoureuse du protagoniste, celui-ci court aussi quotidiennement le risque d’être tué par des intégristes assassins. Ces derniers sont donc aussi de farouches opposants à la quête identitaire du narrateur. Le héros de Timimoun est conscient de cette haine que lui vouent certains individus malintentionnés : « ma vie, déjà très boiteuse, devint carrément intenable. La recrudescence des assassinats abominables me révoltait. Les magouilles politiques et financières proliféraient. La secte des Assassins tenait le haut du pavé et ciblait tout particulièrement les intellectuels et les citoyens les plus pauvres et les plus inoffensifs. Aveuglément ! »[410].
Nombreux sont ceux qui viendront barrer la route à Santiago. Comme chez Boudjedra, le personnage principal sera dès l’âge de raison confronté au traditionalisme impérissable du père. Ce dernier « voulait faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne »[411]. Dans le temps du récit, Santiago rencontre dès son arrivée à Tanger un jeune Arabe qu’il croit être guide, et qui par conséquent pourrait l’aider dans l’accomplissement de sa quête. Mais ce jeune homme se révèlera être un voleur et dépossèdera le protagoniste de tous ses biens : « il n’était plus berger, et n’avait plus rien à lui, pas même l’argent nécessaire pour revenir sur ses pas »[412]. Le jeune berger se trouve ensuite menacé à mort dans un lieu où l’hospitalité est de rigueur, à savoir l’oasis. En effet, le chef de Fayoum demande la mort de Santiago car il a osé prédire une attaque armée. Mais il a la vie sauve car la bataille a lieu. Peu s’en faut que Santiago n’y laisse la vie, tant le désert dévoile des atrocités : « il y avait quatre cent quatre-vingt-dix-neuf cadavres disséminés sur le sol » nous dit l’auteur. Le cinq-centième sera le chef du clan, condamné à une mort déshonorante : « au lieu d’être tué à l’arme blanche ou d’une balle de fusil, il fut pendu à un tronc de palmier desséché »[413]. Dans le désert, le jeune homme est également menacé par des soldats : « le premier signe concret de danger se manifesta dès le lendemain. Trois guerriers armés apparurent, qui, s’étant approchés, demandèrent aux deux voyageurs ce qu’ils faisaient là »[414]. A la suite de cette rencontre, nos deux protagonistes tomberont nez à nez avec une armée de cavaliers malintentionnés qui apparemment sont là pour s’opposer à leur quête : « c’étaient des guerriers vêtus de bleu, avec un triple anneau de couleur noire autour du turban. Les visages étaient masqués sous un autre voile bleu, qui ne laissait voir que les yeux. Même à cette distance, les yeux montraient la force des âmes. Et ces yeux parlaient de mort »[415]. A la fin du roman, d’autres opposants à Santiago apparaîtront. Ce sont des brigands malveillants qui chercheront à mettre un terme à la vie du personnage principal : « ils commencèrent à le frapper. Ils le battirent longtemps, jusqu’à l’apparition des premiers rayons de soleil. Ses vêtements étaient en lambeaux, et il sentit que la mort était proche »[416].
Dans le Journal de Le Clézio, le grand-père de l’auteur a dû faire face à bien des difficultés. Il a notamment connu la guerre et il a été « chassé de sa maison par sa propre famille ». En outre, les « créanciers »[417] étaient toujours là pour lui rappeler ses dettes et s’enorgueillir de sa faillite. L’auteur lui-même se sent dévisagé dès son arrivée : « A Rodrigues, tout se sait. Maintenant je ne peux guère cacher ce que je suis venu chercher. Pourtant, ce que je suis venu chercher a-t-il vraiment un nom ? Comment pourrais-je le dire ? Bien entendu, ils ont un regard ironique, eux, « les gentlemen », les « bourzois » de la bonne société, le directeur de la Barclay’s, le propriétaire de l’hôtel Pointe Vénus »[418]. Ainsi, tout se passe comme si la famille Le Clézio avait subi un mauvais sort sur l’île Rodrigues, tant la réputation du chercheur d’or leur a porté préjudice et suscité des jalousies ou réprimandes dans leur entourage.
En allant au bout d’eux-mêmes et de leurs convictions quasi-idéalistes, les personnages parviendront à vaincre ceux qui s’opposent à leur cheminement identitaire. Mais cette victoire ne se fera pas sans aide. Les protagonistes auront recours pendant leur périple à de véritables « pères spirituels ».
3. Les « pères spirituels »
Par « père spirituel », nous pouvons au préalable entendre « Dieu », car le père est un symbole de la Divinité. Sa présence est indiscutable au sein des œuvres de notre corpus et l’aide qu’il apportera à nos personnages est incontestable. Paulo Coelho s’est d’ailleurs converti au catholicisme après avoir été confronté à une épreuve traumatisante : « à trente-quatre ans, après avoir abandonné la plupart de ses aventures de jeunesse, Paulo Coelho a entrepris un voyage avec sa femme Cristina à la recherche d’un nouveau chemin spirituel. Au cours de ce voyage, à l’endroit le plus impensable, dans le camp de concentration nazi de Dachau, il a vécu une expérience spirituelle très forte qui devait le ramener définitivement vers le catholicisme »[419]. Quand il confie cela, Juan Arias met en évidence l’importance de la religion catholique pour l’auteur du Démon et mademoiselle Prym[420]. Dans L’Alchimiste, c’est au cours de son périple à travers le désert que le berger trouvera la foi et percevra la présence de Dieu autour de lui. Le jeune homme parviendra enfin à comprendre le langage divin. La vieille gitane lui révèlera d’abord que les songes dont il est victime sont révélateurs du « langage de Dieu »[421]. Ce langage n’est pas fortuit, il sera d’une aide considérable à celui qui sait le percevoir. C’est ce que dit le roi de Salem à Santiago : « pour arriver jusqu’au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n’y a qu’à lire ce qu’il a écrit pour toi »[422]. Ainsi, Santiago trouvera sa route en regardant les signes gravitant autour de lui : le cosmos sera de ce fait une véritable carte géographique dont Dieu se sert pour guider le pèlerin : « elle retrouvait devant elle l’astre qui continuait à indiquer dans quelle direction se trouvait l’oasis »[423]. Dieu se révèlera donc un adjuvant capital à la quête de soi. C’est lui qui fera progresser le protagoniste dans sa démarche initiatique. Le jeune homme comprendra effectivement que tout a été écrit par la même « Main », « que l’Ame du Monde faisait partie de l’Ame de Dieu, et […] que l’Ame de Dieu était sa propre Ame. Et qu’il pouvait, dès lors réaliser des miracles »[424] .
Dans Voyage à Rodrigues, l’aide de Dieu paraîtra aussi par l’intermédiaire d’un langage obscur que l’initié devra décrypter pour arriver au terme de sa quête identitaire : « ce feu qui brûle encore dans les blocs de basalte et de lave, ce feu sombre du jour et de la nuit, cette voix de la mer et du vent, ce ciel immense, quel autre trésor pourraient-ils procurer, qui n’ait d’abord été fondu et recréé par l’invisible puissance qui est au centre de toute chose, les force à exister contre le néant ?» nous dit l’auteur, parlant même comme Paulo Coelho de « la main de Dieu »[425] et employant la même formule que l’écrivain brésilien : «c’était écrit »[426]. Dieu se manifestera comme chez Paulo Coelho en laissant des signes dans la nature. Comme Santiago, les protagonistes de Voyage à Rodrigues trouveront une aide considérable dans le cosmos, chef d’œuvre de la création et véritable point de repère divin pour celui qui ère : « le ciel tout entier devait alors lui sembler le plan d’un secret, comme le tracé original de tous les mystères qu’il avait entrepris de déchiffrer »[427]. La quête de Dieu sera ainsi parallèle à celle de soi : « je crois que ce n’est pas au hasard que mon grand-père avait choisi DIEU comme mot de passe pour accéder à la table des Clavicules de Salomon. Y a-t-il une autre présence à rechercher, à ressentir ? »[428]. La recherche de Dieu sera aussi chez Le Clézio un corollaire de la quête de soi.
Dans Timimoun, Dieu ne semble pas vouloir se manifester. Rachid Boudjedra ne fait donc pas l’apologie de l’église invisible. Comment croire en Dieu quand tout ce qui touche au religieux est alarmant ? Cette impression de corruption de l’église visible apparaît clairement dans le roman. Le narrateur associe toujours à la religion des faits négatifs. Par exemple, le chauffeur de bus a été traumatisé par la mort de son frère car la vérité n’a jamais été révélée à quiconque. Cette mort n’a pas été accidentelle : « la mort de mon frère aîné ne pouvait pas être ramenée à un simple fait divers ou à la mauvaise plaisanterie de cancre chahuteur. Trop facile de dire qu’il est mort en ratant une marche de tramway qu’il voulait prendre pour faire des paris avec ses amis et narguer la mort. Mon père avait arrangé la vérité sous la pression des autorités religieuses qui ne voulaient pas entendre parler de suicide »[429]. Ceux qui représentent la religion imposent donc un pouvoir tyrannique sur le commun des mortels. L’image que le narrateur garde du maître de Coran de son enfance est révélatrice de cette dictature violente qu’exercent les religieux au Maghreb : « le maître de Coran m’avait infligé une terrible correction : dix coups de bâton sur la plante des pieds ; parce que j’avais refusé d’écrire sur la planche coranique : … Et ils t’interrogent sur les menstrues ; dis c’est une malédiction… Je ne l’ai jamais avouée à ma mère, cette terrible correction ! » [430]. L’atrocité des crimes commis au nom de la religion finit de ternir l’image d’un Dieu aimant : « UN JOURNALISTE FRANÇAIS ABATTU PAR LES INTEGRISTES DANS LA CASBAH D’ALGER »[431]… Ainsi, tout se passe comme si le seul réconfort accessible face à un Dieu absent était la fuite dans des superstitions naïves. Celles qu’a la mère du narrateur par exemple : « ma mère, chaque fois qu’elle est confrontée à un problème qui la dépasse, l ‘émeut ou l’étonne, se réfugie dans ses migraines légendaires. Elle s’entourait alors la tête d’un magnifique fichu berbère […] Le fichu ne servait, en fait, qu’à lui serrer la tête en cas de migraine et elle lui octroyait, certainement, des qualités miraculeuses pour guérir ses maux de tête et calmer ses angoisses rentrées et ses frustrations de femme délaissée par son époux »[432]. Chez Boudjedra, le personnage principal est tenté par le désespoir du fait certes de l’absence de Dieu, mais aussi parce qu’aucun « père spirituel » ne lui vient en aide.
Ce n’est pas le cas dans Voyage à Rodrigues. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, l’auteur et son grand-père ont trouvé du soutien dans la même personne malgré les générations qui les séparent. Cet individu qui leur offrit ses services s’appelle Fritz Castel. Originaire de l’île Rodrigues, c’est lui qui sert de guide à J. M. G. et Alexis Le Clézio. A ses yeux, ces deux hommes sont du reste une seule et même personne. C’est ce qu’écrit l’auteur dans son Journal : « je me souviens de ma première rencontre avec Fritz Castel, en haut de la pointe Vénus. Etrangement, je n’ai même pas été étonné qu’il me reconnaisse tout de suite. Ne savait-il pas que je devais revenir ? »[433].
Mais c’est dans L’Alchimiste qu’apparaît le plus grand nombre d’adjuvants à la quête du personnage. Notons d’emblée que dans la tradition alchimique, comme dans le soufisme[434], le néophyte est toujours épaulé par un Maître chargé de son éducation. C’est le cas chez Paulo Coelho : l’Alchimiste sera le parrain de Santiago. Simone Vierne parle de cette condition obligatoire à l’alchimie : « dans toute initiation, le novice est amené à sa nouvelle naissance par un guide qui possède déjà, par sa ou ses initiations antérieures, une partie du pouvoir, du dépôt sacré qu’il a la charge de lui transmettre. Il est aussi remarquable que ce guide […] est considéré comme le second père »[435]. Mais il y aura pour Santiago d’autres « pères spirituels » en plus de l’Alchimiste: le roi de Salem d’abord, un marchand de bonbons, de cristaux… Ces trois personnages semblent d’ailleurs être une seule et même personne, le chiffre trois revenant sans cesse dans les contes. C’est ce que souligne Lilas Voglimacci : « ce marchand de bonbons qui lui tend la main quand il a faim et soif, ce n’est pas l’homme sans façons de la chanson. Ce sourire de l’Homme, omniprésent, omnipuissant, c’est la présence partout souveraine du vieux roi. Le grand roi de Salem. Ce roi, qui est aussi le marchand de Cristaux est peut-être bien l’Alchimiste. Trois personnages, une seule personne. Il faut insister sur un point, dans les contes d’ici ou d’ailleurs, un élément qui les signale et les régit : leur structure. Le canevas toujours identique, toujours recommencé du récit conté sur lequel se cousent les actions des héros. Les grandes étapes du chemin sont souvent au nombre de trois, ou le personnage apparaît à travers trois personnes presque identiques accomplissant la même action. Et, plus subtilement, comme dans l’Alchimiste, le sorcier prend trois aspects pour apparaître à point nommé dans la vie du jeune novice, trois fois réorienté par son parrain magicien »[436]. Outre ces « pères spirituels », Santiago sera épaulé par une vieille gitane, véritable substitut de la mère selon Lilas Voglimacci car elle se chargera de guider Santiago vers ce à quoi il est destiné : « cette marraine gitane n’est pas vraiment Isis, ni même la femme de l’ogre, mais elle a cependant pour mission d’aider le premier pas du berger. C’est en quelque sorte la femme qui lui apprend à marcher »[437]. Et une fois que le personnage sera lancé sur la route, l’errance le fera aller de découvertes en découvertes
B. Errance et découverte
1. Le chemin
Dans l’inconscient collectif, le chemin est avant tout représenté par une ligne droite, symbole de progression et d’avancée. Mais la linéarité est aussi ce qui caractérise le temps. Cependant, avant leur départ, nos personnages vivaient dans un univers où l’immuabilité des traditions donnaient au temps un caractère circulaire. Rien ne devait évoluer un jour. Ce qui se produisait une fois se reproduisait définitivement. Tout semblait irrémédiablement tourné vers le passé. Ce n’est qu’après avoir franchi l’étape du départ et oser briser le cercle que nos personnages seront projetés sur la ligne du temps. Ils devront vivre dans le présent et oublier leur passé stérile. C’est ce que stipule Jean-Xavier Ridon à propos de Le Clézio : « le désir nomadique provoque un devenir amnésique, une marge d’oubli où tout semble pouvoir se réinventer. L’oubli serait en fait le signe d’une présence retrouvée»[438]. On perçoit en effet cela dans les œuvres de notre corpus. Le chamelier explique à Santiago que seul importe le moment présent. Vivre dans le passé ne rend pas heureux : « je ne vis ni dans mon passé ni dans mon avenir. Je n’ai que le présent, et c’est lui seul qui m’intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux »[439]. Le Clézio et son grand-père se sont également donnés comme philosophie de tirer un trait sur leur vie antérieure : « je ressens cela, j’oublie tout. Comment lui, qui était seul dans ce désert âpre, n’aurait-il pas oublié souvent la raison qui l’avait conduit là ? Il ne cherchait plus rien alors, il ne voulait plus rien. Il était seulement là, près du sol, près des pierres noires, brûlé par le soleil et entouré par le vent, confondu, capturé par la beauté de l’existence »[440]. Le narrateur de Timimoun est continuellement obsédé par un passé désastreux qu’il a du mal à oublier. Ce n’est que lorsqu’il revient à Alger qu’il éprouve un sentiment de « délivrance » et/ou de « soulagement »[441]. Il avoue également que « la nostalgie a quelque chose de poisseux »[442]. Les personnages brisent donc la ligne du temps en ne considérant comme valable que le présent. Mais à côté de ce chemin « temporel » structuré selon le rythme ternaire passé/présent/avenir, existe l’autre chemin, géographique celui-là, qui sert de fil d’Ariane pour se diriger dans un désert labyrinthique.
Il est tout d’abord visible dans la construction matérielle même du roman, qui est délimité par un début, un milieu et une fin. L’écriture se déploie dans l’espace et dans le temps selon un rythme inchangeable : les lettres constituent des mots ; ces mêmes mots deviennent des phrases, qui se transforment en paragraphe puis en chapitre, jusqu’à la clôture finale du récit. Le sens est donc toujours en perpétuelle construction, empruntant le chemin imposé par l’écriture. Toute oeuvre littéraire est donc linéaire : le roman par exemple « entretient avec le temps un rapport primordial, comme la peinture avec l’espace. La peinture est un espace qui dit l’espace. Le cinéma joue sur les deux tableaux : il est un espace qui dit l’espace et un temps qui dit le temps. Certes le roman évoque l’espace, mais il ne le fait que par une suite de lignes imprimées qu’il faut bien lire à la suite et qu’il faut du temps pour lire »[443], écrit Michel Raimond.
Le tracé emprunté par le chauffeur de Timimoun suit cet agencement départ/trajet/arrivée : chaque chapitre du roman constitue une étape du voyage. Le bus suit un chemin toujours balisé, comme le montre Lila Ibrahim dans « promenade exotique à Timimoun de R. Boudjedra ». D’ailleurs, ce dernier l’écrit explicitement dans son roman : « les torchères des champs pétroliers. Elles sont toujours là. Elles jalonnent le désert, le balisent et le flèchent pour ainsi dire »[444]. Dans son journal, J. M. G. Le Clézio, suit un parcours qui n’est pas aléatoire car il prend pour repères les empreintes laissées par son grand-père : « je marche sur ses traces, je vois ce qu’il a vu »[445]écrit-il. Qui plus est, l’auteur et son grand-père se déplacent sur l’île en fonction de la carte qu’ils ont entre les mains. Celle-ci quadrille chaque parcelle de terrain au point de supprimer toute possibilité de découverte : « sans ces tracés de lignes, mesures d’angles, repérages, axes est-ouest, calculs méticuleux des points, est-ce que cette terre aurait existé, est-ce qu’elle aurait eu une signification, est-ce qu’elle aurait pris forme sous ses yeux [...] ? » [446]. Quant au protagoniste de L’Alchimiste, il semble parcourir comme le narrateur de Timimoun, un itinéraire irrémédiablement identique : « il connaissait par cœur toutes les villes de la région »[447] avoue Paulo Coelho.
 Cette
linéarité du parcours apparaît précisément dans le champ lexical du chemin. Nos
auteurs ne cessent d’employer ce terme pour définir l’itinéraire des
personnages. James Burty David n’omet pas de signaler cet aspect de l’œuvre
chez Paulo Coelho : « les grands récits mythologiques et initiatiques
sont pour la plupart organisés autour du thème d’un voyage, avec ses épreuves,
ses combats et ses victoires. De nombreux contes sont également construits sur
des traversées […] Les pèlerinages aussi […] En effet, ce nomadisme est une
démarche vers la découverte de soi. Pour atteindre ce « côté secret »
(autre expression de Coelho) de l’être, il faut oser prendre la route, comme
Santiago, jusqu’au bout de soi. Le chemin vers la Légende Personnelle n’est
autre que celui de la quête de la Sagesse. Dans l’Alchimiste, ce chemin
(une traversée du désert à l’instar des grands initiés) va d’une vieille église
abandonnée au temple-Pyramide »[448].
De plus les véhicules sont ceux qui symbolisent le mieux cette idée de chemin à
parcourir : « la caravane cheminait de jour comme de
nuit » ; « quand la marche du temps s’accélère, les caravanes
aussi se hâtent[449] »
écrit Paulo Coelho.
Cette
linéarité du parcours apparaît précisément dans le champ lexical du chemin. Nos
auteurs ne cessent d’employer ce terme pour définir l’itinéraire des
personnages. James Burty David n’omet pas de signaler cet aspect de l’œuvre
chez Paulo Coelho : « les grands récits mythologiques et initiatiques
sont pour la plupart organisés autour du thème d’un voyage, avec ses épreuves,
ses combats et ses victoires. De nombreux contes sont également construits sur
des traversées […] Les pèlerinages aussi […] En effet, ce nomadisme est une
démarche vers la découverte de soi. Pour atteindre ce « côté secret »
(autre expression de Coelho) de l’être, il faut oser prendre la route, comme
Santiago, jusqu’au bout de soi. Le chemin vers la Légende Personnelle n’est
autre que celui de la quête de la Sagesse. Dans l’Alchimiste, ce chemin
(une traversée du désert à l’instar des grands initiés) va d’une vieille église
abandonnée au temple-Pyramide »[448].
De plus les véhicules sont ceux qui symbolisent le mieux cette idée de chemin à
parcourir : « la caravane cheminait de jour comme de
nuit » ; « quand la marche du temps s’accélère, les caravanes
aussi se hâtent[449] »
écrit Paulo Coelho.
Dans Voyage à Rodrigues, le Privateer sur lequel embarqua le grand-père de l’auteur avance sur les mers sans interruption, comme s’il glissait perpétuellement vers son objectif. Le Clézio ne peut pas s’empêcher de le comparer au navire Argo, « le vaisseau fatidique qui, dirigeant sa course à travers les écueils trompeurs, osa voguer à la recherche du Phase, en Scythie, et qui enfin trouva le repos dans l’Olympe illuminé »[450].
Dans le roman de Rachid Boudjedra, Extravagance semble devoir toujours avancer selon un rythme effréné : « le car, dans l’obscurité, donne, cependant, l’impression de filtrer à travers les phénomènes abstraits et les éléments minéraux qui portent la calcination du monde à la démesure »[451]. Néanmoins, si les personnages s’efforcent de suivre un chemin balisé, ils se retrouveront tôt ou tard face à un carrefour où ils devront eux-mêmes choisir l’itinéraire à emprunter.
2. La liberté
Rachid Boudjedra a toujours évoqué le
problème de la censure dans la littérature maghrébine en général. Cette censure
prive les écrivains de liberté et les empêche de déployer toute forme de
subjectivité : « l’impact de la société est trop important, trop
énorme et trop lourd. L’écrivain arabe est souvent son propre ennemi et son propre
censeur parce qu’il est bloqué en lui-même et bloqué dans une société qui ne
bouge pas assez vite. Cela s’appelle le sous-développement mental »[452].
Rachid Boudjedra ne se considère pas de cette école là car il est un ardent
défenseur de la liberté de penser : « il existe une génération qui
est la mienne, d’ailleurs, qui essaye justement de donner à la subjectivité son
importance et sa place et qui commence à se donner à voir dans les
textes »[453]. L’exemple
du personnage principal de Timimoun s’accorde par exemple des libertés
que beaucoup n’auraient pas osé revendiquer. Le jour de l’enterrement de son
frère, le narrateur a par exemple choisi de ne pas assister aux
funérailles : « j’avais donc préféré rester dans le jardin pour
éviter tout ce tintamarre et toute cette mise en scène funéraires que les
familles apprécient tant »[454].
En outre, le guide enfreint les a priori en empruntant les itinéraires
déconseillés. Il y a là aussi une forme de liberté incontestable :
« En tant que guide, je prenais tous les risques et il m’arrivait de
conduire Extravagance sur des pistes interdites et non balisées à travers le
terrible désert pour essayer de me perdre »[455].
« J’évitais les grands axes et préférais les pistes parfois dangereuses »[456]
écrit-il.
La même image apparaît dans L’Alchimiste.
Santiago, plutôt que d’emprunter un itinéraire connu et vide de surprise,
préfère s’égarer en n’écoutant que ses sentiments : « chaque fois que
c’était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire »[457]
nous dit Paulo Coelho. Le jeune homme arrive donc à prendre des décisions par
lui-même : c’est la raison pour laquelle il n’utilise pas « Ourim et
Toumim », ces deux pierres qui en cas de doute lui permettent d’avoir une
réponse affirmative ou négative à la question qu’il s’est posée.
Dans Voyage à Rodrigues, Le
Clézio ne peut pas suivre à la lettre les plans de son aïeul Alexis car ceux-ci
sont « déjà à demi effacés par le temps »[458].
Il doit donc faire preuve d’intuition et s’accorder une certaine liberté pour
retrouver les traces laissées par son grand-père. Ce dernier, quand il est
arrivé sur l’île, a également pu découvrir Rodrigues à son rythme, en suivant
ses instincts, car il était le premier à vouloir faire une carte du lieu :
« il doit tout reconnaître, tout nommer. Les plans qu’il élabore, année
après année, depuis 1902, les cartes qu’il établit sur la carte de l’Amirauté
britannique, et qu’il colorie à l’aquarelle […]-les schémas où apparaissent les
réseaux de lignes, les angles, les reliefs, les cercles et les ellipses qui
semblent chercher à prendre sa chimère dans leur piège-les calculs compliqués,
les annotations, les relevés des jalons- tout cela est sa reconnaissance du
lieu, sa marque de passage, peut-être son calendrier »[459].
Mais la seule liberté reste pour l’auteur celle des « oiseaux de
l’océan »[460],
que lui et son grand-père admirent de la même façon.
 Mais cette
liberté d’orientation n’a pas que des avantages. En choisissant un itinéraire
que l’on ne connaît pas, on risque facilement de s’égarer pour ne plus jamais
se retrouver. Dans notre corpus, les déserts ont d’ailleurs un aspect
labyrinthique (cf. image[461]).
A cet égard, une description que Boudjedra fait du désert dans Timimoun
est révélatrice. Le Sahara est décrit comme un enchevêtrement complexe
d’éléments naturels : « j’emprunte des pistes difficiles et des
plateaux inaccessibles, parsemés de blocs rocheux capables de se mouvoir, en
une semaine, sur des centaines de mètres sous l’effet du vent et de l’érosion
qui créent un relief tourmenté et lunaire aux formes étranges, toujours
mobiles, toujours en déplacements, avec, brusquement, dans ces régions
sahariennes, des oasis complètement isolées du monde, entourées de rivières
souterraines, étroites mais longues de centaines de kilomètres, au fond de
canons entaillés et basaltiques »[462].
Le narrateur de Timimoun dit également qu’il sent « les autres
occupants du car quelque peu perdus »[463].
Il avoue aussi ne pas avoir de repères fiables dans sa famille : « je
me sentis perdu dans cette famille »[464]
écrit-il.
Mais cette
liberté d’orientation n’a pas que des avantages. En choisissant un itinéraire
que l’on ne connaît pas, on risque facilement de s’égarer pour ne plus jamais
se retrouver. Dans notre corpus, les déserts ont d’ailleurs un aspect
labyrinthique (cf. image[461]).
A cet égard, une description que Boudjedra fait du désert dans Timimoun
est révélatrice. Le Sahara est décrit comme un enchevêtrement complexe
d’éléments naturels : « j’emprunte des pistes difficiles et des
plateaux inaccessibles, parsemés de blocs rocheux capables de se mouvoir, en
une semaine, sur des centaines de mètres sous l’effet du vent et de l’érosion
qui créent un relief tourmenté et lunaire aux formes étranges, toujours
mobiles, toujours en déplacements, avec, brusquement, dans ces régions
sahariennes, des oasis complètement isolées du monde, entourées de rivières
souterraines, étroites mais longues de centaines de kilomètres, au fond de
canons entaillés et basaltiques »[462].
Le narrateur de Timimoun dit également qu’il sent « les autres
occupants du car quelque peu perdus »[463].
Il avoue aussi ne pas avoir de repères fiables dans sa famille : « je
me sentis perdu dans cette famille »[464]
écrit-il.
Dans l’Alchimiste, le désert a
aussi un aspect labyrinthique, comme l’écrit James Burty David: « le
désert devient labyrinthe comme la forêt que traversent le Petit Poucet et ses
frères. Comme celle où s’engage le Prince Charmant pour découvrir la Belle au
bois dormant. On peut s’y perdre ou s’y retrouver. C’est le sens même du
labyrinthe »[465].
Une description que fait Paulo Coelho montre à quel point le désert est un lieu
dangereux si l’on s’y perd : « dans le désert, la désobéissance signifie
la mort »[466].
L’île Rodrigues est aussi, d’après Le
Clézio, semblable à un authentique labyrinthe tant les plans du grand-père sont
alambiqués : « alors que le monde bascule dans la première tragédie
universelle, il ne voit rien d’autre, n’entend rien d’autre que le bruit de sa
quête, et c’est alors que le labyrinthe a atteint le comble de sa
complication »[467].
C’est dans le labyrinthe que les personnages se perdront car ils hésiteront sur
les directions à prendre. A la croisée de différents chemins, ils devront
régulièrement faire face à diverses épreuves pour pouvoir avancer, le carrefour
étant avant tout le lieu de l’inconnu, où l’homme doit affronter différentes
épreuves pour pouvoir poursuivre sa quête.
3. Les rites initiatiques
Dans toute initiation, l’initié doit arriver au centre du labyrinthe pour que naisse la consécration suprême : la connaissance de soi. Pour se faire, l’élu devra passer par différents rites initiatiques, bien représentés dans les œuvres de notre corpus. Nos personnages sont portés par un principe ascensionnel, qui les fait passer de l’ombre à la lumière, du profane au sacré.
Dans le roman Timimoun, le personnage principal effectue certes une « Descente aux Enfers » en allant dans le Sahara. Preuve en est, le narrateur effectue d’abord son trajet d’Alger à Timimoun, c’est-à-dire du nord au sud, du haut vers le bas. Cependant, il y a progression car le retour vers Alger se fait selon un itinéraire ascensionnel, du sud vers le nord. En outre, dans l’imaginaire maghrébin, le sud (les pays d’Afrique du nord) signifie l’origine, la tradition, et le nord (les pays d’Europe) la « civilisation ». Le soucis de passage de l’un à l’autre symbolise donc une la volonté de modernisation, révélatrice d’un principe ascensionnel. Cette idée de progrès est visible dans notre roman : le personnage principal part en effet en Europe avec la volonté de se construire un avenir en achetant un bus. Le franchissement de dunes est aussi représentatif de cette avancée initiatique. Pour que celle-ci se fasse, le protagoniste passe par différents rites de passage. Dans notre roman, cela se traduit par exemple par le fait que le personnage se mette à boire de l’eau pour satisfaire Sarah : « je me suis mis à l’eau, depuis quelques jours, parce que Sarah me dit un soir, sans avoir l’air de s’adresser à quelqu’un en particulier : « Vous buvez trop ! » Je voulus lui plaire. Je restai plusieurs jours sans toucher un verre de vodka. Cela me fit du bien »[468]. Le narrateur passe donc d’une boisson qui exalte de manière impure les désirs à l’eau, instrument de purification rituelle en Islam. Symbole de vie spirituelle, l’eau est une étape de la quête identitaire. De plus, Timimoun est une oasis réputée pour son système d’irrigation : « chaque opération de partage de l’eau donne l’occasion d’une répartition du débit initial en débits dérivés, puis en débits sous-dérivés, donc en nouvelles canalisations dont le nombre se multiplie à l’infini »[469] Le fait que le personnage passe par cette ville « aquatique » n’est pas innocent. C’est une opportunité pour le narrateur de se régénérer. D’ailleurs, tous les lieux de pèlerinage ont une source. Le narrateur va également se baigner à Timimoun, le bain ayant aussi sur lui des vertus purificatrices et régénératrices : « Il m’arrivait d’avoir des envies de tuer Sarah. Je me dépêchais alors d’aller vite nager dans les torrents des gueltas situés à une trentaine de kilomètres de Timimoun. Je me propulsais dans un vertige d’eau pure, comme pour me nettoyer de tous ces désirs avortés et de toutes ces bribes d’érotisme où j’entrevoyais la blancheur démente du corps de Sarah à portée de main »[470].
Il y aussi dans Voyage à Rodrigues des représentations du principe ascensionnel. Comme chez Boudjedra, l’itinéraire de Le Clézio s’oriente d’abord dans la direction Nord-Sud au début du voyage, car l’auteur part de France pour aller à Rodrigues. Le trajet du retour est au contraire ascensionnel car Le Clézio suit un itinéraire Sud-Nord. Dans une échelle plus restreinte, l’auteur signale dans le chapitre central du journal l’importance du ravin dans la quête de son grand-père. Le ravin est certes le lieu où le trésor est caché, mais étant sous terre et en profondeur, l’assimilation à la caverne platonicienne en fait la représentation même de la souffrance, de l’ignorance et de la punition. L’auteur ne se prive d’ailleurs pas de le décrire de manière péjorative : « il y a la mort ici, dans le fond de ce ravin. Eau morte, pierres brûlées, schistes pourris, buissons d’épines qui ferment le passage : le ravin ressemble à la porte de l’Hadès »[471]. Le ravin est donc l’aboutissement du labyrinthe : « la première fois que j’ai vu le ravin, j’ai compris que c’était ici, le lieu le plus important de ce rêve, le centre de la quête de mon grand-père »[472]. Il est l’endroit où toutes les droites du plan se croisent : « le ravin est devenu le lieu de rencontre de toutes les lignes reliant entre eux les repères du plan général de la vallée »[473]. Mais son caractère central en fait donc le lieu de la naissance, de la régénération, de l’initiation[474]. C’est une matrice analogue au creuset des alchimistes : c’est effectivement au sortir de la caverne que le J. M. G. et Alexis Le Clézio termineront leur quête de soi et accèderont à la connaissance ultime : « tandis que j’avance pour la première fois au fond du ravin, je ressens une vive émotion : c’est ici, je ne puis en douter, ici et nulle part ailleurs. Je vois ce que je suis venu chercher à Rodrigues : les traces visibles de cet homme, restées apparentes par le miracle de la solitude »[475]. Le fait de traverser la mer pour aller à Rodrigues est aussi pour eux un symbole de purification, l’eau nettoyant les esprits de toutes ses pensées impures.
C’est dans l’Alchimiste
que sont visibles plus explicitement les différents rites de passage que devra
subir Santiago pendant son parcours. Il fera d’abord comme Le Clézio et le
narrateur de Timimoun un itinéraire Nord-Sud puis Sud-Nord, ce dernier
représentant un principe ascensionnel. Le franchissement des dunes est aussi
révélateur, comme chez Boudjedra, d’une progression identitaire. En outre, Santiago
doit comme le grand-père de Le Clézio creuser pour trouver son trésor enseveli
sous terre. Lors de cette recherche, il vit un véritable enfer car il est battu
à mort par des brigands. Ce n’est qu’au sortir de la grotte qu’il accèdera à la
lumière. Les pyramides symbolisent aussi ce principe ascensionnel du fait de
leur architecture. Elle servent d’intermédiaires entre les cieux et la terre,
entre Dieu et les Hommes. Comme chez les autres auteurs, le symbolisme de l’eau
comme élément purificateur apparaît bien dans l’œuvre. L’eau est appelée materia
prima par les alchimistes car elle est source de régénération. C’est ce que
souligne Burty David dans son essai : «symboliquement, la mort par 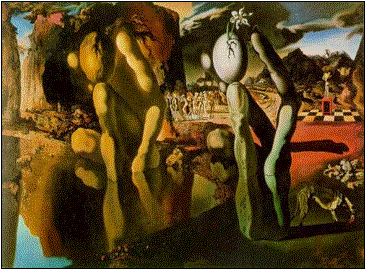 l’eau
débouche sur une transformation. C’est le début d’une vie régénérée, car le
néophyte en quête d’infini retourne aux eaux originelles, se purifie et reprend
le cycle de la vie. La Genèse rapporte que la terre et la race Humaine ont
elles aussi été régénérées par le déluge. Destruction et régénération. Mort et
vie. L’ancien disparaît pour permettre à une vie nouvelle de s’épanouir »[476].
Dès le début du récit Paulo Coelho évoque l’histoire de Narcisse
« ressuscité » des eaux après sa mort -comme Dali dans la peinture
ci-dessus[477]- : «
L’Alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait
tous les jours contempler sa propre beauté dans l’eau d’un lac. Il était si
fasciné par son image qu’un jour il tomba dans le lac et s’y noya. A l’endroit
où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse »[478].
Une fois embarqué sur le « fleuve de la vie », le personnage
principal sera aussi à différentes reprises régénéré par les eaux. Ainsi, la
traversée de la mer au détroit de Gibraltar pour aller en Afrique fera office
de première purification. Et ce n’est pas un hasard si l’oasis de Fayoum est un
des lieux les plus importants de la quête. Il y a effectivement une quantité
d’eau rare étant donnée la sécheresse du désert environnant. Qui plus est, la
plus belle rencontre de Santiago se fera auprès d’un puits. C’est à côté d’une
source d’eau que le jeune berger découvrira l’Amour. Il repartira donc de
l’oasis complètement métamorphosé : « tout l’Univers a conspiré à me
faire arriver jusqu’à toi »[479]
avoue-t-il à Fatima.
l’eau
débouche sur une transformation. C’est le début d’une vie régénérée, car le
néophyte en quête d’infini retourne aux eaux originelles, se purifie et reprend
le cycle de la vie. La Genèse rapporte que la terre et la race Humaine ont
elles aussi été régénérées par le déluge. Destruction et régénération. Mort et
vie. L’ancien disparaît pour permettre à une vie nouvelle de s’épanouir »[476].
Dès le début du récit Paulo Coelho évoque l’histoire de Narcisse
« ressuscité » des eaux après sa mort -comme Dali dans la peinture
ci-dessus[477]- : «
L’Alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait
tous les jours contempler sa propre beauté dans l’eau d’un lac. Il était si
fasciné par son image qu’un jour il tomba dans le lac et s’y noya. A l’endroit
où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse »[478].
Une fois embarqué sur le « fleuve de la vie », le personnage
principal sera aussi à différentes reprises régénéré par les eaux. Ainsi, la
traversée de la mer au détroit de Gibraltar pour aller en Afrique fera office
de première purification. Et ce n’est pas un hasard si l’oasis de Fayoum est un
des lieux les plus importants de la quête. Il y a effectivement une quantité
d’eau rare étant donnée la sécheresse du désert environnant. Qui plus est, la
plus belle rencontre de Santiago se fera auprès d’un puits. C’est à côté d’une
source d’eau que le jeune berger découvrira l’Amour. Il repartira donc de
l’oasis complètement métamorphosé : « tout l’Univers a conspiré à me
faire arriver jusqu’à toi »[479]
avoue-t-il à Fatima.
Il y a dans le conte de Paulo Coelho d’autre symbole de purification. Le sable du désert est par exemple symbole de purification rituelle, comme l’eau. En effet, il épouse les formes qui se moulent à lui, s’apparentant ainsi à une matrice. Le plaisir qu’on éprouve à marcher dans le sable s’apparente au regressus ad uterum des psychanalystes. C’est en effet une recherche de plaisir, de repos, de régénération : « il se releva et se mit en marche en direction des palmiers. Une nouvelle fois, il percevait les multiples langages des choses : maintenant, c’était le désert qui était la sécurité »[480]. Le sable est également la matière première du cristal, pierre intermédiaire entre le visible et l’invisible du fait de sa transparence. Le fait que le personnage principal nettoie les pierres précieuses du Marchand de Cristaux est aussi révélateur d’une purification. En enlevant la poussière déposée sur les cristaux, Santiago se purifie en quelque sorte de ses pensées impures : « ce n’était pas la peine de nettoyer quoi que ce soit. La loi coranique oblige à donner à manger à quiconque a faim. – Mais alors, pourquoi m’avez-vous laissé faire ce travail ? demanda le jeune garçon. –Parce que les cristaux étaient sales. Et toi comme moi avions besoin de nettoyer nos têtes de mauvaises pensées »[481]. Le fait que le personnage se sépare de ses vieux vêtements pour nettoyer les cristaux symbolise aussi un rite de passage vers un état meilleur, un désir de purification absolu : « dans sa besace, il y avait le manteau, et il n’en aurait plus besoin dans le désert. Il le sortit, et se mit à nettoyer les vases »[482].
Le fait que Santiago soit blessé au front par la pointe de l’épée de l’Alchimiste peut être apparenté au rituel du baptême : « il baissa la tête pour recevoir le coup de sabre […] L’arme, cependant, ne s’abaissa pas brutalement. La main du cavalier descendit lentement, et la pointe de la lame vint toucher le front du jeune homme. Elle était si aiguisée qu’une goutte de sang perla »[483]. Après ce geste le personnage sera officiellement un néophyte que l’Alchimiste devra initier, comme le souligne Lilas Voglimacci dans son essai sur le conte de Paulo Coelho : « c’est aussi dans la grande tradition de l’adoubement qu’il marque le jeune homme d’une perle rouge au front […] En réalité, c’est encore, c’est toujours, la Main qui désigne et qui donne le feu sacré. Par cette bénédiction(cf. image ci-contre[484]), cette incision aussi, l’Esprit peut habiter l’Homme et l’inspirer. Ce souffle qui entre par la goutte de sang est bien le baptême de notre petit berger, devenu dès cette seconde un fils du Monde »[485]. Dès lors, après avoir subi les différents rites de passages nécessaires à toute forme d’initiation, les protagonistes quitteront leur situation de déraciné pour retourner chez eux et acquérir une sagesse qu’ils n’auraient jamais imaginée.
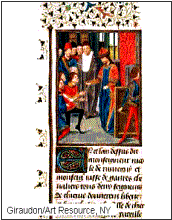
VI.
La sagesse de l’exil
A.
Le retour aux
sources
1. L’originaire originel
« je suis encore gisant au fond de l’océan sans forme »
J. M. G. Le
Clézio[486]
Une fois le trésor trouvé, c’est-à-dire une fois la quête de soi effectuée, les personnages retourneront chez eux, reviendront au lieu des origines. A la différence du déraciné qui ne revient plus sur sa terre de naissance, l’exilé effectue toujours un retour vers le lieu des origines : « on n’est un exilé que parce que l’on sait d’où l’on vient et où l’on va »[487] écrit Shmuel Trigano. Cependant, le lieu des origines paraîtra aux personnages complètement différent. Et sans l’exil, cette différence n’aurait pas été perçue car l’enraciné n’est pas conscient de sa véritable nature. Pour l‘exilé, le retour aux sources ne sera pas retour vers un originaire caduc, mais une rencontre avec l’originel mythique. C’est ce qu’explique Shmuel Trigano : « dans ce retour, l’exil n’est pas en effet annulé par une reconstitution à l’identique de la terre originaire. Il y a bien un retour à une terre concrète et réelle, mais cette terre s’inscrit désormais dans l’originel. La présence que l’originaire recelait se voit alors immergée dans une présence plus grande, jaillissant de l’originel. La terre y était devenue « promise », instance de parole. La terre ne change pas, en fait, mais l’exilé, qui cesse d’être un déraciné. C’est comme si son identité se voyait alors restructurée, définie non plus par rapport à l’originaire - rapport de l’identique- mais rapport à l’originel, caché dans et par l’originaire et référence de l’endehors identique »[488]. Du fait de l’exil, le lieu du retour sera par conséquent perçu dans nos œuvres comme originel.
C’est le cas dans l’Alchimiste, comme le montre James Burty David : « c’est dans sa relation avec la transfiguration de l’âme qu’il faut comprendre l’alchimie, ce processus de croissance vers la perfection. Il s’agit d’une voie mystérieuse et miraculeuse que l’initié emprunte pour retrouver l’état originel »[489]. Dans le conte de Paulo Coelho, l’auteur considère donc le retour de Santiago à la vieille église abandonnée comme un retour vers soi-même, un retour vers l’état originel. D’ailleurs, le début et la fin de l’Alchimiste ont lieu au même endroit, et l’auteur décrit à deux reprises avec des termes identiques la position de Santiago dans la vieille église: « le jour déclinait lorsqu’il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée » / « il arriva à la petite église abandonnée alors que la nuit était déjà tout près de tomber » ; « le toit s’était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à l’emplacement où se trouvait autrefois la sacristie » / « le sycomore poussait toujours dans la sacristie, et l’on pouvait toujours apercevoir les étoiles au travers de la toiture à demi effondrée » ; « il décida de passer la nuit dans cet endroit » / « il se souvint qu’une fois il était venu là avec ses brebis et qu’il avait passé une nuit paisible » ; « il se leva et but une gorgée de vin » / il tira de sa besace une bouteille de vin, et en but », etc. L’étrange similitude entre le prologue et l’épilogue est là pour révéler que derrière l’originaire se cache toujours l’originel. Et ironie de Paulo Coelho, l’étymologie du nom sycomore révèle que celui-ci symbolise le « lieu de l’or ».
Le Clézio explique dans Voyage à Rodrigues, l’importance de la maison Euréka pour lui et pour toute sa famille. Cette demeure est en effet le lieu d’une origine non-corrompue, et y retourner devient une étape du cheminement vers l’originel absolu. Seul l’exil permet de comprendre l’importance d’Euréka dans la quête de soi : « aucune autre maison n’aura jamais d’importance, aucune n’aura autant d’âme. S’il n’y avait eu Euréka, si mon grand-père n’en avait été chassé avec toute sa famille, sa quête de l’or du Corsaire n’aurait pas eu de sens. Cela n’aurait pas été une aventure aussi inquiétante, totale »[490] écrit l’auteur. Le Clézio écrit d’ailleurs que ses actes et ses pensées viennent « d’avant sa propre naissance »[491]. Sa conception du temps est également subversive : « ce que je conçois, plutôt, c’est un avenir qui serait un retour vers une origine »[492] écrit-il dans Ailleurs.
Rachid Boudjedra montre que la quête du narrateur de Timimoun passe aussi par un retour vers l’état originel. Comme pour Le Clézio et Santiago, la cause de l’exil du personnage réside dans un passé peu glorieux mais dans lequel il est nécessaire de retourner pour affirmer une véritable conscience de soi. Le narrateur avoue se situer dans « un contexte général difficile à décrypter dans lequel [il se ] perdai[t] totalement et dont l ‘explication était profondément enfouie dans [s]on passé ». Le narrateur affirme même clairement que la source de son errance dans le désert est due à un « dégoût originel »[493] qu’il a du mal à exorciser.
Une fois retrouvé leur « moi » originel, les personnages pourraient revivre sur leur terre d’origine la même vie stérile qu’avant leur départ. Mais ce n’est pas le cas : ils accèderont effectivement malgré eux à une nouvelle naissance : « le retour d’exil n’est pas un réenracinement. Si le « retour aux sources » -qui est le désir de l’enraciné- est illusoire parce qu’il équivaut à refaire corps avec la terre perdue, le retour d’exil vaut pour l’exilé comme une renaissance, une résurrection » écrit Trigano.
2. La re-naissance
« je suis mort, vivant, mort, vivant, mort, vivant, des millions de fois mort et vivant »
J. M. G. Le
Clézio[494]
Une fois de retour au lieu des origines, les personnages sembleront métamorphosés, tout se passant comme s’ils accédaient à une nouvelle naissance. L’image de la graine qui doit mourir pour renaître est particulièrement révélatrice de cette re-naissance finale. Cette dernière révèlera le « moi » authentique et l’identité propre des personnages. La re-naissance devient une co-naissance de soi. Dans le roman de Rachid Boudjedra, la renaissance du narrateur passe par le fait qu’il assume enfin son homosexualité. Dans tout le récit, cette homosexualité n’était pas pleinement révélée mais elle était néanmoins suggérée entre les lignes : « les femmes, j’en avais peur »[495] écrit le narrateur. Si cette aversion pour le sexe faible suggère une attirance pour les hommes, le narrateur avoue avoir une part féminine en lui : il aime par exemple « faire ces choses généralement dévolues aux femmes ». Ironie certaine de Boudjedra, le narrateur en arrive même à comparer l’arrivée du sentiment amoureux chez lui à une « sorte de grossesse ou de montée de lait »[496]. Et le désir qu’il a de « couper net [s]on sexe »[497] révèle aussi une sexualité mal assumée. Cette attirance pour les hommes est aussi suggérée au fil du roman par le fait que le narrateur assimile la femme dont il est amoureux à son ami d’enfance, Kamel Rais. Sarah ressemble effectivement à ce dernier. Le narrateur ne cesse de la comparer à un garçon : « ce grand corps souple. Cette peau mate. Ce buste plat. Ces manières de garçon »[498]. A la fin du roman, le narrateur se rendra compte que Sarah ressemble de manière stupéfiante à Kamel Raïs : « brusquement, je réalise qu’elle est presque le sosie de Kamel Raïs quand il était adolescent. Mêmes yeux entre le bleu et le violet. Mêmes cils longs et recourbés. Même allure dégingandée. Même visage sculpté ». Face à cet événement, le narrateur est obligé de se rendre à l’évidence que son « admiration pour Kamel Raïs » n’était pas gratuite mais révélatrice d’une homosexualité non assumée. Et c’est « cette révélation incroyable et troublante » qu’il vient de faire qui est signe certes de réconciliation avec soi-même, mais aussi de renaissance à part entière : « je me sentais un autre homme »[499] avoue le narrateur. Notons que dans Timimoun, l’ambiguïté de la sexualité du narrateur est telle qu’il pourrait finalement se révéler être un androgyne (le narrateur ne se dit-il pas « asexué »[500] ?). La quête de soi serait alors parfaite. L’androgynie représente en effet, du fait de la fusion entre le masculin et le féminin, une abolition des contraires, c’est-à-dire un état de totalité absolu. Notons que Paulo Coelho attache aussi beaucoup d’importance à la part féminine de chaque être : « je me sens à la fois homme et femme »[501] confie-t-il à Juan Arias.
Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio semble renaître à la fin du Journal car il devient autre. Il accède enfin à son identité propre : le Corsaire inconnu qu’il s’est évertué à chercher se révèlera finalement n’être que lui-même : « un instant, dans ce paysage minéral, avec ce vent, ce soleil, cette lumière, j’ai été celui que je cherchais ! Non plus moi, ni mon grand-père, mais le Corsaire inconnu »[502]. Il y a donc eu une véritable évolution chez le narrateur : si au début du Journal il se demande pourquoi son grand-père est venu à Rodrigues, il est à la fin de l’œuvre convaincu de la raison de son exil : « je peux comprendre pourquoi mon grand-père a porté la plupart des recherches de ce côté. Je peux comprendre comment il a pu vivre dans cette brèche, mois après mois, année après année »[503].
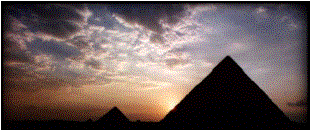 James
Burty David établit un parallèle entre la démarche initiatique de Moïse et
celle du berger Santiago : « quand il se relève au pied du buisson
ardent pour entendre la voix de ce Dieu qui s’impose comme le « Je
suis », Moïse est un être métamorphosé. Il est à la fois le Libéré et le
Libérateur. Le désert, ce lieu de la nudité, du vide et du silence est
également celui de la découverte de soi et de la re-naissance »[504].
Après son épreuve du baptême en plein désert, Santiago renaîtra dans la mesure
où il sera l’Apprenti de l’Alchimiste. Il passera de la condition de berger à
celle d’Alchimiste. Il sera la représentation de l’évolution du passage du
plomb à l’or, du métal vil au métal noble. Cette évolution est aussi
représentée par le fait que Santiago retrouve son prénom à la fin du roman. En
effet, Paulo Coelho ne l’avait appelé Santiago qu’au début du conte, se
contentant par la suite de parler de lui en tant que simple « jeune
homme ». Le fait que Santiago arrive finalement aux pieds des pyramides
n’est pas anodin. C’est en effet le lieu idéal pour une nouvelle naissance car
les pyramides représentent le passage de la Terre au Ciel, du Matériel au
Spirituel. Comme le souligne Lilas Voglimacci, la pyramide n’est pas chez Paulo
Coelho signe d’évolution sociale : « Paulo Coelho dit tranquillement
que la démonstration du brillant jeune cadre dynamique, issu d’une superbe
université, est fausse. La fortune ne se trouve pas au sommet mais à la base.
Mieux, sous la terre, dans les racines d’un vieil arbre, dans un édifice en
ruine. L’image de la pyramide que le monde de la finance ou des affaires
utilise est usurpée. Elle est manipulée »[505].
Santiago, a la fin de l’alchimiste, trouve sa fortune en réalisant sa
« Légende Personnelle ». La célèbre doctrine alchimique ayant pour
initiales VITRIOL prend alors tout son sens : « visita interiorem
terrae rectificando invenies operae lapidem » soit « Descends au
plus profond de toi-même et trouve le noyau insécable, sur lequel tu pourras
bâtir une autre personnalité, un homme nouveau ». Mais ce baptême auquel
prétendent les protagonistes sera sans doute le dernier car il est un accessit
à la vie éternelle. En effet, une fois transformés en or, symbole d’absolue
perfection, les personnages n’auront plus du temps une image négative. Le temps
sera pour eux synonyme de pérennité : « à quel type de bonheur ouvre
l’exil ? A un bonheur libéré de l’hypothèque de la mortalité »[506]
écrit Trigano.
James
Burty David établit un parallèle entre la démarche initiatique de Moïse et
celle du berger Santiago : « quand il se relève au pied du buisson
ardent pour entendre la voix de ce Dieu qui s’impose comme le « Je
suis », Moïse est un être métamorphosé. Il est à la fois le Libéré et le
Libérateur. Le désert, ce lieu de la nudité, du vide et du silence est
également celui de la découverte de soi et de la re-naissance »[504].
Après son épreuve du baptême en plein désert, Santiago renaîtra dans la mesure
où il sera l’Apprenti de l’Alchimiste. Il passera de la condition de berger à
celle d’Alchimiste. Il sera la représentation de l’évolution du passage du
plomb à l’or, du métal vil au métal noble. Cette évolution est aussi
représentée par le fait que Santiago retrouve son prénom à la fin du roman. En
effet, Paulo Coelho ne l’avait appelé Santiago qu’au début du conte, se
contentant par la suite de parler de lui en tant que simple « jeune
homme ». Le fait que Santiago arrive finalement aux pieds des pyramides
n’est pas anodin. C’est en effet le lieu idéal pour une nouvelle naissance car
les pyramides représentent le passage de la Terre au Ciel, du Matériel au
Spirituel. Comme le souligne Lilas Voglimacci, la pyramide n’est pas chez Paulo
Coelho signe d’évolution sociale : « Paulo Coelho dit tranquillement
que la démonstration du brillant jeune cadre dynamique, issu d’une superbe
université, est fausse. La fortune ne se trouve pas au sommet mais à la base.
Mieux, sous la terre, dans les racines d’un vieil arbre, dans un édifice en
ruine. L’image de la pyramide que le monde de la finance ou des affaires
utilise est usurpée. Elle est manipulée »[505].
Santiago, a la fin de l’alchimiste, trouve sa fortune en réalisant sa
« Légende Personnelle ». La célèbre doctrine alchimique ayant pour
initiales VITRIOL prend alors tout son sens : « visita interiorem
terrae rectificando invenies operae lapidem » soit « Descends au
plus profond de toi-même et trouve le noyau insécable, sur lequel tu pourras
bâtir une autre personnalité, un homme nouveau ». Mais ce baptême auquel
prétendent les protagonistes sera sans doute le dernier car il est un accessit
à la vie éternelle. En effet, une fois transformés en or, symbole d’absolue
perfection, les personnages n’auront plus du temps une image négative. Le temps
sera pour eux synonyme de pérennité : « à quel type de bonheur ouvre
l’exil ? A un bonheur libéré de l’hypothèque de la mortalité »[506]
écrit Trigano.
Ce désir d’éternité apparaît clairement dans les œuvres de notre corpus. Pour Le Clézio, l’homme fait partie intégrante du monde et il ne peut en aucun cas se séparer de lui. Même en mourant, on ne disparaît pas car on se fond dans l’immensité terrestre. En ce sens, tout est éternel souligne Le Clézio dans L’Extase matérielle : « pourquoi chercher dans le lointain la réalisation de l’infini et de l’éternel ? L’infini, l’éternel sont ici, présents devant nous. Sous nos pas, sous nos yeux, contre notre peau »[507]. Cette conception de la réalité temporelle est effectivement mise en pratique dans Voyage à Rodrigues. Tout ce que regarde l’auteur et son aïeul semble définitivement éternel, « immuable »[508] comme écrit Le Clézio. Le grand-père de ce dernier est également venu à Rodrigues pour, semble-t-il, rechercher la vie éternelle : « c’est un autre ordre que cherchait mon grand-père, peut-être celui de sa propre destinée. Peut-être ce point inconnu qui ferait coïncider sa vie avec celle de ce mystérieux voyageur qui n’avait laissé qu’une carte de ce lieu en guise de testament, et dont l’aventure lui livrerait, au-delà des barrières de la mort, le trésor brillant des milles feux de la vie éternelle »[509]. Ce souci d’éternité apparaît également dans l’œuvre par le fait que le grand-père de Le Clézio trouve des successeurs à son entreprise. L’histoire du chercheur d’or entre ainsi dans la légende : « mon grand-père a su inspirer des suiveurs dans son rêve, puisque c’est lui qui, le premier, a inventé la légende du trésor de Rodrigues. La légende vit encore […] Le trésor a poussé ses racines dans la mémoire des terriens de l’Anse aux Anglais, la légende fait partie d’eux-mêmes, et beaucoup sont nés avec elle »[510]. Le grand-père de l’auteur, en laissant en suspense la quête du chercheur d’or accède à l’immortalité car il a rendu son entreprise « légendaire »[511].
L’aventure du jeune berger consiste pareillement en la réalisation de sa Légende Personnelle. Lilas Voglimacci a montré qu’effectivement l’aventure que vit Santiago tend à devenir légendaire de part le fait qu’elle est universelle : « ce conte-ci sera ce que sont tous les contes : un petit cours particulier d’éthique personnelle à usage collectif. Pour opérer sur nous, il faut, d’abord, qu’il parle en secret une langue à la fois familière et proche des formules magiques et que, de surcroît, le personnage-acteur soit encouragé par le conteur-narrateur à montrer l’exemple. Parce que cette histoire est un « exemple » pas un « modèle ». Santiago doit être l’illustration indiscutable du possible de l’aventure humaine qui consiste à réussir à créer sa propre légende »[512]. Le personnage accède à l’immortalité en réussissant à accomplir sa Légende Personnelle, et en parvenant à se transformer en vent : « pendant des générations, les Arabes contèrent la légende d’un jeune homme qui s’était transformé en vent »[513] . Accéder à l’immortalité est donc possible en entrant dans la légende. Mais les alchimistes ont apparemment une manière plus radicale pour freiner l’écoulement du temps : « le jeune homme découvrit que la partie liquide du Grand Œuvre était appelée Elixir de Longue Vie, et cet élixir non seulement guérissait toutes les maladies, mais empêchait aussi l’alchimiste de vieillir »[514]. L’Elixir de Longue Vie du jeune homme, c’est indiscutablement son entrée dans la légende. Néanmoins, L’Alchimiste étant un conte, il n’est pas surprenant d’y rencontrer des personnages immortels voire intemporels On ne s’étonnera pas par exemple de rencontrer le personnage biblique Melchisédech[515], qui dit de Salem qu’elle est « comme toujours, depuis toujours »[516] tout se passant comme si le personnage avait traversé les âges sans devoir affronter les méfaits du temps. Paulo Coelho dit des pyramides d’Egypte qu’elles sourirent au jeune homme : elles sont donc elles aussi des figures éternelles et immortelles.
Dans le roman de Rachid Boudjedra, cette attraction pour une vie éternelle apparaît également. Sans cesse le personnage cherche à s’élever, tout se passant comme s’il voulait échapper à la réalité terrestre pour accéder à un état plus spirituel. Fuir la réalité humaine équivaut à fuir l’espace-temps. Ce désir d’élévation est visible dans le roman à travers plusieurs figures. Primo par le fait que le narrateur ait pris dans sa jeunesse des risques inconsidérés en pilotant des « Mig-21 », des « Mig-28 » et des « sukhois »[517]. Deusio, parce que le narrateur-guide fait régulièrement des haltes dans une chapelle au sommet du Hoggar : « j’escaladais à pied, seul ou avec quelques rares clients, les monstrueux rochers noircis et calcinés du Hoggar, dans l’attente des couchers de soleil où les formes se dépouillent d’une façon étrange, presque aveuglément. Que de nuits et que d’aubes j’ai passées, tout seul, dans la chapelle minuscule et ascétique du père de Foucault, en haut de l’Assekrem, le point culminant du Hoggar »[518].
Notons que le désir d’éternité des personnages est doublé par celui des auteurs. Ces derniers accèdent effectivement à l’immortalité en créant des œuvres qui transcenderont le temps. Les artistes réputés ne meurent jamais. Lilas Voglimacci n’écrit-elle pas que l’Alchimiste est une fable « de tous les temps »[519] ? Le Clézio, même s’il nuance ses propos, se sent obliger d’admettre que son nom ne s’éteindra pas : « je ne suis pas venu à l’Anse aux Anglais pour laisser une trace, même si ces pages que j’écris maintenant, ces cahiers du chercheur d’or sont la dernière phase de cette quête (cette enquête) commencée par mon grand-père il y a plus de quatre-vingt ans »[520].
Parallèlement, Jean-Yves Tadié souligne que le genre du roman d’aventure, duquel est inspiré Voyage à Rodrigues, ne sera jamais démodé et toujours d’actualité : « la pérennité du roman d’aventure est garante de ses lois. Une structure vieille comme la littérature et jeune comme notre espoir supporte la décoration nouvelle que chaque pays, chaque société, chaque génération lui impose. Un genre littéraire, donc ; un sous-genre du roman, à moins qu’au contraire le roman d’aventure n’engendre, ne soutienne, ne fasse être toutes les espèces de roman »[521].
Le genre du conte, utilisé par Paulo Coelho, est lui aussi éternel, comme le montre Lilas Voglimacci : « D’une certaine manière, on pourrait dire que le conte de Paulo Coelho est le Conte des contes, le Livre des livres. C’est un récit qui enseigne le passé du savoir par des pages porteuses de vérités immémoriales. La parole qui dort dans les écrits est une science simple et éternelle »[522]. En ce qui concerne Rachid Boudjedra, il explique à Hafid Gafaïti la difficulté qu’ont les écrivains algériens à tendre vers l’universalité : «en ce qui concerne les écrivains algériens, il semblerait que pour atteindre l’universel, il faille d’abord qu’ils considèrent […] que le travail de la création est un travail qui […] nécessite beaucoup de rigueur, une discipline sévère, beaucoup de solitude et une culture généreuse, ouverte et illimitée ; voire même une véritable érudition […] Toutes ces conditions une fois réunies, il n’est pas sûr que l’on arrive à un travail, à un résultat de qualité qui permette à l’œuvre d’accéder à l’universel »[523]. L’œuvre littéraire est donc un moyen possible pour renaître éternel. En ce qui concerne les œuvres de notre corpus, cette renaissance pour une vie éternelle est incontestablement à l’origine de la béatification finale des personnages.
B.
La
béatification finale
1. Le sacré
« N’est-ce pas visible, n’est-ce
pas bien lumineux que nous sommes tous des dieux ? »
J. M. G. Le Clézio[524]
De retour sur les lieux des origines, une fois la quête effectuée, les personnages parviendront, semble-t-il, à communier avec le divin. Cette ascension pourra se faire certes en pleine nature, mais aussi dans des lieux sacrés. Dans L’Alchimiste tout d’abord. Le fait que l’histoire de Santiago commence dans une vieille chapelle n’est pas anodin. Il n’est effectivement pas rare que l’itinéraire initiatique ait pour point de départ un bâtiment sacré, ce dernier symbolisant la séparation d’avec le monde, étape préalable à toute initiation divine. C’est ce que souligne Simone Vierne : « le lieu sacré, hors de l’espace courant, et la purification ont ceci de commun qu’elles impliquent, pour le futur initié, une rupture avec le monde profane – qu’il s’agisse de l’univers maternel ou du passé personnel du myste. Et cette séparation est bien plutôt un arrachement »[525]. Santiago est en effet en retrait du monde au début du conte de Paulo Coelho car il passe la nuit dans « une vieille église abandonnée »[526]. La communion divine n’aura cependant lieu qu’au terme de son parcours dans le désert, quand il reviendra dans ce même endroit sacré, après plusieurs mois d’errance : « avant de pouvoir pénétrer dans le lieu sacré, le novice doit tout naturellement se purifier »[527] écrit Simone Vierne. Au terme de sa quête, quand il arrivera pour la deuxième fois dans la vieille église, Santiago prendra conscience de l’aide que Dieu lui a apportée : « il pensa à tous les chemins qu’il avait parcourus, et à l’étrange façon dont Dieu lui avait montré le trésor »[528]. Le désert, même s’il n’est qu’un lieu naturel, est l’endroit idéal pour retrouver Dieu. C’est sous cette étendue stérile que doit être recherchée la Réalité. Santiago parvient d’ailleurs à trouver Dieu dans le Sahara. En alchimie, l’univers entier est un temple à lui tout seul, comme l’explique James Burty David : « Tout l’univers (le ciel et la terre) est engagé dans le symbolisme du temple. Au-delà de l’aspect structural de l’édifice, ce sont les pierres vivantes qui intéresse le « grand architecte de l’univers » (expression gravée sur un des piliers de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ). Ces pierres vivantes renvoient à l’image de l’homme en construction, en devenir »[529].
Même s’il n’éprouve aucune croyance religieuse, le narrateur de Timimoun conçoit dans la chapelle du père de Foucauld une sensation mystique unique. Encore une fois, c’est au sein d’un lieu sacré que tend à se manifester la présence divine : « que de nuits et d’aubes j’ai passées, tout seul, dans la chapelle minuscule et ascétique du père de Foucauld, en haut de l’Assekrem, le point culminant du Hoggar. Je n’y éprouvais aucun sentiment religieux mais une esthétique inconcevable, ailleurs ! »[530]. Parallèlement, c’est dans les cimetières berbères, des lieux sacrés donc, que le narrateur éprouve une rare quiétude : « il me fallait me dépêcher alors pour m’arrêter à l’ombre de quelque cimetière berbère dont le dépouillement, la beauté et la sérénité, en plein désert rocailleux, me rapprochaient de la mort et du néant tranquille »[531]. Comme Santiago, le protagoniste éprouve aussi dans le désert un sentiment mystique : «trois heures à regarder le même aspect du désert, c’est trop long et très dangereux. Je dis à Sarah : « C’est comme cela qu’on devient fou, ou, au mieux, mystique »[532].
Le Clézio, dans Voyage à Rodrigues, éprouve aussi un mysticisme certain à force de contempler l’étendue désertique de Rodrigues : « comment ne pas voir dans ce paysage désertique, façonné par le vent et par la pluie, imprégné de soleil, l’expression d’une volonté ? »[533].
Le désert est donc le cadre idéal pour recevoir Dieu car l’initié se rend compte en le parcourant que de « la fragmentation du rationnel » née, comme l’écrit James Burty David, « l’harmonie du sacré »[534]. Ainsi, Santiago en arrivant au terme de sa quête, parviendra à établir une relation quintessencielle avec le sacré. Le jeune berger découvrira effectivement en lui l’essence divine : « le jeune homme se plongea dans l’Ame du monde, et vit que l’Ame du Monde faisait partie de l’Ame de Dieu, et vit que l’Ame de Dieu était sa propre âme »[535].
Pour Le Clézio, la meilleure religion qui soit semble être celle de la nature, et la tâche fondamentale de l’homme consiste en la protection de cette dernière. Influencé par le bouddhisme zen, Le Clézio considère plutôt la recherche de Dieu comme un état d’esprit visant à participer à l’harmonie du monde : « l’espace religieux chez Le Clézio est simplement un vecteur énergétique tendu entre deux pôles : tout rapport qui engendre de l’être, par opposition à la matière statique (et qui par conséquent accroît l’extraction extatique de l’esprit et la montée conscientielle hors de la matière visqueuse), mérite cette appellation »[536], note Ook Chung à propos de Le Clézio. Claude Dis souligne que la relation du grand-père de Le Clézio avec le monde tient de l’alchimie : « le grand-père devient alors un alchimiste pour qui l’objet premier se perd au profit d’un dialogue avec la perfection du monde, échange incessant où la parole se fait offrande »[537]. La présence divine est donc à rechercher dans la nature profonde de l’homme. Dans Voyage à Rodrigues, l’auteur dit d’ailleurs des aventuriers qu’ils sont des hommes qui « touchent au divin »[538]. Dieu est donc plus une sensation qu’une entité à part entière : « je crois que ce n’est pas au hasard que mon grand-père avait choisi DIEU comme mot de passe pour accéder à la table des Clavicules de Salomon. Y a-t-il ici une autre présence à rechercher, à ressentir ? »[539].
Dans le roman de Rachid Boudjedra, la relation avec le sacré n’apparaît pas de manière explicite. Pour l’auteur, l’aridité stérile du désert ne représente rien d’autre que le monde éloigné de Dieu, c’est-à-dire le symbole même de l’indifférenciation principielle. Cependant, le narrateur avoue ressembler à une « vieille tortue »[540], celle-ci étant un animal sacré dans la tradition musulmane. Preuve en est, la protection maladive de tante Fatma pour le vieil animal domestique : « je me laissais souvent rattraper par le souvenir de tante Fatma, une servante de l’époque de mon enfance, dont la laideur m’avait toujours intrigué, comme m’avait intrigué la peur que cette pauvre femme éprouvait à l’égard de la vieille tortue familiale »[541]. Le fait que le roman comporte sept chapitres peut également être interprété symboliquement. Le septième chapitre correspondrait ainsi au septième jour, celui où Dieu se repose après la Création. Ce repos du septième jour marque un pacte entre Dieu et l’Homme : le narrateur de Timimoun est ainsi sacralisé par l’auteur.
Parce que nos personnages possèdent Dieu en eux, ils ont un caractère sacré incontestable, qui transcende leur condition d’homme mortel. Elevés au rang supérieur de l’humanité, ils peuvent donc faire figure de personnages exceptionnels. C’est ce que note Lilas Voglimacci à propos de Santiago : « ce lien vivant entre le Ciel et la Terre est donc bien réalisé par des êtres à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Ce que les Grecs appelaient déjà des démiurges. Ce que les peuples adorent comme des demi-dieux. Les chrétiens comme leurs saints. Et les sociétés en tout genre comme leurs héros »[542]. Effectivement, Paulo Coelho compare l’aventure de Santiago à celle de Joseph : « cet homme délivra l’Egypte de la famine. Il se nommait Joseph. C’était aussi, comme toi, un étranger en terre étrangère, et il devait avoir à peu près ton âge »[543]. Dès lors, parce que le jeune berger a des visions prémonitoires, il peut faire figure de messager d’Allah : les hommes du désert « croient que s’ils doivent être mis au courant de quelque chose qu’Allah veuille leur faire savoir, quelqu’un viendra les en informer. Cela s’est produit bien des fois. Mais aujourd’hui, c’est toi qui es ce messager »[544], explique le chamelier à Santiago.
De tels parallèles
n’apparaissent pas explicitement dans Voyage à Rodrigues et Timimoun.
Cependant, aussi bien Le Clézio que Boudjedra prônent une sacralisation globale
du monde. Pour eux, toutes les religions sont valables et doivent cohabiter
harmonieusement. Paulo Coelho aussi prône un syncrétisme religieux et considère
de la même façon toutes formes de croyances : « toutes les religions mènent
au même Dieu et toutes méritent le même respect »[545]
affirme l’auteur. Paulo Coelho souhaite donc une abolition des différences
religieuses. On retrouve cette influence dans L’Alchimiste. Quand les
personnages partent dans le désert, le chef de la caravane demande à chacun de
prier pour le Dieu en qui il croit : « il y a aussi toutes sortes de gens
et différents dieux dans le cœur des gens. Mais mon seul Dieu est Allah, et je
jure par Allah que je ferai tout ce que je pourrai, et de mon mieux, pour
vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous
jure par le Dieu en qui il croit »[546].
La prière de Santiago s’adresse à Jésus-Christ car le personnage est issu d’une
famille catholique profondément croyante. Le père de Santiago « voulait faire
de lui un prêtre »[547]
mais le jeune homme reste convaincu qu’on ne peut trouver Dieu qu’en
voyageant : « comment peut-on aller chercher Dieu au
séminaire ? »[548]
se demande-t-il alors. Victoire de l’église invisible sur l’église visible…
Cette conception de la religion est profondément moderne. James Burty David
souligne cela dans « L’Alchimiste », parcours initiatique :
«habituellement, c’est dans un tel moule que se pétrissent les convictions au
point où le sacré a été confondu avec les institutions religieuses. Aussi la
question du berger, loin de constituer une hérésie, est fondamentale.
L’expérience de l’Universel ne peut être enfermée dans les limites
institutionnelles et dans les dogmes figés »[549].
En ce qui concerne Rachid Boudjedra, il semble lui aussi considérer de manière égale toutes les religions. Dans Timimoun, cette harmonie religieuse est visible à travers la présence de différents courants religieux au sein du roman. Par exemple, Boudjedra évoque à plusieurs reprise le père de Foucauld, initiateur d’un mouvement religieux apparenté au franciscanisme. L’auteur parle aussi bien sûr de l’islamisme, même si ce qu’il en dit laisse persister le doute quant à la bonne application des textes du Coran dans la réalité. Enfin, les nombreux éléments relatifs à la mystique soufi dans Timimoun ne font que renforcer cet œcuménisme religieux.
Pour J. M. G. Le Clézio, l’harmonie religieuse résiderait dans la transformation de tous les dieux en un seul Dieu, qui serait symbole de totalité absolue. Selon Ook Chung, il faut considérer les dieux, « ces personae divines, comme hypostases de la déité globale »[550]. Dans Voyage à Rodrigues, le mot de passe qu’a choisi le grand-père de Le Clézio pour comprendre les Clavicules de Salomon est « DIEU ». Ce dernier permet par conséquent au grand-père de l’auteur de découvrir le sens caché de l’univers. Dieu peut donc être considéré comme détenteur du langage du monde. Ce dernier apparaît donc comme sacralisé. Nos auteurs sont d’ailleurs conscients que le langage peut servir de guide.
2. La fonction messianique du langage
Le langage a une fonction messianique, révélatrice, dans la mesure où les écrivains l’utilisent pour faire voyager le lecteur dans des univers nouveaux, pour le guider dans un monde qu’ils ont imaginé. Mais ce langage n’a d’intérêt que s’il peut être compris par le plus grand nombre d’individus. Une des tâches de nos auteurs consistera donc à élaborer un mode de communication universel.
Le Brésilien Paulo Coelho prône tout d’abord une écriture de la simplicité. C’est selon lui le meilleur moyen pour se faire écouter et rendre le plus compréhensible possible ce que l’on a envie de dire. Dans L’Alchimiste, l’écriture de la simplicité passe par l’utilisation de nombreux aphorismes, chargés de délivrer des messages universels de sagesse, que tout le monde peut comprendre et utiliser à sa guise. Lilas Voglimacci établit d’ailleurs un parallèle entre le conte de Paulo Coelho et la Bible: « lorsqu’il nous est donné d’entendre la parole des livres qui constituent ce que communément on appelle la Bible ; un ton et un style lui appartiennent de façon indéniable. Que ce soit dans l’Ecclésiaste, dans le Livre de la Sagesse ou dans le Cantique des Cantiques, l’écriture est faite d’aphorismes et de sentences que nous gardons en mémoire […] Dans L’Alchimiste, l’écriture de Paulo Coelho fonctionne essentiellement comme une permanente variation sur cette musique des phrases qui sonnent toujours comme des proverbes »[551]. Le conte de Coelho regorge effectivement de préceptes universels, que l’auteur prend plaisir à répéter. L’Alchimiste devient un livre de sagesse : « quand tu veux quelque chose, tout l’Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir »[552] ; « plus on s’approche de son rêve, plus la Légende Personnelle devient la véritable raison de vivre »[553], etc. Paulo Coelho affectionne particulièrement ce genre de formules. Il a d’ailleurs écrit Le Manuel du Guerrier de la Lumière[554] et la préface de Lettres à Prunelle[555] d’Alain Ayache, qui reposent sur le même principe[556]. Parallèlement, d’autres symboles de la langue universelle sont présents : l’épée par exemple. Santiago est en effet émerveillé par une épée sur le marché de Tanger, et l’alchimiste lui fait une marque sur le front avec cet objet tranchant. Si le protagoniste est mis en contact avec l’épée, ce n’est pas anodin : la possession de cette arme représente effectivement la possession du Verbe universel, de la Parole éternelle[557]. Dans la Cinquième montagne, Paulo Coelho parle du langage de Byblos en terme d’universalité : « l’invention de Byblos[558], elle, risquait d’avoir des effets considérables : n’importe quel pays pouvait l’utiliser, quelle que soit sa langue. Même les Grecs, qui en général rejetaient tout ce qui n’était pas originaire de leurs cités, avaient déjà adopté l’écriture de Byblos et la pratiquaient couramment dans leurs transactions commerciales. Comme ils étaient spécialistes dans l’art de s’approprier tout ce qui avait un caractère novateur, ils l’avaient baptisée du nom grec d’alphabet »[559]. La langue de Paulo Coelho fonctionne comme Byblos. Sa simplicité la rend universelle.
Rachid Boudjedra est également conscient de la fonction messianique du langage. S’il est bien utilisé, ce dernier peut effectivement servir de guide. Pour être entendu par la société algérienne, l’auteur de L’Escargot entêté[560] opte pour une solution radicale : la provocation. « Il est certain que ma littérature a beaucoup dérangé. Parce que c’est une littérature qui a voulu descendre dans les boyaux et les couches profondes de la réalité et de la conscience arabes. Elle a voulu remettre en cause et soi-même et les autres ; et surtout la société algérienne qui met trop de temps à dépasser sa propre vision traditionnelle »[561]. Ainsi Rachid Boudjedra ose dépasser les tabous. Il parle par exemple de l’aspect charnel du corps humain, du fait qu’il soit source de souffrance et de jouissance à la fois. Cette réhabilitation brutale du corps de la femme apparaît dans Timimoun : « je n’ai jamais rien compris à un sexe de femme non plus… ça me renverse… chez l’homme c’est tragi-comique c’est burlesque… chez la femme c’est carrément tragique… tout ce magma de peaux rosâtres de grandes lèvres de petites lèvres de clitoris de plis et de replis de vulve de poils… comment peuvent-elles gérer toutes ces choses humides… toutes ces secrétions… »[562]. Cette tentative de vulgarisation des tabous justifie donc le terme de « litté-rature » souvent employé pour qualifier l’œuvre de Rachid Boudjedra.
Pour toucher à l’universalité, J. M. G. Le Clézio opte pour une écriture à l’état brut, qui soit l’expression immanente de l’expérience sensible. Jean Onimus insiste sur cet aspect de l’œuvre de l’auteur : « l’art actuel donne une foule d’exemples d’art brut : on cherche à mettre le contemplateur en présence de la chose même, en laissant l’interprétation ouverte. Le Clézio ne prend aucune précaution préalable, n’organise pas ses discours (ou à peine), laisse courir sa plume. Il exprime le jeu complexe et rapide des associations : cela crépite. Le flux sémantique s’élargit, tourbillonne, se disperse, puis se reforme en vifs remous pour se perdre de nouveau en d’étranges bras morts »[563]. Il y a donc chez Le Clézio un souci de « tout dire ». Cette intention globale est source d’universalité. Dans Voyage à Rodrigues, cette volonté qu’a Le Clézio de tout dire passe certes par la reproduction d’anciens documents du grand-père mais aussi par l’évocation de noms propres dont la seule prononciation est une invitation universelle au rêve : « Maison blanche, légère, appuyée contre la chaîne des sommets aux noms pour moi magiques, le Pouce, les Deux mamelles, le Pieter Both, avec, sur le versant est, au-delà des frondaisons des arbres du parc, les immenses plaines de cannes : Phœnix, Floréal, jusqu’au-delà de Curepipe, vers Mare aux Vacoas, et vers le nord-est, Alma, Bar le Duc, Nouvelle Découverte, et les silhouettes de la Montagne Blanche et du Piton du Milieu »[564].
Ainsi, en concevant par le langage un univers à chaque fois unique, les écrivains peuvent servir d’intermédiaire au Créateur. Leurs œuvres sont ainsi parole de Dieu : « l’œuvre vient ainsi des dieux aux hommes, elle aide à ce passage »[565] écrit Maurice Blanchot. Lilas Voglimacci considère ainsi la parole de Paulo Coelho comme parole divine : « ce langage épais qui donne à entendre la sagesse des peuples, c’est celui des hommes instruits d’un autre savoir. Comme si une voix parlait par la voix de l’auteur. Comme s’il écrivait sous la dictée d’un Grand Aîné penché, toutes ailes au vent, sur son travail d’écriture, son devoir de calligraphe inspiré : passer le Message de Dieu créateur du ciel et de la terre aux hommes qui l’espèrent. Le texte devient alors un miroir, dans l’eau duquel le lecteur voit des forces claires qui lui parlent personnellement. C’est la passerelle entre l’humain et le divin dans une communion des mots qui parlent en quelque sorte tout seuls »[566]. Dans le conte, cela est représenté par le fait que Santiago entre en relation avec la cime des pyramides à la fin du récit : symboliquement, le haut des pyramides représente le point d’union entre le langage humain et la Parole divine : « le sommet des pyramides symboliserait le Verbe démiurgique, Puissance première inengendrée, mais émergée du Père et gouvernant toute chose créée, totalement parfait et fécond. Ainsi, au terme de l’ascension pyramidale, l’initié atteindrait l’union au Verbe, comme le Pharaon défunt s’identifie au creux de la pierre au dieu immortel »[567].
Le grand-père de Le Clézio, en arrivant sur l’île, a dû comme Dieu nommer ce qu’il découvrait, créant ainsi un langage neuf pour un monde nouveau : « sans ces tracés de lignes, mesures d’angles, repérages, axes est-ouest, calculs méticuleux des points, est-ce que cette terre aurait eu une signification, est-ce qu’elle aurait pris forme sous ses yeux, je veux dire, non plus comme n’importe quel point indifférencié de la planète, mais comme cette « Anse aux Anglais » choisie par le Privateer pour y cacher son or et ses diamants, c’est-à-dire l’un des lieux les plus puissants et les plus secrets du monde ? Ainsi faisaient les premiers hommes, lorsqu’ils donnaient leurs noms aux endroits de la terre, montagnes, rivières, marécages, forêts, plaines d’herbes ou de cailloux, pour les créer en même temps qu’ils les nommaient »[568].
Servant ainsi d’intermédiaire entre Dieu et les Hommes, nos auteurs pourraient faire figure de prophète. C’est ce que souligne Ook Chung à propos de Le Clézio : « le discours prophétique leclézien est l’expression d’une démarche phénoménologique qui s’inscrit dans un rapport entre la conscience individuelle et l’absolu »[569]. Le berger Santiago, victime de visions prémonitoires, est incontestablement une figure prophétique. On peut croire que Paulo Coelho est lui aussi un prophète, qui délivre des messages de sagesse aux hommes. Mais l’auteur du Pèlerin de Compostelle[570] refuse une telle étiquette : « Je suis écrivain. Je ne me permettrais jamais de jouer le rôle de Maître – je n’en aurais d’ailleurs jamais la patience. Un prophète ? En aucun cas ! »[571]. En ce qui concerne Rachid Boudjedra, il ne s’assimile jamais à un prophète : « la littérature, c’est un dur labeur. Et pas du tout une affaire de don ou de muse ! »[572].
Avant d’être prophète, l’écrivain est donc une personne qui apprend à se connaître dans ses livres. La quête de soi passe non pas par un exil spatial mais par un exil dans l’écriture : « Saint-John Perse, en nommant l’un de ses poèmes Exil, a aussi nommé la condition poétique. Le poète est en exil, il est exilé de la cité, exilé des occupations réglées et des obligations limitées, de ce qui est résultat, réalité saisissable, pouvoir […] Le poème est l’exil, et le poète qui lui appartient appartient à l’insatisfaction de l’exil, est toujours hors de lui-même, hors de son lieu natal, appartient à l’étranger, à ce qui est le dehors sans intimité et sans limite »[573] écrit Maurice Blanchot. La quête de soi semble donc être le but de toute activité d’écriture. L’écrivain est un exilé qui se cherche en écrivant. C’est ce qu’explique Paulo Coelho à Olivier Barrot : « chaque fois que j’écris un livre, je ne pense pas que j’écris pour telle personne ou pour telle autre, je me dis que j’écris pour moi-même, je me dis qu’il faut oublier les millions de lecteurs […] Je veux savoir qui je suis»[574].
Quant à Le Clézio, l’écriture est pour lui un principe d’identification. Voyage à Rodrigues permet ainsi à l’auteur de s’assimiler à son grand-père et de découvrir une part de sa personnalité jusque là méconnue. Jean-Xavier Ridon parle de cette quête de soi par celle des autres chez Le Clézio : « on se trouve alors dans un double mouvement qui porte l’écrivain à se projeter en l’autre pour mieux revenir sur lui-même mais qui le fait partir de lui-même aussi pour mieux comprendre l’autre »[575].
Pour Rachid Boudjedra, écrire est le seul moyen pour se libérer de nos frustrations originelles, pour laisser se manifester nos pulsions enfouies. Cette libre manifestation de l’inconscient est un reflet identitaire incontestable dans la mesure où elle laisse s’exprimer le Moi véritable de l’écrivain : « écrire, c’est se vider. C’est l’impression que l’on a. Lorsqu’on écrit tous les jours, on se sent à la fin de la journée vidé, pompé. Mais au fond vidé de sa peur, de son échec et de sa folie. Je crois que l’écriture comme catharsis a été démontrée il y a longtemps de cela » [576] confie Boudjedra à Gafaïti.
Ecrire est donc une activité amenant à se connaître soi-même. Mais, selon Blanchot, l’œuvre joue aussi un rôle important dans l’initiation du lecteur : « Le lecteur voit dans la clarté merveilleuse de l’œuvre, non pas ce qui s’éclaire de par l’obscur qui le retient et s’y dissimule, non pas l’évidence qui n’illumine qu’au nom de la nuit, mais ce qui est clair en soi-même, la signification, ce que l’on comprend et ce qu’on peut prendre à l’œuvre, en l’en séparant, pour en jouir ou en disposer. Ainsi, le dialogue du lecteur avec l’œuvre consiste-t-il toujours davantage à l’ « élever » à la vérité, à la transformer en un langage courant, en formules efficaces, en valeurs utiles, tandis que le dilettante et le critique se consacrent aux « beautés » de l’œuvre, à sa valeur esthétique »[577].
Un problème subsiste, cependant. Le langage a certes une fonction messianique mais il se caractérise aussi par son impuissance fondamentale à retranscrire l’harmonie du monde. Boudjedra explique à Hafid Gafaïti l’incessant combat que l’écrivain livre au langage : « écrire, c’est se battre avec les mots si nombreux, si glissants et si fuyants qu’il est très difficile de les maîtriser. Et surtout, comme je l’ai dit tantôt, écrire c’est s’acharner à trouver à chaque fois le mot adéquat, susceptible d’exprimer exactement l’image mentale qui obsède celui qui écrit. En réalité je pense qu’il y a là une tâche impossible parce que, justement, les mots ne se laissent pas faire. Parce que, aussi, entre le concept et l’objet se trouve le mot. Et de par cette situation, le mot est quelque chose d’insaisissable »[578].
Le Clézio éprouve aussi une difficulté certaine à écrire du fait du paradoxe fondamental de son écriture : comment décrire un monde impossible à décrire ? Comment trouver les mots justes pour expliquer une harmonie universelle qui n’a d’existence qu’en dehors de l’écriture ? Cela débouche effectivement sur une impasse il serait paradoxal d’écrire que les mots sont impuissants. En parlant de Le Clézio, Jean Onimus écrit : « que cet incorrigible bavard en soit arrivé à faire l’éloge du silence, cela donne beaucoup à réfléchir ! »[579] La quête de soi par le langage, qui s’offre à l’écrivain comme au lecteur, pourrait donc être sinon impossible, du moins perpétuelle. De plus, les personnages de notre corpus semblent ne jamais devoir réaliser pleinement leur recherche identitaire.
3. Une perpétuelle quête de soi ?
« L’acte de création ne s’arrête jamais »
J.
M. G. Le Clézio[580]
Rachid Boudjedra établit un parallèle entre écriture et sexualité. Pour lui, le point commun entre ces deux sujets réside dans l'insatisfaction : « quant au rapport entre le roman interminable et la sexualité qui est aussi un voyage, une exploration sans fin, décevante et exaltante en même temps, il se pose de la même manière, il est vrai. Comme la sexualité l’écriture romanesque est une chose qui n’a pas de fin, qui n’a pas de but, qui est une exploration perpétuelle et permanente, et qui est aussi une exploration décevante parce qu’il n’y a pas de roman idéal, ni de roman parfait. De la même manière qu’il n’y pas de sexualité idéale, ni de sexualité parfaite. La perfection dans ces cas-là est un leurre, un mythe, une tension, une tentation ou une attitude carrément désespérée. La littérature comme la sexualité sont fondées sur la notion de l’inassouvissement »[581]. L’initiation de l’auteur est donc perpétuelle. Celui qui écrit n’apprend à se connaître qu’au fil des ouvrages qu’il rédige. Preuve en est, la dimension intertextuelle de l’écriture et les échos qui se font entre différents ouvrages de périodes différentes. Boudjedra explique cette dimension de son œuvre : sa littérature « n’aboutit pas […] elle n’a pas de fin ni de début. C’est une littérature de la mémoire et la mémoire n’est pas organisée d’une façon régulière, d’une façon normalisée et normative. Elle tourne sur elle-même, interminablement. Elle est un va-et-vient permanent et il n’y a pas de fin à la mémoire. Même dans le sommeil elle continue à fonctionner. Et le récit dans mes livres n’arrive jamais à son terme. Il s’arrête à un moment sans être achevé. Achever un livre c’est achever la vie »[582]. L’aspect tautologique de l’œuvre de Boudjedra est effectivement flagrant. Le roman Timimoun fonctionne par exemple sur des récurrences thématiques : la mort du frère (la description de la scène de l’enterrement est d’ailleurs identique dans Timimoun et La Macération !), la peur du sang menstruel, le silence de la mère, etc. Le métier d’écrivain consiste donc en une perpétuelle interrogation sur son identité. L’initiation est donc l’affaire de toute une vie : « L’homme en principe est tautologique »[583] insiste Boudjedra. Dès lors, nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement que le personnage central de Timimoun, à la fin du roman, arrive enfin à acquérir son identité véritable, car la quête de soi ne s’achève pas du jour au lendemain. Il est plus que vraisemblable que le narrateur continuera d’errer dans le désert à bord de son bus. La rencontre avec Sarah n’est pas le premier ni le dernier bouleversement que devra subir le narrateur au cours de sa vie ! Notons que le roman, divisé en sept chapitres suggère une continuité : sept est en effet le nombre de l’achèvement cyclique et de son renouvellement.
Pareillement, Le Clézio explique dans Ailleurs que sa littérature est ouverte, qu’il y a des ponts tendus entre toutes ses œuvres : « j’ai un peu l’impression que l’écrivain suit un chemin circulaire. Il est sur cette roue qui tourne et, en se dirigeant vers sa fin, vers la fin de ce qu’il est en train de faire, il lui faut nécessairement retrouver ce qu’il avait commencé de façon à former un tout cohérent, et que lui-même puisse se sentir un être cohérent »[584]. Pour Le Clézio, l’apprentissage littéraire de l’écrivain est donc en perpétuelle construction et sa quête identitaire reste illimitée. A la fin de Voyage à Rodrigues, la démarche identitaire de l’auteur semble achevée car il arrive enfin à comprendre et à trouver sa place fondamentale dans l’histoire du Chercheur d’or. La légende pourrait s’arrêter là, mais elle repart : « en écrivant cette aventure, en mettant mes mots là où il a mis ses pas, il me semble que je ne fais qu’achever ce qu’il a commencé, boucler une ronde, c’est-à-dire recommencer la possibilité du secret, du mystère »[585]. La conclusion devient une introduction. Elle annonce un nouveau départ. La fin du Journal contient d’ailleurs deux images synonymes de régénération : « le tamarinier sous lequel il s’est assis pour fumer en regardant passer les oiseaux du soir est déjà vieux, je crois qu’il ne résistera pas au prochain cyclone… »[586]. En choisissant d’une part les points de suspension pour achever son Journal, Le Clézio signale que la quête n’est pas finie, qu’elle va se prolonger au-delà des mots, bref, qu’elle est laissée définitivement en suspens. D’autre part, l’auteur signale l’arrivée possible d’un cyclone destructeur sur l’île. Comme le déluge, le cyclone est un cataclysme naturel non-définitif. A la destruction brutale succède toujours la reconstruction, la naissance d’une nouvelle humanité. Bref, un nouveau départ, comme l’écrit James Burty David : « symboliquement, la mort par l’eau débouche sur une transformation. C’est le début d’une vie régénérée, car le néophyte en quête d’infini retourne aux eaux originelles, se purifie et reprend le cycle de la vie. La Genèse rapporte que la Terre et la race humaine ont elles aussi été régénérées après le déluge. Destruction et régénération. Mort et vie. L’ancien disparaît pour permettre à une vie nouvelle de s’épanouir »[587]. Une nuance cependant doit être apportée. Puisque la quête de soi n’est jamais définitive, celui qui entreprend de la réaliser se trouve tôt ou tard en situation d’échec. Claude Dis souligne ainsi l’échec de la famille Le Clézio dans la recherche du trésor : « le grand-père et son petit-fils ont tous deux connus l’échec. La parole sacrée ne peut plus aujourd’hui se faire entendre, le Corsaire inconnu a laissé place à un soldat tout aussi inconnu ; les évocations de trésors fabuleux, à la taille des rêves de l’enfance, les noms des navires qui étaient à eux seuls une aventure, les vieux grimoires dont la splendeur suffisait d’être seule proférée, ont cédé devant les noms de batailles : la langue du grand-père et sa magie ont déserté l’île comme les oiseaux de la mer ; il ne reste plus maintenant que le silence dans lequel on peut entendre parfois claquer une plainte sourde, l’écho appauvri d’un temps foudroyant »[588].
Paulo Coelho souligne aussi que sa quête de soi se fait progressivement, livre après livre. Elle suit le fil de l’écriture et ne s’arrête jamais. A la question « que cherches-tu quand tu écris ? » l’auteur de La Rivière Piedra[589] répond : « Moi-même. A chaque moment de ma vie, j’ai changé intérieurement et je ne me comprends pas encore totalement. J’écris aussi pour savoir qui je suis au moment précis où j’écris. Après je change et je dois écrire un autre livre, ainsi je peux partager mes nombreux changements, mes nombreuses facettes, mes nombreuses nuances »[590]. La recherche de la Légende Personnelle est donc constante. Ainsi, quand il trouve le trésor à la fin du conte, Santiago ne franchit qu’une étape de la quête identitaire. Comme le souligne James Burty David, il n’y a pas de conclusion possible : « Impossible de conclure définitivement. Au moment où Santiago se lance à la rencontre de Fatima, nous sentons bien que l’histoire ne se termine pas. Une autre, encore plus merveilleuse, est sur le point de commencer. La quête est une démarche perpétuelle. Le plomb vil se transforme-t-il en or que l’œuvre ne se terminerait pas pour autant […] Saint Paul souligne dans ses épîtres qu’une telle œuvre de purification (qu’il qualifie de sanctification) est celle de toute une vie. Voilà pourquoi il est impossible de conclure définitivement. Sur le chemin de la vie, chaque étape est une avancée vers d’autres victoires, d’autres richesses, d’autres états de conscience. Vers l’infini des possibilités que nous portons en nous »[591] La dernière phrase de L’Alchimiste résonne en effet comme un nouveau départ : « Me voici, Fatima, dit-il. J’arrive »[592].
VII.
Conclusion
L’analyse des œuvres de notre corpus tend à montrer que la quête de soi n’est réalisable que si elle place l’initié dans une situation d’exil. Cette dernière permet en effet au personnage de franchir différentes étapes initiatiques qui lui permettent au fur et à mesure de son voyage d’acquérir sa propre identité. Mais la situation d’exil n’a lieu qu’à différentes conditions : le personnage, comme nous l’avons vu dans notre première partie, doit être seul, foncièrement malheureux et son départ motivé par la découverte possible de quelque chose qui le rende heureux : un trésor, un lieu édénique, etc. C’est en étant dans ces conditions préalables à toute démarche identitaire que le personnage trouve la volonté de partir.
Les protagonistes de Timimoun, Voyage à Rodrigues et L’Alchimiste ne découvriront donc leur identité véritable, comme nous l’avons vu dans la partie suivante, qu’après avoir franchi l’étape du départ pour aller chercher sur des terres inconnues la promesse du bonheur. Mais parce qu’ils sont inconnus et déserts, les lieux de l’exil plongent les personnages dans une solitude infernale. Seuls face au monde qui les entoure, les exilés regrettent d’avoir entrepris leur quête. Cet état de démission les pousse même jusqu’à la folie, tant l’obsession nostalgique des souvenirs d’avant leur départ est grande. Néanmoins, ce repli sur soi est une étape indispensable à toute initiation : il permet à l’individu qui s’exile de se retrouver seul face à lui-même, c’est-à-dire de s’interroger sur sa véritable identité.
Notre troisième partie nous a permis de constater qu’en se rendant sur des terres qu’ils ne connaissent pas ou peu, les personnages vont de découvertes en découvertes, rencontrent des individus avec qui ils ont des échanges enrichissants et acquièrent une expérience certaine qui renforce leur conscience d’être. Le départ réserve alors aux personnages de bonnes surprises. La découverte de l’amour et l’appui incontestable d’individus bien intentionnés leur permettent par exemple de trouver la force nécessaire à toute démarche initiatique. Mais les personnages doivent faire face à bien des difficultés et sont confrontés fréquemment à des situations d’échec. Ils doivent par conséquent se battre pour ne jamais abandonner leur périple. C’est en passant outre les difficultés rencontrées qu’ils progressent et arrivent peu à peu à affirmer leur personnalité. Ce combat perpétuel est aussi une étape à la quête de soi.
Le voyage, comme nous l’avons étudié dans une dernière partie, a ainsi permis aux personnages d’acquérir une maturité étonnante. Au terme de leur quête, les protagonistes accèdent même à une certaine forme de sagesse, qui leur permet de se regarder avec plus de recul. Ils découvrent alors que ce qu’ils avaient entrepris de chercher n’était en fait rien d’autre que leur propre identité.
Après cette analyse des œuvres, une conclusion s’impose : c’est en se perdant que l’on se trouve au plus proche de soi-même. Ce constat permet de mettre en évidence l’importance du désert dans toute initiation : dans les œuvres que nous avons étudiées, les personnages s’exilent systématiquement dans des endroits désertiques, tout se passant comme si la quête de soi n’avait de sens que si elle était réalisée dans des lieux délaissés par l’homme. Là est le paradoxe de l’initiation : trouver l’Homme nécessite une fuite de l’Homme. Autant dire que l’entreprise initiatique est quasi-impossible.
Pourtant, les personnages crées par J. M. G. Le Clézio, Rachid Boudjedra et Paulo Coelho, parviennent à mettre un terme à leur quête de soi. Dans les œuvres de notre corpus, il y aurait donc quelque chose qui favoriserait l’initiation, qui permettrait aux personnages de trouver leur identité, en plus de leur exil dans des lieux désertiques. Dans Timimoun, Rachid Boudjedra évoque de manière implicite l’appartenance du personnage au soufisme, mais les allusions que l’auteur fait ne sont pas négligeables. Tous ces renvois laissent en effet penser que pour l’auteur de Timimoun l’initiation n’a de sens que si elle est mise en rapport avec la mystique soufi. Une étude plus poussée de cette thématique chez le romancier algérien permettrait d’éclaircir nettement la caractère initiatique de Timimoun. Chez Paulo Coelho, les références à l’alchimie sont nombreuses et hétéroclites, tout se passant comme si l’idée d’exil n’avait d’intérêt qu’en termes alchimiques. Etudier L’Alchimiste selon cette optique permettrait sans doute d'expliquer plus nettement la démarche initiatique décrite par Paulo Coelho. Parallèlement, dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio fait de nombreuses références aux Clavicules de Salomon. Ce texte obscur est aussi un traité d’alchimie, qui nécessiterait de plus amples explications, tant Le Clézio et son grand-père semblent y attacher de l’importance. Cette étude permettrait certainement de trouver d’autres significations quant au caractère initiatique de Voyage à Rodrigues.
La quête de soi pourrait donc être fondamentalement utopique si elle n’était pas rattachée aux diverses sciences secrètes évoquées ci-dessus. Cette impossibilité de se réaliser en ne faisant que s’exiler apparaît implicitement dans nos œuvres. Tout d’abord l’initiation n’est pas une quête de soi mais une quête de l’harmonie du monde. Les personnages découvrent en effet au terme de leur aventure qu’ils ne sont qu’une infime partie de la Création et qu’au fond, leur vie n‘est pas dissociable de celle du monde qui les entoure. On ne peut se connaître qu’en sachant s’intégrer au monde, c’est-à-dire en relativisant notre condition d’être humain.
Ensuite, ce n’est pas une quête de soi mais une quête des autres. Dans les œuvres de notre corpus, les personnages font de multiples rencontres au cours de leur périple. Des individus viennent en effet les épauler dans leur quête et d’autres sont là pour leur barrer la route. Mais qu’ils soient bons ou mauvais, ces échanges sont toujours bénéfiques pour la construction identitaire. C’est en effet en favorisant l’échange avec autrui, en communiquant avec des personnes que l’on ne connaît pas que l’on découvre sa véritable identité. La quête des autres passe par conséquent avant celle de soi.
Enfin, une quête de soi n’a pas de terme dans le temps. Etant donné que nous sommes continuellement en train de changer, d’évoluer et de modifier nos comportements et notre personnalité, nous ne pouvons jamais prétendre nous connaître de manière définitive. On ne découvre sa véritable personnalité qu’au fil des jours, en vieillissant. Le processus de maturité n’ayant pas de terme dans le temps, l’initiation est donc perpétuelle. Mais si la quête de soi est l’affaire de toute une vie, une chose cependant peut y mettre un terme définitif tout en la rendant ainsi absolue : la mort.
« Chaque acte que j’accomplis, chaque sensation qui vibre en moi et marque l’imperceptible déclic du temps, sont là pour me dire : il faut que tu disparaisses pour que s’accomplisse l’œuvre qui a commencé ».
J.
M. G. Le Clézio[593]
VIII.
Bibliographie
Corpus de référence :
· Boudjedra, Rachid, Timimoun, Alger, Ed. El Ijtihad, 1994, texte français de l’auteur, Timimoun, Paris, Ed. Denoël, collection Folio n°2704, 1994
· Coelho, Paulo, O Alquimista, 1988, traduit du portugais (Brésil) par Jean Orecchioni, L’Alchimiste, Paris, Ed. Anne Carrière, J’ai lu, 1994
· Le Clézio, J. M. G., Voyage à Rodrigues, Paris, Editions Gallimard, collection Folio n°2949, 1986, p. 68
Ouvrages sur
Rachid Boudjedra :
· Bensmain, Abdallah, Crise du Sujet, Crise de l’Identité : Une lecture psychanalytique de Rachid Boudjedra, Casablanca, Afrique Orient, 1984
·
Boutet de Monvel, M., Boudjedra l’insolé,
L’Insolation, Racines et Greffes, Paris, L’Harmattan, 1994
·
Gafaïti, Hafid, Boudjedra
ou la passion de la modernité, Paris, Denoël, 1987
·
R. Boudjedra : une poétique de la subversion /
Autobiographie et Histoire ; sous la direction de H. Gafaïti, Paris,
L’Harmattan, 1999, Collection Critiques Littéraires
·
Ibrahim-Ouali, Lila, R. Boudjedra, Ecriture poétique
et structures romanesques, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté des Lettres de
Clermont-Ferrand, CRLMC, 1998
·
Toso Rodinis, Giuliana, Fêtes et défaites d’éros
dans l’œuvre de R. Boudjedra, Paris, L’Harmattan, 1994
Articles sur
Rachid Boudjedra :
·
« Algérie, l’énigme d’une guerre sans
nom » in Magazine Littéraire n°378, juillet - août 1999,
« Ecrire la guerre », pp. 107-108
·
« Rachid Boudejedra, la réalité dépasse la
fiction » Interview de R. Boudjedra par Abida Allouache in Algérie
Actualité n°1466, 16-22 novembre
1993
Articles sur Timimoun :
·
Ibrahim-Ouali, Lila, « Promenade exotique à Timimoun
de R. Boudjedra », in Promenades
et écritures, Cahiers de recherches du CRLMC, Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand, 1996
·
Riad, Zohra, « Rachid Boudjedra et Assia Djebar
écrivent l’Algérie du temps présent » et Kheriji ,Rym,
« renouvellement ou continuité de l’écriture de R. Boudjedra ?
Lecture de Timimoun » in Paysages littéraires algériens des
années 90 : témoigner d’une tragédie ?, Etudes littéraires
maghrébines N°14, Paris, L’Harmattan, 1999
·
Pancrazi, Jean-Noël, « L’épreuve de vérité »
in Le Monde, Le Monde des Livres, 15/07/1994
·
Redouane, N., « voyage au bout de l’être dans Timimoun de R. Boudjedra » in R.
Boudjedra, une poétique de la subversion / II. Lectures critiques, sous la
direction de H. Gafaïti, Paris, L’Harmattan
Autres œuvres
de Rachid Boudjedra :
·
Boudjedra, Rachid, Al Marth, Editions Enal-Alger,
1984, traduit de l’arabe par A. Moussali en collaboration avec
l’auteur, La Macération, Paris, Denoël, 1985
·
Boudjedra, Rachid, Ettafakouk, Alger Editions
SNED, beyrouth, Edition Ibn Rochd, Le Démantèlement, traduit de l’arabe
par l’auteur, Paris, Denoël, 1981
·
Boudjedra, Rachid, FIS de la haine, Paris,
Denoël, collection Folio n°2617, 1992, postface, 1994
·
Boudjedra, Rachid, La Répudiation, Paris,
Editions Denoël, collection Folio n°
1326, 1969
·
Boudjedra, Rachid, La Vie à l’endroit, Paris,
Editions Grasset et Fasquelle, Le Livre de poche, 1997
·
Boudjedra, Rachid, Les 1001 années de la nostalgie,
Paris, Editions Denoël, collection Folio, 1979
·
Boudjedra, Rachid, L’Escargot entêté, Paris,
Denoël, 1977
·
Boudjedra, Rachid, Lettres algériennes, Paris,
Editions Grasset et Fasquelle, le Livre de poche, 1995
·
Boudjedra,
Rachid, Likah, Alger, Ed. Amal, 1983, traduit de l’arabe par
Antoine Moussali en collaboration avec l’auteur, Greffe, poèmes, Paris,
Editions Denoël, 1983
·
Boudjedra, Rachid, L’Insolation, Paris, Editions
Denoël, collection Folio n°1871, 1972
Ouvrages sur
Paulo Coelho :
·
Arias, Juan, Conversations avec Paulo Coelho, Paris,
Ed. Anne Carrière, traduit de l’Espagnol par F. Marchand-Sauvagnargues, 1999
Articles sur
Paulo Coelho :
· « Interview
de Paulo Coelho » in Le Courrier de l’UNESCO, mars 1998, pp. 34-37
Ouvrages sur L’Alchimiste :
·
Burty David, James, « L’Alchimiste », parcours
initiatique, Paris, Editions des Ecrivains, 1999
·
Voglimacci, Lilas, Les
secrets de L’Alchimiste, Paris, Editions Ramsay, 1997
Autres œuvres
de Paulo Coelho :
· Coelho, Paulo, Na margem do rio piedra eu senti e chorei, 1994, traduit du portugais (Brésil) par Jean Orecchioni, Sur le bord de la rivière Piedra je me suis assise et j’ai pleuré, Paris, Ed. Anne Carrière, 1995
· Coelho, Paulo, O Alquimista, 1988, traduit du portugais (Brésil) par Jean Oreccchioni, L’Alchimiste, Edition illustrée par Moebius, Anne Carrière, 1994
· Coelho, Paulo, O diaro de um mago, 1987, traduit du portugais (Brésil) par Françoise Marchand-Sauvagnargues, Le Pèlerin de Compostelle, Paris, Ed. Anne Carrière, 1996
·
Coelho, Paulo, O Quinta montanha, traduit du
Portugais (Brésil) par F. Marchand-Sauvagnargues, La Cinquième Montagne,
Paris, Editions Anne Carrière, Le Livre de poche, 1998
·
Coelho, Paulo, O demônio e a Srta. Prym, traduit
du portugais (Brésil) par Jacques Thiériot, Le Démon et mademoiselle Prym,
Paris, Ed. Anne Carrière, 2001
·
Coelho, Paulo, Manuel du Guerrier de la
lumière, Paris, Ed. Anne Carrière, Le livre de poche, traduit du portugais
par F. Marchand-Sauvagnargues, 1997
·
Coelho, Paulo, Véronika décide de mourir, Paris,
Ed. Anne Carrière, traduit du portugais par F. Marchand-sauvagnargues, 1998
·
Coelho Paulo, « préface » in Ayache, Alain, Lettres
à Prunelle, Paris, Edition°1, 1998, pp. 7-12
Ouvrages sur
J. M. G. Le Clézio :
·
Brée, Germaine, Le Monde fabuleux de J. M. G.
Le Clézio, Amsterdam-Atlanta, Editions Rodopi B. V., GA 1990
·
Chung, Ook, Le Clézio, une écriture prophétique,
Paris, Imago, 2001
·
Domange, Simone, Le Clézio ou la quête du désert,
Paris, Editions Imago, 1993
·
Labbé, Michelle, Le Clézio, L’Ecart romanesque,
Paris, L’Harmattan, 1999
·
Le Clézio, J. M. G., Ailleurs, Entretiens avec Jean-Louis Ezine, arléa, mai 1995
·
Onimus, Jean, Pour
lire Le Clézio, Paris, PUF écrivains, 1994
·
Ridon, Jean-Xavier, Henri Michaux, J. M. G. Le
Clézio, L’Exil des mots, Paris, Ed. Kimé, 1995
Articles sur
J. M.G. Le Clézio :
·
« J. M. G. Le Clézio, errances et
mythologies » in Magazine littéraire N°362, février 1998
Articles sur Voyage
à Rodrigues :
·
Dis, Claude, La Nouvelle Revue Française , n°
401 – 1er juin 1986, pp. 72-74
Autres œuvres
de J. M. G. Le Clézio :
·
Le Clézio, J. M. G., Balaabilou, Paris,
Gallimard Jeunesse, Illustrations de George Lemoine, Collection Folio Cadet n°
404, 1980
·
Le Clézio, J.M.G., Celui qui n’avait jamais
vu la mer suivi de La montagne du dieu vivant, Paris, Gallimard
Jeunesse, Illustration de George Lemoine, Collection Folio Junior, 1978
·
Le Clézio, J
. M. G., Désert, Paris, Editions
Gallimard, Collection Folio n°1670, 1980
·
Le Clézio, J. M. G., Etoile errante,
Paris, Editions Gallimard, Collection Folio n°2592, 1992
·
Le Clézio, J. M. G. et Jémia, Gens des nuages ;
Photographies de Bruno Barbey, Paris, Stock, collection Folio n° 3284,
1997
·
Le Clézio, J.
M. G., Le Chercheur d’or, Paris,
Editions Gallimard, collection Folio n°2000, 1985
·
Le Clézio, J. M. G., Le jour où Beaumont fit
connaissance avec sa douleur, Mercure de France, 1964, Paris, Gallimard,
1965
·
Le Clézio, J. M. G., Le Procès-verbal, Paris,
Editions Gallimard, collection Folio n°353, 1963
·
Le Clézio, J. M. G., L’Extase matérielle, Paris, Editions Gallimard, Collection Folio
Essais, 1967
·
Le Clézio, J.M.G., Lullaby, Paris,
Gallimard Jeunesse, Illustration de George Lemoine, Collection Folio Junior,
1978
·
Le Clézio, J. M. G., Printemps et autres saisons, Paris, Editions Gallimard, 1989
·
Le Clézio, J. M. G. & J., Sirandanes
suivies d’un petit lexique de la langue créole et des oiseaux, Ed. Seghers,
Collection Volubile, 1990
·
Le Clézio, J. M.G., Villa Aurore suivi de
Orlamonde, Paris, Gallimard Jeunesse, Illustration de George Lemoine,
Collection Folio Junior, 1983
·
Le Clézio, J. M. G., Voyages de l’autre côté,
Paris, Gallimard, L’imaginaire, 1975
Ouvrage
collectif réunissant Paulo Coelho et J. M. G. Le Clézio :
·
Histoires d’enfance, Sol En Si, Paris, Editions
Robert Laffont, Collection Pocket, 1998
Ouvrages
généraux :
Sur le
Maghreb :
· Benarab, Abdelkader, Les Voix de l’exil, Paris, L’Harmattan, 1994
· Bonn, Charles, Le Roman algérien de langue française, Paris, L’Harmattan, 1985
· Callies de Salies, Bruno, Le Maghreb en mutation : Entre tradition et modernité, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999
· Déjeux, Jean, La Littérature maghrébine d’expression française, Paris, PUF, Que Sais-je ? N°2675, 1992
· Lings, Martin, What is sufism ?, Londres, Georg Allen & Unwin Ltd, 1975 ; Qu’est-ce que le soufisme ?, traduit de l’anglais par Roger Du Pasquier, Paris, Ed. du Seuil, 1977
· Noiray, Jacques, Littératures francophones, I. Le Maghreb, Paris, Belin Sup Lettres, 1996
· Reeber, Michel, L’Islam, Paris, Milan, 1998
·
Le Coran, traduit par Jean Grosjean, Paris,
Editions Philippe Lebaud, Points/Sagesse, 1979
Autres
critiques :
·
Bachelard, Gaston, La Poétique de l’espace,
Paris, Quadrige/ PUF, 1957 (voir surtout le chapitre VIII)
·
Bergounioux, Pierre, La Puissance du souvenir dans
l’écriture, Nantes, Ed. Pleins feux, 2000
·
Biès, Jean, Les Alchimistes, Paris, Editions du
Félin, Philippe Lebaud, 2000
·
Blanchot, Maurice, L’Espace littéraire, Paris,
Editions Gallimard, collection Folio Essais n°89,1955
·
Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain, Dictionnaire
des Symboles, Paris, Robert Laffont/Jupiter, 1969, 1982
·
Compagnon, Antoine, Les Cinq paradoxes de la
modernité, Paris, Ed. du Seuil, 1990
·
Davy, Marie-Madeleine, Le Désert intérieur,
Paris, Albin Michel S. A., « spiritualités vivantes », 1985
· Eliade, Mircea, The Quest,
Chicago, University of Chicago, 1969 ; La Nostalgie des origines,
Paris, Gallimard, Collection Folio essais n° 164, 1971
·
Hannoun, Michel, Solitudes et Sociétés, PUF/
Que-sais-je ?, Paris, 1993
·
Karatson, André & Bessière, Jean, Déracinement
et Littérature, Lille, Université de Lille III, Travaux et Recherches, 1982
·
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique,
nouvelle édition augmentée, Paris, Ed. du Seuil, 1975, 1996
·
Leloup, Jean-Yves,
Désert, Déserts, Paris, Albin Michel,
« espaces libres », 1996
·
Lyotard, Jean-François, La Condition postmoderne,
Paris, Les Editions de Minuit, 1979
·
Mathé, Roger, L’Exotisme, Paris, Bordas, 1985
·
Moura, Jean-Marc, Lire l’Exotisme, Paris, Dunod,
1992
·
Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris,
Seuil, 1965 et 1970
·
Raimond, Michel, Le Roman, 2è édition, Paris,
Armand Colin, 1987et 2000
·
Sablé, Erik, La Pierre des sages ou Essai sur
l’Alchimie Spirituelle, Paris, Editions Dervy, 1997
·
Segalen, Victor, Essai sur l’Exotisme, Fata
Morgana, Le Livre de Poche, biblio essais, 1978
·
Stegagno Picchio, Luciana, La Littérature
brésilienne, traduit de l’italien par Luc-François Granier et Guia Boni,
Paris, PUF/ Que sais-je ?, 1981 et 1996
·
Tadié, Jean-Yves, Le Roman au XX è siècle,
Paris, Pierre Belfond, collection Pocket n°180, 1990
·
Tadié, Jean-Yves, Le roman d’aventures, Paris,
Quadrige/ PUF, 1982
·
Trigano, Shmuel, Le Temps de l’exil, Paris, Editions Payot & Rivages, 2000
·
Viart, Dominique, Le Roman français au 20ème
siècle, Paris, Hachette, 1999
·
Vierne, Simone, Rite Roman Initiation, Grenoble,
PUG, 2000
· Encyclopaedia Universalis, version 5, CD-ROM PC
· Encyclopédie Encarta, CD-ROM PC
Articles de
référence généraux :
· « La Littérature et l’Exil » in Magazine Littéraire n°221, juillet – août 1985, pp. 14-59
· « La Solitude » in Magazine Littéraire n°290, juillet – août 1991, pp.16-59
· « Le Maghreb dans l’imaginaire français : la colonie, le désert, l’exil » in Revue de l’Occident musulman et de la méditerranée, Edisud, Collection « Maghreb contemporain », Centre de recherches sur les sociétés méditerranéennes
· « L’Errance » in Magazine Littéraire n° 353, avril 1997, pp. 16-58
·
« Littératures des
immigrations / 2 : Exils croisés » in Etudes littéraires maghrébines
n°8, Paris, L’Harmattan, 1995
·
« Mythes et
réalités d’Algérie et d’ailleurs » in Langues et Littératures n°6,
Alger, Université d’Alger, Institut des Langues Etrangères, 1995
Lectures
complémentaires :
Autour de la
littérature maghrébine :
· Ben Jelloun, Tahar, La Nuit sacrée, Paris, Editions du Seuil, septembre 1987 et Le Racisme expliqué à ma fille, Paris, Editions du Seuil, 1998
· Chraïbi, Driss, Le Passé simple, Paris, Editions Denoël, collection Folio n°1728, 1954
· Djaout, Tahar, Les Chercheurs d’os, Paris, Seuil, 1984 (cité dans Timimoun)
· Khayyâm, Omar, Quatrains, traduit du persan sur le manuscrit de la Bodleian Library d’Oxford par Charles Grolleau, postface de Chochana Boukhobza, Paris, Editions Mille et Une Nuits n°51, 1995 (cité dans Timimoun)
· Le Monde, Lettres d’Algérie, rassemblées par Philippe Bernard et Nathaniel Herzberg, Editions Gallimard, collection Folio Actuel n° 60, 1998
· Pancrazi, Jean-Noël, Madame Arnoul, Paris, Editions Gallimard, collection Folio n°2925, 1995
Romans
d’aventures :
·
Golding, Williams, Lord of the Flies, Faber and
Faber, 1956, traduit de l’Anglais
par Lola tranec, Sa Majesté des
Mouches, Paris, Editions Gallimard, collection Folio n°1480, 1956
·
Saint-Pierre, Bernardin (de), Paul et Virginie,
1790, Paris, Pocket n° 6041, 1998
·
Stevenson, Robert-Louis, Treasure Island, 1883, L’île
au trésor, traduction de Déodat Serval, Paris, GF Flammarion, 1990
·
Tournier, Michel, Vendredi ou les limbes du
Pacifique, Paris, Editions Gallimard, collection Folio n°959, 1972
Autres lectures :
· Bergounioux, Pierre, Miette, Paris, Editions Gallimard, Collection Folio n°2889, 1995
·
Clavicules de Salomon, Paris, 1825, Perthuis,
1966 (cité dans Voyage à Rodrigues)
·
Homère, L’Odyssée, Paris, GF Flammarion, 1965
· Lesage, Alain-René, Histoire de Gil Blas de Santillane, 1715-1735, Paris, GF Flammarion, 1977
· Verhaeren, Emile, Les Villes tentaculaires, 1895, collection Libretti, LGF, Le Livre de poche n° 13793, 1995
· Wilde, Oscar, Le Portrait de Dorian Gray, 1890, traduction nouvelle de Vladimir Volkoff, Paris, Le Livre de poche classique, 2001 (cité dans L’Alchimiste)
IX.
Sites Internet
En
rapport avec Paulo Coelho :
http://www.paulocoelho.com (un panorama complet sur Paulo Coelho, des actualités mises régulièrement à jour, un forum, la présentation de sa vie et de ses livres)
http://www.alchymie.net (un site sur l’alchimie)
http://www.anne-carriere.fr/coelho/index.html (le site de la maison d’édition Anne Carrière, avec de nombreuses informations sur Paulo Coelho)
http://www.construire.ch/SOMMAIRE/9931/31entre.htm (interview de Paulo Coelho accordée au magazine Construire n°31, en août 1999)
http://www.france3.fr/elections/emissions/livre/livre586.html (entretien de Paulo Coelho avec Olivier Barrot dans le cadre de l’émission Un livre, Un jour)
http://www.webdo.ch/illustre/2000/11/vos_questions_11.html (entretien en mars 2000 de Paulo Coelho avec Sophie Winteler du magazine Webdo)
http://wwwa051.infonegocio.com/860/Le%20Monde.htm ( article du Monde (27 juillet 2000) sur Paulo Coelho )
En rapport
avec Rachid Boudjedra :
http://www.limag.com (le site référence en matière de littérature du Maghreb)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/fredmalher/page30.html (un site Internet sur Timimoun et le Gourara, crée par Frédéric Malher)
http://www.algeria-watch.de/farticle/sale_guerre/boudjedra.htm (« mon hommage à l’armée » : interview dans Le Matin du 22/02/01de Rachid Boudjedra par Rachid Mokhatari)
http://www.imarabe.org (le site Internet de l’Institut du monde arabe)
En
rapport avec J. M. G. Le Clézio :
http://www.rodrigues-island.org/ et http://www.france-maurice-rodrigues.com/ (sites Internet dur l’île Rodigues : informations générales, histoire, culture, actualité, etc.)
http://www.multi.fi/~fredw/ (Le Clézio par Fredrik Westerlund, avec une bibliographie très complète)
http://www.vn.refer.org/textinte/litoi/11-5.htm (un site Internet sur les racines mauriciennes de J. M. G. Le Clézio)
Sites
généralistes :
http://www.magazine-littéraire.fr (le site du Magazine Littéraire. Possibilité de consulter d’anciens articles de la revue)
http://www.lire.fr (le site de la revue Lire. Possibilité de consulter d’anciens articles de la revue)
http://www.bnf.fr (le site de la Bibliothèque Nationale de France)
http://www.auteurs.net (le portail littéraire sur Internet)
X.
Table des illustrations
·
p. 27 :
photo de Rodrigues extraite du site : http://www.rodrigues-island.org/
·
p. 28 :
peinture extraite de l’encyclopédie Microsoft Encarta 1998
· p. 37 : photo de Constantine extraite
de l’encyclopédie Microsoft Encarta 1998
· p. 47 : photo du désert extraite de Le
Clézio, J. M. G. et Jémia, Gens des nuages ; Photographies de
Bruno Barbey, Paris, Stock, collection Folio n° 3284, 1997, p. 12
· p. 75 : portrait extrait de l’encyclopédie Microsoft
Encarta 1998
· p. 77 : jeune fille afghane en
1985 : photo extraite de Mc Curry, Steeve, Portraits, Paris,
Phaidon, 1999
· p.
88 : photo extraite de, Arthus-Bertrand, Yann, 365 jours pour la Terre,
Paris, Editions de La Martinière
· p. 90 : Le Labyrinthe de Crète et
l’histoire de Thésée et d’Ariane, gravure, vers 1470-1475, BNF. Image
extraite du site Internet : http://www.bnf.fr/pages/expos/utopie/pistes/grand/crete.htm
· p. 94 : La Métamorphose de Narcisse par Salvador Dali. Image extraite du site
Internet : http://www.multimania.com/reno3000/dali.html
· p. 96 :
enluminure extraite
de l’encyclopédie Microsoft Encarta 1998
· p. 101 : photo des
pyramides d’Egypte extraite du site Internet : http://www.multimania.com/vdisanzo/egypte.html